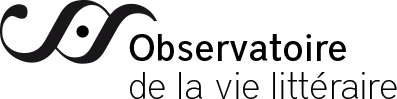Université d’été | Bi-licence "Lettres – Informatique" | Ateliers
PAGE ACCUEIL
Entretien avec Milad Doueihi
Entretien avec Milad Doueihi

Milad Doueihi est titulaire de la chaire HUMANUM de Sorbonne-Universités. Il revient sur son parcours, qui l'a mené de l'histoire des religions à l'anthropologie de la culture numérique, et nous présente les activités que l'équipe de la chaire mène en étroite collaboration avec le labex OBVIL.
Pouvez-vous nous présenter votre parcours ?
Dans la première période de ma carrière, j’ai beaucoup travaillé sur l’histoire des religions, en me concentrant sur deux volets : tout d’abord les Pères de l’Église (surtout Saint-Augustin) et ensuite le xviie siècle. J’ai travaillé autour de la question de la réception de certains récits bibliques par les philosophes (le paradis, le récit de la genèse, etc.), et aussi autour de la question de l’émergence de la tolérance, à travers une figure comme Pierre Bayle et son Dictionnaire historique et critique. Au fur et à mesure, je me suis un petit peu déplacé vers mon objet d’étude actuel, qui est la culture numérique. J’avais commencé relativement tôt à travailler sur cette question, à la fin des années 80, avant le web. J’ai publié un premier livre en anglais chez Harvard University Press, Digital Culture, qui a été traduit en français sous le titre La Grande Conversion numérique. En même temps, j’ai enseigné un petit peu partout, aux États-Unis à Johns Hopkins, puis au Canada, à l’Université de Glasgow et à Berlin.
Au cours de cette carrière internationale, avez-vous constaté des différences dans la place qu’occupent les humanités numériques dans la société et le monde académique ?
Oui, c’est très différent. Les humanités numériques reposent véritablement sur une approche transversale et multidisciplinaire. Or il y a une certaine souplesse dans le système universitaire américain, où, bien qu’on soit membre d’un département qui peut être de littérature, de media studies ou même d’histoire ou de sociologie, on n’a pas nécessairement besoin d’être identifié à une discipline. Dans le cas français et même anglais, on est beaucoup plus inscrit dans un champ disciplinaire et on aborde les humanités numériques de point de vue là. En France, l’histoire des humanités numériques, qui est très riche et assez ancienne, est associée à la stylistique : c’est ce qu’on appelait à l’époque l’informatique littéraire, ou humanities computing aux États-Unis. Aux États-Unis, elles ont évolué entre le domaine de la littérature et celui des media studies. En outre, ce qui a été très fort et qui continue de jouer un rôle très influent, ce sont les juristes. La fondation du Berkman Center et les travaux de Laurence Lessig, de James Boyle, etc. ont ouvert une voie qui s’inscrit dans la relation du numérique à la loi, que ce soit du côté du copyright, de la production de nouvelles licences, des mutations autour des droits d’auteur, etc. En France, les humanités numériques sont également associées à l’infocom, dont il n’y a pas vraiment d’équivalent aux États-Unis en tant que discipline constituée, et qui est très ancrée ici. Certains travaux sur les humanités numériques héritent donc de la tradition sémiotique et sémiologique française. Une figure comme Michel de Certeau est très influente, et ses travaux sur les pratiques et les stratégies de lecture sont souvent cités. Il y a aussi en France – mais c’est une impression purement personnelle – un fétichisme et une valorisation symbolique du livre qui n’existent par aux États-Unis et qui sont ici extrêmement puissants, que ce soit du côté des éditeurs, du côté de la presse ou même du côté des spécialistes littéraires. Le culte de l’œuvre et du grand homme propres au xixe siècle s’est traduit par une forme de valorisation du littéraire, qui est associé à ces notions et à ces concepts, ce qui explique parfois certaine des difficultés qu’on a pu avoir vis-à-vis de ce que le numérique peut faire pour fragiliser ou fragmenter l’œuvre. Il y a une certaine crispation vis-à-vis des droits d’auteur qui bloque l’effort d’expérimentation et la mise en œuvre des potentialités de production offertes par le numérique. C’est une question qui a été débattue pendant un certain temps, alors que du côté américain, on n’est pas du tout entré dans ce débat avec la même urgence. Ce sont donc des paysages différents, mais, aujourd'hui, je dirais qu’on est en train de se retrouver, tout en tenant compte des différences juridiques qui existent entre ces deux cultures.
Comment concevez-vous le rapport entre la chaire HUMANUM et le labex OBVIL ?
C’est un rapport naturel. Le projet de la chaire a été développé en partenariat avec Didier Alexandre, le directeur du labex. À l’époque où nous rédigions le projet, nous nous sommes dit que ma réflexion pourrait être utile et complémentaire, à la fois pour essayer de donner un cadre anthropologique et réflexif à l’histoire de la culture numérique et des pratiques qui y sont associées, et pour réfléchir à la culture de l’encodage et aux techniques qui sont mises en œuvre au sein du labex, comme la TEI par exemple. En même temps, nous avions insisté sur la dimension éthique des humanités numériques. Il s’agit de réfléchir aux mutations de l’humain qu’elles impliquent, que ce soit du côté du lecteur ou de la figure de l’auteur, et au statut des interfaces numériques. Le labex produit des interfaces et il faut se demander comment ces interfaces, dans la manière dont elles sont conçues, peuvent modifier, d’une façon parfois inconsciente ou implicite, le rapport que l’on a aux œuvres. Un autre aspect qui nous a intéressé, c’est tout le travail sur les annotations, que nous cherchons à étudier sur le temps long. C’est la raison pour laquelle nous avons pris un poct-doctorant qui travaille sur ce sujet. L’encodage est une forme d’annotation hybride, qui présente une dimension informatique ou numérique d’un côté, et une dimension lettrée et savante de l’autre. Il nous a semblé que c’est quelque chose de fondamental pour la réflexion qui est menée au sein du laboratoire. Enfin, il y a une autre réflexion que nous espérons pouvoir développer et qui porte sur les écritures et la littérature numériques. L’un des objectifs premiers du labex est de travailler sur la valorisation de la littérature dans le monde contemporain et de voir comment l’émergence des pratiques d’écriture numérique, qui sont très diversifiées, peuvent être analysées et étudiées dans le cadre d’une histoire littéraire, et ce sur la longue durée.
Sur quels projets travaillez-vous actuellement, à titre personnel ou avec l’équipe de la chaire ?
Nous avons deux projets auxquels nous travaillons en commun avec l’équipe de la chaire, avec les post-doctorants et certains des doctorants. Tout d’abord, nous sommes en train de préparer un volume autour de la notion de matérialisme numérique. Nous partons d’une hypothèse relativement simple : la fin du xixe siècle et une grande partie du xxe siècle ont été façonnés par la réflexion (qu’elle positive ou négative) portant sur le matérialisme historique, que ce soit du côté économique ou méthodologique. Aujourd'hui, on voit émerger une certaine forme de matérialisme numérique, qui occupe presque le même statut, mais qui n’est pas encore aussi bien reconnue. Le volume réunira des travaux sur les formes de la bibliographie matérielle jusqu’au matérialisme numérique, sur la fabrication du goût par le biais des machines algorithmiques dans la musique et l’écoute musicale, sur le lien entre les environnements 3D et la construction des arts de mémoire de la Renaissance jusqu’à aujourd'hui, sur l’utilisation du vocabulaire scientifique dans la littérature du xixe siècle, etc. Nous organisons également des journées d’étude autour de certaines des figures qui ont marqué la réflexion sur la technique. Nous en avons consacré une à Ivan Illich et nous allons nous intéresser à André Leroi-Gourhan, à Jacques Ellul, à Gilbert Simondon, etc. Au fur et à mesure que nous avançons dans nos réflexions, il nous est en effet apparu que le mot « technique », dans son acception actuelle, et même au sens philosophique, ne suffit plus pour saisir ce que le numérique représente aujourd'hui. Il s’agit donc de revisiter les grands textes canoniques et la manière dont ces penseurs ont conçu la technique afin d’essayer de voir ce que nous pouvons en tirer dans notre réflexion sur la culture numérique, que ce soit du côté de la méthode ou des théories.
Quant à moi, j’ai terminé un essai qui s’intitule L’Imaginaire de l’intelligence, et où je cherche à faire non pas nécessairement l’histoire mais plutôt l’anthropologie de l’intelligence, envisagée comme mythe fondateur de l’informatique. Aujourd'hui, ce mythe est présent partout. Presque tout est intelligent : les villes, les objets, etc. C’est très intéressant de revenir vers les pères fondateurs de l’informatique pour voir comment on retrouve aujourd'hui, après toutes les évolutions et les mutations que l’on connaît, les questions qu’ils se sont posées. J’ai aussi écrit un petit essai qui s’intitule Un Sauvage chez les geeks, et qui prend comme point de départ la figure du sauvage, qui se retrouve dans toute une série de paysages culturels et littéraires. Il y a beaucoup de textes importants qui réfléchissent sur le statut du sauvage, que ce soit chez André Leroi-Gourhan, Norbert Elias ou d’autres. On peut utiliser cette figure pour avancer une hypothèse qui est relativement simple : au début, les geeks et les nerds étaient les sauvages de nos sociétés, mais aujourd'hui, à cause du succès et surtout de la pénétration de la culture numérique, c’est nous qui sommes en train d’être civilisés par les geeks, comme si nous étions les sauvages d’une nouvelle civilisation émergente. J’ai également travaillé sur un très beau texte de Charles Sanders Peirce, qui parle dans une de ses grandes conférences à Harvard du « greedy master of intelligence », le « maître vorace de l’intelligence ». L’intelligence, surtout dans ses déclinaisons informatiques et numériques, est « vorace » de nos données. Il y a aujourd'hui une certaine forme de « gloutonnerie » de la machine qui éclaire en grande partie la fascination qu’exerce le big data. Je ne mets pas du tout en question l’intérêt des travaux qui peuvent y être associés, mais j’essaie de porter un autre regard sur la manière dont on est invité à nourrir cette machine. La métaphore de la nourriture est présente partout dans la culture numérique : on parle de « feed », de « digest », etc. Il y a toute une déclinaison de vocabulaire qui appartient à ce registre.
Vous parlez de la « conversion » numérique. Jusqu’à quel point peut-on pousser l’analogie entre le numérique et la religion ?
Il y a plusieurs manières de répondre à cette question. À l’origine, « conversion », en grec (« épistrophê »), c’est un terme de mathématiques et de géométrie. Il y a un côté technique qui a toujours existé dans le terme de « conversion », et l’on a souvent oublié cette origine à cause de Saint-Augustin et du grand texte fondateur des Confessions. Mais au-delà, la culture numérique ne cesse de convertir de format en format. On le sait très bien : il faut toujours mettre à jour, modifier le format pour que les documents et les fichiers restent lisibles et accessibles. Cette image de l’informatique se généralise : c’est la société elle-même, notre patrimoine ou nos archives qui sont en voie de conversion. D’un autre côté, on constate que les gens qui ont réfléchi sur la technique étaient, dans une proportion assez importante, des gens religieux ou des théologiens. Le père Busa, qui a été le premier acteur des humanités numériques, était un jésuite. Jacques Ellul était un théologien. Illich était également un théologien et un prêtre. Il y a une proximité assez intéressante, surtout quand on pense que, à l’époque scolastique, les pratiques de lecture étaient associées à la tradition monastique, et que toute une série de pratiques d’annotation et de lecture sont ancrées dans des pratiques religieuses ou dévotes. En même temps, je suis de plus en plus convaincu qu’il y a une forme de croyance et d’utopie qui est associée à l’informatique et à ses promesses, et qui est d’ordre religieux. C’est quelque chose qu’il faut interroger.
Propos recueillis par Marc Douguet le 15 avril 2016