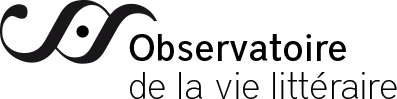Université d’été | Bi-licence "Lettres – Informatique" | Ateliers
PAGE ACCUEIL
Entretien avec Servanne Monjour
04 Novembre 2019
Entretien avec Servanne Monjour

Entretien avec Servanne Monjour, maîtresse de conférences à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université (CELLF). Elle a publié Mythologies postphotographiques. L’invention littéraire de l’image numérique aux Presses de l’Université de Montréal, dans la collection « Parcours numériques », dirigée par Marcello Vitali-Rosati et Michael E. Sinatra.
Pouvez-vous nous présenter vos recherches dans le domaine de la photo-littérature ?
J’ai d’abord rédigé une thèse en littérature comparée, dans le cadre du programme doctoral en études intermédiales de l’Université de Montréal. Mes recherches portaient sur la remédiation de la photographie – comprise comme une réalité tout autant technique que discursive, et donc littéraire. De nombreux chercheurs en photolittérature ont montré comment la fiction avait participé à l’invention du media photographique au XIXe siècle à travers ses récits poétiques, fantastiques voire prophétiques. L’imaginaire littéraire a ainsi exploré le sens de la vue et ses significations, et fantasmé les pouvoirs de cette nouvelle machine qu’était l’appareil photo. Mon point de vue était cependant plus contemporain : je me suis intéressée aux nouvelles fictions de la photographie en cette période de transition technologique, mais aussi culturelle, initiée par le numérique : que devient l’autoportrait face au selfie ? Quel sens prend la photo de famille alors qu’on la partage désormais sur les réseaux sociaux ? Qu’est-ce qu’un détail photographique à l’ère du pixel ? Il s’agissait pour moi d’interroger les nouvelles mythologies de la photographie, à travers l’analyse d’un corpus littéraire et photographique, tout en en me confrontant à la réalité technique et aux usages « grand public » de l’image numérique. La photographie, dans sa version numérique, est en effet d’abord un code, donc de l’écriture : c’est un changement de paradigme important pour l’image. Si la photo a toujours été un media populaire, elle l’est plus encore aujourd’hui : selon le photographe Joan Fontcuberta, les plus importants photographes de notre époque seraient même les adolescents, qui ont inventé un nouveau rapport à l’image, en captant, publiant et commentant des photos sans cesse. Après la génération du texto, il y aurait donc la génération « conversationnelle », pour reprendre l’expression d’André Gunthert. La littérature, quant à elle, se fait à la fois observatoire et laboratoire de ces mutations.
Vous avez également beaucoup travaillé dans le domaine de l’édition numérique : pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ?
J’ai travaillé pendant plusieurs années au sein de la Chaire de recherche du Canada en écritures numériques, dirigée par Marcello Vitali-Rosati à Montréal. Au sein de la Chaire, nous avons beaucoup travaillé sur la conception de chaînes éditoriales modulaires, faciles à utiliser, conçues pour les revues savantes, les monographies mais aussi l’édition critique. Le plus grand chantier sur lequel j’ai été engagée est celui de la refonte de la revue Sens Public, pour lequel nous avons engagé une réflexion sur les formats de la revue savante et de l’article scientifique. Les revues jouent un rôle majeur dans l’échange et l’avancement des connaissances, peut-être plus encore que les monographies. C’est en effet dans la revue que s’incarne le plus la discussion scientifique. L’idée sur laquelle nous travaillons à Sens Public avec, notamment, Marcello Vitali-Rosati, Nicolas Sauret et Margot Mellet, est de retrouver l’esprit et la philosophie des toutes premières revues en favorisant la conversation autour des textes, ainsi que leur réappropriation par les lecteurs. Conserver cette fonction première à l’ère numérique passe par une réflexion sur les chaînes éditoriales. Il s’agira, par exemple, de permettre la production de textes en formats multiples (HTML, XML, PDF ou EpuB), à partir d’une même source native numérique, avec des données riches et finement structurées. Nous avons créé pour cela l’éditeur Stylo, qui permet d’éditer les métadonnées (YAML), le corps de texte (markdown) et les références bibliographiques (BibTeX), pour générer via l’outil Pandoc des documents HTML pour notre site web, des PDF (à partir de LaTeX), ainsi que des fichiers XML pour un archivage sur la plateforme Érudit. L’objectif de Stylo est de permettre aux chercheurs de reprendre la main sur la production de leurs textes et des données qui y sont associées. À la base de notre réflexion, il y a ce constat selon lequel les chercheurs ne maîtrisent pas forcément les outils avec lesquels ils travaillent, comme Word par exemple, qui les conduit à avoir une pensée d’abord graphique de leur écriture, plutôt qu’une pensée sémantique. Avec le logiciel Stylo, l’idée est justement de leur permettre de « resémantiser » leur écriture. Il ne s’agit pas de diaboliser les pratiques actuelles, mais plutôt d’offrir aux auteurs la possibilité de se concentrer davantage sur leur écriture, là où se forge et où émerge la pensée. L’enjeu, à terme, est de se demander si les technologies numériques peuvent nous conduire vers d’autres formats d’écriture - et donc d’autres formes de savoir.
Vous travaillez sur la littérature numérique. Quelles sont les particularités de de cet objet de recherche ?
Le corpus auquel je m’intéresse est paradoxalement plus en danger que nombre de corpus anciens. La littérature publiée sur des blogs, sur des réseaux sociaux, est fragile, car elle est soumise à beaucoup d’aléas, comme l’obsolescence technique ou l’abandon pur et simple d’un site web, d’une plateforme, d’un DNS... Elle est encore peu institutionnalisée par les instances littéraires traditionnelles, ce qui fait qu’elle échappe aux entreprises de conservation et aux analyses, contrairement à une partie de la littérature électronique qui, elle, a été davantage prise en charge par les universitaires, en particulier dans le cadre de travaux en recherche-création (comme on le voit dans les critical code studies). Là où la littérature électronique engageait une forme de littérarité consubstantielle aux compétences informatiques, la littérature numérique, dans une acception plus large, comprend un versant très peu « intéressant » d’un point de vue technique et médiatique (du moins en apparence) : il s’agira par exemple de textes publiés sur un simple CMS. En l’absence de dimension médiatique ou technique « spectaculaire », cette production littéraire a tendance à passer inaperçue. Son statut ambigu, puisqu’elle ne passe pas par des éditeurs traditionnels mais n’a pas non plus la dimension expérimentale de la littérature électronique. Elle présente pourtant un intérêt du point de vue littéraire, mais aussi du point de vue de notre culture numérique. Pour ses auteurs, la publication en ligne fait sens : elle engage une dimension conversationnelle, une liberté d’écriture très importante à leurs yeux. La littérature numérique s’extrait des circuits éditoriaux traditionnels, mais pour se tourner vers de nouvelles instances de légitimation : à commencer, peut-être, par celle des plateformes. C’est d’ailleurs problématique, car pour beaucoup d’écrivains la volonté de publier sur le web était liée à une l’envie de gagner davantage de liberté par rapport aux éditeurs traditionnels. Mais une nouvelle forme d’hétéronomie, comme celle des plateformes et des moteurs de recherche, s’est imposée. Dans le même temps, les écrivains en ligne forment des communautés très fortes, alors même que le web établit de nouvelles formes de sociabilité, via les réseaux sociaux par exemple, qui pourraient presque être comparés à nos anciens salons littéraires. C’est donc une nouvelle forme de vie littéraire qui se met en place, et qui fait évoluer les frontières du fait littéraire.
Pouvez-vous nous en dire plus sur vos projets de recherche à venir ?
Parmi les enjeux de la littérature numérique, il y a toute une réflexion à mener sur la notion même de corpus. J’ai commencé à l’université McGill un projet de recherche sur le collectif numérique, avec Stéfan Sinclair. L’idée initiale était de faire du text mining et de la visualisation de données, pour cerner le concept de littérature « brouhaha » défini par Lionel Ruffel (c’est-à-dire une littérature « hors le livre », plurimédiatique, très disséminée et hétérogène). Mais définir ce corpus « hors le livre » est bien plus complexe qu’il n’y parait : il faut en décider la granularité, déterminer où il commence et où s’arrête – quelles sont ses formes médiatiques, aussi. J’ai l’intention de poursuivre ces recherches en travaillant la notion de collectif littéraire et artistique à l’ère du numérique.
Propos recueillis par Marguerite Bordry