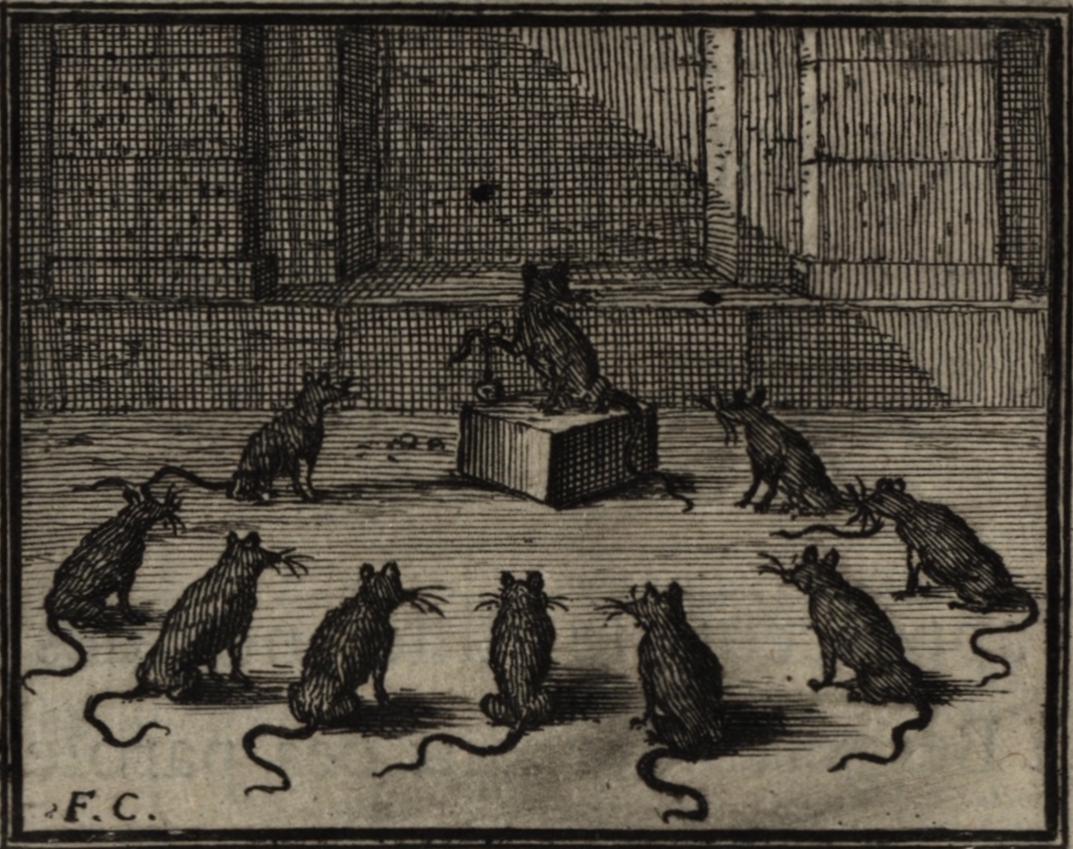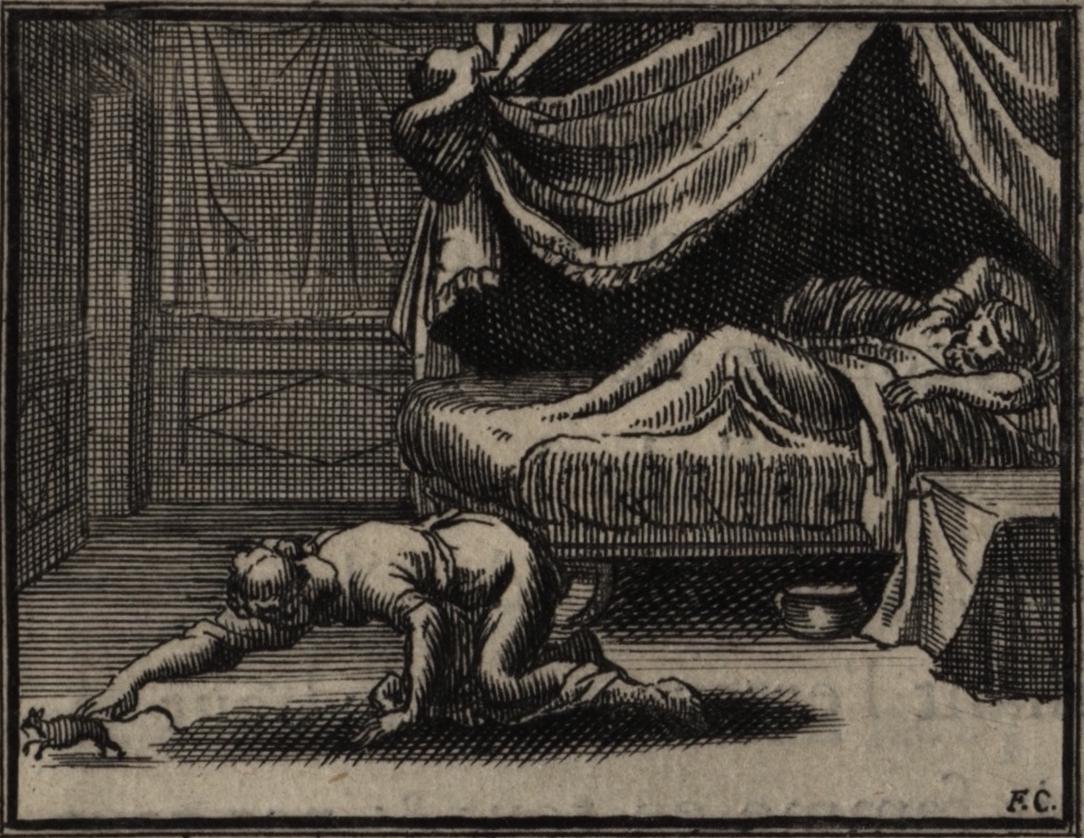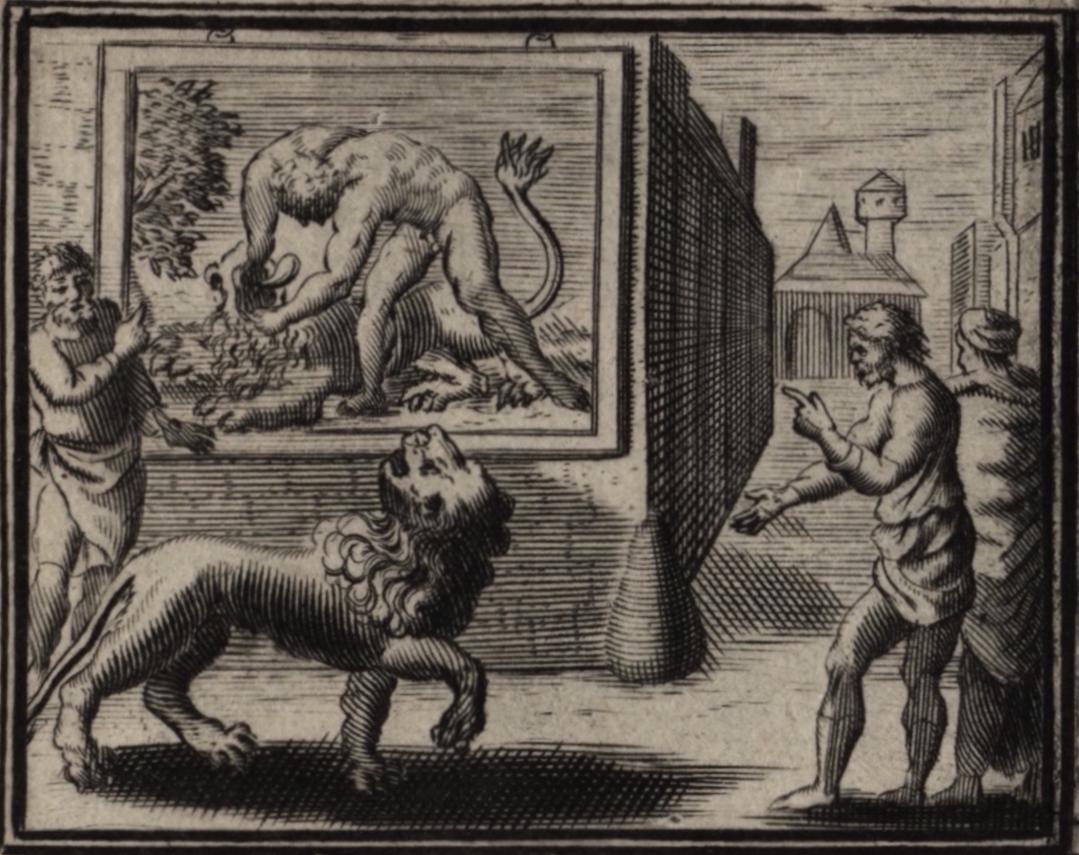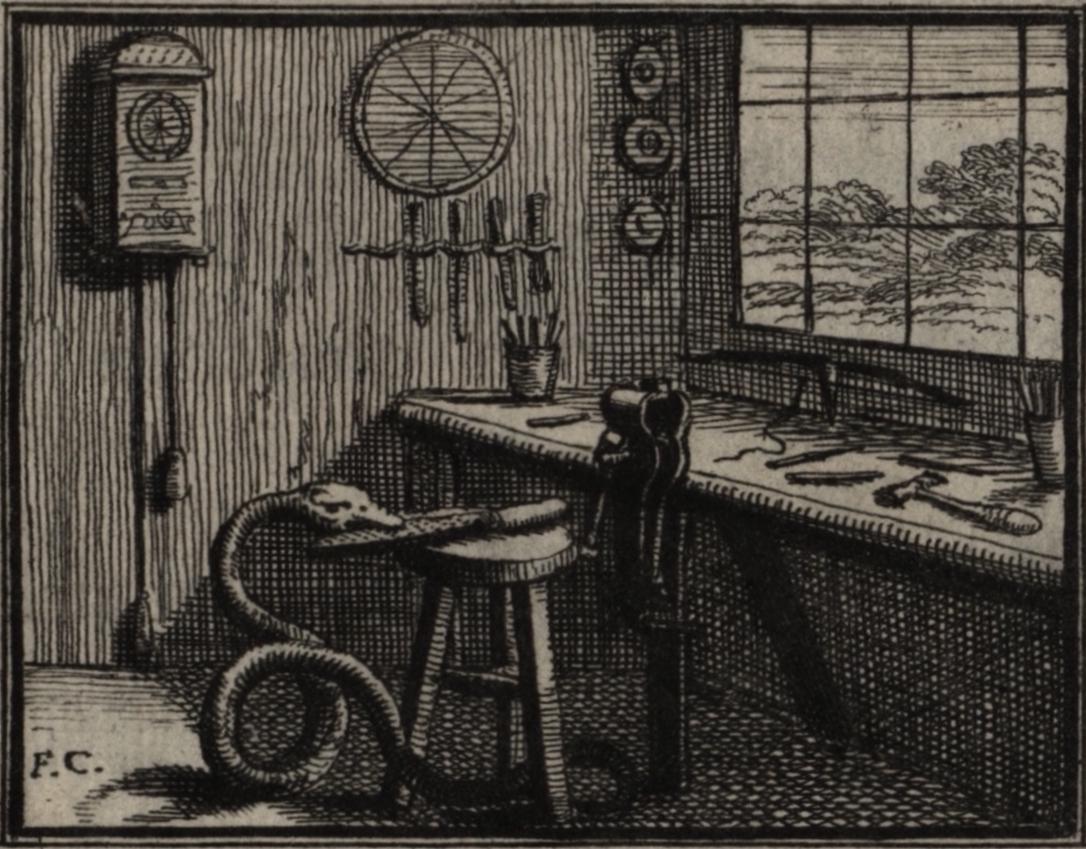Livre premier. §
Fable I. § [P112/373] La Cigale et la Fourmy. § L a Cigale ayant chanté
Tout l’Esté,
Se trouva fort dépourvuë
Quand la bise fut venuë.
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau.
Elle alla crier famine
Chez la Fourmy sa voisine ;
La priant de luy prester
Quelque grain pour subsister
Jusqu’à la saison nouvelle.
Je vous payray, luy dit-elle,
Avant l’Oust, foy d’animal,
Interest et principal.
La Fourmy n’est pas presteuse ;
C’est là son moindre défaut.
Que faisiez-vous au temps chaud ?
Dit-elle à cette emprunteuse.
Nuit et jour à tout venant
Je chantois, ne vous déplaise.
Vous chantiez ? j’en suis fort aise.
Et bien, dansez maintenant.
II. § [P124] Le Corbeau et le Renard. § M aistre Corbeau sur un arbre perché,
Tenoit en son bec un fromage.
Maistre Renard par l’odeur alleché
Luy tint à peu prés ce langage :
Et bon jour, Monsieur du Corbeau.
Que vous estes joly ! que vous me semblez beau !
Sans mentir, si vostre ramage
Se rapporte à vostre plumage,
Vous estes le Phenix des hostes de ces bois.
A ces mots le Corbeau ne se sent pas de joye :
Et pour monstrer sa belle voix,
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proye.
Le Renard s’en saisit, et dit : Mon bon Monsieur,
Apprenez que tout flateur
Vit aux dépens de celuy qui l’écoute.
Cette leçon vaut bien un fromage sans doute.
Le Corbeau honteux et confus
Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendroit plus.
III. § [P376] La Grenoüille qui se veut faire § U ne Grenoüille vid un Bœuf,
Qui luy sembla de belle taille.
Elle qui n’estoit pas grosse en tout comme un œuf,
Envieuse s’étend, et s’enfle et se travaille,
Pour égaler l’animal en grosseur ;
Disant : Regardez bien, ma sœur,
Est-ce assez ? Dites-moy ? N’y suis-je point encore ?
Nenny. M’y voicy donc ? Point du tout. M’y voila ?
Vous n’en approchez point. La chetive pecore
S’enfla si bien qu’elle creva.
Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages :
Tout Bourgeois veut bastir comme les grands Seigneurs ;
Tout petit Prince a des Ambassadeurs :
Tout Marquis veut avoir des Pages.
IV. § [P491] Les deux Mulets. § D eux Mulets cheminoient ; l’un d’avoine chargé :
L’autre portant l’argent de la Gabelle.
Celuy-cy glorieux d’une charge si belle,
N’eût voulu pour beaucoup en estre soulagé.
Il marchoit d’un pas relevé,
Et faisoit sonner sa sonnette :
Quand l’ennemi se presentant,
Comme il en vouloit à l’argent,
Sur le Mulet du fisc une troupe se jette,
Le saisit au frein, et l’arreste.
Le Mulet en se défendant,
Se sent percer de coups, il gemit, il soûpire.
Est-ce donc là, dit-il, ce qu’on m’avoit promis ?
Ce Mulet qui me suit, du danger se retire,
Et moy j’y tombe, et je peris.
Ami, luy dit son camarade,
Il n’est pas toujours bon d’avoir un haut Employ.
Si tu n’avois servi qu’un Meusnier, comme moy,
Tu ne serois pas si malade.
V. § [P346] Le Loup et le Chien. § U n Loup n’avoit que les os et la peau,
Tant les Chiens faisoient bonne garde.
Ce Loup rencontre un Dogue aussi puissant que beau ;
Gras, poli, qui s’estoit fourvoyé par mégarde.
L’attaquer, le mettre en quartiers,
Sire Loup l’eust fait volontiers.
Mais il falloit livrer bataille ;
Et le Mâtin estoit de taille
A se défendre hardiment.
Le Loup donc l’aborde humblement,
Entre en propos, et luy fait compliment
Sur son embonpoint qu’il admire :
Il ne tiendra qu’à vous, beau Sire,
D’estre aussi gras que moy, luy repartit le Chien.
Quittez les bois, vous ferez bien :
Vos pareils y sont miserables,
Cancres, haires, et pauvres diables,
Dont la condition est de mourir de faim.
Car quoy ? Rien d’assuré ; point de franche lipée ;
Tout à la pointe de l’épée.
Suivez-moy ; vous aurez bien un meilleur destin.
Le Loup reprit : Que me faudra-t-il faire ?
Presque rien, dit le Chien, donner la chasse aux gens
Portans bastons, et mendians ;
Flater ceux du logis ; à son Maistre complaire ;
Moyennant quoy vostre salaire
Sera force reliefs de toutes les façons ;
Os de poulets, os de pigeons :
Sans parler de mainte caresse.
Le Loup déjà se forge une felicité
Qui le fait pleurer de tendresse.
Chemin faisant il vid le col du Chien pelé.
Qu’est-ce là, luy dit-il ? Rien. Quoy rien ? Peu de chose.
Mais encor ? Le collier dont je suis attaché
De ce que vous voyez est peut-estre la cause.
Attaché ? dit le Loup, vous ne courez donc pas
Où vous voulez ? Pas toujours ; mais qu’importe ?
Il importe si bien, que de tous vos repas
Je ne veux en aucune sorte ;
Et ne voudrois pas mesme à ce prix un tresor.
Cela dit, Maistre Loup s’enfuit, et court encor.
VI. § [P339 ; cf. P149] La Genisse, la Chevre et la Brebis en societé avec le Lion. § L a Genisse, la Chevre, et leur sœur la Brebis,
Avec un fier Lion, Seigneur du voisinage,
Firent societé, dit-on, au temps jadis,
Et mirent en commun le gain et le dommage.
Dans les lacqs de la Chevre un Cerf se trouva pris.
Vers ses associez aussi-tost elle envoye.
Eux venus, le Lion par ses ongles conta,
Et dit : Nous sommes quatre à partager la proye ;
Puis en autant de parts le Cerf il dépeça :
Prit pour lui la premiere en qualité de Sire ;
Elle doit estre à moy, dit-il ; et la raison,
C’est que je m’appelle Lion,
A cela l’on n’a rien à dire.
La seconde par droit me doit échoir encor :
Ce droit, vous le sçavez, c’est le droit du plus fort.
Comme le plus vaillant je prétens la troisiéme.
Si quelqu’une de vous touche à la quatriéme
Je l’étrangleray tout d’abord.
VII. § [P266] La Besace. § J upiter dit un jour : Que tout ce qui respire
S’en vienne comparoistre aux pieds de ma grandeur.
Si dans son composé quelqu’un trouve à redire,
Il peut le declarer sans peur :
Je mettray remede à la chose.
Venez singe, parlez le premier, et pour cause.
Voyez ces animaux : faites comparaison
De leurs beautez avec les vôtres.
Estes-vous satisfait ? Moy, dit-il, pourquoy non ?
N’ai-je pas quatre pieds aussi-bien que les autres ?
Mon portrait jusqu’icy ne m’a rien reproché.
Mais pour mon frere l’Ours, on ne l’a qu’ébauché.
Jamais, s’il me veut croire, il ne se fera peindre.
L’Ours venant là-dessus, on crut qu’il s’alloit plaindre.
Tant s’en faut ; de sa forme il se loüa tres-fort ;
Glosa sur l’Elephant : dit qu’on pourroit encor
Ajoûter à sa queue, ôter à ses oreilles :
Que c’étoit une masse informe et sans beauté.
L’Elephant estant écouté,
Tout sage qu’il estoit, dit des choses pareilles.
Il jugea qu’à son appetit
Dame Baleine estoit trop grosse.
Dame Fourmi trouva le Ciron trop petit ;
Se croyant pour elle un colosse.
Jupin les renvoya s’estant censurez tous :
Du reste contens d’eux : mais parmy les plus fous
Nôtre espece excella : car tout ce que nous sommes,
Lynx envers nos pareils, et Taupes envers nous,
Nous nous pardonnons tout, et rien aux autres hommes.
On se void d’un autre œil qu’on ne void son prochain.
Le Fabricateur souverain
Nous créa Besaciers tous de mesme maniere,
Tant ceux du temps passé que du temps d’aujourd’huy.
Il fit pour nos défauts la poche de derriere,
Et celle de devant pour les défauts d’autruy.
VIII. § [P39] L’Hirondelle et les petits Oyseaux. § U ne Hirondelle en ses voyages
Avoit beaucoup appris. Quiconque a beaucoup veu,
Peut avoir beaucoup retenu.
Celle-cy prévoyoit jusqu’aux moindres orages.
Et devant qu’ils fussent éclos
Les annonçoit aux Matelots.
Il arriva qu’au tems que la chanvre se seme
Elle vid un Manant en couvrir maints sillons.
Ceci ne me plaist pas, dit-elle aux Oysillons,
Je vous plains : Car pour moy, dans ce peril extrême
Je sçauray m’éloigner, ou vivre en quelque coin.
Voyez-vous cette main qui par les airs chemine ?
Un jour viendra qui n’est pas loin,
Que ce qu’elle répand sera vôtre ruine.
De là naîtront engins à vous enveloper,
Et lacets pour vous attraper ;
Enfin mainte et mainte machine
Qui causera dans la saison
Vostre mort ou vostre prison.
Gare la cage ou le chaudron.
C’est pourquoy, leur dit l’Hirondelle,
Mangez ce grain, et croyez-moy.
Les Oyseaux se moquerent d’elle :
Ils trouvoient aux champs trop dequoy.
Quand la cheneviere fut verte,
L’Hirondelle leur dit : Arrachez brin à brin
Ce qu’a produit ce maudit grain ;
Ou soyez seurs de vôtre perte.
Prophete de malheur, babillarde, dit-on,
Le bel employ que tu nous donnes !
Il nous faudroit mille personnes
Pour éplucher tout ce canton.
La chanvre estant tout-à-fait creuë,
L’Hirondelle ajoûta : Cecy ne va pas bien :
Mauvaise graine est tost venuë.
Mais puisque jusqu’icy l’on ne m’a cruë en rien ;
Dés que vous verrez que la terre
Sera couverte, et qu’à leurs bleds
Les gens n’estant plus occupez
Feront aux Oisillons la guerre ;
Quand regingletes et rezeaux
Attraperont petits Oiseaux ;
Ne volez plus de place en place :
Demeurez au logis, ou changez de climat :
Imitez le Canard, la Gruë, et la Becasse.
Mais vous n’estes pas en estat
De passer comme nous les deserts et les ondes,
Ny d’aller chercher d’autres mondes.
C’est pourquoy vous n’avez qu’un party qui soit seur :
C’est de vous renfermer aux trous de quelque mur.
Les Oisillons las de l’entendre,
Se mirent à jazer aussi confusément,
Que faisoient les Troyens quand la pauvre Cassandre
Ouvroit la bouche seulement.
Il en prit aux uns comme aux autres.
Maint oisillon se vit esclave retenu.
Nous n’écoutons d’instincts que ceux qui sont les nôtres,
Et ne croyons le mal que quand il est venu.
IX. § [P352] Le Rat de Ville, et le Rat des Champs. § A utrefois le Rat de ville
Invita le Rat des champs,
D’une façon fort civile,
A des reliefs d’Ortolans.
Sur un Tapis de Turquie
Le couvert se trouva mis.
Je laisse à penser la vie
Que firent ces deux amis.
Le regal fut fort honneste :
Rien ne manquoit au festin ;
Mais quelqu’un troubla la feste
Pendant qu’ils estoient en train.
A la porte de la salle
Ils entendirent du bruit.
Le Rat de ville détale,
Son camarade le suit.
Le bruit cesse, on se retire,
Rat en campagne aussi-tost :
Et le Citadin de dire,
Achevons tout nôtre rost.
C’est assez, dit le Rustique ;
Demain vous viendrez chez moy :
Ce n’est pas que je me pique
De tous vos festins de Roy.
Mais rien ne vient m’interrompre ;
Je mange tout à loisir.
Adieu donc, fy du plaisir
Que la crainte peut corrompre.
X. § [P155] Le Loup et l’Agneau. § L a raison du plus fort est toûjours la meilleure.
Nous l’allons montrer tout à l’heure.
Un Agneau se desalteroit
Dans le courant d’une onde pure.
Un Loup survient à jeun qui cherchoit avanture,
Et que la faim en ces lieux attiroit.
Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?
Dit cet animal plein de rage :
Tu seras châtié de ta temerité.
Sire, répond l’Agneau, que votre Majesté
Ne se mette pas en colere ;
Mais plutost qu’elle considere
Que je me vas desalterant
Dans le courant,
Plus de vingt pas au-dessous d’elle ;
Et que par consequent en aucune façon
Je ne puis troubler sa boisson.
Tu la troubles, reprit cette beste cruelle,
Et je sçai que de moy tu médis l’an passé.
Comment l’aurois-je fait si je n’estois pas né ?
Reprit l’Agneau, je tete encor ma mere,
Si ce n’est toy, c’est donc ton frere :
Je n’en ay point. C’est donc quelqu’un des tiens :
Car vous ne m’épargnez guéres,
Vous, vos bergers, et vos chiens.
On me l’a dit : il faut que je me vange.
Là-dessus au fond des forests
Le Loup l’emporte, et puis le mange,
Sans autre forme de procés.
XI. § [PØ] L’homme, et son Image. Pour M. L. D. D. L. R. § U n homme qui s’aimoit sans avoir de rivaux,
Passoit dans son esprit pour le plus beau du monde.
Il accusoit toûjours les miroirs d’estre faux,
Vivant plus que content dans son erreur profonde.
Afin de le guérir, le sort officieux
Presentoit par tout à ses yeux
Les Conseillers muets dont se servent nos Dames ;
Miroirs dans les logis, miroirs chez les Marchands,
Miroirs aux poches des galands,
Miroirs aux ceintures des femmes.
Que fait nostre Narcisse ? Il se va confiner
Aux lieux les plus cachez qu’il peut s’imaginer,
N’osant plus des miroirs éprouver l’avanture :
Mais un canal formé par une source pure
Se trouve en ces lieux écartez.
Il s’y void, il se fâche ; et ses yeux irritez
Pensent appercevoir une chimere vaine.
Il fait tout ce qu’il peut pour éviter cette eau.
Mais quoy, le canal est si beau,
Qu’il ne le quitte qu’avec peine.
On voit bien où je veux venir.
Je parle à tous ; et cette erreur extrême
Est un mal que chacun se plaist d’entretenir.
Nostre ame c’est cet Homme amoureux de luy-mesme.
Tant de Miroirs ce sont les sottises d’autruy ;
Miroirs de nos défauts les Peintres legitimes.
Et quant au Canal, c’est celuy
Que chacun sçait, le Livre des Maximes.
XII. § [PØ] Le Dragon à plusieurs testes, et le Dragon à plusieurs queuës. § U n Envoyé du Grand seigneur
Preferoit, dit l’Histoire, un jour chez l’Empereur
Les forces de son Maistre à celles de l’Empire.
Un Alleman se mit à dire :
Nostre Prince a des dépendans
Qui de leur chef sont si puissans,
Que chacun d’eux pourroit soudoyer une armée.
Le Chiaoux homme de sens
Luy dit : Je sçais par renommée
Ce que chaque Electeur peut de monde fournir ;
Et cela me fait souvenir
D’une avanture étrange, et qui pourtant est vraye.
J’estois en un lieu seur, lors que je vis passer
Les cent testes d’une Hydre au travers d’une haye.
Mon sang commence à se glacer,
Et je crois qu’à moins on s’effraye.
Je n’en eus toutefois que la peur sans le mal.
Jamais le corps de l’animal
Ne pût venir vers moy, ni trouver d’ouverture.
Je révais à cette avanture,
Quand un autre Dragon qui n’avoit qu’un seul chef,
Et bien plus d’une queuë à passer se presente.
Me voilà saisi derechef
D’étonnement et d’épouvante.
Ce chef passe, et le corps, et chaque queuë aussi.
Rien ne les empescha ; l’un fit chemin à l’autre.
Je soûtiens qu’il en est ainsi
De vostre Empereur et du nostre.
XIII. § [Cf. P147] Les Voleurs et l’Asne. § P our un Asne enlevé deux voleurs se battoient :
L’un vouloit le garder ; l’autre le vouloit vendre.
Tandis que coups de poing trottoient,
Et que nos champions songeaient à se défendre.
Arrive un troisiéme larron,
Qui saisit Maistre Aliboron.
L’Asne c’est quelquefois une pauvre Province.
Les Voleurs sont tel et tel Prince ;
Comme le Transsilvain, le Turc, et le Hongrois.
Au lieu de deux j’en ay rencontré trois.
Il est assez de cette marchandise,
De nul d’eux n’est souvent la Province conquise.
Un quart Voleur survient qui les accorde net,
En se saisissant du Baudet.
XIV. § [P522] Simonide préservé par les Dieux. § O n ne peut trop loüer trois sortes de personnes ;
Les Dieux, sa Maistresse, et son Roy.
Malherbe le disoit : j’y souscris quant à moy :
Ce sont maximes toujours bonnes.
La loüange chatoüille, et gagne les esprits.
Les faveurs d’une belle en sont souvent le prix.
Voyons comme les Dieux l’ont quelquefois payée.
Simonide avoit entrepris
L’éloge d’un Athlete ; et la chose essayée,
Il trouva son sujet plein de recits tout nuds.
Les parens de l’Athlete estoient gens inconnus,
Son pere un bon Bourgeois ; luy sans autre merite ;
Matiere infertile et petite.
Le Poëte d’abord parla de son Heros.
Aprés en avoir dit ce qu’il en pouvoit dire ;
Il se jette à costé ; se met sur le propos
De Castor et Pollux ; ne manque pas d’ecrire
Que leur exemple estoit aux luteurs glorieux ;
Eleve leurs combats, specifiant les lieux
Où ces freres s’estoient signalez davantage.
Enfin l’éloge de ces Dieux
Faisoit les deux tiers de l’ouvrage.
L’Athlete avoit promis d’en payer un talent :
Mais quand il le vid, le galand
N’en donna que le tiers, et dit fort franchement
Que Castor et Pollux acquitassent le reste.
Faites-vous contenter par ce couple celeste.
Je vous veux traiter cependant.
Venez souper chez moy, nous ferons bonne vie.
Les conviez sont gens choisis,
Mes parens, mes meilleurs amis.
Soyez donc de la compagnie.
Simonide promit. Peut-estre qu’il eut peur
De perdre, outre son dû, le gré de sa loüange.
Il vient, l’on festine, l’on mange.
Chacun estant en belle humeur,
Un domestique accourt, l’avertit qu’à la porte
Deux hommes demandoient à le voir promptement.
Il sort de table, et la cohorte
N’en perd pas un seul coup de dent.
Ces deux hommes estoient les gemeaux de l’éloge.
Tous deux luy rendent grace, et pour prix de ses vers
Ils l’avertissent qu’il déloge,
Et que cette maison va tomber à l’envers.
La prediction fut vraye ;
Un pilier manque ; et le platfonds
Ne trouvant plus rien qui l’estaye,
Tombe sur le festin, brise plats et flacons,
N’en fait pas moins aux Echansons.
Ce ne fut pas le pis ; car pour rendre complete
La vengeance deuë au Poëte,
Une poutre cassa les jambes à l’Athlete,
Et renvoya les conviez
Pour la pluspart estropiez.
La renommée eut soin de publier l’affaire.
Chacun cria miracle ; on doubla le salaire
Que meritoient les vers d’un homme aimé des Dieux.
Il n’estoit fils de bonne mere
Qui les payant à qui mieux mieux,
Pour ses ancestres n’en fist faire.
Je reviens à mon texte, et dis premierement
Qu’on ne sçauroit manquer de loüer largement
Les Dieux et leurs pareils : de plus, que Melpomene
Souvent, sans déroger, trafique de sa peine :
Enfin qu’on doit tenir nostre art en quelque prix.
Les Grands se font honneur dés-lors qu’ils nous font grace.
Jadis l’Olympe et le Parnasse
Estoient freres et bons amis.
XV. § [P60] La mort et le Malheureux. § XVI. § [P60] La mort et le Buscheron. § U n Malheureux appelloit tous les jours
La mort à son secours.
O mort, luy disoit-il, que tu me sembles belle !
Vien viste, vien finir ma fortune cruelle.
La mort crut, en venant, l’obliger en effet.
Elle frappe à sa porte, elle entre, elle se montre.
Que vois-je ! cria-t-il, ostez-moy cet objet ;
Qu’il est hideux ! que sa rencontre
Me cause d’horreur et d’effroy !
N’approche pas, ô mort, ô mort, retire-toy.
Mecenas fut un galand homme :
Il a dit quelque part : Qu’on me rende impotent,
Cu de jatte, gouteux, manchot, pourveu qu’en somme
Je vive, c’est assez, je suis plus que content.
Ne vien jamais ô mort, on [t]’en dit tout autant.
U n pauvre Bucheron tout couvert de ramée,
Sous le faix du fagot aussi-bien que des ans,
Gemissant et courbé marchoit à pas pesans,
Et tâchoit de gagner sa chaumine enfumée.
Enfin n’en pouvant plus d’effort et de douleur,
Il met bas son fagot, il songe à son malheur.
Quel plaisir a-t-il eu depuis qu’il est au monde ?
En est-il un plus pauvre en la machine ronde ?
Point de pain quelquefois, et jamais de repos.
Sa femme, ses enfans, les soldats, les imposts,
Le creancier, et la corvée
Luy font d’un mal-heureux la peinture achevée.
Il appelle la mort, elle vient sans tarder ;
Luy demande ce qu’il faut faire.
C’est, dit-il, afin de m’aider
A recharger ce bois ; tu ne tarderas guéres.
Le trépas vient tout guérir ;
Mais ne bougeons d’où nous sommes.
Plûtost souffrir que mourir,
C’est la devise des hommes.
XVII. § [P31] L’Homme entre deux âges, et ses deux Maistresses. § U n homme de moyen âge,
Et tirant sur le grison,
Jugea qu’il étoit saison
De songer au mariage.
Il avoit du contant.
Et partant
Dequoy choisir. Toutes vouloient luy plaire ;
En quoy nostre amoureux ne se pressoit pas tant.
Bien adresser n’est pas petite affaire.
Deux veuves sur son cœur eurent le plus de part ;
L’une encor verte, et l’autre un peu bien mûre ;
Mais qui reparoit par son art
Ce qu’avoit détruit la nature.
Ces deux Veuves en badinant,
En riant, en luy faisant feste,
L’alloient quelquefois testonnant,
C’est-à-dire ajustant sa teste.
La Vieille à tous momens de sa part emportoit
Un peu du poil noir qui restoit,
Afin que son amant en fust plus à sa guise.
La Jeune saccageoit les poils blancs à son tour.
Toutes deux firent tant que nostre teste grise
Demeura sans cheveux, et se douta du tour.
Je vous rends, leur dit-il, mille graces, les Belles,
Qui m’avez si bien tondu ;
J’ai plus gagné que perdu :
Car d’Hymen, point de nouvelles.
Celle que je prendrois voudroit qu’à sa façon
Je vécusse, et non à la mienne.
Il n’est teste chauve qui tienne ;
Je vous suis obligé, Belles, de la leçon.
XVIII. § [P426] Le Renard et la Cicogne. § C ompere le Renard se mit un jour en frais,
Et retint à disner commere la Cicogne.
Le régal fut petit, et sans beaucoup d’apprests ;
Le galand pour toute besogne
Avoit un broüet clair (il vivoit chichement.)
Ce broüet fut par luy servy sur une assiette :
La Cicogne au long bec n’en put attraper miette ;
Et le drôle eut lapé le tout en un moment.
Pour se vanger de cette tromperie,
A quelque temps de là la Cicogne le prie :
Volontiers, luy dit-il, car avec mes amis
Je ne fais point ceremonie.
A l’heure dite il courut au logis
De la Cicogne son hôtesse,
Loüa trés-fort la politesse,
Trouva le disner cuit à point.
Bon appetit sur tout ; Renards n’en manquent point.
Il se rejoüissoit à l’odeur de la viande
Mise en menus morceaux, et qu’il croyoit friande.
On servit pour l’embarrasser
En un vase à long col, et d’étroite embouchure.
Le bec de la Cicogne y pouvoit bien passer,
Mais le museau du Sire estoit d’autre mesure.
Il luy falut à jeun retourner au logis ;
Honteux comme un Renard qu’une Poule auroit pris,
Serrant la queue, et portant bas l’oreille.
Trompeurs, c’est pour vous que j’écris,
Attendez-vous à la pareille.
XIX. § [P211] L’Enfant et le Maistre d’Ecole. § D ans ce recit je pretens faire voir
D’un certain sot la remontrance vaine.
Un jeune enfant dans l’eau se laissa choir,
En badinant sur les bords de la Seine.
Le Ciel permit qu’un saule se trouva
Dont le branchage, aprés Dieu, le sauva.
S’estant pris, dis-je, aux branches de ce saule ;
Par cet endroit passe un Maistre d’école.
L’Enfant luy crie : Au secours, je peris.
Le Magister se tournant à ses cris,
D’un ton fort grave à contre-temps s’avise
De le tancer. Ah le petit baboüin !
Voyez, dit-il, où l’a mis sa sotise !
Et puis prenez de tels fripons le soin.
Que les parens sont malheureux, qu’il faille
Toûjours veiller à semblable canaille !
Qu’ils ont de maux, et que je plains leur sort !
Ayant tout dit, il mit l’enfant à bord.
Je blâme icy plus de gens qu’on ne pense.
Tout babillard, tout censeur, tout pedant,
Se peut connoistre au discours que j’avance :
Chacun des trois fait un peuple fort grand ;
Le Createur en a beny l’engeance.
En toute affaire ils ne font que songer
Aux moyens d’exercer leur langue.
Hé, mon amy, tire-moy de danger :
Tu feras aprés ta harangue.
XX. § [P503] Le Coq et la Perle. § U n jour un Coq détourna
Une Perle qu’il donna
Au beau premier Lapidaire.
Je la crois fine, dit-il,
Mais le moindre grain de mil
Seroit bien mieux mon affaire.
Un ignorant herita
D’un manuscrit qu’il porta
Chez son voisin le Libraire.
Je crois, dit-il, qu’il est bon ;
Mais le moindre ducaton
Seroit bien mieux mon affaire.
XXI. § [P504] Les Frelons, et les Moûches à miel. § À l’œuvre on connoist l’Artisan.
Quelques rayons de miel sans maistre se trouverent.
Des Frelons les reclamerent.
Des Abeilles s’opposant,
Devant certaine Guespe on traduisit la cause.
Il estoit mal-aisé de décider la chose.
Les témoins déposoient qu’autour de ces rayons
Des animaux aîlez bourdonnans, un peu longs,
De couleur fort tannée ; et tels que les Abeilles,
Avoient long-temps paru. Mais quoy, dans les Frelons
Ces enseignes estoient pareilles.
La Guespe ne sçachant que dire à ces raisons,
Fit enqueste nouvelle ; et pour plus de lumiere
Entendit une fourmilliere.
Le point n’en pût estre éclaircy.
De grace, à quoy bon tout cecy ?
Dit une Abeille fort prudente.
Depuis tantost six mois que la cause est pendante,
Nous voicy comme aux premiers jours.
Pendant cela le miel se gaste.
Il est temps desormais que le Juge se haste :
N’a-t-il point assez leché l’Ours ?
Sans tant de contredits, et d’interlocutoires,
Et de fatras, et de grimoires,
Travaillons, les Frelons et nous :
On verra qui sçait faire avec un suc si doux
Des cellules si bien basties.
Le refus des Frelons fit voir
Que cet art passoit leur sçavoir :
Et la Guespe adjugea le miel à leurs parties :
Plust à Dieu qu’on reglast ainsi tous les procez ;
Que des Turcs en cela l’on suivist la methode :
Le simple sens commun nous tiendroit lieu de Code.
Il ne faudroit point tant de frais.
Au lieu qu’on nous mange, on nous gruge ;
On nous mine par des longueurs :
On fait tant à la fin, que l’huistre est pour le Juge,
Les écailles pour les plaideurs.
XXII. § [P70] Le Chesne et le Rozeau. § L e Chesne un jour dit au Rozeau :
Vous avez bien sujet d’accuser la Nature.
Un Roitelet pour vous est un pesant fardeau.
Le moindre vent qui d’aventure
Fait rider la face de l’eau
Vous oblige à baisser la teste :
Cependant que mon front au Caucase pareil,
Non content d’arrester les rayons du soleil,
Brave l’effort de la tempeste.
Tout vous est Aquilon ; tout me semble Zephir.
Encor si vous naissiez à l’abry du feüillage
Dont je couvre le voisinage ;
Vous n’auriez pas tant à souffrir ;
Je vous defendrois de l’orage :
Mais vous naissez le plus souvent
Sur les humides bords des Royaumes du vent.
La Nature envers vous me semble bien injuste.
Vostre compassion, luy répondit l’Arbuste,
Part d’un bon naturel ; mais quittez ce soucy.
Les vents me sont moins qu’à vous redoutables.
Je plie, et ne romps pas. Vous avez jusqu’icy
Contre leurs coups épouvantables
Resisté sans courber le dos :
Mais attendons la fin. Comme il disoit ces mots,
Du bout de l’orizon accourt avec furie
Le plus terrible des enfans
Que le Nort eust porté jusques-là dans ses flancs.
L’Arbre tient bon, le Roseau plie ;
Le vent redouble ses efforts,
Et fait si bien qu’il déracine
Celuy de qui la teste au Ciel estoit voisine,
Et dont les pieds touchoient à l’Empire des Morts.
Livre deuxiéme. §
FABLE I. § [PØ] Contre ceux qui ont le goust difficile. § Q uand j’aurois, en naissant, receu de Calliope
Les dons qu’à ses Amans cette Muse a promis,
Je les consacrerois aux mensonges d’Esope :
Le mensonge et les vers de tout temps sont amis.
Mais je ne me crois pas si cheri du Parnasse,
Que de sçavoir orner toutes ces fictions :
On peut donner du lustre à leurs inventions :
On le peut, je l’essaye, un plus sçavant le fasse.
Cependant jusqu’icy d’un langage nouveau
J’ay fait parler le Loup, et répondre l’Agneau.
J’ay passé plus avant ; les Arbres et les Plantes
Sont devenus chez moy creatures parlantes.
Qui ne prendroit cecy pour un enchantement ?
Vraiment, me diront nos Critiques,
Vous parlez magnifiquement
De cinq ou six contes d’enfant.
Censeurs, en voulez-vous qui soient plus authentiques,
Et d’un stile plus haut ? En voicy. Les Troyens,
Après dix ans de guerre, autour de leurs murailles,
Avoient lassé les Grecs, qui, par mille moyens,
Par mille assauts, par cent batailles,
N’avoient pû mettre à bout cette fiere Cité :
Quand un cheval de bois par Minerve inventé
D’un rare et nouvel artifice,
Dans ses énormes flancs receut le sage Ulysse,
Le vaillant Diomede, Ajax l’impetueux,
Que ce Colosse monstrueux
Avec leurs escadrons devoit porter dans Troye,
Livrant à leur fureur ses Dieux mesmes en proye.
Stratagême inouï, qui des fabricateurs
Paya la constance et la peine.
C’est assez, me dira quelqu’un de nos Auteurs ;
La periode est longue, il faut reprendre haleine.
Et puis vostre Cheval de bois,
Vos Heros avec leurs Phalanges,
Ce sont des contes plus étranges
Qu’un Renard qui cajole un Corbeau sur sa voix.
De plus il vous sied mal d’écrire en si haut stile.
Et bien, baissons d’un ton. La jalouse Amarille
Songeoit à son Alcippe, et croyoit de ses soins
N’avoir que ses Moutons et son Chien pour témoins.
Tircis qui l’apperceut, se glisse entre des Saules,
Il entend la Bergere adressant ces paroles
Au doux Zephire, et le priant
De les porter à son Amant.
Je vous arreste à cette rime,
Dira mon Censeur à l’instant.
Je ne la tiens pas legitime,
Ni d’une assez grande vertu.
Remettez, pour le mieux, ces deux vers à la fonte.
Maudit Censeur, te tairas-tu ?
Ne sçaurois-je achever mon conte ?
C’est un dessein tres-dangereux
Que d’entreprendre de te plaire.
Les delicats sont malheureux ;
Rien ne sçauroit les satisfaire.
II. § [P613] Conseil tenu par les Rats. § U n Chat nommé Rodilardus,
Faisoit de Rats telle déconfiture,
Que l’on n’en voyoit presque plus,
Tant il en avoit mis dedans la sepulture.
Le peu qu’il en restoit n’osant quitter son trou,
Ne trouvoit à manger que le quart de son sou ;
Et Rodilard passoit chez la gent miserable,
Non pour un Chat, mais pour un Diable.
Or un jour qu’au haut et au loin
Le galand alla chercher femme ;
Pendant tout le sabat qu’il fit avec sa Dame,
Le demeurant des Rats tint Chapitre en un coin
Sur la necessité presente.
Dés l’abord leur Doyen, personne fort prudente,
Opina qu’il faloit, et plustost que plus tard,
Attacher un grelot au cou de Rodilard ;
Qu’ainsi quand il iroit en guerre,
De sa marche avertis ils s’enfuiroient sous terre.
Qu’il n’y sçavoit que ce moyen.
Chacun fut de l’avis de Monsieur le Doyen,
Chose ne leur parut à tous plus salutaire.
La difficulté fut d’attacher le grelot.
L’un dit : Je n’y vas point, je ne suis pas si sot :
L’autre, Je ne sçaurois. Si bien que sans rien faire
On se quitta. J’ay maints Chapitres vûs,
Qui pour neant se sont ainsi tenus ;
Chapitres, non de Rats, mais Chapitres de Moines,
Voire Chapitres de Chanoines.
Ne faut-il que deliberer ?
La Cour en Conseillers foisonne ;
Est-il besoin d’executer ?
L’on ne rencontre plus personne.
III. § [P474] Le Loup plaidant contre le Renard pardevant le Singe. § U n Loup disoit que l’on l’avoit volé.
Un Renard son voisin, d’assez mauvaise vie,
Pour ce pretendu vol par luy fut appellé.
Devant le Singe il fut plaidé,
Non point par Avocats, mais par chaque Partie.
Themis n’avoit point travaillé,
De memoire de Singe, à fait plus embroüillé.
Le Magistrat suoit en son lit de Justice.
Aprés qu’on eut bien contesté,
Repliqué, crié, tempesté,
Le Juge instruit de leur malice,
Leur dit : Je vous connois de long-temps, mes amis ;
Et tous deux vous payrez l’amende :
Car toy, Loup, tu te plains, quoiqu’on ne t’ait rien pris ;
Et toy, Renard, as pris ce que l’on te demande.
Le Juge pretendoit qu’à tort et à travers
On ne sçauroit manquer condamnant un pervers.
IV. § [P485] Les deux Taureaux et une Grenoüille. § D eux Taureaux combattoient à qui possederoit
Une Genisse avec l’empire.
Une Grenoüille en soûpiroit.
Qu’avez-vous, se mit à luy dire
Quelqu’un du peuple croassant.
Et ne voyez-vous pas, dit-elle,
Que la fin de cette querelle
Sera l’exil de l’un ; que l’autre le chassant,
Le fera renoncer aux campagnes fleuries ?
Il ne regnera plus sur l’herbe des prairies,
Viendra dans nos marais regner sur les roseaux ;
Et nous foulant aux pieds jusques au fond des eaux,
Tantost l’une, et puis l’autre ; il faudra qu’on patisse
Du combat qu’a causé madame la Genisse.
Cette crainte estoit de bon sens.
L’un des Taureaux en leur demeure
S’alla cacher à leurs dépens,
Il en écrasoit vingt par heure.
Helas ! on voit que de tout temps
Les petits ont pati des sottises des grands.
V. § [P172] La Chauvesouris et les deux Belettes. § U ne Chauvesouris donna teste baissée
Dans un nid de Belette ; et sitost qu’elle y fut,
L’autre envers les Souris de long-temps courroucée,
Pour la devorer accourut.
Quoy ? vous osez, dit-elle, à mes yeux vous produire,
Aprés que vostre race a tâché de me nuire ?
N’estes-vous pas Souris ? Parlez sans fiction.
Ouy vous l’estes, ou bien je ne suis pas Belette.
Pardonnez-moy, dit la pauvrette,
Ce n’est pas ma profession.
Moy Souris ! des méchans vous ont dit ces nouvelles.
Grace à l’Auteur de l’Univers,
Je suis Oyseau ; voyez mes aisles :
Vive la gent qui fend les airs.
Sa raison plut et sembla bonne.
Elle fait si bien qu’on luy donne
Liberté de se retirer.
Deux jours aprés nostre étourdie
Aveuglément va se fourrer
Chez une autre Belette aux Oyseaux ennemie.
La voila derechef en danger de sa vie.
La Dame du logis, avec son long museau,
S’en alloit la croquer en qualité d’Oyseau,
Quand elle protesta qu’on lui faisoit outrage.
Moy pour telle passer ? vous n’y regardez pas.
Qui fait l’Oyseau ? c’est le plumage.
Je suis Souris ; vivent les Rats.
Jupiter confonde les Chats.
Par cette adroite repartie
Elle sauva deux fois sa vie.
Plusieurs se sont trouvez qui d’écharpe changeans,
Aux dangers, ainsi qu’elle, ont souvent fait la figue.
Le Sage dit, selon les gens,
Vive le Roi, vive la Ligue.
VI. § [P276] L’Oyseau blessé d’une fléche. § M ortellement atteint d’une fléche empennée,
Un Oyseau déploroit sa triste destinée.
Et disoit en souffrant un surcroist de douleur,
Faut-il contribuer à son propre malheur ?
Cruels humains, vous tirez de nos aîles
De quoy faire voler ces machines mortelles ;
Mais ne vous mocquez point, engeance sans pitié :
Souvent il vous arrive un sort comme le nostre.
Des enfans de Japet toûjours une moitié
Fournira des armes à l’autre.
VII. § [P480] La Lice et sa Compagne. § U ne Lice estant sur son terme,
Et ne sçachant où mettre un fardeau si pressant,
Fait si bien qu’à la fin sa Compagne consent,
De luy prêter sa hute, où la Lice s’enferme.
Au bout de quelque temps sa Compagne revient.
La Lice luy demande encore une quinzaine.
Ses petits ne marchoient, disoit-elle, qu’à peine.
Pour faire court, elle l’obtient.
Ce second terme échû, l’autre luy redemande
Sa maison, sa chambre, son lit.
La Lice cette fois montre les dents, et dit :
Je suis prête à sortir avec toute ma bande,
Si vous pouvez nous mettre hors.
Ses enfans étoient déja forts.
Ce qu’on donne aux méchans, toûjours on le regrette.
Pour tirer d’eux ce qu’on leur prête,
Il faut que l’on en vienne aux coups ;
Il faut plaider, il faut combattre.
Laissez-leur prendre un pied chez vous,
Ils en auront bien-tôt pris quatre.
VIII. § [P3] L’Aigle et l’Escarbot. § L ’Aigle donnoit la chasse à Maître Jean Lapin,
Qui droit à son terrier s’enfuyoit au plus vîte.
Le trou de l’Escarbot se rencontre en chemin.
Je laisse à penser si ce gîte
Estoit seur ; mais où mieux ? Jean Lapin s’y blotit.
L’Aigle fondant sur luy nonobstant cet azile,
L’Escarbot intercede et dit :
Princesse des Oyseaux, il vous est fort facile
D’enlever malgré moy ce pauvre malheureux :
Mais ne me faites pas cet affront, je vous prie :
Et puisque Jean Lapin vous demande la vie,
Donnez-la luy de grace, ou l’ôtez à tous deux :
C’est mon voisin, c’est mon compere.
L’Oyseau de Jupiter, sans répondre un seul mot,
Choque de l’aîle l’Escarbot,
L’étourdit, l’oblige à se taire ;
Enleve Jean Lapin. L’Escarbot indigné
Vole au nid de l’Oyseau, fracasse en son absence
Ses œufs, ses tendres œufs, sa plus douce esperance :
Pas un seul ne fut épargné.
L’Aigle estant de retour, et voyant ce ménage,
Remplit le Ciel de cris, et pour comble de rage,
Ne sçait sur qui venger le tort qu’elle a souffert.
Elle gemit en vain, sa plainte au vent se perd.
Il falut pour cet an vivre en mere affligée.
L’an suivant elle mit son nid en lieu plus haut.
L’Escarbot prend son temps, fait faire aux œufs le saut :
La mort de Jean Lapin derechef est vangée.
Ce second deüil fut tel que l’echo de ces bois
N’en dormit de plus de six mois.
L’Oyseau qui porte Ganimede,
Du Monarque des Dieux enfin implore l’aide ;
Dépose en son giron ses œufs, et croit qu’en paix
Ils seront dans ce lieu, que pour ses interests
Jupiter se verra contraint de les défendre.
Hardy qui les iroit là prendre.
Aussi ne les y prit-on pas.
Leur ennemi changea de note,
Sur la robe du Dieu fit tomber une crote :
Le Dieu la secoüant jetta les œufs à bas.
Quand l’Aigle sçut l’inadvertance,
Elle menaça Jupiter
D’abandonner sa Cour, d’aller vivre au desert :
Avec mainte autre extravagance.
Le pauvre Jupiter se tut.
Devant son Tribunal l’Escarbot comparut,
Fit sa plainte, et conta l’affaire.
On fit entendre à l’Aigle enfin qu’elle avoit tort.
Mais les deux ennemis ne voulant point d’accord,
Le Monarque des Dieux s’avisa, pour bien faire,
De transporter le temps où l’Aigle fait l’amour,
En une autre saison, quand la race Escarbote
Est en quartier d’hyver, et comme la Marmote
Se cache et ne voit point le jour.
IX. § [P255] Le Lion et le Moucheron. § V a-t-en chetif insecte, excrement de la terre.
C’est en ces mots que le Lion
Parloit un jour au Moûcheron.
L’autre luy declara la guerre.
Penses-tu, luy dit-il, que ton titre de Roy
Me fasse peur, ny me soucie ?
Un bœuf est plus puissant que toy ;
Je le meine à ma fantaisie.
A peine il achevoit ces mots,
Que luy-même il sonna la charge,
Fut le Trompette et le Heros.
Dans l’abord il se met au large ;
Puis prend son temps, fond sur le cou
Du Lion qu’il rend presque fou.
Le quadrupede écume, et son œil étincelle ;
Il rugit, on se cache, on tremble à l’environ :
Et cette alarme universelle
Est l’ouvrage d’un Moûcheron.
Un avorton de Moûche en cent lieux le harcelle,
Tantost picque l’échine, et tantost le museau,
Tantost entre au fond du nazeau.
La rage alors se trouve à son faîte montée.
L’invisible ennemy triomphe, et rit de voir
Qu’il n’est griffe ny dent en la beste irritée,
Qui de la mettre en sang ne fasse son devoir.
Le malheureux Lion se déchire luy-mesme,
Fait resonner sa queue à l’entour de ses flancs,
Bat l’air qui n’en peut mais ; et sa fureur extrême
Le fatigue, l’abbat : le voilà sur les dents.
L’insecte du combat se retire avec gloire :
Comme il sonna la charge, il sonne la victoire ;
Va par tout l’annoncer ; et rencontre en chemin
L’embuscade d’une araignée.
Il y rencontre aussi sa fin.
Quelle chose par là nous peut estre enseignée ?
J’en vois deux, dont l’une est qu’entre nos ennemis,
Les plus à craindre sont souvent les plus petits ;
L’autre, qu’aux grands perils tel a pû se soustraire,
Qui perit pour la moindre affaire.
X. § [P180] L’Asne chargé d’éponges, et l’Asne chargé de sel. § U n Asnier, son Sceptre à la main,
Menoit en Empereur Romain
Deux Coursiers à longues oreilles.
L’un d’éponges chargé marchoit comme un Courier ;
Et l’autre se faisant prier
Portoit, comme on dit, les bouteilles.
Sa charge estoit de sel. Nos gaillards pelerins
Par monts, par vaux, et par chemins
Au gué d’une riviere à la fin arriverent,
Et fort empêchez se trouverent.
L’Asnier, qui tous les jours traversoit ce gué-là,
Sur l’Asne à l’éponge monta,
Chassant devant luy l’autre beste,
Qui voulant en faire à sa teste
Dans un trou se precipita,
Revint sur l’eau, puis échapa :
Car au bout de quelques nagées
Tout son sel se fondit si bien,
Que le Baudet ne sentit rien
Sur ses épaules soulagées.
Camarade Epongier prit exemple sur luy,
Comme un Mouton qui va dessus la foy d’autruy.
Voilà mon Asne à l’eau, jusqu’au col il se plonge
Luy, le Conducteur, et l’Eponge.
Tous trois beurent d’autant ; l’Asnier et le Grifon
Firent à l’éponge raison.
Celle-cy devint si pesante,
Et de tant d’eau s’emplit d’abord,
Que l’Asne succombant ne pût gagner le bord.
L’Asnier l’embrassoit dans l’attente
D’une prompte et certaine mort.
Quelqu’un vint au secours : qui ce fut, il n’importe ;
C’est assez qu’on ait veu par là qu’il ne faut point
Agir chacun de mesme sorte.
J’en voulois venir à ce point.
XI. § [P150] Le Lion et le Rat. § XII. § [P235] La Colombe et la Fourmy. § I l faut autant qu’on peut obliger tout le monde.
On a souvent besoin d’un plus petit que soy.
De cette verité deux Fables feront foy,
Tant la chose en preuves abonde.
Entre les pattes d’un Lion,
Un Rat sortit de terre assez à l’étourdie.
Le Roy des animaux en cette occasion
Montra ce qu’il estoit, et luy donna la vie.
Ce bienfait ne fut pas perdu.
Quelqu’un auroit-il jamais crû
Qu’un Lion d’un Rat eût affaire ?
Cependant il avint qu’au sortir des forests,
Ce Lion fut pris dans des rets,
Dont ses rugissemens ne le pûrent défaire.
Sire Rat accourut ; et fit tant par ses dents,
Qu’une maille rongée emporta tout l’ouvrage.
Patience et longueur de temps
Font plus que force ny que rage.
L ’autre exemple est tiré d’animaux plus petits.
Le long d’un clair ruisseau beuvoit une Colombe :
Quand sur l’eau se panchant une Fourmy y tombe.
Et dans cet Ocean l’on eust vû la Fourmy
S’efforcer, mais en vain, de regagner la rive.
La Colombe aussi-tost usa de charité.
Un brin d’herbe dans l’eau par elle estant jetté,
Ce fut un promontoire où la Fourmy arrive.
Elle se sauve ; et là-dessus
Passe un certain Croquant qui marchoit les pieds nus.
Ce Croquant par hazard avoit une arbaleste.
Dès qu’il void l’Oiseau de Venus
Il le croit en son pot, et déjà luy fait feste.
Tandis qu’à le tuer mon Villageois s’appreste,
La Fourmy le picque au talon.
Le Vilain retourne la teste.
La Colombe l’entend, part, et tire de long.
Le souper du Croquant avec elle s’envole :
Point de Pigeon pour une obole.
XIII. § [P40] L’Astrologue qui se laisse tomber dans un puits. § U n Astrologue un jour se laissa choir
Au fonds d’un puits. On luy dit : Pauvre beste,
Tandis qu’à peine à tes pieds tu peux voir,
Penses-tu lire au-dessus de ta teste ?
Cette avanture en soy, sans aller plus avant,
Peut servir de leçon à la pluspart des hommes.
Parmi ce que de gens sur la terre nous sommes,
Il en est peu qui fort souvent
Ne se plaisent d’entendre dire,
Qu’au Livre du Destin les mortels peuvent lire.
Mais ce Livre qu’Homere et les siens ont chanté,
Qu’est-ce que le hazard parmi l’Antiquité ?
Et parmi nous la Providence ?
Or du hazard il n’est point de science.
S’il en estoit, on auroit tort
De l’appeller hazard, ni fortune, ni sort,
Toutes choses trés-incertaines.
Quant aux volontez souveraines
De celuy qui fait tout, et rien qu’avec dessein,
Qui les sçait que luy seul ? Comment lire en son sein ?
Auroit-il imprimé sur le front des étoiles
Ce que la nuit des temps enferme dans ses voiles ?
A quelle utilité, pour exercer l’esprit
De ceux qui de la Sphere et du Globe ont écrit ?
Pour nous faire éviter des maux inévitables ?
Nous rendre dans les biens de plaisirs incapables ?
Et causant du dégoust pour ces biens prévenus,
Les convertir en maux devant qu’ils soient venus ?
C’est erreur, ou plutost c’est crime de le croire.
Le Firmament se meut ; les Astres font leur cours ;
Le Soleil nous luit tous les jours ;
Tous les jours sa clarté succede à l’ombre noire ;
Sans que nous en puissions autre chose inferer
Que la necessité de luire et d’éclairer,
D’amener les saisons, de meurir les semences,
De verser sur les corps certaines influences.
Du reste, en quoy répond au sort toujours divers
Ce train toujours égal dont marche l’Univers ?
Charlatans, faiseurs d’horoscope,
Quittez les Cours des Princes de l’Europe.
Emmenez avec vous les souffleurs tout d’un temps.
Vous ne meritez pas plus de foy que ces gens.
Je m’emporte un peu trop ; revenons à l’histoire
De ce Speculateur, qui fut contraint de boire.
Outre la vanité de son art mensonger,
C’est l’image de ceux qui baaillent aux chimeres,
Cependant qu’ils sont en danger,
Soit pour eux, soit pour leurs affaires.
XIV. § [P138] Le Lievre et les Grenoüilles. § U n Lievre en son giste songeoit,
(Car que faire en un giste, à moins que l’on ne songe ?)
Dans un profond ennuy ce Lievre se plongeoit :
Cet animal est triste, et la crainte le ronge.
Les gens de naturel peureux
Sont, disoit-il, bien malheureux.
Ils ne sçauroient manger morceau qui leur profite.
Jamais un plaisir pur, toujours assauts divers.
Voilà comme je vis : cette crainte maudite
M’empesche de dormir, sinon les yeux ouverts.
Corrigez-vous, dira quelque sage cervelle.
Et la peur se corrige-t-elle ?
Je croy mesme qu’en bonne foy
Les hommes ont peur comme moy.
Ainsi raisonnoit nostre Lievre,
Et cependant faisoit le guet.
Il estoit douteux, inquiet :
Un souffle, une ombre, un rien, tout luy donnoit la fiévre.
Le melancolique animal
En rêvant à cette matiere,
Entend un leger bruit : ce luy fut un signal
Pour s’enfuïr devers sa taniere.
Il s’en alla passer sur le bord d’un Estang.
Grenoüilles aussi-tost de sauter dans les ondes,
Grenoüilles de rentrer en leurs grottes profondes.
Oh, dit-il, j’en fais faire autant
Qu’on m’en fait faire ! ma presence
Effraye aussi les gens, je mets l’alarme au camp !
Et d’où me vient cette vaillance ?
Comment des animaux qui tremblent devant moy !
Je suis donc un foudre de guerre.
Il n’est, je le vois bien, si poltron sur la terre,
Qui ne puisse trouver un plus poltron que soy.
XV. § [P671] Le Coq et le Renard. § S ur la branche d’un arbre estoit en sentinelle
Un vieux Coq adroit et matois.
Frere, dit un Renard adoucissant sa voix,
Nous ne sommes plus en querelle :
Paix generale à cette fois.
Je viens te l’annoncer ; descends que je t’embrasse.
Ne me retarde point de grace :
Je dois faire aujourd’huy vingt postes sans manquer.
Les tiens et toy pouvez vaquer
Sans nulle crainte à vos affaires ;
Nous vous y servirons en freres.
Faites-en les feux dés ce soir.
Et cependant vien recevoir
Le baiser d’amour fraternelle.
Ami, reprit le Coq, je ne pouvois jamais
Apprendre une plus douce et meilleure nouvelle,
Que celle
De cette paix.
Et ce m’est une double joye
De la tenir de toy. Je voy deux Levriers,
Qui, je m’assure, sont couriers,
Que pour ce sujet on envoye.
Ils vont viste, et seront dans un moment à nous.
Je descends ; nous pourrons nous entrebaiser tous.
Adieu, dit le Renard, ma traite est longue à faire.
Nous nous réjouïrons du succès de l’affaire
Une autre fois. Le galand aussi-tost
Tire ses gregues, gagne au haut,
Mal-content de son stratagême ;
Et nostre vieux Coq en soy-mesme
Se mit à rire de sa peur :
Car c’est double plaisir de tromper le trompeur.
XVI. § [P2] Le Corbeau voulant imiter l’Aigle. § L ’Oyseau de Jupiter enlevant un Mouton,
Un Corbeau témoin de l’affaire,
Et plus foible de reins, mais non pas moins glouton,
En voulut sur l’heure autant faire.
Il tourne à l’entour du troupeau ;
Marque entre cent Moutons le plus gras, le plus beau,
Un vray Mouton de sacrifice.
On l’avoit reservé pour la bouche des Dieux.
Gaillard Corbeau disoit, en le couvrant des yeux,
Je ne sçay qui fut ta nourrice ;
Mais ton corps me paroist en merveilleux état :
Tu me serviras de pâture.
Sur l’animal beslant, à ces mots, il s’abat.
La Moutonniere creature
Pesoit plus qu’un fromage ; outre que sa toison
Estoit d’une épaisseur extrême,
Et meslée à peu prés de la mesme façon
Que la barbe de Polipheme.
Elle empestra si bien les serres du Corbeau,
Que le pauvre animal ne put faire retraite ;
Le Berger vient, le prend, l’encage bien et beau ;
Le donne à ses enfans pour servir d’amusette.
Il faut se mesurer, la consequence est nette.
Mal prend aux Volereaux de faire les Voleurs
L’exemple est un dangereux leure.
Tous les mangeurs de gens ne sont pas grands Seigneurs,
Où la Guespe a passé, le Mouscheron demeure.
XViI. § [P509] Le Paon se plaignant à Junon. § L e Paon se plaignoit à Junon :
Deesse, disoit-il, ce n’est pas sans raison
Que je me plains, que je murmure ;
Le chant dont vous m’avez fait don
Déplaist à toute la Nature :
Au lieu qu’un Rossignol, chetive creature,
Forme des sons aussi doux qu’éclatans ;
Est luy seul l’honneur du Printemps.
Junon répondit en colere :
Oyseau jaloux, et qui devrois te taire,
Est-ce à toy d’envier la voix du Rossignol ?
Toy que l’on voit porter à l’entour de ton col
Un arc-en-ciel nué de cent sortes de soyes,
Qui te panades, qui déployes
Une si riche queuë, et qui semble à nos yeux
La Boutique d’un Lapidaire ?
Est-il quelque oyseau sous les Cieux
Plus que toy capable de plaire ?
Tout animal n’a pas toutes proprietez ;
Nous vous avons donné diverses qualitez,
Les uns ont la grandeur et la force en partage ;
Le Faucon est leger, l’Aigle plein de courage ;
Le Corbeau sert pour le présage ;
La Corneille avertit des malheurs à venir ;
Tous sont contens de leur ramage.
Cesse donc de te plaindre, ou bien, pour te punir,
Je t’osteray ton plumage.
XVIII. § [P50] La Chate metamorphosée en Femme. § U n homme cherissoit éperdument sa Chate ;
Il la trouvoit mignonne, et belle, et delicate ;
Qui miauloit d’un ton fort doux.
Il estoit plus fou que les foux.
Cet Homme donc par prieres, par larmes,
Par sortileges et par charmes,
Fait tant qu’il obtient du destin,
Que sa Chate en un beau matin
Devient femme, et le matin mesme
Maistre sot en fait sa moitié.
Le voilà fou d’amour extrême,
De fou qu’il estoit d’amitié.
Jamais la Dame la plus belle
Ne charma tant son Favory,
Que fait cette épouse nouvelle
Son hypocondre de mary.
Il l’amadouë, elle le flate,
Il n’y trouve plus rien de Chate :
Et poussant l’erreur jusqu’au bout
La croit femme en tout et par tout.
Lors que quelques Souris qui rongeoient de la natte
Troublerent le plaisir des nouveaux mariez.
Aussi-tost la femme est sur pieds :
Elle manqua son avanture.
Souris de revenir, femme d’estre en posture
Pour cette fois elle accourut à point ;
Car ayant changé de figure
Les Souris ne la craignoient point.
Ce luy fut toûjours une amorce,
Tant le naturel a de force,
Il se mocque de tout, certain âge accomply.
Le vase est imbibé, l’étoffe a pris son ply.
En vain de son train ordinaire
On le veut desaccoûtumer.
Quelque chose qu’on puisse faire,
On ne sçauroit le reformer.
Coups de fourche ny d’étrivieres
Ne luy font changer de manieres ;
Et, fussiez-vous embastonnez,
Jamais vous n’en serez les maistres.
Qu’on luy ferme la porte au nez,
Il reviendra par les fenestres.
XIX. § [P151] Le Lion et l’Asne chassant. § L e Roy des animaux se mit un jour en teste
De giboyer. Il celebroit sa feste.
Le gibier du Lion ce ne sont pas moineaux ;
Mais beaux et bons Sangliers, Daims et Cerfs bons et beaux.
Pour réüssir dans cette affaire,
Il se servit du ministere
De l’Asne à la voix de Stentor.
L’Asne à Messer Lion fit office de Cor.
Le Lion le posta, le couvrit de ramée,
Luy commanda de braire, assuré qu’à ce son
Les moins intimidez fuïroient de leur maison.
Leur troupe n’estoit pas encore accoûtumée
A la tempeste de sa voix :
L’air en retentissoit d’un bruit épouventable :
La frayeur saisissoit les hostes de ces bois.
Tous fuyoient, tous tomboient au piége inévitable
Où les attendoit le Lion.
N’ay-je pas bien servy dans cette occasion ?
Dit l’Asne, en se donnant tout l’honneur de la chasse ;
Oüy, reprit le Lion, c’est bravement crié.
Si je ne connoissois ta personne et ta race,
J’en serois moy-mesme effrayé.
L’Asne s’il eût osé se fût mis en colere,
Encor qu’on le raillast avec juste raison :
Car qui pourroit souffrir un Asne fanfaron ?
Ce n’est pas là leur caractere.
XX. § [P512] Testament expliqué par Esope. § S i ce qu’on dit d’Esope est vray,
C’estoit l’Oracle de la Grece :
Luy seul avoit plus de sagesse
Que tout l’Areopage. En voicy pour essay
Une Histoire des plus gentilles,
Et qui pourra plaire au Lecteur.
Un certain homme avoit trois filles,
Toutes trois de contraire humeur.
Une beuveuse, une coquette,
La troisiéme avare parfaite.
Cet Homme par son Testament
Selon les Loix municipales,
Leur laissa tout son bien par portions égales,
En donnant à leur Mere tant ;
Payable quand chacun d’elles
Ne possederoit plus sa contingente part.
Le Pere mort, les trois femelles
Courent au Testament sans attendre plus tard.
On le lit ; on tâche d’entendre
La volonté du Testateur,
Mais en vain : car comment comprendre
Qu’aussi-tost que chacune sœur
Ne possedera plus sa part hereditaire
Il luy faudra payer sa Mere ?
Ce n’est pas un fort bon moyen
Pour payer, que d’estre sans bien.
Que vouloit donc dire le Pere ?
L’affaire est consultée ; et tous les Avocats
Aprés avoir tourné le cas
En cent et cent mille manieres
Y jettent leur bonnet, se confessent vaincus,
Et conseillent aux heritieres
De partager le bien sans songer au surplus.
Quant à la somme de la veuve,
Voicy, leur dirent-ils, ce que le conseil treuve,
Il faut que chaque sœur se charge par traité
Du tiers payable à volonté.
Si mieux n’aime la Mere en créer une rente
Dés le decés du mort courante.
La chose ainsi reglée, on composa trois lots.
En l’un les maisons de bouteille,
Les buffets dressez sous la treille,
La vaisselle d’argent, les cuvettes, les brocs,
Les magasins de malvoisie,
Les esclaves de bouche, et pour dire en deux mots,
L’attirail de la goinfrerie :
Dans un autre celuy de la coquetterie ;
La maison de la Ville, et les meubles exquis,
Les Eunuques, et les Coëffeuses,
Et les Brodeuses,
Les joyaux, les robes de prix.
Dans le troisiéme lot, les fermes, le ménage,
Les troupeaux, et le pasturage,
Valets et bestes de labeur.
Ces lots faits, on jugea que le sort pourroit faire,
Que peut-estre pas une sœur
N’auroit ce qui luy pourroit plaire.
Ainsi chacune prit son inclination ;
Le tout à l’estimation.
Ce fut dans la ville d’Athenes,
Que cette rencontre arriva.
Petits et grands, tout approuva
Le partage et le choix. Esope seul trouva
Qu’aprés bien du temps et des peines,
Les gens avoient pris justement
Le contrepied du Testament.
Si le défunt vivoit, disoit-il, que l’Attique
Auroit de reproches de luy !
Comment ! ce peuple qui se pique
D’estre le plus subtil des peuples d’aujourd’huy,
A si mal entendu la volonté suprême
D’un testateur ! Ayant ainsi parlé
Il fait le partage luy-mesme,
Et donne à chaque sœur un lot contre son gré.
Rien qui pust estre convenable,
Partant rien aux sœurs d’agreable.
A la Coquette l’attirail,
Qui suit les personnes beuveuses.
La Biberonne eut le bestail
La Ménagere eut les coëffeuses.
Tel fut l’avis du Phrygien ;
Alleguant qu’il n’estoit moyen
Plus seur pour obliger ces fille
A se défaire de leur bien.
Qu’elles se mariroient dans les bonnes familles,
Quand on leur verroit de l’argent :
Pairoient leur Mere tout contant ;
Ne possederoient plus les effets de leur Pere ;
Ce que disoit le Testament.
Le peuple s’étonna comme il se pouvoit faire
Qu’un homme seul eust plus de sens
Qu’une multitude de gens.
Livre troisiéme. §
FABLE I. § [P721] Le Meusnier, son Fils, et l’Asne. A. M. D. M. § L ’Invention des Arts estant un droit d’aînesse,
Nous devons l’Apologue à l’ancienne Grece.
Mais ce champ ne se peut tellement moissonner,
Que les derniers venus n’y trouvent à glaner.
La feinte est un païs plein de terres desertes.
Tous les jours nos Auteurs y font des découvertes.
Je t’en veux dire un trait assez bien inventé.
Autrefois à Racan Malherbe l’a conté.
Ces deux rivaux d’Horace, heritiers de sa Lyre,
Disciples d’Apollon, nos Maistres pour mieux dire,
Se rencontrant un jour tout seuls et sans témoins ;
(Comme ils se confioient leurs pensers et leurs soins)
Racan commence ainsi : Dites-moy, je vous prie,
Vous qui devez sçavoir les choses de la vie,
Qui par tous ses degrez avez déja passé,
Et que rien ne doit fuïr en cet âge avancé ;
A quoy me resoudray-je ? Il est temps que j’y pense.
Vous connoissez mon bien, mon talent, ma naissance.
Dois-je dans la Province établir mon sejour ?
Prendre employ dans l’Armée ? Ou bien charge à la Cour ?
Tout au monde est mêlé d’amertume et de charmes.
La guerre a ses douceurs, l’Hymen a ses alarmes.
Si je suivois mon goust, je sçaurois où buter ;
Mais j’ay les miens, la Cour, le peuple à contenter.
Malherbe là-dessus. Contenter tout le monde !
Ecoutez ce recit avant que je réponde.
J’ay lu dans quelque endroit, qu’un Meusnier et son fils,
L’un vieillard, l’autre enfant, non pas des plus petits,
Mais garçon de quinze ans, si j’ay bonne memoire,
Alloient vendre leur Asne un certain jour de foire.
Afin qu’il fût plus frais et de meilleur débit,
On luy lia les pieds, on vous le suspendit ;
Puis cet homme et son fils le portent comme un lustre ;
Pauvres gens, idiots, couple ignorant et rustre.
Le premier qui les vid, de rire s’éclata.
Quelle farce, dit-il, vont joüer ces gens-là ?
Le plus asne des trois n’est pas celuy qu’on pense.
Le Meusnier à ces mots connoist son ignorance.
Il met sur pieds sa beste, et la fait détaler.
L’Asne, qui goustoit fort l’autre façon d’aller
Se plaint en son patois. Le Meusnier n’en a cure.
Il fait monter son fils, il suit, et d’aventure
Passent trois bons Marchands. Cet objet leur déplut.
Le plus vieux au garçon s’écria tant qu’il put :
Oh là oh, descendez, que l’on ne vous le dise,
Jeune homme qui menez Laquais à barbe grise.
C’estoit à vous de suivre, au vieillard de monter.
Messieurs, dit le Meusnier, il vous faut contenter.
L’enfant met pied à terre, et puis le vieillard monte ;
Quand trois filles passant, l’une dit : C’est grand’ honte,
Qu’il faille voir ainsi clocher ce jeune fils ;
Tandis que ce nigaut, comme un Evesque assis,
Fait le veau sur son Asne, et pense estre bien sage.
Il n’est, dit le Meusnier, plus de Veaux à mon âge.
Passez vostre chemin, la fille, et m’en croyez.
Aprés maints quolibets coup sur coup renvoyez,
L’homme crut avoir tort, et mit son fils en croupe.
Au bout de trente pas une troisiéme troupe
Trouve encore à gloser. L’un dit : Ces gens sont fous,
Le Baudet n’en peut plus, il mourra sous leurs coups.
Hé quoy, charger ainsi cette pauvre Bourique !
N’ont-ils point de pitié de leur vieux domestique ?
Sans doute qu’à la Foire ils vont vendre sa peau.
Parbieu, dit le Meusnier, est bien fou du cerveau,
Qui pretend contenter tout le monde et son pere.
Essayons toutefois, si par quelque maniere
Nous en viendrons à bout. Ils descendent tous deux.
L’Asne se prélassant marche seul devant eux.
Un quidan les rencontre, et dit : Est-ce la mode,
Que Baudet aille à l’aise, et Meusnier s’incommode ?
Qui de l’Asne ou du Maistre est fait pour se lasser ?
Je conseille à ces gens de le faire enchasser.
Ils usent leurs souliers, et conservent leur Asne :
Nicolas au rebours ; car quand il va voir Jeanne,
Il monte sur sa beste, et la chanson le dit.
Beau trio de Baudets ! Le Meusnier repartit :
Je suis Asne, il est vray, j’en conviens, je l’avouë ;
Mais que doresnavant on me blâme, on me loüe ;
Qu’on dise quelque chose, ou qu’on ne dise rien ;
J’en veux faire à ma teste. Il le fit, et fit bien.
Quant à vous, suivez Mars, ou l’Amour, ou le Prince ;
Allez, venez, courez, demeurez en Province ;
Prenez femme, Abbaye, Employ, Gouvernement ;
Les gens en parleront, n’en doutez nullement.
II. § [P130] Les Membres et l’Estomach. § J e devois par la Royauté
Avoir commencé mon Ouvrage.
A la voir d’un certain costé,
1 Messer Gaster en est l’image.
S’il a quelque besoin, tout le corps s’en ressent.
De travailler pour luy les membres se lassant,
Chacun d’eux resolut de vivre en Gentil-homme,
Sans rien faire, alleguant l’exemple de Gaster.
Il faudroit, disoient-ils, sans nous qu’il vécust d’air.
Nous suons, nous peinons comme bestes de somme :
Et pour qui ? Pour luy seul ; nous n’en profitons pas :
Nostre soin n’aboutit qu’à fournir ses repas.
Chommons, c’est un métier qu’il veut nous faire apprendre.
Ainsi dit, ainsi fait. Les mains cessent de prendre ;
Les bras d’agir, les jambes de marcher.
Tous dirent à Gaster, qu’il en allast chercher.
Ce leur fut une erreur dont ils se repentirent ;
Bien-tost les pauvres gens tomberent en langueur :
Il ne se forma plus de nouveau sang au cœur :
Chaque membre en souffrit, les forces se perdirent.
Par ce moyen les mutins virent
Que celuy qu’ils croyoient oisif et paresseux,
A l’interest commun contribuoit plus qu’eux.
Cecy peut s’appliquer à la grandeur Royale.
Elle reçoit et donne, et la chose est égale.
Tout travaille pour elle, et reciproquement
Tout tire d’elle l’aliment.
Elle fait subsister l’artisan de ses peines,
Enrichit le Marchand, gage le Magistrat.
Maintient le Laboureur, donne paye au soldat,
Distribuë en cent lieux ses graces souveraines,
Entretient seule tout l’Estat.
Menenius le sceut bien dire.
La Commune s’alloit separer du senat.
Les mécontens disoient qu’il avoit tout l’Empire,
Le pouvoir, les tresors, l’honneur, la dignité ;
Au lieu que tout le mal estoit de leur côté ;
Les tributs, les imposts, les fatigues de guerre.
Le peuple hors des murs estoit déja posté.
La pluspart s’en alloient chercher une autre terre,
Quand Menenius leur fit voir
Qu’ils estoient aux membres semblables ;
Et par cet Apologue insigne entre les Fables,
Les ramena dans leur devoir.
III. § [P451] Le Loup devenu Berger. § U n Loup qui commençoit d’avoir petite part
Aux Brebis de son voisinage,
Crut qu’il faloit s’aider de la peau du Renard,
Et faire un nouveau personnage.
Il s’habille en Berger, endosse un hoqueton,
Fait sa houlette d’un baston ;
Sans oublier la Cornemuse.
Pour pousser jusqu’au bout la ruse,
Il auroit volontiers écrit sur son chapeau,
C’est moy qui suis Guillot Berger de ce troupeau.
Sa personne estant ainsi faite,
Et ses pieds de devant posez sur sa houlette,
Guillot le
2 Sycophante approche
doucement.
Guillot le vray Guillot étendu sur l’herbette,
Dormoit alors profondément.
Son chien dormoit aussi, comme aussi sa musette.
La pluspart des Brebis dormoient pareillement.
L’hypocrite les laissa faire :
Et pour pouvoir mener vers son fort les Brebis,
Il voulut ajoûter la parole aux habits,
Chose qu’il croyoit necessaire.
Mais cela gâta son affaire.
Il ne pût du Pasteur contrefaire la voix.
Le ton dont il parla fit retentir les bois,
Et découvrit tout le mystere.
Chacun se reveille à ce son,
Les Brebis, le Chien, le Garçon.
Le pauvre Loup dans cet esclandre,
Empêché par son hoqueton,
Ne pût ny fuïr ny se défendre.
Toûjours par quelque endroit fourbes se laissent prendre.
Quiconque est Loup, agisse en Loup ;
C’est le plus certain de beaucoup.
IV. § [P44] Les Grenoüilles qui demandent un Roy. § L es Grenoüilles se lassant
De l’estat Democratique,
Par leurs clameurs firent tant
Que Jupin les soûmit au pouvoir Monarchique.
Il leur tomba du Ciel un Roy tout pacifique :
Ce Roy fit toutefois un tel bruit en tombant,
Que la gent marécageuse,
Gent fort sotte et fort peureuse,
S’alla cacher sous les eaux,
Dans les joncs, dans les roseaux,
Dans les trous du marécage,
Sans oser de long-temps regarder au visage
Celuy qu’elles croyoient estre un geant nouveau ;
Or c’estoit un soliveau,
De qui la gravité fit peur à la premiere,
Qui de le voir s’avanturant
Osa bien quitter sa taniere.
Elle approcha, mais en tremblant.
Une autre la suivit, une autre en fit autant,
Il en vint une fourmilliere ;
Et leur troupe à la fin se rendit familiere
Jusqu’à sauter sur l’épaule du Roy.
Le bon Sire le souffre, et se tient toûjours coy.
Jupin en a bien-tost la cervelle rompuë.
Donnez-nous, dit ce peuple, un Roy qui se remuë.
Le Monarque des Dieux leur envoye une Gruë,
Qui les croque, qui les tuë,
Qui les gobe à son plaisir ;
Et Grenoüilles de se plaindre ;
Et Jupin de leur dire : Et quoy ! vostre desir
A ses loix croit-il nous astraindre ?
Vous avez dû premierement
Garder vostre Gouvernement ;
Mais ne l’ayant pas fait, il vous devoit suffire
Que vostre premier Roy fust debonnaire et doux :
De celuy-cy contentez-vous,
De peur d’en rencontrer un pire.
V. § [P9] Le Renard et le Bouc. § C apitaine Renard alloit de compagnie
Avec son amy Bouc des plus haut encornez.
Celuy-cy ne voyoit pas plus loin que son nez.
L’autre estoit passé maistre en fait de tromperie.
La soif les obligea de descendre en un puits.
Là chacun d’eux se desaltere.
Après qu’abondamment tous deux en eurent pris,
Le Renard dit au Bouc : Que ferons-nous compere ?
Ce n’est pas tout de boire ; il faut sortir d’icy.
Leve tes pieds en haut, et tes cornes aussi :
Mets-les contre le mur. Le long de ton eschine
Je grimperay premierement :
Puis sur tes cornes m’élevant,
A l’aide de cette machine
De ce lieu-cy je sortiray,
Aprés quoy je t’en tireray.
Par ma barbe, dit l’autre, il est bon ; et je louë
Les gens bien sensez comme toy.
Je n’aurois jamais quant à moy
Trouvé ce secret, je l’avouë.
Le Renard sort du puits, laisse son compagnon,
Et vous luy fait un beau sermon
Pour l’exhorter à patience.
Si le Ciel t’eust, dit-il, donné par excellence
Autant de jugement que de barbe au menton,
Tu n’aurois pas à la legere
Descendu dans ce puits. Or adieu, j’en suis hors :
Tasche de t’en tirer, et fais tous tes efforts ;
Car pour moy, j’ay certaine affaire,
Qui ne me permet pas d’arrester en chemin.
En toute chose il faut considerer la fin.
VI. § [P488] L’Aigle, la Laye, et la Chate. § L ’Aigle avoit ses petits au haut d’un arbre creux
La Laye au pied, la Chate entre les deux :
Et sans s’incommoder, moyennant ce partage
Meres et nourrissons faisoient leur tripotage.
La Chate détruisit par sa fourbe l’accord.
Elle grimpa chez l’Aigle, et luy dit : Nôtre mort,
(Au moins de nos enfans, car c’est tout un aux meres)
Ne tardera possible gueres.
Voyez-vous à nos pieds foüir incessament
Cette maudite Laye, et creuser une mine ?
C’est pour déraciner le chesne asseurément,
Et de nos nourrissons attirer la ruine.
L’arbre tombant ils seront devorez :
Qu’ils s’en tiennent pour assurez.
S’il m’en restoit un seul j’adoucirois ma plainte.
Au partir de ce lieu qu’elle remplit de crainte,
La perfide descend tout droit
A l’endroit
Où la Laye estoit en gesine.
Ma bonne amie et ma voisine,
Luy dit-elle tout bas, je vous donne un avis.
L’Aigle, si vous sortez, fondra sur vos petits :
Obligez-moy de n’en rien dire.
Son couroux tomberoit sur moy.
Dans cette autre famille ayant semé l’effroy,
La Chate en son trou se retire.
L’Aigle n’ose sortir, ny pourvoir aux besoins
De ses petits : La Laye encore moins :
Sottes de ne pas voir que le plus grand des soins
Ce doit estre celuy d’éviter la famine.
A demeurer chez soy l’une et l’autre s’obstine ;
Pour secourir les siens dedans l’occasion :
L’Oyseau Royal en cas de mine,
La Laye en cas d’irruption.
La faim détruisit tout : il ne resta personne
De la gent Marcassine et de la gent Aiglonne,
Qui n’allast de vie à trépas ;
Grand renfort pour Messieurs les Chats.
Que ne sçait point ourdir une langue traîtresse
Par sa pernicieuse adresse ?
Des malheurs qui sont sortis
De la boëte de Pandore,
Celuy qu’à meilleur droit tout l’Univers abhorre,
C’est la fourbe à mon avis.
VII. § [P246] L’Yvrogne et sa femme. § C hacun a son défaut où toûjours il revient :
Honte ny peur n’y remedie.
Sur ce propos d’un conte il me souvient :
Je ne dis rien que je n’appuye
De quelque exemple. Un suppost de Bacchus
Alteroit sa santé, son esprit, et sa bourse.
Telles gens n’ont pas fait la moitié de leur course,
Qu’ils sont au bout de leurs écus.
Un jour que celui-cy plein du jus de la treille,
Avoit laissé ses sens au fond d’une bouteille,
Sa femme l’enferma dans un certain tombeau.
Là les vapeurs du vin nouveau
Cuverent à loisir. A son réveil il treuve
L’attirail de la mort à l’entour de son corps,
Un luminaire, un drap des morts.
Oh ! dit-il, qu’est-cecy ? ma femme est-elle veuve ?
Là-dessus son épouse en habit d’Alecton,
Masquée, et de sa voix contrefaisant le ton,
Vient au prétendu mort ; approche de sa biere ;
Luy presente un chaudeau propre pour Lucifer.
L’Epoux alors ne doute en aucune maniere
Qu’il ne soit citoyen d’enfer.
Quelle personne es-tu ? dit-il à ce phantosme.
La celeriere du Royaume
De Satan, reprit-elle ; et je porte à manger
A ceux qu’enclost la tombe noire.
Le Mary repart sans songer ;
Tu ne leur portes point à boire ?
VIII. § [P587] La Goute et l’Araignée. § Q uand l’Enfer eut produit la Goute et l’Araignée,
Mes filles, leur dit-il, vous pouvez vous vanter,
D’estre pour l’humaine lignée
Egalement à redouter.
Or avisons aux lieux qu’il vous faut habiter.
Voyez-vous ces cases étretes,
Et ces Palais si grands, si beaux, si bien dorez ?
Je me suis proposé d’en faire vos retraites.
Tenez donc ; voicy deux buchetes ;
Accommodez-vous, ou tirez.
Il n’est rien, dit l’Aragne, aux cases qui me plaise.
L’autre tout au rebours voyant les Palais pleins
De ces gens nommez Medecins,
Ne crut pas y pouvoir demeurer à son aise.
Elle prend l’autre lot ; y plante le piquet ;
S’étend à son plaisir sur l’orteil d’un pauvre homme,
Disant : Je ne croy pas qu’en ce poste je chomme,
Ny que d’en déloger, et faire mon paquet
Jamais Hippocrate me somme.
L’Aragne cependant se campe en un lambris,
Comme si de ces lieux elle eust fait bail à vie ;
Travaille à demeurer : voilà sa toile ourdie ;
Voilà des moûcherons de pris.
Une servante vient balayer tout l’ouvrage.
Autre toile tissuë, autre coup de balay.
Le pauvre Bestion tous les jours déménage.
Enfin après un vain essay
Il va trouver la Goute. Elle estoit en campagne,
Plus malheureuse mille fois
Que la plus malheureuse Aragne.
Son hoste la menoit tantost fendre du bois,
Tantost fouïr, hoüer. Goute bien tracassée
Est, dit-on, à demi pansée.
O, je ne sçaurois plus, dit-elle, y resister.
Changeons, ma sœur l’Aragne. Et l’autre d’écouter.
Elle la prend au mot, se glisse en la cabane :
Point de coup de balay qui l’oblige à changer.
La Goute d’autre part va tout droit se loger
Chez un Prelat qu’elle condamne
A jamais du lit ne bouger.
Cataplasmes, Dieu sçait. Les gens n’ont point de honte
De faire aller le mal toujours de pis en pis.
L’une et l’autre trouva de la sorte son compte,
Et fit trés-sagement de changer de logis.
IX. § [P156] Le Loup et la Cicogne. § L es Loups mangent gloutonnement.
Un Loup donc estant de frairie,
Se pressa, dit-on, tellement,
Qu’il en pensa perdre la vie.
Un os luy demeura bien avant au gosier.
De bonheur pour ce Loup, qui ne pouvoit crier,
Prés de là passe une Cicogne.
Il luy fait signe, elle accourt.
Voilà l’Operatrice aussi-tost en besogne.
Elle retira l’os ; puis pour un si bon tour
Elle demanda son salaire.
Vostre salaire ? dit le Loup,
Vous riez, ma bonne comere.
Quoy, ce n’est pas encor beaucoup
D’avoir de mon gosier retiré vostre cou ?
Allez, vous estes une ingratte ;
Ne tombez jamais sous ma patte.
X. § [P284] Le Lion abattu par l’Homme. § O n exposoit une peinture,
Où l’Artisan avoit tracé
Un Lion d’immense stature
Par un seul homme terrassé.
Les regardans en tiroient gloire.
Un Lion en passant rabattit leur caquet,
Je voy bien, dit-il, qu’en effet
On vous donne icy la victoire :
Mais l’Ouvrier vous a déçus,
Il avoit liberté de feindre.
Avec plus de raison nous aurions le dessus,
Si mes confreres sçavoient peindre.
XI. § [P15] Le Renard et les Raisins. § C ertain Renard Gascon, d’autres disent Normant,
Mourant presque de faim, vid au haut d’une treille
Des raisins murs apparemment,
Et couverts d’une peau vermeille.
Le galand en eust fait volontiers un repas.
Mais comme il n’y pouvoit atteindre,
Ils sont trop verds, dit-il, et bons pour des goujats.
Fit-il pas mieux que de se plaindre ?
XII. § [P399] Le Cigne et le Cuisinier. § D ans une ménagerie
De volatiles remplie
Vivoient le Cigne et l’Oison :
Celuy-là destiné pour les regards du Maître,
Celuy-cy pour son goust ; l’un qui se piquoit d’estre
Commensal du jardin, l’autre de la maison.
Des fossez du Chasteau faisant leurs galeries,
Tantost on les eût vûs coste à coste nager.
Tantost courir sur l’onde, et tantost se plonger,
Sans pouvoir satisfaire à leurs vaines envies.
Un jour le Cuisinier ayant trop bû d’un coup,
Prit pour Oison le Cigne ; et le tenant au cou,
Il alloit l’égorger, puis le mettre en potage.
L’oiseau prest à mourir, se plaint en son ramage.
Le Cuisinier fut fort surpris,
Et vid bien qu’il s’estoit mépris.
Quoy ? je mettrois, dit-il, un tel chanteur en soupe ?
Non, non, ne plaise aux Dieux que jamais ma main coupe
La gorge à qui s’en sert si bien.
Ainsi dans les dangers qui nous suivent en croupe,
Le doux parler ne nuit de rien.
XIII. § [P153] Les Loups et les Brebis. § A prés mille ans et plus de guerre declarée,
Les Loups firent la paix avecque les Brebis.
C’estoit apparemment le bien des deux partis :
Car si les Loups mangeoient mainte beste égarée,
Les Bergers de leur peau se faisoient maints habits.
Jamais de liberté, ni pour les pasturages,
Ni d’autre part pour les carnages.
Ils ne pouvoient jouïr qu’en tremblant de leurs biens.
La paix se conclud donc ; on donne des ostages ;
Les Loups leurs Louveteaux, et les Brebis leurs Chiens.
L’échange en estant fait aux formes ordinaires,
Et reglé par des Commissaires,
Au bout de quelque temps que Messieurs les Louvats
Se virent Loups parfaits et friands de tuerie ;
Ils vous prennent le temps que dans la Bergerie
Messieurs les Bergers n’estoient pas ;
Estranglent la moitié des Agneaux les plus gras ;
Les emportent aux dens, dans les bois se retirent.
Ils avoient averti leurs gens secretement.
Les Chiens, qui, sur leur foy, reposoient seurement,
Furent étranglez en dormant.
Cela fut si tost fait, qu’à peine ils le sentirent.
Tout fut mis en morceaux ; un seul n’en échapa.
Nous pouvons conclure de là
Qu’il faut faire aux méchans guerre continuelle.
La paix est fort bonne de soy,
J’en conviens ; mais de quoy sert-elle
Avec des ennemis sans foy ?
XIV. § [P481] Le Lion devenu vieux. § L e Lion, terreur des forests,
Chargé d’ans, et pleurant son antique proüesse,
Fut enfin attaqué par ses propres sujets,
Devenus forts par sa foiblesse.
Le Cheval s’approchant luy donne un coup de pied,
Le Loup un coup de dent, le Bœuf un coup de corne.
Le malheureux Lion languissant, triste et morne ;
Peut à peine rugir, par l’âge estropié.
Il attend son destin sans faire aucunes plaintes ;
Quand voyant l’Asne mesme à son antre accourir,
Ah c’est trop, luy dit-il, je voulois bien mourir ;
Mais c’est mourir deux fois que souffrir tes atteintes.
XV. § [P277] Philomele et Progné. § A utrefois Progné l’hirondelle
De sa demeure s’écarta ;
Et loin des Villes s’emporta
Dans un Bois où chantoit la pauvre Philomele.
Ma sœur, luy dit Progné, comment vous portez-vous ?
Voicy tantost mille ans que l’on ne vous a vuë :
Je ne me souviens point que vous soyez venuë
Depuis le temps de Thrace habiter parmi nous.
Dites-moy, que pensez-vous faire ?
Ne quitterez-vous point ce sejour solitaire ?
Ah ! reprit Philomele, en est-il de plus doux ?
Progné luy repartit : Et quoy, cette musique
Pour ne chanter qu’aux animaux,
Tout au plus à quelque rustique ?
Le desert est-il fait pour des talens si beaux ?
Venez faire aux citez éclater leurs merveilles.
Aussi-bien en voyant les bois,
Sans cesse il vous souvient que Terée autrefois
Parmi des demeures pareilles,
Exerça sa fureur sur vos divins appas.
Et c’est le souvenir d’un si cruel outrage
Qui fait, reprit sa sœur, que je ne vous suis pas.
En voyant les hommes, helas !
Il m’en souvient bien davantage.
XVI. § [P682] La Femme noyée. § J e ne suis pas de ceux qui disent,
Ce n’est rien ;
C’est une femme qui se noye.
Je dis que c’est beaucoup ; et ce sexe vaut bien
Que nous le regrettions, puisqu’il fait nôtre joye.
Ce que j’avance icy n’est point hors de propos ;
Puisqu’il s’agit dans cette Fable
D’une femme qui dans les flots
Avoit fini ses jours par un sort déplorable,
Son Epoux en cherchoit le corps,
Pour luy rendre en cette avanture
Les honneurs de la sepulture.
Il arriva que sur les bords
Du fleuve auteur de sa disgrace
Des gens se promenoient, ignorans l’accident.
Ce mary donc leur demandant
S’ils n’avoient de sa femme apperçu nulle trace ;
Nulle, reprit l’un d’eux ; mais cherchez-la plus bas ;
Suivez le fil de la riviere.
Un autre repartit : Non, ne le suivez pas ;
Rebroussez plutost en arriere.
Quelle que soit la pente et l’inclination
Dont l’eau par sa course l’emporte,
L’esprit de contradiction
L’aura fait floter d’autre sorte.
Cet homme se railloit assez hors de saison.
Quant à l’humeur contredisante,
Je ne sçay s’il avoit raison.
Mais que cette humeur soit, ou non,
Le défaut du sexe et sa pente,
Quiconque avec elle naistra,
Sans faute avec elle mourra,
Et jusqu’au bout contredira,
Et, s’il peut, encor par-delà.
XVII. § [P24] La Belette entrée dans un Grenier. § D amoiselle Belette au corps long et floüet,
Entra dans un Grenier par un trou fort étroit.
Elle sortoit de maladie.
Là vivant à discretion,
La galande fit chere lie,
Mangea, rongea ; Dieu sçait la vie,
Et le lard qui perit en cette occasion.
La voilà pour conclusion
Grasse, mafluë, et rebondie.
Au bout de la semaine ayant disné son sou,
Elle entend quelque bruit, veut sortir par le trou,
Ne peut plus repasser, et croit s’estre méprise.
Aprés avoir fait quelques tours,
C’est, dit-elle, l’endroit, me voilà bien surprise ;
J’ay passé par icy depuis cinq ou six jours.
Un Rat qui la voyoit en peine,
Luy dit : Vous aviez lors la panse un peu moins pleine.
Vous estes maigre entrée, il faut maigre sortir.
Ce que je vous dis là, l’on le dit à bien d’autres.
Mais ne confondons point, par trop approfondir,
Leurs affaires avec les vostres.
XVIII. § [P79/511] Le Chat et un vieux Rat. § J ’ay lû chez un conteur de Fables,
Qu’un second Rodilard, l’Alexandre des Chats,
L’Attila, le fleau des Rats,
Rendoit ces derniers miserables.
J’ay lû, dis-je, en certain Auteur,
Que ce Chat exterminateur,
Vray Cerbere, estoit craint une lieuë à la ronde ;
Il vouloit de Souris dépeupler tout le monde.
Les planches qu’on suspend sur un leger appuy,
La mort aux Rats, les Souricieres,
N’estoient que jeux au prix de luy.
Comme il void que dans leurs tanieres
Les souris estoient prisonnieres ;
Qu’elles n’osoient sortir ; qu’il avoit beau chercher ;
Le galand fait le mort ; et du haut d’un plancher
Se pend la teste en bas. La beste scelerate
A de certains cordons se tenoit par la pate.
Le peuple des Souris croit que c’est châtiment ;
Qu’il a fait un larcin de rost ou de fromage,
Egratigné quelqu’un, causé quelque dommage :
Enfin qu’on a pendu le mauvais garnement.
Toutes, dis-je, unanimement
Se promettent de rire à son enterrement ;
Mettent le nez à l’air, montrent un peu la teste ;
Puis rentrent dans leurs nids à rats ;
Puis ressortant font quatre pas ;
Puis enfin se mettent en queste.
Mais voicy bien une autre feste.
Le pendu ressuscite ; et sur ses pieds tombant
Attrape les plus paresseuses.
Nous en sçavons plus d’un, dit-il en les gobant :
C’est tour de vieille guerre ; et vos cavernes creuses
Ne vous sauveront pas ; je vous en avertis ;
Vous viendrez toutes au logis.
Il prophetisoit vray ; nostre maistre Mitis
Pour la seconde fois les trompe et les affine ;
Blanchit sa robe, et s’enfarine ;
Et de la sorte déguisé
Se niche et se blotit dans une huche ouverte :
Ce fut à luy bien avisé :
La gent trote-menu s’en vient chercher sa perte.
Un Rat sans plus s’abstient d’aller flairer autour.
C’estoit un vieux routier ; il sçavoit plus d’un tour ;
Mesme il avoit perdu sa queuë à la bataille.
Ce bloc enfariné ne me dit rien qui vaille,
S’écria-t-il de loin au General des Chats.
Je soupçonne dessous encor quelque machine.
Rien ne te sert d’estre farine ;
Car quand tu serois sac je n’approcherois pas.
C’estoit bien dit à luy ; j’approuve sa prudence.
Il estoit experimenté ;
Et sçavoit que la méfiance
Est mere de la seureté.
Livre quatriéme. §
FABLE I. § [P140] Le Lion amoureux. A Mademoiselle de Sevigné. § S evigné, de qui les attraits
Servent aux graces de modele,
Et qui naquistes toute belle,
A vostre indifference prés,
Pourriez-vous estre favorable
Aux jeux innocens d’une Fable ?
Et voir sans vous épouventer,
Un Lion qu’amour sceut dompter ?
Amour est un étrange maistre.
Heureux qui peut ne le connoistre
Que par recit, luy ny ses coups !
Quand on en parle devant vous,
Si la verité vous offense,
La Fable au moins se peut souffrir.
Celle-cy prend bien l’asseurance
De venir à vos pieds s’offrir,
Par zele et par reconnoissance.
Du temps que les bestes parloient
Les Lions entr’autres vouloient
Estre admis dans nostre alliance.
Pourquoy non ? Puisque leur engeance
Valoit la nostre en ce temps-là,
Ayant courage, intelligence,
Et belle hure outre cela.
Voicy comment il en alla.
Un Lion de haut parentage
En passant par un certain pré,
Rencontra Bergere à son gré.
Il la demande en mariage.
Le pere auroit fort souhaité
Quelque gendre un peu moins terrible.
La donner luy sembloit bien dur ;
La refuser n’estoit pas seur.
Mesme un refus eust fait possible,
Qu’on eust vû quelque beau matin
Un mariage clandestin.
Car outre qu’en toute maniere
La belle estoit pour les gens fiers ;
Fille se coëffe volontiers
D’amoureux à longue criniere.
Le Pere donc ouvertement
N’osant renvoyer nostre amant,
Luy dit : Ma fille est délicate ;
Vos griffes la pourront blesser
Quand vous voudrez la caresser.
Permettez donc qu’à chaque pate
On vous les rogne ; et pour les dents,
Qu’on vous les lime en mesme temps.
Vos baisers en seront moins rudes
Et pour vous plus délicieux ;
Car ma fille y répondra mieux
Estant sans ces inquietudes.
Le Lion consent à cela
Tant son ame estoit aveuglée.
Sans dents ni griffes le voilà
Comme place démantelée.
On lascha sur luy quelques chiens,
Il fit fort peu de resistance.
Amour, amour, quand tu nous tiens,
On peut bien dire, Adieu prudence.
[Par tes conseils ensorcelans
Ce Lion crût son adversaire.
Helas comment pourrois-tu faire
Que les Bestes devinssent Gens,
Si tu nuis aux plus sages testes,
Et fais les Gens devenir Bestes !]
I II. § [P207] Le Berger et la Mer. § D u rapport d’un troupeau dont il vivoit sans soins
Se contenta long-temps un voisin d’Amphitrite.
Si sa fortune estoit petite,
Elle estoit seure tout au moins.
A la fin les tresors déchargez sur la plage,
Le tenterent si bien qu’il vendit son troupeau,
Trafiqua de l’argent, le mit entier sur l’eau ;
Cet argent perit par naufrage.
Son maistre fut reduit à garder les Brebis ;
Non plus Berger en chef comme il estoit jadis,
Quand ses propres Moutons paissoient sur le rivage ;
Celuy qui s’estoit veu Coridon ou Tircis,
Fut Pierrot et rien davantage.
Au bout de quelque temps il fit quelques profits ;
Racheta des bestes à laine ;
Et comme un jour les vents retenant leur haleine,
Laissoient paisiblement aborder les vaisseaux ;
Vous voulez de l’argent, ô Mesdames les Eaux,
Dit-il, adressez-vous, je vous prie, à quelqu’autre :
Ma foy vous n’aurez pas le nostre.
Cecy n’est pas un conte à plaisir inventé.
Je me sers de la verité
Pour montrer par experience,
Qu’un sou quand il est assuré,
Vaut mieux que cinq en esperance :
Qu’il se faut contenter de sa condition ;
Qu’aux conseils de la Mer et de l’Ambition
Nous devons fermer les oreilles.
Pour un qui s’en loüera, dix mille s’en plaindront.
La Mer promet monts et merveilles ;
Fiez-vous-y, les vents et les voleurs viendront.
III. § [P521] La Moûche et la Fourmy. § L a Moûche et la Fourmy contestoient de leur prix.
O Jupiter ! dit la premiere,
Faut-il que l’amour propre aveugle les esprits
D’une si terrible maniere,
Qu’un vil et rampant animal
A la fille de l’air ose se dire égal ?
Je hante les Palais ; je m’assied à la table :
Si l’on t’immole un bœuf, j’en goûte devant toy :
Pendant que celle-cy chetive et miserable,
Vit trois jours d’un festu qu’elle a traîné chez soy.
Mais ma mignonne, dites-moy,
Vous campez-vous jamais sur la teste d’un Roy,
D’un Empereur, ou d’une Belle ?
Je le fais ; et je baise un beau sein quand je veux :
Je me jouë entre des cheveux :
Je rehausse d’un teint la blancheur naturelle :
Et la derniere main que met à sa beauté
Une femme allant en conqueste,
C’est un ajustement des Moûches emprunté.
Puis allez-moy rompre la teste
De vos greniers. Avez-vous dit ?
Luy repliqua la ménagere.
Vous hantez les Palais : mais on vous y maudit.
Et quant à goûter la premiere
De ce qu’on sert devant les Dieux,
Croyez-vous qu’il en vaille mieux ?
Si vous entrez par tout : aussi font les profanes.
Sur la teste des Rois et sur celle des Asnes
Vous allez vous planter ; je n’en disconviens pas ;
Et je sçay que d’un prompt trépas
Cette importunité bien souvent est punie.
Certain ajustement, dites-vous, rend jolie.
J’en conviens : il est noir ainsi que vous et moy.
Je veux qu’il ait nom Mouche ; est-ce un sujet pourquoy
Vous fassiez sonner vos merites ?
Nomme-t-on pas aussi Moûches les parasites ?
Cessez donc de tenir un langage si vain :
N’ayez plus ces hautes pensées :
Les Moûches de Cour sont chassées :
Les Moûcharts sont pendus : et vous mourrez de faim,
De froid, de langueur, de misere,
Quand Phœbus regnera sur un autre hemisphere.
Alors je joüiray du fruit de mes travaux.
Je n’iray par monts ny par vaux
M’exposer au vent, à la pluye.
Je vivray sans mélancolie.
Le soin que j’auray pris, de soin m’exemptera.
Je vous enseigneray par là
Ce que c’est qu’une fausse ou veritable gloire.
Adieu : je perds le temps : laissez-moy travailler.
Ny mon grenier ny mon armoire
Ne se remplit à babiller.
IV. § [PØ] Le Jardinier et son Seigneur. § U n amateur du jardinage,
Demy Bourgeois, demy manant,
Possedoit en certain Village
Un jardin assez propre, et le clos à tenant.
Il avoit de plan vif semé cette étenduë,
Là croissoit à plaisir l’oseille et la laituë ;
Dequoy faire à Margot, pour sa feste, un bouquet ;
Peu de jasmin d’Espagne, et force serpolet.
Cette felicité par un Lievre troublée,
Fit qu’au Seigneur du Bourg nostre homme se plaignit.
Ce maudit animal vient prendre sa goulée
Soir et matin, dit-il, et des pieges se rit :
Les pierres, les bastons y perdent leur crédit.
Il est Sorcier, je croy. Sorcier ? je l’en défie,
Repartit le Seigneur. Fust-il diable, Miraut,
En dépit de ses tours, l’attrapera bien-tost.
Je vous en déferay, bon homme, sur ma vie :
Et quand ? et dés demain, sans tarder plus long-temps.
La partie ainsi faite, il vient avec ses gens :
Çà déjeunons, dit-il, vos poulets sont-ils tendres ?
La fille du logis, qu’on vous voye, approchez.
Quand la marierons-nous ? Quand aurons-nous des gendres ?
Bon homme, c’est ce coup qu’il faut, vous m’entendez,
Qu’il faut foüiller à l’escarcelle.
Disant ces mots, il fait connoissance avec elle ;
Auprés de luy la fait asseoir ;
Prend une main, un bras, leve un coin du mouchoir ;
Toutes sotises dont la Belle
Se défend avec grand respect ;
Tant qu’au pere à la fin cela devient suspect.
Cependant on fricasse, on se ruë en cuisine.
De quand sont vos jambons ? Ils ont fort bonne mine.
Monsieur, ils sont à vous. Vraiment, dit le Seigneur,
Je les reçois, et de bon cœur.
Il déjeûne trés-bien, aussi fait sa famille,
Chiens, chevaux et valets, tous gens bien endentez :
Il commande chez l’hoste, y prend des libertez,
Boit son vin, caresse sa fille.
L’embarras des Chasseurs succede au déjeuné.
Chacun s’anime et se prépare :
Les trompes et les cors font un tel tintamarre,
Que le bon homme est étonné.
Le pis fut que l’on mit en piteux équipage
Le pauvre potager ; adieu planches, quarreaux ;
Adieu chicorée et poreaux ;
Adieu dequoy mettre au potage.
Le Lievre estoit gisté dessous un maistre chou.
On le queste, on le lance, il s’enfuit par un trou,
Non pas trou, mais troüée, horrible et large playe
Que l’on fit à la pauvre haye
Par ordre du Seigneur ; car il eust esté mal
Qu’on n’eust pû du jardin sortir tout à cheval.
Le bon homme disoit : Ce sont là jeux de Prince :
Mais on le laissoit dire ; et les chiens et les gens
Firent plus de degât en une heure de temps,
Que n’en auroient fait en cent ans
Tous les Lievres de la Province.
Petits Princes, vuidez vos debats entre vous :
De recourir aux Rois vous seriez de grands fous.
Il ne les faut jamais engager dans vos guerres,
Ni les faire entrer sur vos terres.
V. § [P91] L’Asne et le petit Chien. § N e forçons point nostre talent ;
Nous ne ferions rien avec grace.
Jamais un lourdaut, quoy qu’il fasse,
Ne sçauroit passer pour galant.
Peu de gens que le Ciel cherit et gratifie,
Ont le don d’agréer infus avec la vie.
C’est un point qu’il leur faut laisser ;
Et ne pas ressembler à l’Asne de la Fable,
Qui, pour se rendre plus aimable
Et plus cher à son Maistre, alla le caresser.
Comment, disoit-il en son ame,
Ce Chien, parce qu’il est mignon,
Vivra de pair à compagnon
Avec Monsieur, avec Madame,
Et j’auray des coups de baston ?
Que fait-il ? Il donne la pate,
Puis aussi-tost il est baisé.
S’il en faut faire autant afin que l’on me flate,
Cela n’est pas bien mal-aisé.
Dans cette admirable pensée,
Voyant son Maistre en joye, il s’en vient lourdement,
Leve une corne toute usée ;
La luy porte au menton fort amoureusement.
Non sans accompagner pour plus grand ornement
De son chant gracieux cette action hardie.
Oh oh ! quelle caresse, et quelle mélodie !
Dit le Maistre aussi-tost. Holà, Martin bâton.
Martin bâton accourt ; l’Asne change de ton.
Ainsi finit la Comedie.
VI. § [P165] Le combat des Rats et des Belettes. § L a nation des Belettes,
Non plus que celle des Chats,
Ne veut aucun bien aux Rats ;
Et sans les portes étretes
De leurs habitations,
L’animal à longue eschine
En feroit je m’imagine,
De grandes destructions.
Or une certaine année
Qu’il en estoit à foison,
Leur Roy nommé Ratapon,
Mit en campagne une armée.
Les Belettes de leur part
Déployerent l’étendard.
Si l’on croit la Renommée,
La Victoire balança.
Plus d’un Gueret s’engraissa
Du sang de plus d’une bande.
Mais la perte la plus grande
Tomba presque en tous endroits
Sur le peuple Souriquois.
Sa déroute fut entière :
Quoy que pust faire Artarpax,
Psicarpax, Meridarpax,
Qui tout couverts de poussiere,
Soûtinrent assez long-temps
Les efforts des combattans.
Leur resistance fut vaine :
Il falut ceder au sort :
Chacun s’enfuit au plus fort,
Tant Soldat que Capitaine.
Les Princes perirent tous.
La racaille dans des trous
Trouvant sa retraite preste,
Se sauva sans grand travail.
Mais les Seigneurs sur leur teste
Ayant chacun un plumail,
Des cornes ou des aigrettes ;
Soit comme marques d’honneur :
Soit afin que les Belettes
En conçussent plus de peur :
Cela causa leur malheur.
Trou, ny fente, ny crevasse
Ne fut large assez pour eux :
Au lieu que la populace
Entroit dans les moindres creux.
La principale jonchée
Fut donc des principaux Rats.
Une teste empanachée
N’est pas petit embarras.
Le trop superbe équipage
Peut souvent en un passage
Causer du retardement.
Les petits en toute affaire
Esquivent fort aisément :
Les grands ne le peuvent faire.
VII. § [P73] Le Singe et le Daufin. § C ’estoit chez les Grecs un usage,
Que sur la mer tous voyageurs
Menoient avec eux en voyage
Singes et Chiens de Bâteleurs.
Un Navire en cet équipage
Non loin d’Athenes fit naufrage.
Sans les Dauphins tout eust pery.
Cet animal est fort amy
De nostre espece ; En son Histoire
Pline le dit, il le faut croire.
Il sauva donc tout ce qu’il pût.
Mesme un Singe en cette occurrence,
Profitant de la ressemblance,
Luy pensa devoir son salut.
Un Daufin le prit pour un homme,
Et sur son dos le fit asseoir,
Si gravement qu’on eust crû voir
Ce chanteur que tant on renomme.
Le Daufin l’alloit mettre à bord ;
Quand par hazard il luy demande :
Estes-vous d’Athenes la grande ?
Oüy, dit l’autre, on m’y connoist fort,
S’il vous y survient quelque affaire
Employez-moy ; car mes parens
Y tiennent tous les premiers rangs ;
Un mien cousin est Juge-Maire.
Le Daufin dit bien-grammercy.
Et le Pirée a part aussi
A l’honneur de vostre presence ?
Vous le voyez souvent ? Je pense.
Tous les jours ; il est mon amy,
C’est une vieille connoissance.
Nostre Magot prit pour ce coup
Le nom d’un port pour un nom d’homme.
De telles gens il est beaucoup,
Qui prendroient Vaugirard pour Rome ;
Et qui, caquetans au plus drû,
Parlent de tout et n’ont rien vû.
Le Daufin rit, tourne la teste,
Et le Magot consideré
Il s’apperçoit qu’il n’a tiré
Du fond des eaux rien qu’une beste.
Il l’y replonge, et va trouver
Quelque homme afin de le sauver.
VIII. § [P285] L’Homme et l’Idole de bois. § C ertain Payen chez luy gardoit un Dieu de bois ;
De ces Dieux qui sont sourds, bien qu’ayans des oreilles.
Le Payen cependant s’en promettoit merveilles.
Il luy coustoit autant que trois.
Ce n’estoient que vœux et qu’offrandes,
Sacrifices de bœufs couronnez de guirlandes.
Jamais Idole, quel qu’il fust,
N’avoit eu cuisine si grasse ;
Sans que pour tout ce culte à son hoste il écheût
Succession, tresor, gain au jeu, nulle grace.
Bien plus, si pour un sou d’orage en quelque endroit
S’amassoit d’une ou d’autre sorte,
L’homme en avoit sa part, et sa bourse en souffroit.
La pitance du Dieu n’en estoit pas moins forte.
A la fin se fâchant de n’en obtenir rien,
Il vous prend un levier, met en pieces l’Idole,
Le trouve remply d’or. Quand je t’ay fait du bien,
M’as-tu valu, dit-il, seulement une obole ?
Va, sors de mon logis : cherche d’autres autels.
Tu ressembles aux naturels
Malheureux, grossiers, et stupides :
On n’en peut rien tirer qu’avecque le bâton.
Plus je te remplissois, plus mes mains estoient vuides :
J’ay bien fait de changer de ton.
IX. § [P101/472] Le Geay paré des plumes du Paon. § U n Paon muoit ; un Geay prit son plumage ;
Puis aprés se l’accommoda ;
Puis parmy d’autres Paons tout fier se panada,
Croyant estre un beau personnage.
Quelqu’un le reconnut ; il se vit bafoüé,
Berné, sifflé, moqué, joüé ;
Et par Messieurs les Paons plumé d’étrange sorte :
Mesme vers ses pareils s’estant refugié
Il fut par eux mis à la porte.
Il est assez de Geais à deux pieds comme luy,
Qui se parent souvent des dépoüilles d’autruy :
Et que l’on nomme plagiaires.
Je m’en tais ; et ne veux leur causer nul ennuy ;
Ce ne sont pas là mes affaires.
X. § [P195+P177] Le Chameau, et les Bastons flotans. § L e premier qui vid un Chameau
S’enfuit à cet objet nouveau ;
Le second approcha ; le troisiéme osa faire
Un licou pour le Dromadaire.
L’accoûtumance ainsi nous rend tout familier.
Ce qui nous paroissoit terrible et singulier,
S’apprivoise avec nostre veuë,
Quand ce vient à la continuë.
Et puisque nous voicy tombez sur ce sujet :
On avoit mis des gens au guet,
Qui voyant sur les eaux de loin certain objet,
Ne pûrent s’empêcher de dire,
Que c’estoit un puissant navire.
Quelques momens aprés, l’objet devint brûlot,
Et puis nacelle, et puis balot ;
Enfin bâtons flotans sur l’onde.
J’en sçais beaucoup de par le monde
A qui cecy conviendroit bien :
De loin c’est quelque chose, et de prés ce n’est rien.
XI. § [P384] La Grenoüille et le Rat. § T el, comme dit Merlin, cuide en[g]eigner autruy,
Qui souvent s’en[g]eigne soy-mesme.
J’ay regret que ce mot soit trop vieux aujourd’huy,
Il m’a toujours semblé d’une énergie extrême.
Mais afin d’en venir au dessein que j’ay pris :
Un Rat plein d’en-bon-point, gras, et des mieux nourris,
Et qui ne connoissoit l’Avent ni le Carême,
Sur le bord d’un marais égayoit ses esprits.
Une Grenoüille approche, et luy dit en sa langue :
Venez me voir chez moy, je vous feray festin.
Messire Rat promit soudain :
Il n’estoit pas besoin de plus longue harangue.
Elle allegua pourtant les delices du bain,
La curiosité, le plaisir du voyage,
Cent raretez à voir le long du marécage :
Un jour il conteroit à ses petits enfans
Les beautez de ces lieux, les mœurs des habitans,
Et le gouvernement de la chose publique
Aquatique.
Un point sans plus tenoit le galand empesché.
Il nageoit quelque peu ; mais il faloit de l’aide.
La Grenoüille à cela trouve un trés-bon remede.
Le Rat fut à son pied par la pate attaché.
Un brin de jonc en fit l’affaire.
Dans le marais entrez, nostre bonne commere
S’efforce de tirer son hoste au fond de l’eau,
Contre le droit des gens, contre la foy jurée,
Pretend qu’elle en fera gorge chaude et curée ;
(C’estoit, à son avis, un excellent morceau.)
Déja dans son esprit la galande le croque.
Il atteste les Dieux ; la perfide s’en moque.
Il resiste ; elle tire. En ce combat nouveau,
Un Milan qui dans l’air planoit, faisoit la ronde,
Voit d’enhaut le pauvret se debattant sur l’onde.
Il fond dessus, l’enleve, et par mesme moyen
La Grenoüille et le lien.
Tout en fut ; tant et si bien
Que de cette double proye
L’Oiseau se donne au cœur joye ;
Ayant de cette façon,
A souper chair et poisson.
La ruse la mieux ourdie
Peut nuire à son inventeur :
Et souvent la perfidie
Retourne sur son autheur.
XII. § [PØ ; cf. P339] Tribut envoyé par les Animaux à Alexandre. § U ne Fable avoit cours parmi l’Antiquité :
Et la raison ne m’en est pas connuë.
Que le Lecteur en tire une moralité.
Voicy la Fable toute nuë.
La Renommée ayant dit en cent lieux,
Qu’un fils de Jupiter, un certain Alexandre,
Ne voulant rien laisser de libre sous les Cieux,
Commandoit que sans plus attendre,
Tout peuple à ses pieds s’allast rendre ;
Quadrupedes, Humains, Elephans, Vermisseaux,
La Republique des Oiseaux :
La Deesse aux cent bouches, dis-je,
Ayant mis par tout la terreur
En publiant l’Edit du nouvel Empereur ;
Les Animaux, et toute espece lige
De son seul appetit, creurent que cette fois
Il falloit subir d’autres loix.
On s’assemble au desert ; Tous quittent leur taniere.
Aprés divers avis, on resout, on conclut
D’envoyer hommage et tribut.
Pour l’hommage et pour la maniere,
Le Singe en fut chargé : l’on luy mit par écrit
Ce que l’on vouloit qui fust dit.
Le seul tribut les tint en peine.
Car que donner ? Il faloit de l’argent.
On en prit d’un Prince obligeant,
Qui possedant dans son domaine
Des mines d’or fournit ce qu’on voulut.
Comme il fut question de porter ce tribut,
Le Mulet et l’Asne s’offrirent,
Assistez du Cheval ainsi que du Chameau.
Tous quatre en chemin ils se mirent
Avec le Singe Ambassadeur nouveau.
La Caravanne enfin rencontre en un passage
Monseigneur le Lion. Cela ne leur plût point.
Nous nous rencontrons tout à point,
Dit-il, et nous voicy compagnons de voyage.
J’allois offrir mon fait à part ;
Mais bien qu’il soit leger, tout fardeau m’embarasse.
Obligez-moy de me faire la grace
Que d’en porter chacun un quart.
Ce ne vous sera pas une charge trop grande ;
Et j’en seray plus libre, et bien plus en estat,
En cas que les Voleurs attaquent nostre bande,
Et que l’on en vienne au combat.
Econduire un Lion rarement se pratique.
Le voilà donc admis, soulagé, bien receu,
Et malgré le Heros de Jupiter issu,
Faisant chere et vivant sur la bourse publique.
Ils arriverent dans un pré
Tout bordé de ruisseaux, de fleurs tout diapré ;
Où maint Mouton cherchoit sa vie ;
Sejour du frais, veritable patrie
Des Zephirs. Le Lion n’y fut pas, qu’à ses gens
Il se plaignit d’estre malade.
Continuez vôtre Ambassade,
Dit-il ; je sens un feu qui me brûle au dedans,
Et veux chercher icy quelque herbe salutaire.
Pour vous ne perdez point de temps.
Rendez-moy mon argent, j’en puis avoir affaire.
On déballe ; et d’abord le Lion s’écria
D’un ton qui témoignoit sa joye :
Que de filles, ô Dieux, mes pieces de monnoye
Ont produites ! voyez ; La plûspart sont déja
Aussi grandes que leurs meres.
Le croist m’en appartient. Il prit tout là-dessus ;
Ou bien s’il ne prit tout, il n’en demeura gueres.
Le Singe et les sommiers confus,
Sans oser repliquer en chemin se remirent.
Au fils de Jupiter on dit qu’ils se plaignirent,
Et n’en eurent point de raison.
Qu’eust-il fait ? C’eust esté Lion contre Lion ;
Et le Proverbe dit : Corsaires à Corsaires,
L’un l’autre s’attaquant ne font pas leurs affaires.
XIII. § [P269] Le Cheval s’estant voulu vanger du Cerf. § D e tout temps les Chevaux ne sont nez pour les hommes.
Lors que le genre humain de glan se contentoit,
Asne, Cheval, et Mule aux forests habitoit ;
Et l’on ne voyoit point, comme au siecle où nous sommes,
Tant de selles et tant de basts,
Tant de harnois pour les combats,
Tant de chaises, tant de carosses ;
Comme aussi ne voyoit-on pas
Tant de festins et tant de nôces.
Or un Cheval eut alors different
Avec un Cerf plein de vîtesse,
Et ne pouvant l’attraper en courant,
Il eut recours à l’Homme, implora son adresse.
L’Homme luy mit un frein, luy sauta sur le dos,
Ne luy donna point de repos
Que le Cerf ne fust pris, et n’y laissast la vie.
Et cela fait, le Cheval remercie
L’Homme son bienfaiteur, disant : Je suis à vous,
Adieu. Je m’en retourne en mon sejour sauvage.
Non pas cela, dit l’Homme, il fait meilleur chez nous :
Je vois trop quel est votre usage.
Demeurez donc, vous serez bien traité,
Et jusqu’au ventre en la litiere.
Helas ! que sert la bonne chere
Quand on n’a pas la liberté ?
Le Cheval s’apperçut qu’il avoit fait folie ;
Mais il n’estoit plus temps ; déja son écurie
Estoit prête et toute bâtie.
Il y mourut en traînant son lien ;
Sage s’il eût remis une legere offense.
Quel que soit le plaisir que cause la vengeance,
C’est l’acheter trop cher, que l’acheter d’un bien,
Sans qui les autres ne sont rien.
XIV. § [P27] Le Renard et le Buste. § L es Grands, pour la pluspart, sont masques de theatre.
Leur apparence impose au vulgaire idolâtre.
L’Asne n’en sçait juger que par ce qu’il en void.
Le Renard au contraire à fonds les examine,
Les tourne de tout sens ; et quand il s’apperçoit
Que leur fait n’est que bonne mine,
Il leur applique un mot qu’un Buste de Heros
Luy fit dire fort à propos.
C’estoit un Buste creux, et plus grand que nature.
Le Renard en loüant l’effort de la Sculpture,
Belle teste, dit-il, mais de cervelle point.
Combien de grands Seigneurs sont Bustes en ce point ?
XV. § [P572] Le Loup, la Chevre, et le Chevreau. § XVI. § [P158] Le Loup, la Mere et l’Enfant. § L a Bique allant remplir sa traînante mammelle,
Et paistre l’herbe nouvelle,
Ferma sa porte au loquet ;
Non sans dire à son Biquet ;
Gardez-vous sur votre vie
D’ouvrir, que l’on ne vous die
Pour enseigne et mot du guet,
Foin du Loup et de sa race.
Comme elle disoit ces mots,
Le Loup de fortune passe.
Il les recueille à propos,
Et les garde en sa memoire.
La Bique, comme on peut croire,
N’avoit pas vû le glouton.
Dés qu’il la voit partie, il contrefait son ton ;
Et d’une voix papelarde
Il demande qu’on ouvre, en disant Foin du Loup,
Et croyant entrer tout d’un coup.
Le Biquet soupçonneux par la fente regarde.
Montrez-moy pate blanche, ou je n’ouvriray point,
S’écria-t-il d’abord (pate blanche est un point
Chez les Loups comme on sçait rarement en usage.)
Celuy-cy fort surpris d’entendre ce langage,
Comme il estoit venu s’en retourna chez soy.
Où seroit le Biquet s’il eust ajoûté foy
Au mot du guet, que de fortune
Nostre Loup avoit entendu ?
Deux seuretez valent mieux qu’une :
Et le trop en cela ne fut jamais perdu.
C e Loup me remet en memoire
Un de ses compagnons qui fut encor mieux pris.
Il y perit ; voicy l’histoire.
Un Villageois avoit à l’écart son logis.
Messer Loup attendoit chape-chute à la porte.
Il avoit vû sortir gibier de toute sorte ;
Veaux de lait, Agneaux et Brebis,
Regimens de Dindons, enfin bonne Provende.
Le larron commençoit pourtant à s’ennuyer.
Il entend un enfant crier.
La mere aussi-tost le gourmande,
Le menace, s’il ne se taist,
De le donner au Loup. L’Animal se tient prest ;
Remerciant les Dieux d’une telle avanture.
Quand la mere appaisant sa chere geniture,
Luy dit : Ne criez point ; s’il vient, nous le tuërons.
Qu’est cecy ? s’écria le mangeur de Moutons.
Dire d’un, puis d’un autre ? Est-ce ainsi que l’on traite
Les gens faits comme moy ? Me prend-on pour un sot ?
Que quelque jour ce beau marmot
Vienne au bois cueillir la noisette.
Comme il disoit ces mots, on sort de la maison.
Un chien de cour l’arreste. Epieux et fourches fieres
L’ajustent de toutes manieres.
Que veniez-vous chercher en ce lieu, luy dit-on ?
Aussi-tost il conta l’affaire.
Mercy de moy, luy dit la Mere,
Tu mangeras mon fils ? L’ay-je fait à dessein
Qu’il assouvisse un jour ta faim ?
On assomma la pauvre beste.
Un manant luy coupa le pied droit et la teste.
Le Seigneur du Village à sa porte les mit ;
Et ce dicton Picard à l’entour fut écrit :
Biaux chires leups n’écoutez mie
Mere tenchent chen fieux qui crie.
XVII. § [P500] Parole de Socrate. § S ocrate un jour faisant bâtir,
Chacun censuroit son ouvrage.
L’un trouvoit les dedans, pour ne luy point mentir,
Indignes d’un tel personnage.
L’autre blâmoit la face ; et tous estoient d’avis
Que les appartemens en estoient trop petits.
Quelle maison pour luy ! L’on y tournoit à peine.
Pleust au Ciel que de vrais amis
Telle qu’elle est, dit-il, elle pût estre pleine !
Le bon Socrate avoit raison
De trouver pour ceux-là trop grande sa maison.
Chacun se dit ami ; mais fol qui s’y repose ;
Rien n’est plus commun que ce nom,
Rien n’est plus rare que la chose.
XVIII. § [P53] Le Vieillard et ses enfans. § T oute puissance est foible, à moins que d’estre unie.
Ecoutez là-dessus l’Esclave de Phrygie.
Si j’ajoûte du mien à son invention,
C’est pour peindre nos mœurs, et non point par envie ;
Je suis trop au dessous de cette ambition.
Phedre encherit souvent par un motif de gloire ;
Pour moy de tels pensers me seroient malseans.
Mais venons à la Fable, ou plutost à l’Histoire
De celuy qui tâcha d’unir tous ses enfans.
Un Vieillard prest d’aller où la mort l’appelloit,
Mes chers enfans, dit-il, (à ses fils il parloit)
Voyez si vous romprez ces dards liez ensemble ;
Je vous expliqueray le nœud qui les assemble.
L’aisné les ayant pris, et fait tous ses efforts,
Les rendit en disant : Je le donne aux plus forts.
Un second luy succede, et se met en posture ;
Mais en vain. Un cadet tente aussi l’aventure.
Tous perdirent leur temps, le faisceau resista ;
De ces dards joints ensemble un seul ne s’éclata.
Foibles gens ! dit le pere, il faut que je vous montre
Ce que ma force peut en semblable rencontre.
On crut qu’il se moquoit ; on soûrit, mais à tort.
Il separe les dards, et les rompt sans effort.
Vous voyez, reprit-il, l’effet de la concorde.
Soyez joints, mes enfans, que l’amour vous accorde.
Tant que dura son mal il n’eut autre discours.
Enfin se sentant prest de terminer ses jours,
Mes chers enfans, dit-il, je vais où sont nos peres ;
Adieu, promettez-moy de vivre comme freres ;
Que j’obtienne de vous cette grace en mourant.
Chacun de ses trois fils l’en asseure en pleurant.
Il prend à tous les mains ; il meurt ; et les trois freres
Trouvent un bien fort grand, mais fort meslé d’affaires.
Un creancier saisit, un voisin fait procés.
D’abord nostre Trio s’en tire avec succés.
Leur amitié fut courte autant qu’elle estoit rare.
Le sang les avoit joints, l’interest les separe.
L’ambition, l’envie, avec les consultans,
Dans la succession entrent en mesme temps.
On en vient au partage, on conteste, on chicane.
Le Juge sur cent points tour à tour les condamne.
Creanciers et voisins reviennent aussi-tost ;
Ceux-là sur une erreur, ceux-cy sur un défaut.
Les freres desunis sont tous d’avis contraire :
L’un veut s’accommoder, l’autre n’en veut rien faire.
Tous perdirent leur bien ; et voulurent trop tard
Profiter de ces dards unis et pris à part.
XIX. § [P36] L’Oracle et l’Impie. § V ouloir tromper le Ciel, c’est folie à la Terre.
Le Dedale des cœurs en ses détours n’enserre
Rien qui ne soit d’abord éclairé par les Dieux.
Tout ce que l’homme fait, il le fait à leurs yeux ;
Même les actions que dans l’ombre il croit faire.
Un Payen qui sentoit quelque peu le fagot,
Et qui croyoit en Dieu pour user de ce mot,
Par benefice d’inventaire,
Alla consulter Apollon.
Dés qu’il fut en son sanctuaire,
Ce que je tiens, dit-il, est-il en vie ou non ?
Il tenoit un moineau, dit-on,
Prest d’étouffer la pauvre beste,
Ou de la lâcher aussi-tost,
Pour mettre Apollon en défaut.
Apollon reconnut ce qu’il avoit en teste.
Mort ou vif, luy dit-il, montre-nous ton moineau,
Et ne me tends plus de panneau ;
Tu te trouverois mal d’un pareil stratagême.
Je vois de loin, j’atteins de même.
XX. § [P225] L’Avare qui a perdu son tresor. § L ’Usage seulement fait la possession.
Je demande à ces gens, de qui la passion
Est d’entasser toûjours, mettre somme sur somme,
Quel avantage ils ont que n’ait pas un autre homme ?
Diogene là-bas est aussi riche qu’eux ;
Et l’Avare icy haut, comme luy vit en gueux.
L’homme au tresor caché qu’Esope nous propose,
Servira d’exemple à la chose.
Ce malheureux attendoit
Pour joüir de son bien une seconde vie ;
Ne possedoit pas l’or, mais l’or le possedoit.
Il avoit dans la terre une somme enfoüie ;
Son cœur avec ; n’ayant autre déduit
Que d’y ruminer jour et nuit,
Et rendre sa chevance à luy-mesme sacrée.
Qu’il allast ou qu’il vinst, qu’il bust ou qu’il mangeast,
On l’eust pris de bien court à moins qu’il ne songeast
A l’endroit où gisoit cette somme enterrée.
Il y fit tant de tours qu’un Fossoyeur le vid ;
Se douta du dépost, l’enleva sans rien dire.
Nostre Avare un beau jour ne trouva que le nid.
Voilà mon homme aux pleurs ; il gémit, il soûpire,
Il se tourmente, il se déchire.
Un passant luy demande à quel sujet ses cris.
C’est mon tresor que l’on m’a pris.
Vostre tresor ? Où pris ? Tout joignant cette pierre.
Eh sommes-nous en temps de guerre
Pour l’apporter si loin ? N’eussiez-vous pas mieux fait
De le laisser chez vous en votre cabinet,
Que de le changer de demeure ?
Vous auriez pû sans peine y puiser à toute heure.
A toute heure ? Bons Dieux ! Ne tient-il qu’à cela ?
L’argent vient-il comme il s’en va ?
Je n’y touchois jamais. Dites-moy donc de grace,
Reprit l’autre, pourquoy vous vous affligez tant,
Puisque vous ne touchiez jamais à cet argent :
Mettez une pierre à la place,
Elle vous vaudra tout autant.
XXI. § [P492] L’œil du Maistre. § U n Cerf s’estant sauvé dans une estable à bœufs,
Fut d’abord averty par eux,
Qu’il cherchât un meilleur azile.
Mes freres, leur dit-il, ne me decelez pas :
Je vous enseigneray les pâtis les plus gras ;
Ce service vous peut quelque jour estre utile ;
Et vous n’en aurez point regret.
Les Bœufs à toutes fins promirent le secret.
Il se cache en un coin, respire, et prend courage.
Sur le soir on apporte herbe fraische et fourage,
Comme l’on faisoit tous les jours.
L’on va, l’on vient, les valets font cent tours ;
L’Intendant mesme, et pas un d’aventure
N’apperçut ny corps ny ramure,
Ny Cerf enfin. L’habitant des forests
Rend déja grace aux Bœufs, attend dans cette étable
Que chacun retournant au travail de Cerés,
Il trouve pour sortir un moment favorable.
L’un des Bœufs ruminant luy dit : Cela va bien :
Mais quoy l’homme aux cent yeux n’a pas fait sa reveuë.
Je crains fort pour toy sa venuë.
Jusques-là pauvre Cerf, ne te vante de rien.
Là-dessus le Maistre entre et vient faire sa ronde.
Qu’est-ce-cy ? dit-il à son monde.
Je trouve bien peu d’herbe en tous ces rateliers.
Cette litiere est vieille ; allez vîte aux greniers.
Je veux voir desormais vos bestes mieux soignées.
Que couste-t-il d’oster toutes ces araignées ?
Ne sçauroit-on ranger ces jougs et ces colliers ?
En regardant à tout, il voit une autre tête
Que celles qu’il voyoit d’ordinaire en ce lieu.
Le Cerf est reconnu ; chacun prend un épieu ;
Chacun donne un coup à la beste.
Ses larmes ne sçauroient la sauver du trépas.
On l’emporte, on la sale, on en fait maint repas,
Dont maint voisin s’éjoüit d’estre.
Phedre, sur ce sujet, dit fort élegamment,
Il n’est pour voir que l’œil du Maître.
Quant à moy, j’y mettrois encor l’œil de l’Amant.
XXII. § [P325] L’Aloüette et ses petits, avec le Maistre d’un champ. § N e t’attens qu’à toy seul, c’est un commun Proverbe.
Voicy comme Esope le mit
En credit.
Les Aloüettes font leur nid
Dans les bleds quand ils sont en herbe :
C’est-à-dire environ le temps
Que tout aime, et que tout pullule dans le monde ;
Monstres marins au fond de l’onde,
Tigres dans les Forests, Aloüettes aux champs.
Une pourtant de ces dernieres
Avoit laissé passer la moitié d’un Printemps
Sans gouster le plaisir des amours printanieres.
A toute force enfin elle se resolut
D’imiter la Nature, et d’estre mere encore.
Elle bâtit un nid, pond, couve, et fait éclore
A la haste ; le tout alla du mieux qu’il put.
Les bleds d’alentour mûrs, avant que la nitée
Se trouvast assez forte encor
Pour voler et prendre l’essor,
De mille soins divers l’Aloüette agitée
S’en va chercher pâture, avertit ses enfans
D’estre toujours au guet et faire sentinelle.
Si le possesseur de ces champs
Vient avecque son fils (comme il viendra) dit-elle,
Ecoutez bien ; selon ce qu’il dira,
Chacun de nous décampera.
Si-tost que l’Aloüette eut quitté sa famille,
Le possesseur du champ vient avecque son fils.
Ces bleds sont mûrs, dit-il, allez chez nos amis
Les prier que chacun apportant sa faucille,
Nous vienne aider demain dés la pointe du jour.
Nostre Aloüette de retour
Trouve en alarme sa couvée.
L’un commence. Il a dit que l’Aurore levée,
L’on fist venir demain ses amis pour l’aider.
S’il n’a dit que cela, repartit l’Aloüette,
Rien ne nous presse encor de changer de retraite :
Mais c’est demain qu’il faut tout de bon écouter.
Cependant soyez gais, voilà dequoy manger.
Eux repus, tout s’endort ; les petits et la mere.
L’aube du jour arrive ; et d’amis point du tout.
L’Aloüette à l’essor, le Maistre s’en vient faire
Sa ronde ainsi qu’à l’ordinaire.
Ces bleds ne devroient pas, dit-il, estre debout.
Nos amis ont grand tort, et tort qui se repose
Sur de tels paresseux à servir ainsi lents.
Mon fils, allez chez nos parens
Les prier de la mesme chose.
L’épouvante est au nid plus forte que jamais.
Il a dit ses parens, mere, c’est à cette heure…
Non, mes enfans, dormez en paix ;
Ne bougeons de nôtre demeure.
L’Aloüette eut raison, car personne ne vint.
Pour la troisiéme fois le Maistre se souvint
De visiter ses bleds. Nostre erreur est extrême,
Dit-il, de nous attendre à d’autres gens que nous.
Il n’est meilleur ami ni parent que soy-même.
Retenez bien cela, mon fils, et sçavez-vous
Ce qu’il faut faire ? Il faut qu’avec nostre famille
Nous prenions dés demain chacun une faucille ;
C’est là nostre plus court ; et nous acheverons
Nostre moisson quand nous pourrons.
Dés-lors que ce dessein fut sceu de l’Aloüette,
C’est ce coup qu’il est bon de partir, mes enfans.
Et les petits en mesme temps,
Voletans, se culebutans,
Délogerent tous sans trompette.
Livre cinquiéme. §
FABLE I. § [P173] Le Buscheron et Mercure. A.M.L.C.D.B. § V ostre goust a servi de regle à mon Ouvrage.
J’ay tenté les moyens d’acquerir son suffrage.
Vous voulez qu’on évite un soin trop curieux,
Et des vains ornemens l’effort ambitieux.
Je le veux comme vous ; cet effort ne peut plaire.
Un Auteur gaste tout quand il veut trop bien faire.
Non qu’il faille bannir certains traits delicats :
Vous les aimez ces traits, et je ne les hais pas.
Quant au principal but qu’Esope se propose,
J’y tombe au moins mal que je puis.
Enfin si dans ces Vers je ne plais et n’instruis,
Il ne tient pas à moy, c’est toujours quelque chose.
Comme la force est un poinct
Dont je ne me pique point,
Je tâche d’y tourner le vice en ridicule,
Ne pouvant l’attaquer avec des bras d’Hercule.
C’est là tout mon talent ; je ne sçay s’il suffit.
Tantost je peins en un recit
La sotte vanité jointe avecque l’envie,
Deux pivots sur qui roule aujourd’huy notre vie.
Tel est ce chetif animal
Qui voulut en grosseur au Bœuf se rendre égal.
J’oppose quelquefois, par une double image,
Le vice à la vertu, la sottise au bon sens ;
Les Agneaux aux Loups ravissans,
La Moûche à la Fourmy ; faisant de cet ouvrage
Une ample Comedie à cent actes divers,
Et dont la scene est l’Univers.
Hommes, Dieux, Animaux, tout y fait quelque rôle ;
Jupiter comme un autre : introduisons celuy
Qui porte de sa part aux Belles la parole :
Ce n’est pas de cela qu’il s’agit aujourd’huy.
Un Bûcheron perdit son gagne-pain ;
C’est sa coignée ; et la cherchant en vain,
Ce fut pitié là-dessus de l’entendre.
Il n’avoit pas des outils à revendre.
Sur celuy-cy rouloit tout son avoir.
Ne sçachant donc où mettre son espoir,
Sa face estoit de pleurs toute baignée.
O ma cognée, ô ma pauvre cognée !
S’écrioit-il, Jupiter rend la moy :
Je tiendray l’estre encore un coup de toy.
Sa plainte fut de l’Olimpe entenduë.
Mercure vient. Elle n’est pas perduë,
Luy dit ce Dieu, la connoîtras-tu bien ?
Je crois l’avoir prés d’icy rencontrée.
Lors une d’or à l’homme estant montrée,
Il répondit : Je n’y demande rien.
Une d’argent succede à la premiere ;
Il la refuse. Enfin une de bois.
Voilà, dit-il, la mienne cette fois ;
Je suis content, si j’ay cette derniere.
Tu les auras, dit le Dieu, toutes trois.
Ta bonne foy sera recompensée.
En ce cas-là je les prendray, dit-il.
L’Histoire en est aussi-tost dispersée.
Et Boquillons de perdre leur outil,
Et de crier pour se le faire rendre.
Le Roi des Dieux ne sçait auquel entendre.
Son fils Mercure aux criards vient encor,
A chacun d’eux il en montre une d’or.
Chacun eût crû passer pour une beste
De ne pas dire aussi-tost, La voilà.
Mercure, au lieu de donner celle-là,
Leur en décharge un grand coup sur la teste.
Ne point mentir, estre content du sien,
C’est le plus seur : cependant on s’occupe
A dire faux pour attraper du bien :
Que sert cela ? Jupiter n’est pas dupe.
II. § [P378] Le Pot de terre et le Pot de fer. § L e Pot de fer proposa
Au Pot de terre un voyage.
Celuy-cy s’en excusa ;
Disant qu’il feroit que sage
De garder le coin du feu ;
Car il luy faloit si peu,
Si peu, que la moindre chose
De son débris seroit cause.
Il n’en reviendroit morceau.
Pour vous, dit-il, dont la peau
Est plus dure que la mienne,
Je ne vois rien qui vous tienne.
Nous vous mettrons à couvert,
Repartit le Pot de fer.
Si quelque matiere dure
Vous menace d’avanture,
Entre deux je passeray,
Et du coup vous sauveray.
Cette offre le persuade.
Pot de fer son camarade
Se met droit à ses côtez.
Mes gens s’en vont à trois pieds
Clopin clopant comme ils peuvent,
L’un contre l’autre jettez,
Au moindre hoquet qu’ils treuvent.
Le pot de terre en souffre : il n’eut pas fait cent pas
Que par son compagnon il fut mis en éclats,
Sans qu’il eût lieu de se plaindre.
Ne nous associons qu’avecque nos égaux ;
Ou bien il nous faudra craindre
Le destin d’un de ces pots.
III. § [P18] Le petit Poisson et le Pescheur § P etit poisson deviendra grand,
Pourveu que Dieu lui preste vie.
Mais le lascher en attendant,
Je tiens pour moi que c’est folie ;
Car de le ratraper il n’est pas trop certain.
Un Carpeau qui n’estoit encore que fretin,
Fut pris par un Pescheur au bord d’une riviere.
Tout fait nombre, dit l’homme en voyant son butin ;
Voilà commencement de chere et de festin :
Mettons-le en nostre gibeciere.
Le pauvre Carpillon luy dit en sa maniere :
Que ferez-vous de moy ? Je ne sçaurois fournir
Au plus qu’une demy bouchée,
Laissez-moy Carpe devenir :
Je serai par vous repêchée.
Quelque gros Partisan m’achetera bien cher,
Au lieu qu’il vous en faut chercher
Peut-estre encor cent de ma taille
Pour faire un plat. Quel plat ? Croyez-moy ; rien qui vaille.
Rien qui vaille ? Et bien soit, repartit le Pêcheur ;
Poisson mon bel amy, qui faites le Prêcheur,
Vous irez dans la poësle ; et vous avez beau dire,
Dés ce soir on vous fera frire.
Un tien vaut, ce dit-on, mieux que deux tu l’auras :
L’un est seur, l’autre ne l’est pas.
IV. § [PØ] Les Oreilles du Liévre. § U n animal cornu blessa de quelques coups
Le Lion, qui plein de couroux,
Pour ne plus tomber en la peine,
Bannit des lieux de son domaine
Toute beste portant des cornes à son front.
Chevres, Beliers, Taureaux aussi-tost délogerent,
Daims, et Cerfs de climat changerent ;
Chacun à s’en aller fut prompt.
Un Lievre appercevant l’ombre de ses oreilles,
Craignit que quelque Inquisiteur
N’allast interpreter à cornes leur longueur :
Ne les soûtinst en tout à des cornes pareilles.
Adieu voisin Grillon, dit-il, je pars d’icy ;
Mes oreilles enfin seroient cornes aussi ;
Et quand je les aurois plus courtes qu’une Autruche,
Je craindrois mesme encor. Le Grillon repartit :
Cornes cela ? Vous me prenez pour cruche ;
Ce sont oreilles que Dieu fit.
On les fera passer pour cornes,
Dit l’animal craintif, et cornes de Licornes.
J’auray beau protester ; mon dire et mes raisons
Iront aux petites Maisons.
V. § [P17] Le Renard ayant la queuë coupée. § U n vieux Renard, mais des plus fins,
Grand croqueur de Poulets, grand preneur de Lapins ;
Sentant son Renard d’une lieuë,
Fut enfin au piege attrapé.
Par grand hazard en estant échapé,
Non pas franc, car pour gage il y laissa sa queuë :
S’estant, dis-je, sauvé sans queuë et tout honteux ;
Pour avoir des pareils, (comme il estoit habile)
Un jour que les Renards tenoient conseil entr’eux :
Que faisons-nous, dit-il, de ce poids inutile,
Et qui va balayant tous les sentiers fangeux ?
Que nous sert cette queue ? Il faut qu’on se la coupe.
Si l’on me croit, chacun s’y resoudra.
Votre avis est fort bon, dit quelqu’un de la troupe ;
Mais tournez-vous, de grace, et l’on vous répondra.
A ces mots il se fit une telle huée,
Que le pauvre écourté ne put estre entendu.
Pretendre oster la queuë eust esté temps perdu ;
La mode en fut continuée.
VI. § [P55] La Vieille et les deux Servantes. § I l estoit une Vieille ayant deux Chambrieres.
Elles filoient si bien, que les sœurs filandieres
Ne faisoient que broüiller au prix de celles-cy.
La Vieille n’avoit point de plus pressant soucy
Que de distribuer aux Servantes leur tâche
Dés que Thetis chassoit Phœbus aux crins dorez,
Tourets entroient en jeu, fuseaux estoient tirez,
Deçà, delà, vous en aurez ;
Point de cesse, point de relâche.
Dés que l’Aurore, dis-je, en son char remontoit ;
Un miserable Coq à point nommé chantoit.
Aussi-tost nostre Vieille encor plus miserable
S’affubloit d’un jupon crasseux et detestable ;
Allumoit une lampe, et couroit droit au lit
Où de tout leur pouvoir, de tout leur appetit,
Dormoient les deux pauvres Servantes.
L’une entr’ouvroit un œil, l’autre étendoit un bras ;
Et toutes deux trés-mal contentes,
Disoient entre leurs dents, Maudit Coq, tu mourras.
Comme elles l’avoient dit, la beste fut gripée ;
Le Réveille-matin eut la gorge coupée.
Ce meurtre n’amanda nullement leur marché.
Notre couple au contraire à peine estoit couché,
Que la Vieille craignant de laisser passer l’heure,
Couroit comme un Lutin par toute sa demeure.
C’est ainsi que le plus souvent,
Quand on pense sortir d’une mauvaise affaire,
On s’enfonce encor plus avant :
Témoin ce Couple et son salaire.
La Vieille, au lieu du Coq, les fit tomber par là
De Caribde en Sylla.
VII. § [P35] Le Satyre et le Passant. § A u fond d’un antre sauvage,
Un Satyre et ses enfans,
Alloient manger leur potage
Et prendre l’écuelle aux dents.
On les eust vûs sur la mousse
Luy, sa femme, et maint petit ;
Ils n’avoient tapis ni housse,
Mais tous fort bon appetit.
Pour se sauver de la pluye
Entre un Passant morfondu.
Au broüet on le convie ;
Il n’estoit pas attendu.
Son hoste n’eut pas la peine
De le semondre deux fois ;
D’abord avec son haleine
Il se réchauffe les doigts.
Puis sur le mets qu’on luy donne
Delicat il souffle aussi ;
Le Satyre s’en étonne :
Nostre hoste, à quoy bon cecy ?
L’un refroidit mon potage ;
L’autre réchauffe ma main.
Vous pouvez, dit le Sauvage,
Reprendre vostre chemin.
Ne plaise aux Dieux que je couche
Avec vous sous mesme toit.
Arriere ceux dont la bouche
Souffle le chaud et le froid.
VIII. § [P187] Le Cheval et le Loup. § U n certain Loup, dans la saison
Que les tiedes Zephirs ont l’herbe rajeunie,
Et que les animaux quittent tous la maison,
Pour s’en aller chercher leur vie.
Un Loup, dis-je, au sortir des rigueurs de l’Hyver,
Apperceut un Cheval qu’on avoit mis au vert.
Je laisse à penser quelle joye.
Bonne chasse, dit-il, qui l’auroit à son croc.
Eh ! que n’es-tu Mouton ? car tu me serois hoc :
Au lieu qu’il faut ruser pour avoir cette proye.
Rusons donc. Ainsi dit, il vient à pas comptez,
Se dit Ecolier d’Hippocrate ;
Qu’il connoist les vertus et les proprietez
De tous les Simples de ces prez :
Qu’il sçait guerir, sans qu’il se flate,
Toutes sortes de maux. Si Dom Coursier vouloit
Ne point celer sa maladie,
Luy Loup gratis le gueriroit.
Car le voir en cette prairie
Paistre ainsi sans estre lié,
Témoignoit quelque mal, selon la Medecine.
J’ay, dit la Beste chevaline,
Une apostume sous le pied.
Mon fils, dit le Docteur, il n’est point de partie
Susceptible de tant de maux.
J’ay l’honneur de servir Nosseigneurs les Chevaux,
Et fais aussi la Chirurgie.
Mon galand ne songeoit qu’à bien prendre son temps,
Afin de haper son malade.
L’autre qui s’en doutoit, luy lâche une ruade,
Qui vous luy met en marmelade
Les mendibules et les dents.
C’est bien fait, dit le Loup en soy-mesme fort triste ;
Chacun à son métier doit toûjours s’attacher.
Tu veux faire icy l’Arboriste,
Et ne fus jamais que Boucher.
IX. § [P42] Le Laboureur et ses enfans. § T ravaillez, prenez de la peine.
C’est le fonds qui manque le moins.
Un riche Laboureur sentant sa mort prochaine,
Fit venir ses enfans, leur parla sans témoins.
Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l’heritage
Que nous ont laissé nos parens.
Un tresor est caché dedans.
Je ne sçai pas l’endroit ; mais un peu de courage
Vous le fera trouver, vous en viendrez à bout.
Remuez vostre champ dés qu’on aura fait l’Oust.
Creusez, foüillez, bêchez, ne laissez nulle place
Où la main ne passe et repasse.
Le pere mort, les fils vous retournent le champ
Deçà, delà, par tout ; si bien qu’au bout de l’an
Il en rapporta davantage.
D’argent, point de caché. Mais le pere fut sage
De leur montrer avant sa mort,
Que le travail est un tresor.
X. § [P520] La Montagne qui accouche. § U ne Montagne en mal d’enfant,
Jettoit une clameur si haute,
Que chacun au bruit accourant,
Crut qu’elle accoucheroit, sans faute,
D’une Cité plus grosse que Paris :
Elle accoucha d’une Souris.
Quand je songe à cette Fable,
Dont le recit est menteur,
Et le sens est veritable ;
Je me figure un Auteur,
Qui dit : Je chanteray la guerre
Que firent les Titans au Maistre du tonnerre.
C’est promettre beaucoup ; mais qu’en sort-il souvent ?
Du vent.
XI. § [P174] La Fortune et le jeune Enfant. § S ur le bord d’un puits trés-profond,
Dormoit étendu de son long
Un Enfant alors dans ses classes.
Tout est aux Ecoliers couchette et matelas.
Un honneste homme en pareil cas
Auroit fait un saut de vingt brasses.
Prés de là tout heureusement
La Fortune passa, l’éveilla doucement,
Luy disant, Mon mignon, je vous sauve la vie.
Soyez une autre fois plus sage, je vous prie.
Si vous fussiez tombé, l’on s’en fust pris à moy :
Cependant c’estoit vostre faute.
Je vous demande en bonne foy
Si cette imprudence si haute
Provient de mon caprice ? Elle part à ces mots.
Pour moy j’approuve son propos.
Il n’arrive rien dans le monde
Qu’il ne faille qu’elle en réponde.
Nous la faisons de tous Echos.
Elle est prise à garand de toutes avantures.
Est-on sot, étourdi, prend-on mal ses mesures ;
On pense en estre quitte en accusant son sort.
Bref la Fortune a toujours tort.
XII. § [Cf. P114 ; P170] Les Medecins. § L e Medecin Tant-pis alloit voir un malade,
Que visitoit aussi son confrere Tant-mieux,
Ce dernier esperoit, quoique son camarade
Soûtinst que le gisant iroit voir ses ayeux.
Tous deux s’estant trouvez differens pour la cure,
Leur malade paya le tribut à Nature ;
Aprés qu’en ses conseils Tant-pis eust esté cru.
Ils triomphoient encor sur cette maladie.
L’un disoit, Il est mort, je l’avois bien prévû.
S’il m’eust cru, disoit l’autre, il seroit plein de vie.
XIII. § [P87] La Poule aux œufs d’or. § L ’Avarice perd tout en voulant tout gagner.
Je ne veux, pour le témoigner,
Que celuy dont la Poule, à ce que dit la Fable,
Pondoit tous les jours un œuf d’or.
Il crut que dans son corps elle avoit un tresor.
Il la tua, l’ouvrit, et la trouva semblable
A celle dont les œufs ne lui rapportoient rien,
S’estant luy-mesme osté le plus beau de son bien.
Belle leçon pour les gens chiches :
Pendant ces derniers temps combien en a-t-on vus
Qui du soir au matin sont pauvres devenus
Pour vouloir trop tost estre riches ?
XIV. § [P182] L’Asne portant des Reliques. § U n Baudet, chargé de Reliques,
S’imagina qu’on l’adoroit.
Dans ce penser il se quarroit,
Recevant comme siens l’Encens et les Cantiques.
Quelqu’un vit l’erreur, et lui dit :
Maistre Baudet, ostez-vous de l’esprit
Une vanité si folle :
Ce n’est pas vous, c’est l’Idole
A qui cet honneur se rend,
Et que la gloire en est deuë.
D’un Magistrat ignorant
C’est la Robe qu’on saluë.
XV. § [P77] Le Cerf et la Vigne. § U n Cerf à la faveur d’une Vigne fort haute,
Et telle qu’on en voit en de certains climats,
S’estant mis à couvert, et sauvé du trépas ;
Les Veneurs pour ce coup croyoient leurs chiens en faute.
Ils les rappellent donc. Le Cerf hors de danger
Broute sa bienfaitrice, ingratitude extrême !
On l’entend, on retourne, on le fait déloger,
Il vient mourir en ce lieu mesme.
J’ay mérité, dit-il, ce juste chastiment :
Profitez-en, ingrats. Il tombe en ce moment.
La Meute en fait curée. Il luy fut inutile
De pleurer aux Veneurs à sa mort arrivez.
Vraye image de ceux qui profanent l’azile
Qui les a conservez.
XVI. § [P93] Le Serpent et la Lime. § O n conte qu’un serpent voisin d’un Horloger,
(C’estoit pour l’Horloger un mauvais voisinage)
Entra dans sa boutique, et cherchant à manger
N’y rencontra pour tout potage
Qu’une Lime d’acier qu’il se mit à ronger.
Cette Lime luy dit, sans se mettre en colere,
Pauvre ignorant ! et que pretends-tu faire ?
Tu te prends à plus dur que toy,
Petit Serpent à teste folle,
Plutost que d’emporter de moy
Seulement le quart d’une obole,
Tu te romprois toutes les dents.
Je ne crains que celles du temps.
Cecy s’adresse à vous, esprits du dernier ordre,
Qui n’estant bons à rien cherchez sur tout à mordre,
Vous vous tourmentez vainement.
Croyez-vous que vos dents impriment leurs outrages
Sur tant de beaux ouvrages ?
Ils sont pour vous d’airain, d’acier, de diamant.
XVII. § [P473] Le Liévre et la Perdrix. § I l ne se faut jamais moquer des miserables :
Car qui peut s’asseurer d’estre toûjours heureux ?
Le sage Esope dans ses Fables
Nous en donne un exemple ou deux.
Celuy qu’en ces Vers je propose,
Et les siens, ce sont mesme chose.
Le Lievre et la Perdrix concitoyens d’un champ,
Vivoient dans un état ce semble assez tranquille :
Quand une Meute s’approchant
Oblige le premier à chercher un azile.
Il s’enfuit dans son fort, met les chiens en défaut ;
Sans mesme en excepter Briffaut.
Enfin il se trahit luy-mesme
Par les esprits sortans de son corps échauffé.
Miraut sur leur odeur ayant philosophé,
Conclut que c’est son Liévre ; et d’une ardeur extrême
Il le pousse ; et Rustaut qui n’a jamais menti,
Dit que le Liévre est reparti.
Le pauvre malheureux vient mourir à son giste.
La Perdrix le raille et luy dit :
Tu te vantois d’estre si vîte :
Qu’as-tu fait de tes pieds ? Au moment qu’elle rit,
Son tour vient, on la trouve. Elle croit que ses aisles
La sçauront garentir à toute extremité :
Mais la pauvrette avoit compté
Sans l’Autour aux serres cruelles.
XVIII. § [PØ] L’Aigle et le Hibou. § L ’Aigle et le Chat-huant leurs querelles cesserent ;
Et firent tant qu’ils s’embrasserent.
L’un jura foy de Roy, l’autre foy de Hibou,
Qu’ils ne se goberoient leurs petits peu ny prou.
Connoissez-vous les miens ? dit l’Oiseau de Minerve.
Non, dit l’Aigle. Tant pis, reprit le triste Oiseau.
Je crains en ce cas pour leur peau :
C’est hazard si je les conserve.
Comme vous estes Roy, vous ne considerez
Qui ny quoy : Rois et Dieux mettent, quoy qu’on leur die,
Tout en mesme categorie.
Adieu mes nourriçons si vous les rencontrez.
Peignez-les moy, dit l’Aigle, ou bien me les montrez.
Je n’y toucheray de ma vie.
Le Hibou repartit : Mes petits sont mignons,
Beaux, bien faits, et jolis sur tous leurs compagnons.
Vous les reconnoistrez sans peine à cette marque.
N’allez pas l’oublier ; retenez-la si bien
Que chez moy la maudite Parque
N’entre point par vostre moyen.
Il avint qu’au Hibou Dieu donna geniture,
De façon qu’un beau soir qu’il estoit en pasture,
Nostre Aigle apperceut d’avanture,
Dans les coins d’une roche dure,
Ou dans les trous d’une mazure
(Je ne sçai pas lequel des deux),
De petits monstres fort hideux,
Rechignez, un air triste, une voix de Megere.
Ces enfans ne sont pas, dit l’Aigle, à nôtre amy :
Croquons-les. Le galand n’en fit pas à demy.
Ses repas ne sont point repas à la legere.
Le Hibou de retour ne trouve que les pieds
De ses chers nourriçons, hélas ! pour toute chose.
Il se plaint, et les Dieux sont par luy suppliez
De punir le brigand qui de son deüil est cause.
Quelqu’un luy dit alors : N’en accuse que toy,
Ou plutost la commune loy,
Qui veut qu’on trouve son semblable
Beau, bien fait, et sur tous aimable.
Tu fis de tes enfans à l’Aigle ce portrait,
En avoient-ils le moindre trait ?
XIX. § [PØ] Le Lion s’en allant en guerre. § L e Lion dans sa teste avoit une entreprise.
Il tint conseil de guerre, envoya ses Prevosts ;
Fit avertir les animaux :
Tous furent du dessein ; chacun selon sa guise.
L’Elephant devait sur son dos
Porter l’attirail necessaire,
Et combattre à son ordinaire :
L’Ours s’apprester pour les assauts :
Le Renard ménager de secrettes pratiques :
Et le Singe amuser l’ennemi par ses tours.
Renvoyez, dit quelqu’un, les Asnes qui sont lourds ;
Et les Liévres sujets à des terreurs paniques.
Point du tout, dit le Roy, je les veux employer.
Nostre troupe sans eux ne seroit pas complete.
L’Asne effrayra les gens nous servant de trompete ;
Et le Liévre pourra nous servir de courrier.
Le Monarque prudent et sage
De ses moindres sujets sçait tirer quelque usage,
Et connoist les divers talens :
Il n’est rien d’inutile aux personnes de sens.
XX. § [P65] L’Ours et les deux Compagnons. § D eux compagnons pressez d’argent,
A leur voisin Fourreur vendirent
La peau d’un Ours encor vivant ;
Mais qu’ils tuëroient bien-tost ; du moins à ce qu’ils dirent.
C’estoit le Roy des Ours au compte de ces gens.
Le Marchand à sa peau devoit faire fortune.
Elle garentiroit des froids les plus cuisans.
On en pourroit fourrer plutost deux robes qu’une.
Dindenaut prisoit moins ses Moutons qu’eux leur Ours.
Leur, à leur compte, et non à celui de la Beste.
S’offrant de la livrer au plus tard dans deux jours,
Ils conviennent de prix, et se mettent en queste,
Trouvent l’Ours qui s’avance, et vient vers eux au trot.
Voilà mes gens frappez comme d’un coup de foudre.
Le marché ne tint pas ; il fallut le resoudre :
D’interests contre l’Ours, on n’en dit pas un mot.
L’un des deux Compagnons grimpe au faiste d’un arbre ;
L’autre, plus froid que n’est un marbre,
Se couche sur le nez, fait le mort, tient son vent ;
Ayant quelque part oüy dire
Que l’Ours s’acharne peu souvent
Sur un corps qui ne vit, ne meut, ny ne respire.
Seigneur Ours, comme un sot, donna dans ce panneau.
Il void ce corps gisant, le croit privé de vie,
Et, de peur de supercherie
Le tourne, le retourne, approche son museau,
Flaire aux passages de l’haleine.
C’est, dit-il, un cadavre ; Ostons-nous, car il sent.
A ces mots, l’Ours s’en va dans la forest prochaine.
L’un de nos deux Marchands de son arbre descend,
Court à son compagnon ; luy dit que c’est merveille,
Qu’il n’ait eu seulement que la peur pour tout mal.
Et bien, ajoûta-t-il, la peau de l’animal ?
Mais que t’a-t-il dit à l’oreille ?
Car il s’approchoit de bien prés,
Te retournant avec sa serre.
Il m’a dit qu’il ne faut jamais
Vendre la peau de l’Ours qu’on ne l’ait mis par terre.
XXI. § [P188/358] L’Asne vestu de la peau du Lion. § D e la peau du Lion l’Asne s’étant vestu,
Estoit craint par tout à la ronde ;
Et bien qu’animal sans vertu,
Il faisoit trembler tout le monde.
Un petit bout d’oreille échapé par malheur,
Découvrit la fourbe et l’erreur.
Martin fit alors son office.
Ceux qui ne sçavoient pas la ruse et la malice,
S’estonnoient de voir que Martin
Chassast les Lions au moulin.
Force gens font du bruit en France,
Par qui cet Apologue est rendu familier.
Un équipage cavalier
Fait les trois quarts de leur vaillance.
Livre sixiéme. §
FABLE I. § [P49] Le Pâtre et le Lion. § II. § [P326] Le Lion et le Chasseur. § L es Fables ne sont pas ce qu’elles semblent estre ;
Le plus simple animal nous y tient lieu de Maistre.
Une Morale nuë apporte de l’ennuy :
Le conte fait passer le precepte avec luy.
En ces sortes de feinte il faut instruire et plaire ;
Et conter pour conter me semble peu d’affaire.
C’est par cette raison qu’égayant leur esprit,
Nombre de gens fameux en ce genre ont écrit.
Tous ont fuy l’ornement et le trop d’étenduë.
On ne voit point chez eux de parole perduë.
Phedre estoit si succint, qu’aucuns l’en ont blâmé.
Esope en moins de mots s’est encore exprimé.
Mais sur tous certain
3 Grec rencherit et se
pique
D’une élegance Laconique.
Il renferme toujours son conte en quatre Vers ;
Bien ou mal, je le laisse à juger aux Experts.
Voyons-le avec Esope en un sujet semblable.
L’un ameine un Chasseur, l’autre un Pâtre en sa Fable.
J’ay suivi leur projet quant à l’évenement,
Y cousant en chemin quelque trait seulement.
Voicy comme à peu prés Esope le raconte.
U n Pâtre à ses Brebis trouvant quelque méconte,
Voulut à toute force attraper le Larron.
Il s’en va prés d’un antre, et tend à l’environ
Des laqs à prendre Loups, soupçonnant cette engeance.
Avant que partir de ces lieux,
Si tu fais, disoit-il, ô Monarque des Dieux,
Que le drosle à ces laqs se prenne en ma presence,
Et que je goûte ce plaisir,
Parmi vingt Veaux je veux choisir
Le plus gras, et t’en faire offrande.
À ces mots sort de l’antre un Lion grand et fort.
Le Pâtre se tapit, et dit à demy mort,
Que l’homme ne sçait guere, helas ! ce qu’il demande !
Pour trouver le Larron qui détruit mon troupeau,
Et le voir en ces laqs pris avant que je parte,
O Monarque des Dieux, je t’ay promis un Veau ;
Je te promets un Bœuf, si tu fais qu’il s’écarte.
C’est ainsi que l’a dit le principal Auteur :
Passons à son imitateur.
U n Fanfaron, amateur de la chasse,
Venant de perdre un Chien de bonne race,
Qu’il soupçonnoit dans le corps d’un Lion,
Vid un Berger. Enseigne-moy, de grace,
De mon voleur, luy dit-il, la maison,
Que de ce pas je me fasse raison.
Le Berger dit : C’est vers cette montagne
En luy payant de tribut un Mouton
Par chaque mois, j’erre dans la campagne
Comme il me plaist, et je suis en repos.
Dans le moment qu’ils tenoient ces propos,
Le Lion sort, et vient d’un pas agile.
Le Fanfaron aussi-tost d’esquiver.
O Jupiter ! montre-moy quelque azile,
S’écria-t-il, qui me puisse sauver.
La vraye épreuve de courage
N’est que dans le danger que l’on touche du doigt.
Tel le cherchoit, dit-il, qui, changeant de langage,
S’enfuit aussi-tost qu’il le void.
III. § [P46] Phœbus et Borée. § B orée et le Soleil virent un Voyageur
Qui s’étoit muni par bonheur
Contre le mauvais temps. (On entroit dans l’Automne,
Quand la précaution aux Voyageurs est bonne :
Il pleut ; le Soleil luit ; et l’écharpe d’Iris
Rend ceux qui sortent avertis
Qu’en ces mois le manteau leur est fort necessaire.
Les Latins les nommoient douteux pour cette affaire.)
Nostre homme s’estoit donc à la pluye attendu.
Bon manteau bien doublé ; bonne étoffe bien forte.
Celuy-cy, dit le Vent, prétend avoir pourvû
A tous les accidens ; mais il n’a pas préveu
Que je sçauray souffler de sorte,
Qu’il n’est bouton qui tienne : il faudra, si je veux,
Que le manteau s’en aille au Diable.
L’ébatement pourroit nous en estre agreable :
Vous plaist-il de l’avoir ? Et bien gageons nous deux
(Dit Phœbus) sans tant de paroles,
A qui plustost aura dégarny les épaules
Du Cavalier que nous voyons.
Commencez : Je vous laisse obscurcir mes rayons.
Il n’en falut pas plus. Notre souffleur à gage
Se gorge de vapeurs, s’enfle comme un balon ;
Fait un vacarme de demon ;
Siffle, souffle, tempeste, et brise en son passage
Maint toit qui n’en peut mais, fait perir maint bateau ;
Le tout au sujet du manteau.
Le Cavalier eut soin d’empêcher que l’orage
Ne se pût engouffrer dedans.
Cela le preserva : le vent perdit son temps :
Plus il se tourmentoit, plus l’autre tenoit ferme :
Il eut beau faire agir le colet et les plis.
Si tost qu’il fut au bout du terme
Qu’à la gageure on avoit mis ;
Le Soleil dissipe la nuë :
Recrée, et puis penetre enfin le Cavalier ;
Sous son balandras fait qu’il suë ;
Le contraint de s’en dépoüiller.
Encor n’usa-t-il pas de toute sa puissance.
Plus fait douceur que violence.
IV. § [PØ] Jupiter et le Métayer. § J upiter eut jadis une ferme à donner.
Mercure en fit l’annonce ; et gens se presenterent,
Firent des offres, écouterent :
Ce ne fut pas sans bien tourner.
L’un alleguoit que l’heritage
Estoit frayant et rude, et l’autre un autre si.
Pendant qu’ils marchandoient ainsi,
Un d’eux le plus hardi, mais non pas le plus sage,
Promit d’en rendre tant, pourveu que Jupiter
Le laissast disposer de l’air,
Luy donnast saison à sa guise,
Qu’il eust du chaud, du froid, du beau temps, de la bise,
Enfin du sec et du moüillé,
Aussi-tost qu’il auroit baaillé.
Jupiter y consent. Contract passé ; nostre homme
Tranche du Roy des airs, pleut, vente et fait en somme
Un climat pour luy seul : ses plus proches voisins
Ne s’en sentoient non plus que les Ameriquains.
Ce fut leur avantage ; ils eurent bonne année,
Pleine moisson, pleine vinée.
Monsieur le Receveur fut trés-mal partagé.
L’an suivant voilà tout changé.
Il ajuste d’une autre sorte
La temperature des Cieux.
Son champ ne s’en trouve pas mieux,
Celuy de ses voisins fructifie et rapporte.
Que fait-il ? Il recourt au Monarque des Dieux :
Il confesse son imprudence.
Jupiter en usa comme un Maistre fort doux.
Concluons que la Providence
Sçait ce qu’il nous faut, mieux que nous.
V. § [P716] Le Cochet, le Chat et le Souriceau. § U n Souriceau tout jeune, et qui n’avoit rien veu,
Fut presque pris au dépourveu.
Voicy comme il conta l’avanture à sa mere.
J’avois franchi les Monts qui bornent cet Etat ;
Et trotois comme un jeune Rat
Qui cherche à se donner carriere.
Lorsque deux animaux m’ont arresté les yeux :
L’un doux, benin et gracieux ;
Et l’autre turbulent, et plein d’inquietude.
Il a la voix perçante et rude ;
Sur la teste un morceau de chair ;
Une sorte de bras dont il s’éleve en l’air,
Comme pour prendre sa volée ;
La queuë en panache étalée.
Or c’estoit un Cochet dont notre Souriceau
Fit à sa mere le tableau,
Comme d’un animal venu de l’Amerique.
Il se batoit, dit-il, les flancs avec ses bras,
Faisant tel bruit et tel fracas,
Que moy, qui grace aux Dieux de courage me pique,
En ay pris la fuite de peur,
Le maudissant de trés-bon cœur.
Sans luy j’aurois fait connoissance
Avec cet animal qui m’a semblé si doux.
Il est velouté comme nous,
Marqueté, longue queuë, une humble contenance ;
Un modeste regard, et pourtant l’œil luisant :
Je le crois fort sympatisant
Avec Messieurs les Rats ; car il a des oreilles
En figure aux nôtres pareilles.
Je l’allois aborder ; quand d’un son plein d’éclat
L’autre m’a fait prendre la fuite.
Mon fils, dit la Souris, ce doucet est un Chat,
Qui sous son minois hypocrite
Contre toute ta parenté
D’un malin vouloir est porté.
L’autre animal tout au contraire,
Bien éloigné de nous mal faire,
Servira quelque jour peut-être à nos repas.
Quant au Chat ; c’est sur nous qu’il fonde sa cuisine.
Garde-toy tant que tu vivras
De juger des gens sur la mine.
VI. § [P81] Le Renard, le Singe, et les Animaux. § L es Animaux, au deceds d’un Lion,
En son vivant Prince de la contrée,
Pour faire un Roy s’assemblerent, dit-on.
De son étuy la couronne est tirée.
Dans une chartre un Dragon la gardoit.
Il se trouva que sur tous essayée,
A pas un d’eux elle ne convenoit.
Plusieurs avoient la teste trop menuë,
Aucuns trop grosse, aucuns même cornuë.
Le Singe aussi fit l’épreuve en riant,
Et par plaisir la Tiare essayant,
Il fit autour force grimaceries,
Tours de souplesse, et mille singeries :
Passa dedans ainsi qu’en un cerceau.
Aux animaux cela sembla si beau,
Qu’il fut élû : chacun luy fit hommage.
Le Renard seul regretta son suffrage ;
Sans toutefois montrer son sentiment.
Quand il eut fait son petit compliment :
Il dit au Roy : Je sçay, Sire, une cache ;
Et ne crois pas qu’autre que moy la sçache.
Or tout tresor par droit de Royauté
Appartient, Sire, à vôtre Majesté.
Le nouveau Roy baaille aprés la Finance,
Lui-même y court pour n’estre pas trompé.
C’estoit un piége : il y fut attrapé.
Le Renard dit au nom de l’assistance :
Pretendrois-tu nous gouverner encor ;
Ne sçachant pas te conduire toy-même ?
Il fut démis : et l’on tomba d’accord
Qu’à peu de gens convient le Diadême.
VII. § [P315] Le Mulet se vantant de sa Genealogie. § L e Mulet d’un Prelat se piquoit de noblesse,
Et ne parloit incessamment
Que de sa mere la Jument,
Dont il contoit mainte proüesse :
Elle avoit fait cecy, puis avoit esté là.
Son fils prétendoit, pour cela,
Qu’on le dust mettre dans l’Histoire.
Il eust cru s’abaisser servant un Medecin.
Estant devenu vieux, on le mit au moulin.
Son pere l’Asne alors lui revint en memoire.
Quand le malheur ne seroit bon
Qu’à mettre un sot à la raison,
Toujours seroit-ce à juste cause
Qu’on le dit bon à quelque chose.
VIII. § [P476] Le Vieillard et l’Asne. § U n Vieillard sur son Asne apperçut en passant
Un Pré plein d’herbe et fleurissant.
Il y lâche sa beste, et le Grison se ruë
Au travers de l’herbe menuë,
Se veautrant, gratant et frotant,
Gambadant, chantant et broutant,
Et faisant mainte place nette.
L’ennemi vient sur l’entrefaite.
Fuyons, dit alors le Vieillard.
Pourquoy ? répondit le paillard ;
Me fera-t-on porter double bast, double charge ?
Non pas, dit le Vieillard, qui prit d’abord le large.
Et que m’importe donc, dit l’Asne, à qui je sois ?
Sauvez-vous, et me laissez paistre :
Nôtre ennemi c’est nôtre Maistre,
Je vous le dis en bon François.
IX. § [P74] Le Cerf se voyant dans l’eau § D ans le crystal d’une fontaine
Un Cerf se mirant autrefois,
Loüoit la beauté de son bois,
Et ne pouvoit qu’avecque peine
Souffrir ses jambes de fuseaux,
Dont il voyoit l’objet se perdre dans les eaux.
Quelle proportion de mes pieds à ma teste !
Disoit-il en voyant leur ombre avec douleur :
Des taillis les plus hauts mon front atteint le faiste ;
Mes pieds ne me font point d’honneur.
Tout en parlant de la sorte,
Un Limier le fait partir ;
Il tâche à se garentir ;
Dans les forests il s’emporte.
Son bois, dommageable ornement,
L’arrestant à chaque moment,
Nuit à l’Office que luy rendent
Ses pieds, de qui ses jours dépendent.
Il se dédit alors, et maudit les presens
Que le Ciel luy fait tous les ans.
Nous faisons cas du beau, nous méprisons l’utile ;
Et le beau souvent nous détruit.
Ce Cerf blâme ses pieds qui le rendent agile :
Il estime un bois qui luy nuit.
X. § [P226] Le Lievre et la Tortuë. § R ien ne sert de courir ; il faut partir à point.
Le Lievre et la Tortuë en sont un témoignage.
Gageons, dit celle-cy, que vous n’atteindrez point
Si-tost que moy ce but. Si-tost ? Estes-vous sage ?
Repartit l’animal leger.
Ma commere il vous faut purger
Avec quatre grains d’ellebore.
Sage ou non, je parie encore.
Ainsi fut fait : et de tous deux
On mit prés du but les enjeux :
Sçavoir quoy, ce n’est pas l’affaire,
Ni de quel juge l’on convint.
Notre Lievre n’avoit que quatre pas à faire ;
J’entends de ceux qu’il fait lorsque prest d’estre atteint,
Il s’éloigne des chiens, les renvoye aux Calendes,
Et leur fait arpenter les Landes.
Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter,
Pour dormir, et pour écouter
D’où vient le vent ; il laisse la Tortuë
Aller son train de Senateur.
Elle part, elle s’évertuë ;
Elle se haste avec lenteur.
Luy cependant méprise une telle victoire,
Tient la gageure à peu de gloire ;
Croit qu’il y va de son honneur
De partir tard. Il broute, il se repose,
Il s’amuse à toute autre chose
Qu’à la gageure. A la fin quand il vid
Que l’autre touchoit presque au bout de la carriere ;
Il partit comme un trait ; mais les élans qu’il fit
Furent vains ; la Tortuë arriva la premiere.
Hé bien, luy cria-t-elle, avois-je pas raison ?
Dequoy vous sert votre vîtesse ?
Moy l’emporter ! et que seroit-ce
Si vous portiez une maison ?
XI. § [P179] L’Asne et ses Maistres. § L ’Asne d’un Jardinier se plaignoit au destin
De ce qu’on le faisoit lever devant l’Aurore.
Les Coqs, luy disoit-il, ont beau chanter matin ;
Je suis plus matineux encore.
Et pourquoy ? Pour porter des herbes au marché.
Belle necessité d’interrompre mon somme !
Le sort de sa plainte touché
Luy donne un autre Maistre ; et l’Animal de somme
Passe du Jardinier aux mains d’un Corroyeur.
La pesanteur des peaux, et leur mauvaise odeur
Eurent bien-tost choqué l’impertinente Beste.
J’ay regret, disoit-il, à mon premier Seigneur.
Encor quand il tournoit la teste,
J’attrapois, s’il m’en souvient bien,
Quelque morceau de chou quy ne me coutoit rien.
Mais icy, point d’aubeine ; ou si j’en ay quelqu’une,
C’est de coups. Il obtint changement de fortune,
Et sur l’état d’un Charbonnier
Il fut couché tout le dernier.
Autre plainte. Quoy donc, dit le Sort en colere,
Ce Baudet-cy m’occupe autant
Que cent Monarques pourroient faire.
Croit-il estre le seul qui ne soit pas content ?
N’ay-je en l’esprit que son affaire ?
Le Sort avoit raison ; tous gens sont ainsi faits :
Nostre condition jamais ne nous contente :
La pire est toujours la presente.
Nous fatiguons le Ciel à force de placets.
Qu’à chacun Jupiter accorde sa requeste,
Nous luy romprons encor la teste.
XII. § [P314] Le Soleil et les Grenoüilles. § A ux noces d’un Tyran tout le peuple en liesse
Noyoit son soucy dans les pots.
Esope seul trouvoit que les gens estoient sots
De témoigner tant d’allegresse.
Le Soleil, disoit-il, eut dessein autrefois
De songer à l’Hymenée.
Aussi-tost on ouït d’une commune voix
Se plaindre de leur destinée
Les Citoyennes des Etangs.
Que ferons-nous, s’il lui vient des enfans ?
Dirent-elles au Sort, un seul Soleil à peine
Se peut souffrir. Une demi-douzaine
Mettra la Mer à sec, et tous ses habitans.
Adieu joncs et marais : notre race est détruite.
Bien-tost on la verra reduite
À l’eau du Styx. Pour un pauvre Animal,
Grenoüilles, à mon sens, ne raisonnoient pas mal.
XIII. § [P176] Le Villageois et le Serpent § E sope conte qu’un Manant
Charitable autant que peu sage,
Un jour d’Hyver se promenant
A l’entour de son heritage,
Apperçut un Serpent sur la neige étendu,
Transi, gelé, perclus, immobile rendu,
N’ayant pas à vivre un quart d’heure.
Le Villageois le prend, l’emporte en sa demeure ;
Et sans considerer quel sera le loyer
D’une action de ce merite,
Il l’étend le long du foyer,
Le réchauffe, le ressuscite.
L’Animal engourdi sent à peine le chaud,
Que l’ame luy revient avecque la colere.
Il leve un peu la teste, et puis siffle aussi-tost,
Puis fait un long repli, puis tâche à faire un saut
Contre son bienfaiteur, son sauveur et son pere.
Ingrat, dit le Manant, voilà donc mon salaire ?
Tu mourras. A ces mots, plein d’un juste courroux
Il vous prend sa cognée, il vous tranche la Beste,
Il fait trois Serpens de deux coups,
Un tronçon, la queuë et la teste.
L’insecte sautillant, cherche à se réunir,
Mais il ne put y parvenir.
Il est bon d’estre charitable :
Mais envers qui, c’est là le poinct.
Quant aux ingrats, il n’en est point
Qui ne meure enfin miserable.
XIV. § [P142] Le Lion malade, et le Renard. § D e par le Roy des Animaux
Qui dans son antre estoit malade,
Fut fait sçavoir à ses vassaux
Que chaque espece en ambassade
Envoyast gens le visiter :
Sous promesse de bien traiter
Les Deputez, eux et leur suite ;
Foy de Lion trés-bien écrite.
Bon passe-port contre la dent ;
Contre la griffe tout autant.
L’Edit du Prince s’execute.
De chaque espece on luy députe.
Les Renards gardant la maison,
Un d’eux en dit cette raison.
Les pas empreints sur la poussiere,
Par ceux qui s’en vont faire au malade leur cour,
Tous, sans exception, regardent sa taniere,
Pas un ne marque de retour.
Cela nous met en méfiance.
Que sa Majesté nous dispense.
Grammercy de son passe-port.
Je le crois bon ; mais dans cet antre
Je vois fort bien comme l’on entre,
Et ne vois pas comme on en sort.
XV. § [PØ] L’Oiseleur, l’Autour et l’Aloüette. § L es injustices des pervers
Servent souvent d’excuse aux nostres.
Telle est la loy de l’Univers.
Si tu veux qu’on t’épargne, épargne aussi les autres.
Un Manant au miroir prenoit des Oisillons.
Le fantôme brillant attire une Aloüette,
Aussi-tost un Autour planant sur les sillons,
Descend des airs, fond, et se jette
Sur celle qui chantoit, quoy que prés du tombeau.
Elle avoit évité la perfide machine,
Lors que se rencontrant sous la main de l’oiseau,
Elle sent son ongle maligne.
Pendant qu’à la plumer l’Autour est occupé,
Luy-mesme sous les rets demeure envelopé.
Oiseleur, laisse-moy, dit-il en son langage ;
Je ne t’ay jamais fait de mal.
L’Oiseleur repartit : Ce petit animal
T’en avoit-il fait davantage ?
XVI. § [P181] Le Cheval et l’Asne. § E n ce monde il se faut l’un l’autre secourir.
Si ton voisin vient à mourir,
C’est sur toy que le fardeau tombe.
Un Asne accompagnoit un Cheval peu courtois,
Celui-ci ne portant que son simple harnois,
Et le pauvre Baudet si chargé qu’il succombe.
Il pria le Cheval de l’aider quelque peu :
Autrement il mourroit devant qu’estre à la ville.
La priere, dit-il, n’en est pas incivile :
Moitié de ce fardeau ne vous sera que jeu.
Le Cheval refusa, fit une petarrade :
Tant qu’il vid sous le faix mourir son camarade,
Et reconnut qu’il avoit tort.
Du Baudet en cette aventure
On luy fit porter la voiture,
Et la peau par dessus encor.
XVII. § [P133] Le Chien qui lâche sa proye pour l’ombre. § C hacun se trompe icy-bas.
On void courir aprés l’ombre
Tant de fous, qu’on n’en sçait pas
La pluspart du temps le nombre.
Au Chien dont parle Esope il faut les renvoyer.
Ce Chien voyant sa proye en l’eau representée,
La quitta pour l’image, et pensa se noyer ;
La riviere devint tout d’un coup agitée.
A toute peine il regagna les bords,
Et n’eut ny l’ombre ny le corps.
XVIII. § [P291] Le Chartier embourbé. § L e Phaëton d’une voiture à foin
Vid son Char embourbé. Le pauvre homme estoit loin
De tout humain secours. C’estoit à la campagne
Prés d’un certain canton de la basse Bretagne
Appellé Quimpercorentin.
On sçait assez que le destin
Adresse là les gens quand il veut qu’on enrage.
Dieu nous préserve du voyage.
Pour venir au Chartier embourbé dans ces lieux ;
Le voilà qui deteste et jure de son mieux.
Pestant en sa fureur extrême
Tantost contre les trous, puis contre ses chevaux,
Contre son char, contre luy-mesme.
Il invoque à la fin le Dieu dont les travaux
Sont si celebres dans le monde.
Hercule, luy dit-il, aide-moy ; si ton dos
A porté la machine ronde,
Ton bras peut me tirer d’icy.
Sa prière estant faite, il entend dans la nuë
Une voix qui luy parle ainsi :
Hercule veut qu’on se remuë,
Puis il aide les gens. Regarde d’où provient
L’achopement qui te retient.
Oste d’autour de chaque rouë
Ce malheureux mortier, cette maudite bouë,
Qui jusqu’à l’aissieu les enduit.
Pren ton pic, et me romps ce caillou qui te nuit.
Comble-moy cette orniere. As-tu fait ? Oüy, dit l’homme.
Or bien je vas t’aider, dit la voix ; pren ton foüet.
Je l’ay pris. Qu’est cecy ? Mon char marche à souhait.
Hercule en soit loüé. Lors la voix : Tu vois comme
Tes chevaux aisément se sont tirez de là.
Aide-toy, le Ciel t’aidera.
XIX. § [PØ] Le Charlatan. § L e monde n’a jamais manqué de Charlatans.
Cette science de tout temps
Fut en Professeurs trés-fertile.
Tantost l’un en Theatre affronte l’Acheron :
Et l’autre affiche par la Ville
Qu’il est un Passe-Ciceron.
Un des derniers se vantoit d’estre
En Eloquence si grand Maistre,
Qu’il rendroit disert un badaut,
Un manant, un rustre, un lourdaut,
Ouy, Messieurs, un lourdaut, un Animal, un Asne :
Que l’on ameine un Asne, un Asne renforcé,
Je le rendray Maistre passé ;
Et veux qu’il porte la soutane.
Le Prince sceut la chose, il manda le Rheteur.
J’ay, dit-il, dans mon écurie
Un fort beau Roussin d’Arcadie :
J’en voudrois faire un Orateur.
Sire, vous pouvez tout, reprit d’abord nôtre homme.
On luy donna certaine somme.
Il devoit au bout de dix ans
Mettre son Asne sur les bancs :
Sinon, il consentoit d’estre en place publique
Guindé, la hard au col, étranglé court et net,
Ayant au dos sa Rhetorique,
Et les oreilles d’un Baudet.
Quelqu’un des Courtisans luy dit qu’à la potence
Il vouloit l’aller voir ; et que pour un pendu
Il auroit bonne grace, et beaucoup de prestance :
Surtout qu’il se souvinst de faire à l’assistance
Un discours où son art fut au long étendu ;
Un discours pathetique, et dont le formulaire
Servist à certains Cicerons
Vulgairement nommez larrons.
L’autre reprit : Avant l’affaire
Le Roy, l’Asne ou moy nous mourrons.
Il avoit raison. C’est folie
De compter sur dix ans de vie.
Soyons bien beuvans, bien mangeans,
Nous devons à la mort de trois l’un en dix ans.
XX. § [PØ] La Discorde. § L a Deesse Discorde ayant broüillé les Dieux,
Et fait un grand procès là-haut pour une pomme ;
On la fit déloger des Cieux.
Chez l’Animal qu’on appelle Homme
On la receut à bras ouverts,
Elle et Que-si que-non son frere,
Avecque Tien-et-mien son pere.
Elle nous fit l’honneur en ce bas Univers
De préferer notre Hemisphere
A celuy des mortels qui nous sont opposez ;
Gens grossiers, peu civilisez,
Et qui se mariant sans Prestre et sans Notaire,
De la Discorde n’ont que faire.
Pour la faire trouver aux lieux où le besoin
Demandoit qu’elle fust presente,
La Renommée avoit le soin
De l’avertir ; et l’autre diligente
Couroit viste aux debats, et prévenoit la paix ;
Faisoit d’une étincelle un feu long à s’éteindre.
La Renommée enfin commença de se plaindre
Que l’on ne luy trouvoit jamais
De demeure fixe et certaine.
Bien souvent l’on perdoit à la chercher sa peine.
Il falloit donc qu’elle eust un sejour affecté,
Un sejour d’où l’on pust en toutes les familles
L’envoyer à jour arresté.
Comme il n’estoit alors aucun Convent de Filles,
On y trouva difficulté.
L’Auberge enfin de l’Hymenée
Luy fut pour maison assignée.
XXI. § [PØ] La jeune Veuve. § L a perte d’un époux ne va point sans soupirs.
On fait beaucoup de bruit, et puis on se console.
Sur les aisles du Temps la tristesse s’envole ;
Le temps rameine les plaisirs.
Entre la Veuve d’une année,
Et la Veuve d’une journée,
La difference est grande. On ne croiroit jamais
Que ce fust la mesme personne.
L’une fait fuïr les gens, et l’autre a mille attraits.
Aux soûpirs vrais ou faux celle-là s’abandonne :
C’est toujours mesme note, et pareil entretien :
On dit qu’on est inconsolable ;
On le dit, mais il n’en est rien ;
Comme on verra par cette Fable,
Ou plutost par la verité.
L’Epoux d’une jeune beauté
Partoit pour l’autre monde. A ses costez sa femme
Lui crioit : Attends-moy, je te suis ; et mon ame,
Aussi-bien que la tienne, est preste à s’envoler.
Le mary fait seul le voyage.
La Belle avoit un pere homme prudent et sage :
Il laissa le torrent couler.
A la fin, pour la consoler,
Ma fille, luy dit-il, c’est trop verser de larmes :
Qu’a besoin le défunt que vous noyez vos charmes ?
Puisqu’il est des vivants, ne songez plus aux morts.
Je ne dis pas que tout à l’heure
Une condition meilleure
Change en des nôces ces transports ;
Mais aprés certain temps souffrez qu’on vous propose
Un époux beau, bien fait, jeune, et tout autre chose
Que le défunt. Ah ! dit-elle aussi-tost,
Un Cloître est l’époux qu’il me faut.
Le pere luy laissa digerer sa disgrace.
Un mois de la sorte se passe
L’autre mois on l’employe à changer tous les jours
Quelque chose à l’habit, au linge, à la coiffure.
Le deüil enfin sert de parure,
En attendant d’autres atours.
Toute la bande des Amours
Revient au colombier, les jeux, les ris, la danse,
Ont aussi leur tour à la fin.
On se plonge soir et matin
Dans la fontaine de Jouvence.
Le Pere ne craint plus ce défunt tant chery.
Mais comme il ne parloit de rien à nostre Belle,
Où donc est le jeune mary
Que vous m’avez promis, dit-elle ?
Epilogue §
B ornons icy cette carriere.
Les longs Ouvrages me font peur.
Loin d’épuiser une matiere,
On n’en doit prendre que la fleur.
Il s’en va temps que je reprenne
Un peu de forces et d’haleine
Pour fournir à d’autres projets.
Amour ce tyran de ma vie
Veut que je change de sujets ;
Il faut contenter son envie.
Retournons à Psiché : Damon vous m’exhortez
A peindre ses malheurs et ses felicitez.
J’y consens : peut-estre ma veine
En sa faveur s’échauffera.
Heureux si ce travail est la derniere peine
Que son époux me causera !