Frontispice §
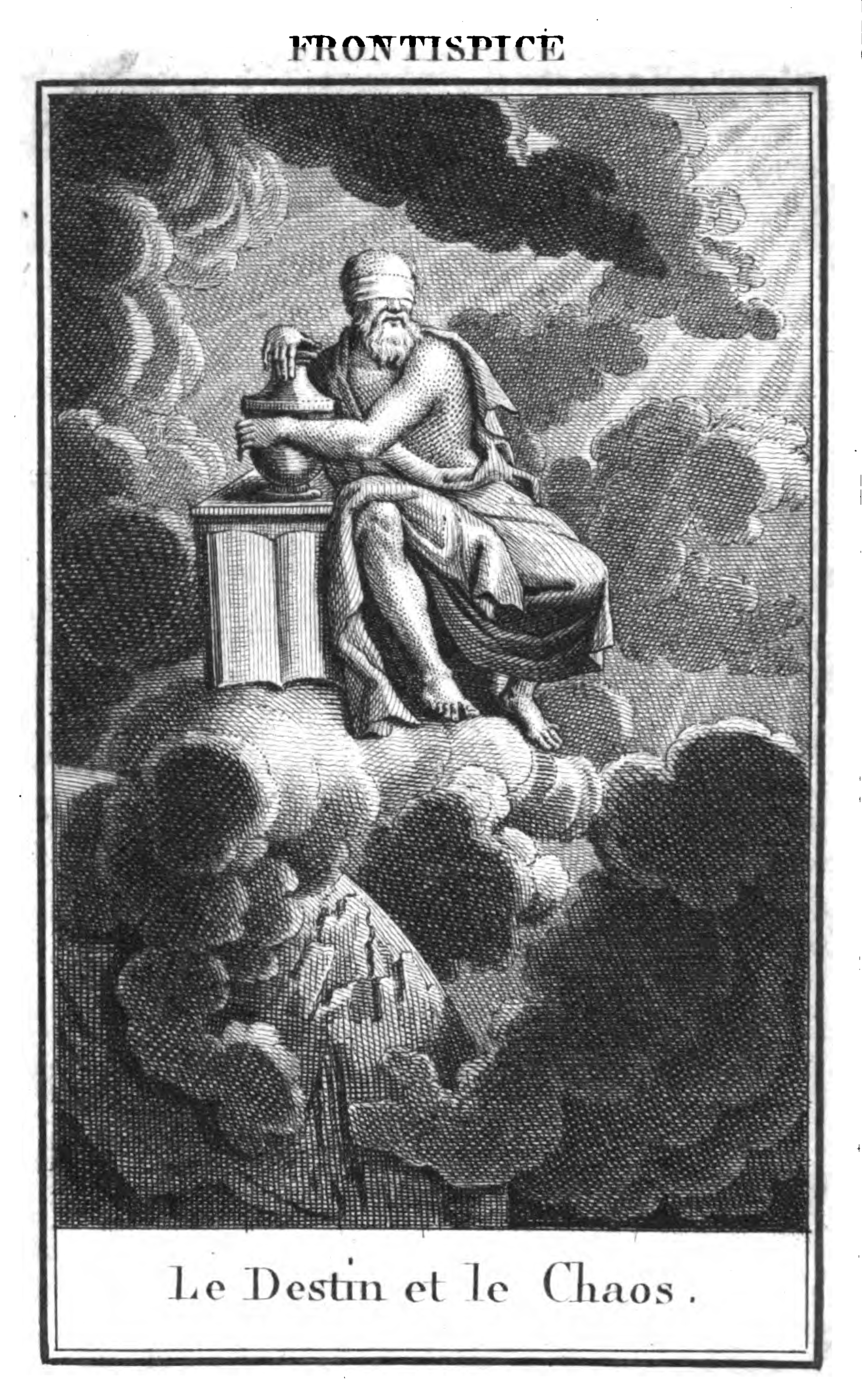
Manuel mythologique. §
Origine et utilité de la Mythologie §
Demande. Qu’est-ce que la Mythologie ?
Réponse. La Mythologie est la science de toutes les fables de l’antiquité païenne ; elle tire son nom de deux mots grecs, mythos et logos, qui signifient discours fabuleux.
D. Quelle est l’origine des fables qui font le sujet de la Mythologie ?
R. Ces fables doivent, leur naissance à l’altération de l’histoire sacrée et profane, à l’ignorance, au penchant pour le merveilleux, et sur-tout aux passions qui, après avoir affoibli l’idée d’un Dieu créateur, ne laissèrent plus juger des choses que par les sens. Bientôt on vit les hommes adorer le soleil et la lune, parce qu’aucun autre objet ne leur parut plus digne de fixer le principe de religion gravé dans touts les cœurs par l’auteur de la nature : ce premier égarement fut suivi d’une idolâtrie moins excusable. Vers l’an du monde 2700, Ninus, fils de Bélus, roi des Assyriens, fit élever, au milieu de Babylone, la statue de son père et, ordonna à touts ses sujets de lui rendre le culte qui est dû à la divinité. A l’exemple des Assyriens, les nations voisines adorèrent ceux de leurs rois, de leurs guerriers, de leurs grands hommes, qui avoient paru s’élever au-dessus de l’humanité. Saturne, Jupiter, Hercule, et plusieurs autres furent mis au rang des dieux, du consentement unanime de touts les peuples.
Bientôt une foule d’idolesUsurpa l’encens des mortels ;Dieux sans force, ornements frivolesDe leurs ridicules autels.Amoureux de son esclavage,Le monde offrit un fol hommageAux monstres les plus odieux :L’insecte eut des demeures saintesEt par ses desirs et ses craintesL’homme aveugle compta ses dieux.( .)
D. A quoi peut nous servir la connoissance des fables du paganisme ?
R. Cette connoissance nous est très-utile. Elle nous apprend quelle étoit la croyance religieuse des peuples les plus célèbres de l’antiquité. Elle nous facilite l’intelligence des anciens écrivains, et sur-tout celle des poëtes. Elle nous fait comprendre l’intention qu’ont eue les peintres et les sculpteurs dans une infinité de leurs ouvrages. La fable est l’ame de la poésie, qui ne dit rien naturellement, mais relève tout par des images et un langage surnaturel. Ici, les bergers sont des satyres, ou des faunes ; les bergères, des nymphes ; les hommes à cheval, des centaures ; les vaisseaux, tantôt des chevaux ailés, comme dans l’histoire de Bellérophon ; tantôt des dragons, comme dans celle de Médée ; on appela les oranges, des pommes d’or. L’or fut regardé comme une pluie de ce précieux métal, comme dans la fable de Danaé ; les flèches passèrent pour des foudres et des carreaux ; etc. Écoutons Boileau à ce sujet :
Là, pour nous enchanter, tout est mis en usage :Tout prend un corps, une ame, un esprit, un visage ;Chaque vertu devient une divinité.Minerve est la prudence, et Vénus, la beauté.Ce n’est plus la vapeur qui produit le tonnerre,C’est Jupiter armé pour effrayer la terre.Un orage terrible aux yeux des matelots,C’est Neptune en courroux qui gourmande les flots.Écho n’est plus un son qui dans l’air retentisse,C’est une nymphe en pleurs, qui se plaint de Narcisse.Ainsi, dans cet amas de nobles fictions,Le poëte s’égaie en mille inventions,Orne, élève, embellit, agrandit toutes choses,Et trouve sous sa main des fleurs toujours écloses.
D. Les anciens reconnoissoient-ils un grand nombre de dieux ?
R. Oui. en compte jusqu’à trente mille ; et nous représente Atlas gémissant sous le poids du ciel, à cause du grand nombre de dieux qu’on y avoit placés.
D. En combien de classes les anciens partageoient-ils leurs dieux ?
R. Ils les partageoient en quatre classes. La première comprenoit les dieux suprêmes, ou les grands dieux ; ils étoient au nombre de vingt, dont douze seulement étoient admis au conseil céleste : c’étoient Jupiter, Junon, Neptune, Cérès, Mercure, Minerve, Vesta, Apollon, Diane, Vénus, Mars et Vulcain. Les huit autres étoient le Destin, Saturne, Génius, Pluton, Bacchus, l’Amour, Cybèle et Proserpine.
La seconde classe renfermoit les dieux subalternes, qui veilloient aux champs, aux fleurs, aux fontaines, aux arbres, etc. ; tels que Pan, Pomone, Vertumne, et une multitude d’autres, qu’
appelle la
populace des dieux
.
On plaçoit dans la troisième classe les demi-dieux, ainsi nommés, parce qu’ils étoient nés d’un dieu et d’une mortelle, ou d’un homme et d’une déesse, tels que Hercule, Castor et Pollux ; etc.
Enfin, la quatrième classe contenoit les héros, c’est-à-dire, les rois et les guerriers illustres que les anciens poëtes ont célébrés ; tels que Agamemnon, Achille, Ulysse, etc.
Première partie. Dieux de la première classe. §
Le Destin. §
Demande. Qu’est-ce que le Destin ?
Réponse. Le Destin étoit une divinité aveugle qui gouvernoit toutes choses par une nécessité inévitable. Les autres dieux et Jupiter lui-même, étoient soumis à ses décrets. Il avoit son culte et ses oracles. Il passoit pour être fils de la Nuit. On le représente avec un bandeau sur les jeux, tenant l’urne qui renferme le sort des humains, et un livre où l’avenir est écrit d’une manière immuable. Les dieux alloient consulter ce livre, mais ils ne pouvoient y rien changer.
décrit ainsi le temple du Destin :
Loin de la sphère où grondent les orages,Loin des soleils, par-delà touts les cieux,S’est élevé cet édifice affreuxQui se soutient sur le gouffre des âges.D’un triple airain touts les murs sont couverts ;Et, sur les gonds quand les portes mugissent,Du temple alors les bases retentissent ;Le bruit pénètre et s’entend aux enfers.Les vœux secrets, les prières, la plainte,Et notre encens détrempé de nos pleurs,Viennent, hélas ! comme autant de vapeurs,Se dissiper autour de cette enceinte.Là, tout est sourd à l’accent des douleurs.Multipliés en échos formidables,Nos cris en vain montent jusqu’à ce lieu ;Ces cris perçants, et ces voix lamentablesN’arrivent point aux oreilles du dieu.A ses regards un bronze incorruptibleOffre en un point l’avenir ramassé.L’urne des sorts est dans sa main terrible ;L’axe des temps par lui seul est fixé.Sous une voûte où l’acier étincelle,Est enfoncé le trône du Destin ;Triste barrière et limite éternelle,Inaccessible à tout l’effort humain.Morne, immobile, et dans soi recueillie,C’est de ce lien que la Nécessité,Toujours sévère, et toujours obéie,Lève sur nous son sceptre ensanglanté,Ouvre l’abyme où disparoît la vie,D’un bras de fer courbe le front des rois,Tient sous ses pieds la terre assujettie,Et dit au Temps : « Exécute mes lois. »
D. Le Temps est donc chargé d’exécuter les ordres du Destin ?
R. Oui ; et nous l’apprend pareillement dans sa Henriade. Voici ce qu’il raconte de Saint Louis, au chant septième.
Comme il disoit ces mots d’une voix gémissante,Le palais des destins devant lui se présente :Il fait marcher son fils vers ces sacrés remparts,Et cent portes d’airain s’ouvrent à ses regards.Le Temps, d’une aile prompte, et d’un vol insensible,Fuit et revient sans cesse à ce palais terrible,Et de là sur la terre il verse, à pleines mains,Et les biens et les maux destinés aux humains.Sur un autel de fer un livre inexplicableContient de l’avenir l’histoire irrévocable.
Le Chaos §
D. Qu’appelez-vous Chaos ?
R. Le Chaos est cette masse informe, dans laquelle le ciel, la terre, la mer, touts les éléments étoient confondus.
Avant que l’air, les eaux et la lumière,Ensevelis dans la masse première,Fussent éclos, par un ordre immortel,Des vastes flancs de l’abyme éternel,Tout n’étoit rien. La nature enchaînée,Oisive et morte, avant que d’être née,Sans mouvement, sans forme, sans vigueur,N’étoit qu’un corps abattu de langueur,Un sombre amas de principes stériles,De l’existence éléments immobiles.Dans ce chaos (ainsi par nos aïeuxFut appelé ce désordre odieux),En pleine paix, sur son trône, affermieRégna long-temps la Discorde ennemie,Jusqu’à ce jour pompeux et florissant,Qui donna l’être à l’univers naissant ;Quand l’Harmonie, architecte du monde,Développant, dans cette nuit profonde,Les éléments pêle-mêle diffus,Vint débrouiller leur mélange confus,Et, variant leurs formes assorties,De ce grand tout animer les parties.Le Ciel reçut, en son vaste contour,Les feux brillants de la nuit et du jour,L’air moins subtil assembla les nuages,Poussa les vents, excita les orages :L’eau vagabonde en ses flots inconstantsMit à couvert ses muets habitants :La Terre enfin, cette tendre nourriceDe touts nos biens sage modératrice,Inépuisable en principes féconds,Fut arrondie, et tourna sur ses gonds,Pour recevoir la céleste influenceDes doux présents que son sein nous dispense.( .)
Saturne. §

D. De qui Saturne étoit-il fils ?
R. Saturne étoit fils du Ciel, le plus ancien des dieux, et de la Terre, la plus ancienne des déesses. Le Ciel s’appeloit encore Uranus, et la Terre étoit aussi nommée Vesta. Mais elle doit être alors distinguée de Vesta, déesse du feu et de la virginité.
D. Le Ciel n’eut-il de fils que Saturne ?
R. Il eut encore Titan, qui étoit l’aîné. Mais celui-ci, pour complaire à sa mère, céda l’empire du monde à Saturne, son cadet, à condition cependant qu’il n’élèveroit aucun enfant mâle. C’est pourquoi Saturne les dévoroit sitôt qu’ils étoient nés. Mais Cybèle, sa femme, ayant eu d’une seule couche Jupiter et Junon, cacha Jupiter et présenta à son mari une, pierre emmaillottée qu’il dévora. Cybèle fit élever secrètement Jupiter dans l’île de Crète.
D. Titan ne découvrit-il point la supercherie de Cybèle ?
R. Oui ; et il déclara aussitôt la guerre à son frère Saturne. Il le vainquit et le renferma dans une étroite prison, avec Cybèle. Jupiter, devenu grand, les en délivra.
D. Que fit Saturne, lorsqu’il fut rétabli sur le trône ?
R. Il avoit lu dans le livre du Destin, que Jupiter lui enlèveroit son royaume. Pour prévenir ce malheur, il déclara la guerre à son fils, et lui tendit des embûches, où il croyoit le faire périr. Mais Jupiter le vainquit, et le chassa pour toujours du ciel.
D. Où se réfugia Saturne ?
R. Il se réfugia en Italie, où Janus, roi du pays Latin, l’accueillit, et partagea son trône avec lui. Cette contrée fut ensuite appelée le Latium, d’un mot latin qui signifie se cacher, parce qu’elle avoit servi de retraite à Saturne.
D. Comment se comporta Saturne dans le Latium ?
R. Il enseigna aux hommes l’agriculture, et fit fleurir les arts et la vertu. Tout le temps qu’il passa dans cette contrée, fut appelé l’âge d’or. Voici la description que nous a donnée de ce siècle où les hommes furent si heureux :
Touts les plaisirs couroient au-devant de leurs vœux :La faim aux animaux ne faisoit point la guerre ;Le blé, pour se donner, sans peine ouvrant la terre,N’attendoit pas qu’un bœuf, pressé par l’aiguillon,Traçât d’un pas tardif un pénible sillon :La vigne offroit par-tout des grappes toujours pleines,Et des ruisseaux de lait serpentoient dans les plaines.
D. Quels noms donna-t-on aux âges qui suivirent le siècle d’or ?
R. On les appela l’âge d’argent, l’âge d’airain, et l’âge de fer, parce que les hommes se sont toujours pervertis de plus en plus.
D. Que fit Saturne en faveur de Janus qui l’avoit si bien accueilli ?
R. Saturne lui accorda la connoissance du passé et celle de l’avenir. Voilà pourquoi Janus est représenté avec deux visages opposés. Le mois de janvier lui fut consacré. On lui mettoit une clef à la main droite, pour marquer qu’il ouvroit l’année ; il tenoit à la gauche une baguette, comme présidant aux augures. Les Romains lui bâtirent un temple, dans lequel il y avoit douze autels, un pour chaque mois de l’année. Ce temple étoit toujours ouvert durant la guerre, et fermé durant la paix.
D. Quels sont les attributs de Saturne ?
R. Saturne étoit regardé comme le Temps, divinité allégorique, représentée sous la figure d’un vieillard, tenant une faux de la main droite, et de l’autre un serpent qui se mord la queue. On lui donne des ailes, et l’on place près de lui un sablier. La faux indique que le temps moissonne tout ; le serpent qui forme un cercle, désigne l’éternité, qui n’a ni commencement ni fin. Le sablier indique la mesure du temps, et les ailes sa rapidité.
Voici le beau portrait que le poëte nous en a laissé :
Ce vieillard, qui d’un vol agile,Fuit sans jamais être arrêté,Le Temps, cette image mobileDe l’immobile éternité,A peine du sein des ténèbres,Fait éclore les faits célèbres,Qu’il les replonge dans la nuit ;Auteur de tout ce qui doit être,Il détruit tout ce qu’il fait naître,A mesure qu’il le produit.
D. Comment nommoit-on les fêtes de Saturne ?
R. Elles se nommoient Saturnales. On les célébroit, à Rome, au mois de décembre. Pendant qu’elles duroient, le sénat ne tenoit point ses assemblées, les écoles publiques étoient fermées, les déclarations de guerre et les exécutions criminelles étoient suspendues et les maîtres servoient à table leurs esclaves, pour marquer que touts les hommes étoient égaux, et que touts les biens étoient communs, sous le règne du bon Saturne.
Cybèle. §
D. Qu’étoit Cybèle ?
R. Cybèle étoit femme de Saturne. Les poëtes lui ont donné différents noms. Ceux de Dindymène, de Bérécynthie et d’Idée, lui viennent de trois montagnes de Phrygie, Dindyme, Bérécynthe et Ida, où elle étoit principalement honorée. Elle étoit aussi appelée la grande mère, parce qu’elle est la mère de la plupart des dieux. On la nommoit encore Ops et Tellus : Ops, veut dire secours, parce qu’elle donnoit du secours aux humains : Tellus signifie terre, parce qu’elle présidoit à la terre, comme Saturne présidoit au ciel. Enfin, elle eut le nom de Rhée, d’un mot grec qui veut dire, je coule, parce que toutes choses coulent, proviennent de la terre.
D. Comment représente-t-on Cybèle ?
R. Elle est représentée assise, parce que les anciens regardoient la terre comme stable. Elle tient un disque ou un tambour, symbole des vents que la terre renferme dans son sein, et qui en sortent avec bruit. On lui donne une couronne de tours et de créneaux de murailles.
D. Quelles étoient les fêtes établies en l’honneur de Cybèle ?
R. Les fêtes de Cybèle s’appeloient les fêtes Mégalésiennes, ou les jeux Mégalésiens. Ce mot vient d’un adjectif grec qui signifie grande, parce que c’étoient les fêtes de la grande déesse. Elles se célébroient au son des tambours, avec des hurlements et des cris extraordinaires. Les prêtres de cette déesse se nommoient Corybantes.
D. Cybèle n’est-elle pas aussi regardée comme déesse du feu ?
R : Oui ; et alors on l’appelle Vesta. Les poëtes distinguent jusqu’à trois Vesta, l’une femme du Ciel, l’autre femme de Saturne, et une troisième qui seroit fille de ce dieu.
Numa Pompilius, second roi de Rome, avoit consacré à Cybèle, sous le nom de Vesta, un feu perpétuel, dont le soin étoit confié à des vierges appelées vestales. On ne pouvoit rallumer ce feu qu’avec les rayons du soleil : s’il s’éteignoit par la faute des vestales, ou si ces jeunes filles violoient leur vœu de virginité, elles étoient enterrées toutes vives.
Jupiter. §

D. Quel rang tient Jupiter parmi les dieux ?
R. Jupiter, fils de Saturne et Cybèle, est regardé comme le plus grand et le plus puissant des dieux : c’étoit le roi du ciel et de la terre.
Une voie en tout temps par les dieux fréquentée,Blanchit l’azur des cieux ; on la nomme Lactée.Elle sert d’avenue à l’auguste séjourOù Jupiter réside au milieu de sa cour.On voit aux deux côtés, sous de vastes portiques,S’ouvrir à deux battants des portes magnifiques,Vestibules pompeux des dieux patriciens.Ailleurs, sont confondus les toits des plébéiens.Au milieu du parvis la façade présenteDes Dieux du premier rang la demeure imposante.C’est là, s’il faut le dire en langage mortel,La cour de Jupiter, et le sénat du ciel.Le dieu, le sceptre en main, se place sur son trône ;L’immortelle assemblée en cercle l’environne.De son auguste front le calme s’est troublé ;Et la terre, et les mers, et les cieux ont tremblé.( , trad. de .)
D. Comment Jupiter fut-il élevé ?
R. Jupiter fut élevé secrètement dans l’île de Crète, sur le mont Ida. Pour empêcher que ses cris ne le découvrissent à Saturne et à Titan, les corybantes inventèrent une sorte de danse, dans laquelle ils s’entre-frappoient avec des boucliers d’airain. Il fut nourri du lait de la chèvre Amalthée, qu’il plaça dans le ciel, en reconnoissance des bons offices qu’il en avoit reçus. Il donna une de ses cornes aux nymphes qui avoient pris soin de son enfance, avec la vertu de produire tout ce que desireroit celui qui en seroit le possesseur. C’est la corne d’abondance. Selon d’autres mythologues, la corne d’abondance est celle qu’Hercule arracha à Achéloüs changé en taureau.
D. Que fit Jupiter, lorsqu’il fut devenu grand ?
R. Il détrôna Saturne son père, épousa Junon sa sœur, et partagea l’empire du monde avec ses deux frères Neptune et Pluton. Il donna l’empire des eaux Neptune, celui des enfers à Pluton ; et garda le ciel pour lui.
D. Après ce partage de l’univers, Jupiter régna-t-il tranquillement ?
R. Non. Les Titans, ou les géants, fils de la Terre et de Titan, entreprirent de rétablir leur père sur le trône, et d’en chasser Jupiter. Ils s’assemblèrent dans la Thessalie, et entassèrent montagnes sur montagnes pour escalader le ciel. Mais Jupiter les renversa à coups de foudre, et les accabla sous les montagnes qu’ils avoient amassées.
La demeure des dieux ne fut pas respectée.On dit que des géants l’audace révoltée,Ivre du fol orgueil d’attaquer Jupiter,Entassant monts sur monts, escalada l’éther.Mais le maître des dieux, armant sa main puissante,Foudroya de leurs monts la menace effrayante,Et les débris d’Ossa haussé sur PélionEcrasèrent l’orgueil de leur rébellion.( , trad. de .)
D. Jupiter put-il tout seul venir à bout de tant d’ennemis ?
R. Il avoit appelé les autres dieux pour combattre et pour partager le péril avec lui ; mais les dieux furent si épouvantés à la vue des géants, qu’ils s’enfuirent touts en Égypte, où ils se cachèrent sous diverses formes d’animaux : c’est pour cela que, dans la suite, les Egyptiens rendirent aux bêtes des honneurs divins ; Bacchus eut plus de courage que les autres dieux : car, ayant pris la figure d’un lion, il combattit avec fermeté pendant quelque temps animé par Jupiter qui lui crioit sans cesse : Courage, courage, mon fils !
D. Quels sont les plus fameux d’entre les géants qui firent la guerre à Jupiter ?
R. Ce furent : Briarée, qui avoit cent bras et cinquante têtes ; Typhée, demi-homme et demi-serpent, dont la tête atteignoit les cieux ; et Encelade, qui lançoit des rochers affreux contre l’Olympe. Les poëtes ont feint que ce géant avoit été abymé sous le mont Etna, en Sicile, et que toutes les fois qu’il vouloit se remuer ou changer de côté, il causoit des tremblements de terre.
Encelade, malgré son air rébarbatif,Sous le terrible Etna fut enterré tout vifLà, chaque fois qu’il éternue,Un volcan embrase les airs,Et quand, par malheur, il remue.Il met la Sicile à l’envers.
D. Quel soin occupa Jupiter, lorsqu’il se trouva paisible possesseur de l’empire du monde ?
R. Il s’appliqua à former l’homme. Prométhée, petit-fils du Ciel, ayant voulu imiter Jupiter, fit avec de la terre, quelques statues d’hommes, et, pour les animer, monta au ciel, par le secours de Pallas, et vola du feu au char du soleil. Jupiter, irrité de cette audace, ordonna à Mercure d’attacher Prométhée sur le mont Caucase, où un aigle lui rongeoit le foie, qui, en renaissant sans cesse, éternisoit son supplice. Hercule, dans la suite, tua l’aigle, et délivra Prométhée.
D. Quel dessein le châtiment de Prométhée inspira-t-il aux autres dieux ?
R. Les autres dieux, indignés que Jupiter prétendit avoir seul le droit de créer des hommes, firent fabriquer une femme par Vulcain ; et, pour la rendre parfaite, chacun lui fit son présent. Pallas, lui donna la sagesse ; Vénus, la beauté ; Mercure, l’éloquence ; etc., et on l’appela Pandore, nom composé de deux mots grecs qui signifient tout don.
D. Jupiter ne fit-il pas aussi son présent à Pandore ?
R. Oui. Jupiter, pour punir l’orgueil des dieux, feignit de vouloir aussi combler Pandore de ses dons. Il lui fit présent d’une boîte, qu’il lui ordonna de porter à Épiméthée, frère de Prométhée. Épiméthée, par une fatale curiosité, ouvrit la boîte, et aussitôt touts les maux de la nature, qui y étoient renfermés, se répandirent sur la terre. L’espérance seule resta au fond.
Voici ce que dit à ce sujet :
D’où peut venir ce mélange adultèreD’adversités, dont l’influence altère.Les plus beaux dons de la terre et des cieux ?L’antiquité nous mit devant les yeuxDe ce torrent la source emblématique,En nous peignant cette femme mystique,Fille des dieux, chef-d’œuvre de Vulcain,A qui le ciel, prodiguant par leur mainTouts les présents dont l’Olympe s’honore,Fit mériter le beau nom de Pandore.L’urne fatale, où les afflictions,Les durs travaux, les malédictions,Jusqu’à ce temps des humains ignorés,Avoient été par les dieux resserrés,Pour le malheur des mortels douloureux,Fut confiée à des soins dangereux.Fatal desir de voir et de connoître !Elle l’ouvrit, et la terre en vit naître,Dans un instant, touts les fléaux diversQui depuis lors inondent l’univers.Quelle que soit, ou vraie, ou figurée,De ce revers l’histoire aventuréeN’en doutons point, la curiositéFut le canal de notre adversité.
D. Quels sont les différents noms donnés à Jupiter ?
R. Le principal surnom de Jupiter étoit Olympien, parce qu’on prétendoit qu’il demeuroit avec toute sa cour sur le sommet du mont Olympe : on l’appeloit aussi le père du jour ; d’autres l’invoquoient sous le nom de Jupiter-Hospitalier, parce qu’il étoit regardé comme le protecteur des hôtes, et le dieu particulier de l’hospitalité. Il y avoit encore Jupiter-Capitolin, Jupiter-Tarpéien, parce qu’il avoit un temple sur le mont du Capitole, et un autre sur la roche Tarpéienne. Enfin, il étoit nommé Jupiter-Ammon et Jupiter-Stator.
D. Pourquoi le maître des dieux fut-il surnommé Jupiter-Ammon ?
R. Ammon, en grec, veut dire arène ou sable. Or, Bacchus s’étant égaré un jour dans les sables brûlants de l’Arabie, fut pris d’une soif ardente, et ne pouvoit trouver une goutte d’eau. Dans cette extrémité, Jupiter se présente à lui sous la forme d’un bélier, frappe du pied la terre, et fait jaillir une source abondante. Bacchus, en reconnoissance, éleva dans cet endroit un temple sous l’invocation de Jupiter-Ammon, c’est-à-dire, Jupiter des Arènes.
D. Pourquoi Jupiter fut-il surnommé Stator ?
R. Ce surnom lui vient du verbe latin stare, qui signifie s’arrêter, en mémoire de ce que Jupiter avoit tout à coup arrêté les Romains, lorsqu’ils commençoient à prendre la fuite, en combattant contre les Sabins.
D. Les métamorphoses de Jupiter sont souvent célébrées par les poëtes, voulez-vous nous faire connoître ces métamorphoses ?
R. On appelle métamorphose la transformation ou le changement d’une forme en une autre. Jupiter, dégoûté de Junon, aima plusieurs mortelles, et prit différentes figures pour les séduire. Il se transforma en cygne pour tromper Léda, dont il eut Castor et Pollux ; il se changea en pluie d’or, pour pénétrer dans la tour d’airain où étoit enfermée Danaé, qui le rendit père de Persée ; il prit la figure d’un taureau, pour enlever Europe, qui lui donna Minos et Rhadamante ; il se métamorphosa en satyre pour surprendre Antiope, dont il eut Zéthus et Amphion. Il se présenta à Alcmène, épouse d’Amphytrion, roi de Mycènes, sous la forme de ce prince, et devint père d’Hercule. Il prit la taille et la figure d’un jeune homme, pour plaire à Sémélé, qui donna le jour à Bacchus. Il emprunta les traits de Diane pour tromper la nymphe Calisto, qui mit au monde Arcas. Enfin, il se fit berger, pour séduire Mnémosyne, de laquelle il eut les neuf Muses.
D. Comment Jupiter est-il ordinairement représenté ?
R. On le représente assis sur un aigle ou sur un trône d’or, au pied duquel sont les deux coupes du bien et du mal qu’il répand à son gré sur le monde. Son front est chargé de sombres images ; ses yeux, menaçants brillent sous de noirs sourcils, son menton est couvert d’une barbe majestueuse, il tient le sceptre d’une main ; de l’autre, il lance la foudre. Les vertus siégent à ses côtés. On le revêt aussi d’un manteau d’or. Denys le Tyran étant entré dans un temple, lui fit ôter ce vêtement, en disant qu’il étoit
pesant en été, et froid en hiver
; il lui en fit mettre un autre de laine, qu’il prétendoit être
propre aux quatre saisons
.
D. Qu’est-ce que l’aigle de Jupiter ?
R. Périphas, roi d’Athènes, se fit tellement aimer de ses sujets, qu’il fut adoré comme Jupiter. Le souverain des dieux en fut si violemment irrité, qu’il voulut foudroyer Périphas ; mais Apollon intercéda pour lui, et obtint qu’il fût changé en aigle. Jupiter s’en servoit pour traverser les airs.
D. Quel arbre étoit consacré à Jupiter ?
R. C’étoit le chêne, parce que Jupiter, à l’exemple de Saturne, apprit aux hommes à se nourrir de gland. On prétend que les chênes de la forêt de Dodone, en Épire, rendoient des oracles. Cette forêt étoit consacrée à Jupiter, qui y avoit un temple, sous le nom de Jupiter-Dodonéen.
Junon. §
D. De qui Junon étoit-elle fille ?
R. Junon étoit fille de Saturne et de Cybèle, et sœur de Jupiter, qui se transforma en un oiseau pour la séduire. Mais la déesse le reconnut, et ne voulut l’écouter qu’à condition qu’il l’épouseroit. Junon devint ainsi la reine des dieux. Elle étoit la déesse des royaumes ; mais elle présidoit sur-tout aux mariages et aux accouchements, sons le nom de Lucine.
D. Quel étoit le caractère de Junon ?
R. Junon étoit d’un caractère impérieux, jaloux et vindicatif. Elle épioit sans cesse les démarches de son époux. Elle persécuta cruellement les femmes qui furent aimées de Jupiter, et même les enfants qu’elles lui donnèrent.
D. Racontez quelques-uns des traits de la vengeance de Junon.
R. Jupiter aimoit Io, fille d’Inachus, le plus ancien roi d’Argos. Pour dérober à Junon la connoissance de cette passion, il changeoit Io en vache. Mais Junon, soupçonnant cette métamorphose, demanda la vache à Jupiter, qui n’osa la lui refuser. Junon la donna à garder à Argus, qui avoit cent yeux, dont cinquante étoient toujours ouverts quand les cinquante autres étoient fermés par le sommeil. Mercure endormit cet espion au son de sa flûte, et le tua. Junon le changea en paon, et attacha les yeux d’Argus à la queue de cet oiseau, qu’elle prit sous sa protection. Cependant., elle mit à la poursuite d’Io, un taon, qui la piquoit continuellement, et lui fit parcourir tout l’univers. On dit qu’en passant auprès de son père, elle écrivit son nom sur le sable avec son pied. Inachus l’ayant reconnue, alloit s’en saisir, lorsque le taon la piqua si vivement, qu’elle se jeta à la mer, passa à la nage toute la Méditerranée, et arriva en Egypte, ou Jupiter lui rendit sa première forme. Ce fut là qu’elle mit au monde Epaphus ; elle y fut depuis adorée sous le nom d’Isis, et représentée sous la forme d’une femme ayant une tête de vache.
D. Quelle vengeance Junon exerça-t-elle contre la ville de Troie ?
R. Junon ne put jamais pardonner à Pâris de ne lui avoir point donné la pomme d’or sur le mont Ida, lorsqu’elle disputa de la beauté avec Vénus et Pallas : elle se déclara dès lors l’ennemie irréconciliable des Troyens, et poursuivit sa vengeance, après la ruine de cette ville, jusque sur Énée ;
Errant en cent climats, triste jouet des flots,Long-temps le sort cruel poursuivit ce héros,Et servit de Junon la haine infatigable.Que n’imagina point la déesse implacable ?Muse, raconte-moi ces grands événements,Dis pourquoi de Junon les fiers ressentiments,Poursuivant en touts lieux le malheureux Enée,Troublèrent si long-temps la haute destinéeD’un prince magnanime, humain, religieux :Tant de fiel entre-t-il dans les ames des dieux ?…Une autre injure parle à son ame indignée :Par un berger troyen sa beauté dédaignée,L’odieux jugement qui fit rougir son front,Hébé pour Ganymède essuyant un affront,Tout l’irrite à la fois, et sa haine bravéeVit au fond de son cœur profondément gravée…Cependant les Troyens, après de longs efforts,Des champs Trinacriens1 avoient rasé les bords,Déjà leurs nefs, perdant l’aspect de la Sicile,Voguoient à pleine voile, et de l’onde docileFendoient d’un cours heureux les bouillons écumants,Quand la fière Junon, de ses ressentimentsNourrissant dans son cœur la blessure immortelle,« Quoi ! sur moi les Troyens l’emporteroient, dit-elle !» Et de ces fugitifs le misérable roi» Pourroit dans l’Italie aborder malgré moi !…» O fureur ! Quoi ! Pallas, une simple déesse,» A bien pu foudroyer les vaisseaux de la Grèce ;» Soldats, chefs, matelots, tout périt sous ses yeux :» Pourquoi ? pour quelques torts d’un jeune furieux,» Elle-même, tonnant du milieu des nuages,» Bouleversa les mers, déchaîna les orages,» Dans un noir tourbillon saisit l’infortuné,» Qui vomissoit des feux de son flanc sillonné,» Et de son corps lancé sur des roches perçantes» Attacha les lambeaux à leurs pointes sanglantes :» Et moi, qui marche égale au souverain des cieux,» Moi, l’épouse, la sœur du plus puissant des dieux,» Armant contre un seul peuple et le ciel et la terre,» Vainement je me lasse à lui livrer la guerre !» Suis-je encore Junon ? et qui d’un vain encens» Fera fumer encor mes autels impuissants ? »(Énéide, trad. de M. .)
D. Quelle peine terrible Junon infligea-t-elle aux Prœtides ?
R. Les Prœtides, filles de Prœtus, roi d’Argos, étoient fort belles. Elles eurent la hardiesse de comparer leur beauté à celle de Junon. La déesse, indignée de ce téméraire orgueil, rendit les Prœtides si furieuses, qu’elles s’imaginèrent être changées en vaches, et couroient en mugissant dans les forêts voisines :
Triste Pasiphaé !… quelle fureur t’inspire,Les filles de Prœtus, par un même délire,Effrayèrent Argos d’un faux mugissement ;Mais, loin de leur démence un tel emportement !Elles croyoient pourtant, s’inclinant vers la terre,Agiter sur leur tête une corne étrangère.
D. Pouvez-vous nous donner encore quelques exemples de l’humeur vindicative de Junon ?
R. Jupiter avoit enlevé Europe. Junon, persécuta cette princesse jusque dans les descendants de son frère Cadmus. Elle fit périr Sémélé, mère de Bacchus. Elle suscita une infinité de traverses à Hercule. Enfin, elle crut devoir faire sentir sa vengeance à son époux lui-même. Elle le quitta donc, et se retira à Samos. Jupiter consulta Vénus sur les moyens de la faire revenir. Cette déesse lui conseilla de faire placer sur un char une figure richement parée, et de faire annoncer que c’étoit Platée, fille d’Asope, qu’il alloit épouser. A cette nouvelle, Junon accourut furieuse et se jeta sur la statue, qu’elle brisa. Cette aventure la couvrit de honte, sans la rendre plus sage.
D. Jupiter et Junon eurent-ils des enfants ?
R. Vulcain fut le seul fruit de leur union.
D. La fable ne donne-t-elle pas d’autres enfants à Junon ?
R. La fable lui attribue encore Hébé et Mars. On raconte ainsi la naissance de ces deux enfants :
Junon, suivant l’avis d’Apollon, mangea, au banquet de Jupiter, un plat de laitues sauvages, et conçut Hébé, dont elle accoucha sur le champ. La naissance de Mars n’est pas moins extraordinaire. Junon, jalouse de ce que Jupiter avoit seul enfanté Minerve, voulut, de son côté, opérer un pareil prodige. Elle en parla à Flore, qui lui indiqua une fleur, que la déesse toucha et aussitôt elle devint mère de Mars.
D. Quel étoit l’emploi d’Hébé ?
R. Hébé étoit la déesse de la jeunesse. Elle fut chargée par Jupiter de verser le nectar aux dieux ; Mais s’étant laissée tomber un jour dans leur assemblée, elle en eut tant de honte, qu’elle n’osa plus y reparoître. Jupiter mit à la place d’Hébé, le beau Ganymède, fils de Tros, qu’il fit enlever par un aigle, lorsque ce jeune homme chassoit sur le mont Ida.
D. Quels étoient les lieux principalement consacrés au culte de Junon ?
R. Cette déesse étoit particulièrement honorée à Samos. Mais c’étoit surtout dans la ville d’Argos, qu’elle jouissoit de toute sa gloire. On y célébroit ses fêtes par le sacrifice d’une hécatombe, c’est-à-dire, de cent taureaux.
D. Comment Junon est-elle représentée ?
R. Elle est ordinairement représentée sur un char brillant traîné par deux paons. Elle a le sceptre en main, et le front couronné de lis et de roses. On place toujours auprès d’elle un paon, son oiseau favori. Quelquefois on y ajoute un arc-en-ciel, parce que Junon aima tendrement Iris, sa confidente et sa messagère. La reine des dieux, contente des services d’Iris, qui ne lui apportoit jamais que de bonnes nouvelles, la transporta au ciel. C’est ce que nous appelons l’arc-en-ciel.
Cérès. §

D. De qui Cérès fut-elle fille ?
R. Elle fut fille de Saturne et de Cybèle. Elle étoit la déesse des moissons. Elle enseigna aux hommes l’agriculture, en parcourant l’univers, pour chercher sa fille Proserpine que Pluton avoit enlevée.
D. Racontez l’histoire de l’enlèvement de Proserpine.
R. Pluton, dieu des enfers, étoit si noir, et avoit un royaume si affreux, que toutes les déesses avoient rejeté ses hommages. Il vit un jour Proserpine qui cueilloit des fleurs avec quelques-unes de ses compagnes, dans la plaine d’Enna, en Sicile. Il l’enleva, malgré les vives oppositions de la nymphe Cyanè, qu’il changea en fontaine. Le dieu, ayant ouvert la terre d’un coup de son trident, rentra dans ses états avec sa proie.
D. Que fit Cérès, lorsqu’elle sut le malheur de sa fille ?
R. Elle alluma deux flambeaux sur le mont Etna, pour la chercher de nuit comme de jour. Lorsqu’elle arriva à la cour de Céléus, roi d’Eleusis, elle enseigna particulièrement l’agriculture à Triptolème, fils de ce prince ; elle continua son voyage, et rencontra la nymphe Aréthuse, qui lui apprit que Proserpine étoit aux enfers. Cérès s’adressa alors à Jupiter, père de Proserpine, et le conjura de lui faire rendre sa fille. Jupiter y consentit, pourvu qu’elle n’eût rien mangé dans les enfers. Mais Ascalaphe rapporta qu’il avoit vu Proserpine sucer une grenade. Cérès changea ce dénonciateur en hibou, oiseau de mauvais augure. Jupiter, pour consoler Cérès, ordonna que Proserpine passeroit six mois de l’année avec elle, et les six autres mois avec son mari.
D. Pourquoi Cérès changea-t-elle Stellio en lézard ?
R. On raconte qu’un jour, cette déesse, fatiguée de ses courses, et épuisée de besoin, entra dans la cabane d’une vieille femme nommée Bécubo ou Baubo, qui lui présenta de la bouillie. Cérès en mangea avec tant d’avidité, qu’un enfant nommé ne put s’empêcher d’en rire. La déesse offensée, lui jeta le reste de sa bouillie, et le changea en lézard.
D. Quelles étoient les fêtes établies en l’honneur de Cérès ?
R. Elles se nommoient Eleusines du nom d’Eleusis, où elles commencèrent. On y gardoit un profond silence, et c’étoit un crime que de révéler ce qui s’y étoit passé. On trouve dans les anciens auteurs, deux autres fêtes instituées en l’honneur de Cérès : premièrement, les Thesmophories, du mot thesmophore où législatrice, parce qu’elle avoit donné des lois ; aux Athéniens, secondement, les Ambarvalies, mot qui signifie faire le tour, parce que, dans ces fêtes, on faisoit le tour des champs, pour obtenir la fertilité des terres et l’abondance des fruits. Le vin étoit banni des autels de Cérès. On lui immoloit un porc, parce que cet animal, en fouillant la terre, détruit les semences.
D. Quelle vengeance Cérès tira-t-elle de l’impiété d’Erésichton ?
R. Erésichton, l’un des principaux habitants de la Thessalie, avoit eu l’audace de couper plusieurs arbres dans une forêt consacrée à Cérès. Cette déesse, pour l’en punir, lui envoya une faim si horrible, qu’il consuma tout son bien, sans pouvoir la satisfaire. Métra, sa fille, que Neptune avoit aimée, obtint de ce Dieu de prendre toute sorte de formes, comme Protée. Son père la vendoit pour avoir de l’argent ; ensuite, elle reprenoit une autre forme, et il la vendoit de nouveau. Cette ruse ne put cependant suffire à la voracité d’Erésichton qui mourut misérablement en dévorant ses propres membres.
Les Dryades pleurant la perte de leur sœur,Et leurs bois dépouillés de leur antique honneur,Vont conjurer Cérès de venger leur injure.Elle les vengera, la déesse le jure :L’or des moissons s’ébranle au signe de son front.Elle apprête à l’impie, auteur de son affront,Un châtiment affreux, mais moindre que son crime.Elle veut à la Faim le livrer en victime ;Mais comme, par la loi des éternels décrets,On ne peut voir ensemble et la Faim et Cérès,Elle appelle une nymphe, Oréade légère,Et l’instruit en ces mots à servir sa colère :Au fond de la Scythie, où jamais les moissonsN’ont germé sur un sol durci par les glaçons,Solitude sans fruits, sans ombre, sans verdure,Est un vallon désert, ou la pâle Froidure,La Fièvre, le Frisson, le Besoin importunHabite avec la Faim, aux entrailles à jeun.Va la trouver ; dis-lui qu’implacable harpie,Elle aille se cacher dans le sein de l’impie ;Que par elle vaincus, mes présents, mes secours,Alimentent son mal et l’irritent toujours ;Qu’elle surmonte enfin ma puissance prodigue.Si le voyage est long, n’en crains pas la fatigue :Prends mon char, mes dragons, et vole sur les vents.
La nymphe prend le char et les dragons volants,S’élève dans les airs, vers les climats de l’Ourse,Et sur l’affreux Caucase elle arrête sa course.Elle cherche la Faim : là, sous des rocs pendants,Elle la voit qui rampe, et ronge de ses dentsQuelques brins d’herbe épars sur la roche indigente.Vous compteriez ses os sous sa peau transparente.Ses cheveux hérissés cachent son œil éteint,La rouille est sur ses dents, la pâleur sur son teint ;De nerfs et d’ossements assemblage difforme,De ses genoux pointus la jointure est énorme ;Et ses talons hideux s’alongent au-dehors,Grossis par la maigreur qui dessèche son corps.La nymphe, en lui parlant, n’ose s’approcher d’elle,Et lui dicte de loin l’ordre de l’immortelle.Elle s’arrête à peine, et déjà dans son sein,Elle a cru ressentir l’aiguillon de la Faim,Et loin d’elle aussitôt dans les airs détournée,Revole aux bords heureux qu’arrose le Pénée.
La Faim, dans touts les temps, si contraire à Cérès,Trouve un plaisir cruel à remplir ses décrets.Un tourbillon de vent la porte en Thessalie :Elle arrive dans l’ombre au palais de l’impie.Le sommeil sur ses yeux épanchoit ses pavots.Tandis qu’il est plongé dans un profond repos,Elle s’étend sur lui, se glisse dans sa couche,Lui souffle en l’embrassant les poisons de sa bouche,Le serre dans ses bras, se presse sur son sein,Allume dans ses sens les ardeurs de la faim,Et quittant un climat pour elle trop fertile,Regagne ses déserts et son antre stérile.
Dans les bras du sommeil, par un songe bercé,L’impie est endormi ; mais, par la faim pressé,II veut la satisfaire, ouvre une bouche avide,La ferme, l’ouvre encore, et se repaît de vide.Son gosier affamé se travaille sans fin,Et ses dents sur ses dents se fatiguent en vain.Quand il est éveillé, son mal n’est plus un songe :Sa faim est une rage, un vautour qui le ronge.Sa table au même instant est servie à grands frais :On dépeuple les airs, les lacs et les forêts,Son estomac à jeun au moment qu’il dévore,Demande d’autres mets, et d’autres mets encore.C’est un gouffre que rien ne peut rassasier ;Lui seul absorbe plus qu’un peuple tout entier.Pareil à l’Océan, ce réservoir du monde,Qui plus il boit de flots, plus il a soif de l’onde ;Pareil au feu qui croit plus il a d’aliment,Et consumant toujours, s’allume en consumant :Rien ne peut assouvir sa faim insatiable ;Plus il veut l’apaiser, plus elle est implacable.( , trad. de .)
D. Comment Cérès est-elle représentée ?
R. On la peint couronnée de fleurs et d’épis, tenant un flambeau d’une main, et de l’autre une gerbe de blé ou une branche de pavot. Quelquefois elle est montée sur un char traîné par des serpents. On lui donne de grosses mamelles, pour indiquer qu’elle est la nourrice du genre humain.
O Cérès ! presse ton retour :Sur nos plaines le dieu du jourRépand les chaleurs et la vie.Proserpine a quitté la courDu sombre époux qui l’a ravie :Le même char qui l’entraînaA travers la flamme et la cendre,A tes yeux charmés va descendreDu sommet brillant de l’Etna.Elle paroît, ton cœur palpite,Tes pas volent devant ses pas :Quand tu l’appelles dans tes bras,L’amour vers toi la précipite.Un mutuel enchantementVous enivre des mêmes charmes :Trop court, mais trop heureux moment,Où le plaisir verse des larmes !Pour un cœur noble et généreux,Qu’il est doux, en quittant Cerbère,De retrouver le monde heureuxPar les seuls bienfaits de sa mère !Belle Proserpine, à tes yeuxDéjà la moisson est tombée,Sous la faucille recourbéeDu moissonneur laborieux :Ici, les gerbes disperséesCouvrent la face des guérets :Plus loin, leurs meules entasséesElèvent un trône à Cérès.Sur l’arbre fécond de Pyrame,Le ver à soie ourdit sa trame,Qui pare les dieux et les rois :Les fraises parfument les bois,L’épine enfante la groseille,Mille fruits naissent à la fois ;Et prête à remplir sa corbeille,La nymphe hésite sur le choix.Par-tout l’abondance circule,L’homme n’est heureux que l’été :L’infatigable pauvretéBénit l’ardente caniculeQui fait frémir la volupté.Dans un salon pavé de marbre,Respire-t’on un air plus frais,Qu’à l’ombre incertaine d’un arbreCher aux déesses des forêts ?La dryade, en robe légère,Brave, sous un chapeau de fleurs,L’aiguillon ardent des chaleurs,Et Pallas, coiffée en bergère,Pour égayer les moissonneursDanse à midi sur la fougère.( .)
Neptune. §
D. De qui Neptune étoit-il fils ?
R. Neptune étoit fils de Saturne et de Cybèle. Son père avoit l’habitude de dévorer ses enfants mâles. Mais Cybèle, qui avoit déjà réussi à le tromper en lui présentant une pierre à la place de Jupiter, eut encore recours à la même ruse, et fit élever secrètement Neptune par des bergers. L’empire de la mer lui échut dans le partage de l’univers.
D. Neptune n’encourut-il point la disgrâce de Jupiter ?
R. Neptune conspira contre son frère ; et le maître des dieux, ayant découvert cette conspiration, l’exila du ciel avec Apollon et les autres conjurés. Laomédon élevoit alors les murs de Troie. Neptune et Apollon l’aidèrent dans cette entreprise. Mais lorsque les murs furent achevés, Laomédon refusa aux dieux la récompense qu’il leur avoit promise. Pour s’en venger, Neptune inonda la ville et suscita un monstre marin qui désoloit tout le rivage. Apollon y envoya la peste. L’oracle consulté répondit que, pour apaiser les dieux offensés, il falloit exposer touts les ans une jeune fille à la fureur du monstre. Bientôt le sort désigna pour victime Hésione, fille de Laomédon. Mais Hercule la délivra. Laomédon, qui s’étoit engagé à la donner à son libérateur, trahit encore sa promesse. Hercule indigné le tua. Cependant Neptune fit sa paix avec Jupiter, s’occupa du soin de gouverner ses états, et épousa Amphitrite.
D. Faites-nous connoître plus particulièrement Amphitrite.
R. Elle étoit fille de l’Océan et de la nymphe Doris. Comme elle avoit formé le projet de ne point se marier, elle rejeta d’abord la demande de Neptune. Mais le dieu des eaux lui envoya un dauphin qui la trouva au pied du mont Atlas, et vainquit sa résistance. C’est ainsi qu’Amphitrite devint déesse de la mer. Neptune, pour récompenser le dauphin, le plaça parmi les astres. Amphitrite, et Neptune eurent ensemble Triton, qui servoit de trompette à son père, usant pour cet effet d’une coquille ou d’une conque en forme de trompette. Il avoit la partie supérieure du corps semblable à l’homme, et le reste semblable à un poisson. La plupart des dieux marins sont aussi appelés Tritons, et sont représentés de la même manière avec des coquillages.
D. Quels sont les principaux d’entre les autres dieux marins ?
R. Nous nommerons d’abord l’Océan, beau-père de Neptune, qui paroît avoir eu plusieurs femmes, savoir Doris, mère d’Amphitrite, et Téthys, qui donna le jour à un grand nombre de nymphes appelées Océanitides ou Océanides, du nom de leur père. Il ne faut pas confondre cette Téthys avec Thétis, mère d’Achille. Quelquefois Téthys est prise pour la déesse de la mer, et pour la mer elle-même : ainsi,
, dans ses Géorgiques,
dit à Auguste que Téthys achetteroit au prix de toutes ses eaux l’honneur de l’avoir pour gendre
; et
dit, en parlant du soleil, que,
sans doute las d’éclairer le monde, il va chez Téthys rallumer dans l’onde ses feux amortis
. Téthys est ordinairement représentée sur un char en forme de coquille, traîné par des dauphins.
D. L’Océan et Téthys eurent-ils d’autres enfants que les Océanitides ?
R. Ils eurent encore Nérée et Doris, qui se marièrent ensemble et donnèrent naissance à cinquante filles appelées Néréides, ou nymphes de la mer. Elles ont le corps terminé en poisson, depuis la ceinture.
D. Les anciens ne donnèrent-ils le nom de nymphes qu’aux déesses de la mer ?
R. Ils appelèrent nymphes plusieurs autres déesses, auxquelles ils donnèrent des noms particuliers, suivant les différents emplois qu’ils leur attribuoient.
Les nymphes des fleuves et des fontaines furent nommées Naïades.
On les représente appuyées sur une urne d’où sort de l’eau.
Les nymphes des bois et des forêts furent appelées Dryades, et l’on donna le nom d’Hamadryades aux nymphes que l’on croyoit naître et mourir avec les chênes.
Les nymphes des vallons et des prairies furent nommées Napées, et celles des montagnes furent appelées Oréades.
D. Quelle fut la plus célèbre des Néréides ?
R. Ce fut Thétis, qui avoit une si grande beauté, que Jupiter voulut l’épouser. Mais Prométhée prédit que cette nymphe mettroit au monde un fils qui seroit plus illustre et plus grand que son père. Alors Jupiter renonça à ses prétentions. Thétis fut mariée avec Pélée, qui devint père d’Achille.
D. Faites-nous connoître les autres enfants de l’Océan et de Téthys.
R. Ils eurent encore les Fleuves dont on porte le nombre à trois mille. Les Fleuves sont représentés nus, couronnés de roseaux, le sein couvert d’une barbe vénérable, et appuyés sur une urne qui verse leur onde blanchissante. Enfin, l’Océan et Téthys eurent un fils appelé Protée. Ce dieu marin avoit la garde du troupeau de Neptune. Il rendoit aussi des oracles. Mais il falloit le lier pour l’y contraindre. Il se changeoit en eau, en feu, en bête féroce, et prenoit toute sorte de formes, pour se retirer des mains qui le retenoient ; de là vient qu’on dit d’un homme qui joue toute sorte de personnages : c’est un Protée.
Tel que le vieux pasteur des troupeaux de Neptune,Protée, à qui le Ciel, père de la Fortune,Ne cache aucun secret,Sous diverse figure, arbre, flamme et fontaine,S’efforce d’échapper à la vue incertaineDes mortels indiscrets.( .)
D. Les poëtes ne nomment-ils pas encore quelques autres divinités maritimes ?
R. Ils en nomment plusieurs, telles que Éole, les Sirènes, les Harpies, Ino et Mélicerte, Glaucus, Scylla et Charybde.
D. Qu’étoit Éole ?
R. Éole, roi des vents, est mis au rang des dieux de la mer, parce qu’il avoit le pouvoir de soulever les flots, et de causer les tempêtes. Il étoit fils de Jupiter. Il habitoit L’Éolie, île située entre l’Italie et la Sicile : (aujourd’hui Lipari.)
En prononçant ces mots, la déesse2 en furieVers ces antres, d’Eole orageuse patrie,Précipite son char. Là, sous de vastes monts,Le dieu tient enchaînés dans leurs gouffres profondsLes vents tumultueux, les tempêtes bruyantes ;S’agitant de fureur dans leurs prisons tremblantes,Ils luttent en grondant, ils s’indignent du frein.Au haut de son rocher, assis le sceptre en main,Eole leur commande ; il maîtrise, il tempèreDu peuple impétueux l’indocile colère :S’ils n’étoient retenus, soudain cieux, terre, mers,Devant eux rouleroient emportés dans les airs.Aussi, pour réprimer leur fougue vagabonde,Jupiter leur creusa cette prison profonde,Entassa des rochers sur cet affreux séjour,Et leur donna pour maître un roi qui, tour à tourIrritant par son ordre, ou calmant leurs haleines,Sût, tantôt resserrer, tantôt lâcher les rênes.Devant lui la déesse, abaissant sa hauteur :« Roi des vents, lui dit-elle avec un air flatteur,» Vous à qui mon époux, le souverain du monde,» Permit et d’apaiser et de soulever l’onde,» Un peuple que je hais, et qui, malgré Junon,» Ose aux champs des Latins transporter Ilion,» Avec ses dieux vaincus, fend les mers d’Etrurie :» Commandez à vos vents de servir ma furie ;» Dispersez sur les mers ou noyez leurs vaisseaux,» Et de leurs corps épars couvrez au loin les eaux. »(Énéide de , liv. ier, trad. de M. .)
D. Quels étoient les principaux vents ?
R. Les Romains reconnoissoient quatre vents principaux : Eurus, ou le vent d’orient, Borée, ou le vent du septentrion ou de bise ; Auster ou Notus, le vent du sud ou du midi, et Zéphire, le vent d’Ouest ou du couchant. Les Latins donnent pour femme à Zéphire la déesse Flore. On le peint sous la figure d’un jeune homme qui a l’air doux et serein, avec des ailes de papillon, et une couronne composée de toute sorte de fleurs, pour désigner son influence bienfaisante sur la nature.
D. Dites-nous quelque chose des Sirènes.
R. Les Sirènes, filles du fleuve Achéloüs et de la muse Calliope, étoient des monstres moitié femmes et moitié oiseaux. Elles habitoient des rochers escarpés sur les bords de la mer, entre l’île de Caprée et la côte d’Italie. Elles chantoient avec tant de mélodie qu’elles attiroient les passants, et ensuite les dévoroient. L’oracle leur avoit prédit que, dès qu’un seul homme passeroit sans être arrêté par le charme de leurs voix, elles périroient. Ulysse, averti par Circé, boucha les oreilles de touts ses compagnons avec de la cire, et se fit attacher lui-même au mât du navire par les pieds et par les mains. Cette précaution le sauva ; et les Sirènes, de dépit, se précipitèrent dans la mer, à un endroit depuis appelé de leur nom Sirénusse, où elles furent changées en rochers. On compte ordinairement trois Sirènes, savoir : Parthénope, qui chante ; Ligée, qui joue de la flûte ; et Leucosie, qui joue du luth.
D. Qu’appelez-vous Harpies ?
R. Les Harpies étoient des monstres qui avoient une tête de femme, des oreilles d’ours, le corps d’un vautour, des ailes de chauve-souris, et des griffes aux pieds et aux mains. Elles infectoient tout ce qu’elles touchoient : les plus connues s’appeloient Aëllo, Ocypète et Célæno.
D. Racontez l’histoire d’Ino et de Mélicerte.
R. Ino, fille de Cadmus et d’Harmonie, épousa en secondes noces Athamas, roi de Thèbes, dont elle eut deux fils, Léarque et Mélicerte. Athamas, devenu furieux, écrasa contre un mur le petit Léarque. Ino, craignant pour elle-même et pour Mélicerte un pareil traitement, prit son fils dans ses bras, et se jeta avec lui, du haut d’un rocher, dans la mer. Les dieux, touchés de compassion, les changèrent en divinités maritimes. Les Grecs honoroient Ino sous le nom de Leucothoé, et les Romains sous le nom de Matuta. Mélicerte étoit invoqué en Grèce sons le nom de Palémon, et à Rome sous le nom de Portunus.
D. Comment Glaucus devint-il un des dieux de la mer ?
R. Glaucus étoit un pêcheur de la ville d’Anthédon, en Béotie. Il s’aperçut un jour que les poissons qu’il posoit sur une certaine herbe du rivage, reprenoient de la force, et se jetoient dans la mer. Persuadé que cette herbe avoit une vertu particulière, il en mangea, et sauta aussitôt lui-même dans les eaux, où il fut reçu au nombre des dieux marins.
Je suis un dieu des mers, et, nouveau Palémon,Je suis au même rang que Protée et Triton.Je fus homme autrefois : toujours ami de l’onde,Assis sur un rocher, dans une paix profonde,J’aimois à tendre un piége aux crédules poissonsSurpris dans mes filets ou par mes hameçons.Non loin du bord lavé par la vague ondoyante,Est un pré que tapisse une herbe verdoyante.La brebis, ni la chèvre à la longue toison,N’ont jamais de leurs dents effleuré ce gazon.L’abeille, des jardins hôtesse voltigeante,N’y butina jamais sa richesse odorante ;Et jamais la bergère amoureuse des fleurs,N’y vint de sa corbeille assortir les couleurs.C’est là que, le premier, je vins sur l’herbe fraîcheDéposer les filets, instruments de ma pêche,Y compter les poissons par l’amorce trompés,Ou dans mes rets noueux sous l’onde enveloppés,Écoutez la merveille ; elle est invraisemblable :Mais que me serviroit d’inventer une fable ?De mes captifs épars quand le peuple écailléEut touché de ces prés le tapis émaillé,Je les vois loin de moi prendre un élan rapide,Nager sur les gazons comme en un champ liquide,Et dans l’onde courir, sauter et se mouvoir.A peine je conçois ce que je viens de voir.Je veux de ce prodige éclaircir le mystère :Est-ce une herbe, disois-je, est-ce un Dieu qui l’opère ?Mais quelle herbe eut jamais de semblables vertus ?Pour convaincre mes sens de doute combattus,Du gazon merveilleux que moi-même je cueille,Mes dents pressent le suc exprimé de sa feuille.Un desir tout nouveau palpite dans mon seinDe changer de nature ainsi que de destin.Je m’écrie, emporté par l’instinct qui m’agite :O terre où je suis né ! pour jamais je te quitte ;Et je cours dans les flots me plonger sans retour.Téthys parmi ses dieux me reçoit dans sa cour,Et le vieux Océan efface, à sa prière,Ce que j’eus de mortel sous ma forme première.( , trad. de .)
D. Que nous direz-vous de Scylla et de Charybde ?
R. Scylla, fille de Phorcys, étoit une belle nymphe qui fut aimée de Glaucus. Mais Circé, par jalousie, empoisonna la fontaine où Scylla avoit coutume de se baigner. A peine la nymphe y fut-elle entrée, qu’elle se vit changée en un monstre effroyable, dont la partie inférieure ressembloit à un chien. Elle eut tant d’horreur d’elle-même qu’elle se précipita dans la mer, et fut changée en un gouffre qui porte son nom.
Charybde, étoit une femme qui, ayant volé des bœufs à Hercule, fut foudroyée par Jupiter et métamorphosée en un gouffre qui se trouve placé en face de celui de Scylla.
Charybde et Scylla étoient deux gouffres très-voisins, au milieu desquels il falloit passer pour aborder en Sicile. Le passage étoit si dangereux, qu’il a donné lieu au proverbe : Tomber dans Charybde pour éviter Scylla.
D. Comment Neptune étoit-il représenté ?
R. On représentoit Neptune sur un char qui avoit la forme d’une vaste coquille et étoit traîné par quatre chevaux marins ou par quatre dauphins. Les roues effleuroient rapidement la surface de l’onde couverte de Tritons et de Néréides. Le front ceint du diadème, le souverain des mers, d’une main calmoit les flots agités, de l’autre tenoit le trident, emblème de sa triple puissance qui s’étend sur la mer, les fleuves et fontaines.
Les habitants de Trézène avoient empreint sur leur monnoie ; d’un côté le trident de Neptune, de l’autre la tête de Minerve ; ce qui semble indiquer le commerce dirigé par la sagesse.
D. Quand célébroit-on les fêtes de Neptune ?
R. Les Romains célébroient sa fête le premier jour du mois de juillet, et lui consacroient le mois de février, pendant lequel ils tâchoient de se rendre le dieu favorable pour l’époque prochaine de la nouvelle navigation. Les libations, qui, pour les autres dieux, étoient composées de vin, de lait et de miel, se faisoient, en l’honneur de Neptune, avec l’eau de la mer, des fleuves et des fontaines. On immoloit ordinairement un taureau blanc sur son autel ; mais, quelle que fût la victime amenée dans son temple, les prêtres lui en présentoient toujours le fiel, par analogie avec l’amertume de la mer. Ces cérémonies attiroient un concours prodigieux à Rome, et sur-tout aussi à l’isthme de Corinthe, où il avoit un temple célèbre dans lequel on lui avoit érigé une statue d’airain, haute de sept coudées. Son culte étoit si universel, qu’en parcourant les rivages de la Grèce, de la Sicile et de l’Italie, on trouvoit dans les moindres hameaux un temple ou au moins un autel dédié au dieu de la mer.
Pluton. §

D. Qu’étoit Pluton ?
R. Pluton, troisième fils de Saturne et de Cybèle, régnoit dans les enfers. Par le nom d’enfers, les poëtes et les mythologues entendent les lieux souterrains où alloient les ames des morts, pour être punies ou récompensées. Les enfers contenoient le Tartare et les Champs élysées. Le Tartare étoit un lieu de supplices, destiné aux méchants. Les Champs élysées étoient un lieu de délices, ou les ombres de ceux, qui avoient bien vécu, jouissoient d’un bonheur parfait.
D. Pluton n’avoit-il pas été dévoré par Saturne ?
R. Il avoit été en effet dévoré par Saturne ; mais Jupiter fit prendre à son père un breuvage qui le força de rejeter Pluton de son sein. C’est ainsi que ce dieu revit le jour. Il eut pour son partage la région des enfers. Il épousa Proserpine qu’il avoit enlevée. On le représente ordinairement sur un char d’ébène, traîné par des chevaux noirs. Il est couronné d’ébène, de narcisses ou de cyprès. Sa main droite est armée d’une longue fourche ; l’autre tient la clef qui ferme la porte de l’éternité.
D. Décrivez-nous la cour de Pluton.
R., dans le dix-huitième livre de Télémaque, décrit ainsi cette cour :
« Au pied du trône étoit la Mort, pâle et dévorante, avec sa faux tranchante, qu’elle aiguisoit sans cesse. Autour d’elle voloient les noirs soucis ; les cruelles défiances ; les vengeances toutes dégouttantes de sang et couvertes de plaies ; les haines injustes ; l’avarice qui se ronge elle-même ; le désespoir qui se déchire de ses propres, mains ; l’ambition forcenée qui renverse tout ; la trahison qui veut se repaître de sang, et qui ne peut jouir des maux qu’elle a faits ; l’envie qui verse son venin mortel autour d’elle et qui se tourne en rage, dans l’impuissance où elle est de nuire ; l’impiété qui se creuse elle-même un abyme sans fond, où elle se précipite sans espérance ; les spectres hideux, les fantômes qui représentent les morts pour épouvanter les vivants ; les songes affreux ; les insomnies aussi cruelles que les tristes songes. Toutes ces images funestes environnoient le fier Pluton, et remplissoient le palais où il habite. »
Nous lisons cette même description dans le sixième livre de l’Énéide de .
Devant le vestibule, aux portes des enfers,Habitent les Soucis et les Regrets amers,Et des Remords rongeurs l’escorte vengeresse ;La pâle Maladie, et la triste Vieillesse ;L’Indigence en lambeaux, l’inflexible Trépas,Et le Sommeil son frère, et le dieu des combats ;Le Travail qui gémit, la Terreur qui frissonne,Et la Faim qui frémit des conseils qu’elle donne,Et l’Ivresse du crime, et les Filles d’enfer,Reposant leur fureur sur des couches de fer ;Et la Discorde enfin, qui, soufflant la tempête,Tresse en festons sanglants les serpents de sa tête.(Trad. de M. .)
a imité ces deux descriptions dans le chant septième de sa Henriade. Il feint que Saint-Louis transporte Henri IV aux enfers.
Henri, dans ce moment, d’un vol précipité,Est, par un tourbillon, dans l’espace emportéVers un séjour informe, aride, affreux, sauvage,De l’antique Chaos abominable image,Impénétrable aux traits de ces Soleils brillants,Chefs-d’œuvre du Très-Haut, comme lui bienfaisants.Sur cette terre horrible, et des Anges haïe,Dieu n’a point répandu le germe de la vie.La Mort, l’affreuse Mort, et la Confusion,Y semblent établir leur domination.Quelles clameurs, ô Dieu ! quels cris épouvantables !Quels torrents de fumée ! et quels feux effroyables !Quels monstres, dit Bourbon, volent dans ces climats ?Quels gouffres enflammés s’entr’ouvrent sous mes pas ?O mon fils ! vous voyez les portes de l’abymeCreusé par la justice, habité par le crime.Suivez-moi ; les chemins en sont toujours ouverts.Ils marchent aussitôt aux portes des Enfers.Là gît la sombre Envie à l’œil timide et louche,Versant sur des lauriers les poisons de sa bouche ;Le jour blesse ses yeux dans l’ombre étincelants :Triste amante des morts, elle hait les vivantsElle aperçoit Henri, se détourne et soupire.Auprès d’elle est l’Orgueil, qui se plaît et s’admire ;La Foiblesse au teint pâle, aux regards abattus,Tyran qui cède au crime, et détruit les vertus ;L’Ambition sanglante, inquiète, égarée,De trônes, de tombeaux, d’esclaves, entourée ;La tendre Hypocrisie aux yeux pleins de douceur,(Le ciel est dans ses yeux, l’enfer est dans son cœur) ;Le Faux-Zèle étalant ses barbares maximes ;Et l’Intérêt enfin, père de touts les crimes.
D. Donnez-nous une idée du gouvernement des enfers.
R. On y comptoit trois juges, Minos, Eaque, et Rhadamante.
Mercure conduisoit les ames devant leur tribunal.
Mais l’enfer ne voit point de jugement injuste :Minos y tient ouvert son tribunal auguste ;Il tient l’urne terrible en ses fatales mains,Et jugé sans retour touts les pâles humains.( , trad. de M. .)
D. Comment Minos mérita-t-il de devenir le président du tribunal des enfers ?
R. Minos, fils de Jupiter et d’Europe, étoit roi de Crète. Il donna à ses sujets des lois qui subsistèrent jusqu’au temps de Platon. C’est la sagesse de ses lois, et sur-tout son équité, qui lui ont fait donner, après sa mort, la fonction de juge souverain des enfers. Il ne faut pas le confondre avec Minos, son petit-fils et père d’Androgée.
D. Faites-nous connoître les deux autres juges des enfers, Eaque et Rhadamante.
R. Eaque étoit fils de Jupiter et d’Égine. Il donna le nom de sa mère à l’île dans laquelle il régna, et qui s’appelle aujourd’hui Engia3. La peste avoit dépeuplé ses états. Il obtint de son père que les fourmis fussent changées en hommes, et appela ses nouveaux sujets Myrmidons. D’autres prétendent que les habitants de l’île Égine étoient si laborieux, qu’ils furent nommés Myrmidons par allusion aux fourmis. Quoi qu’il en soit, Eaque fut un roi si bon et si juste, qu’il obtint une place parmi les juges des enfers.
Rhadamante, fils de Jupiter et d’Europe, étoit frère de Minos. Il régna dans la Lycie4. Son amour pour la justice le fit mettre au nombre des juges de l’enfer. On avoit une si haute opinion de son équité, que lorsque les anciens vouloient exprimer un jugement juste, mais sévère, on l’appeloit un jugement de Rhadamante.
D. A qui les juges des enfers confioient-ils l’exécution de leurs sentences ?
R. Aux Furies ou Euménides, filles de la Nuit et de l’Achéron. On en compte trois, Alecto, Tisiphone et Mégère. On leur donne des couleuvres pour cheveux. Elles tiennent une torche d’une main, et de l’autre un fouet armé de serpents. Elles ont pour compagnes la Terreur, la Rage, la Pâleur et la Mort. Leur ministère ne se-borne point à châtier les ombres criminelles : souvent elles volent au séjour des vivants, planent sur la tête de l’homme coupable, et, portant dans son sein leurs flambeaux dévorants, elles commencent pour lui, sur la terre, les supplices éternels du Tartare. Le parricide Oreste offrit à la Grèce un exemple effrayant de la sévérité des Furies. Des déesses si redoutables ne pouvoient manquer d’avoir un culte très-étendu. Le respect pour elles étoit si grand, qu’on n’osoit presque les nommer, ni jeter les yeux sur leurs temples. Ces temples, très-nombreux dans la Grèce, servoient d’asile inviolable aux criminels. On immoloit aux Furies des brebis pleines, des béliers et des tourterelles.
D. L’enfer ne compte-t-il pas trois autres sœurs parmi ses déesses ?
R. Oui : ce sont les trois Parques, appelées, quelquefois Sœurs filandières. Elles étoient filles de l’Erèbe et de la Nuit. Elles se nommoient Clotho, Lachésis et Atropos. Elles filoient la vie des hommes. Clotho tenoit la quenouille, Lachésis tournoit le fuseau, et Atropos coupoit le fil avec des ciseaux. Les poëtes ont feint qu’elles employoient de la laine blanche mêlée d’or et ou de soie, pour exprimer les jours heureux, et de la laine noire, pour exprimer les jours malheureux.
Les Parques, d’une même soie,Ne dérident pas touts nos jours.( .)
D. Quelles sont les autres divinités qu’on peut encore mettre au nombre des divinités infernales ?
R. Ce sont la Nuit, le Sommeil, la Mort et les dieux Manes.
D. Qu’est-ce que la Nuit ?
R. La Nuit est la déesse des ténèbres : elle est fille du Ciel et de la Terre. On la représente avec, un vêtement noir parsemé d’étoiles, un sceptre de plomb à la main, parcourant silencieusement le ciel, sur un char d’ébène, après le coucher du soleil.
La Nuit s’avance lentement,Et l’obscurité de ses voilesBrunit l’azur du firmament ;Les Songes traînent en silenceSon char parsemé de saphirs ;L’Amour, dans les airs, se balanceSur l’aile humide des zéphyrs.( .)
D. Qu’est-ce que le Sommeil ?
R. Le Sommeil est fils de l’Érèbe et de la Nuit, et père des Songes. Il a son palais dans un antre impénétrable aux rayons du soleil. Jamais les chiens, les coqs, ni les oies n’en troublent la tranquillité. Le Fleuve d’oubli roule doucement ses eaux autour de ce palais. A l’entrée, croissent des pavots et d’autres herbes assoupissantes. Le dieu repose sur un lit d’ébène fermé de rideaux noirs. Amour de lui dorment, nonchalamment étendus, les Songes ses enfants. Son principal ministre veille pour empêcher qu’on ne fasse du bruit.
Près des Cimmériens5, aux limites du monde,Sous les flancs caverneux d’une roche profonde,Repose le Sommeil au fond d’un antre frais,De ce dieu nonchalant solitaire palais.D’une antique forêt l’obscurité paisibleEn ombrage l’entrée, au jour inaccessible.Une sombre clarté, crépuscule douteux,N’éclaire qu’à demi ce séjour nébuleux.Là, jamais des oiseaux la troupe matinaleN’éveille par ses chants l’amante de Céphale.L’Aquilon, de ces lieux respectant le repos,N’ose du moindre souffle agiter les rameaux.Un calme universel règne au loin dans la plaine.Mais au pied du rocher murmure une fontaineQui, roulant mollement sur un lit sablonneux,Endort, au bruit naissant de ses flots paresseux.De pavots odorants une moisson fécondeS’élève autour de l’antre, et se penche sur l’onde.La nuit vient les cueillir, et répand dans les airsLeur baume assoupissant, charme de l’univers.Au seuil de ce palais aucun garde ne veille :Là, nuls verroux bruyants ne font frémir l’oreille.Mais au fond de la grotte, en un lien retiré,A l’ombre d’un vieux dais, de rideaux, entouré,S’élève un lit d’ébène, où, sur la plume oiseuse,Endormi dans les bras d’une mollesse heureuse,Ce dieu silencieux, couronné de pavots,Savoure les douceurs d’un éternel repos.Enfant tout à la fois et père des mensonges,En foule autour de lui voltigent mille songes,Peuple nombreux, égal aux feuilles des forêts,Aux sables du rivage, aux épis des guérets.( , trad. de .)
D. Qu’est-ce que la Mort ?
R. La Mort est fille de l’Érèbe et de la Nuit. Une faux sanglante arme sa main décharnée ; une robe noire, parsemée d’étoiles, couvre les os luisants de son squelette livide. On lui consacroit l’if, le cyprès, et le coq, parce que le chant de cet oiseau semble troubler le silence qui doit régner dans les tombeaux. La Mort est une divinité inexorable, sourde aux vœux et aux prières des humains, n’ayant aucun égard aux rangs et aux talents, a dit, d’après :
La Mort a des rigueurs à nulle autre pareilles :On a beau la prier,La cruelle qu’elle est, se bouche les oreillesEt nous laisse crier.Le pauvre, en sa cabane où le chaume le couvre,Est sujet à ses lois ;Et la garde qui veille aux barrières du Louvre,N’en défend pas nos rois.
, dans son épître au peuple, s’exprime ainsi :
Sur l’univers entier la Mort étend ses droits ;Tout périt, les héros, les ministres, les rois.Rien ne surnagera sur l’abyme des âges ;Ce globe est une mer couverte de naufrages.Qu’importe, lorsqu’on dort dans la nuit du tombeau,D’avoir porté le sceptre ou traîné le râteau ?L’on n’y distingue point l’orgueil du diadème ;De l’esclave et du roi, la poussière est la même,
D. Qu’appelle-t-on Manes ?
R. Les anciens donnoient le nom de Manes à l’ombre, à l’ame d’un mort, Ainsi, l’on dit que Polixène fut sacrifiée aux manes d’Achille. Ils appeloient pareillement Manes des divinités qui présidoient aux tombeaux ; Aussi trouve-t-on souvent sur les tombes des anciens, ces deux lettres initiales D. M., qui indiquent ces deux mots Diis Manibus, aux Dieux Manes, comme pour recommander à leurs soins la sépulture du mort. On immoloit des brebis noires aux dieux Manes, et l’on offroit aux manes de ses amis, du lait, du miel, du vin et des parfums.
D. Indiquez-nous les principaux fleuves des enfers.
R. C’étoient l’Achéron, le Cocyte, le Phlégéton, le Styx, l’Erèbe et le Léthé.
D. Faites-nous connoître chacun de ces fleuves, et commencez par l’Achéron.
R. L’Achéron, fils du Soleil et de la Terre, n’a pas toujours coulé dans les enfers. Mais comme il avoit, fourni de l’eau aux Titans, lorsqu’ils escaladèrent le ciel, Jupiter, pour le punir de cette perfidie, le précipita dans le séjour des morts. Son onde devint bourbeuse et amère.
D. Dites un mot du Cocyte.
R. Le Cocyte entouroit le Tartare, et n’étoit formé que par les larmes des méchants. Des ifs plantés sur ses bords formoient un ombrage triste et ténébreux, et une porte posée sur des gonds d’airain donnoit entrée dans les enfers.
D. Qu’étoit-ce que le Phlégéton ?
R. Le Phlégéton rouloit des torrents de flammes, et environnoit de toutes parts ; les prisons des méchants. Ce fleuve ne voyoit croître aucun arbre aucune plante sur ses bords ; et, après, un cours assez long, en sens contraire du Cocyte, il se jetoit comme lui dans l’Achéron.
D. Que nous direz-vous dit Styx ?
R. Ce fleuve environne neuf fois les enfers. Styx fut, dit-on, fille de l’Océan et de Téthys. Elle eut de l’Achéron une fille appelée la Victoire. Lorsque Jupiter, pour punir les Titans, appela les immortels à son secours, Styx accourut la première avec sa fille. Le maître des dieux, pour reconnoître ce service, la combla de bienfaits, et décréta que les dieux jureroient par son nom, et que ceux qui violeroient ce serment, seroient exilés dix ans de la cour céleste, et privés de l’ambroisie et du nectar. L’ambroisie étoit la nourriture ordinaire des dieux ; et le nectar étoit leur breuvage.
D. Qu’étoit l’Erèbe ?
R. L’Erèbe, fils du Chaos et de la Nuit, fut métamorphosé en fleuve, et précipité dans les enfers, pour avoir secouru les Titans. L’Érèbe se prend aussi pour une partie de l’enfer ou pour l’enfer même.
D, Faites-nous connoître le Léthé.
R. Le Léthé se nomme aussi fleuve d’Oubli. Les ombres étoient obligées de boire de ses eaux, dont la propriété étoit de faire oublier le passé.
D. Où les anciens plaçoient-ils l’entrée des enfers ?
R. Dans la Campanie, contrée d’Italie, au marais d’Averne. Ce marais ou lac, consacré à Pluton, répandoit des exhalaisons infectes. Les oiseaux qui voloient au-dessus, y tomboient morts.
D. Qui gardoit la porte des enfers et du palais de Pluton ?
R. C’étoit Cerbère, chien à trois têtes. Il caressoit ceux qui entroient, et dévoroit ceux qui vouloient sortir, ou qui se présentoient pour entrer avant leur mort. Hercule l’enchaîna, lorsqu’il retira des enfers Alceste, épouse d’Admète. La sibylle, qui conduisit Énée aux enfers, l’assoupit avec une pâte assaisonnée de miel et de pavots ; et Orphée l’endormit pareillement au son de sa lyre, lorsqu’il alla chercher Eurydice.
Et, Cerbère abaissant ses têtes menaçantes,Retint sa triple voix dans ses gueules béantes.
D. Qui étoit le nautonnier des enfers ?
R. C’étoit Caron, fils de l’Érèbe et de la Nuit ; il passoit les ombres dans une barque pour une pièce de monnoie ; de là vient que les Grecs et les Romains mettoient une obole dans la bouche de leurs morts. Ceux qui n’avoient pas reçu, sur la terre, les honneurs de la sépulture, erroient cent ans sur le rivage, avant que d’être admis dans la barque. Voici la peinture que fait de Caron.
De là vers le Tartare un noir chemin conduit ;Là l’Achéron bouillonne, et, roulant à grand bruit,Dans le Cocyte affreux vomit sa fange immonde.L’effroyable Caron est nocher de cette onde.D’un poil déjà blanchi mélangeant sa noirceur,Sa barbe étale aux yeux son inculte épaisseur ;Un nœud lie à son cou sa grossière parure.Sa barque, qu’en roulant noircit la vague impure,Va transportant les morts sur l’avare Achéron ;Sans cesse il tend la voile, ou plonge l’Aviron,Son air est rebutant, et de profondes ridesOnt creusé son vieux front de leurs sillons arides ;Mais, à sa verte audace, à son œil plein de feu,On reconnoît d’abord la vieillesse d’un dieu.(Trad. de M. .)
D. Quels sont les plus fameux scélérats que la fable place dans le Tartare ?
R. Elle nomme entr’autres Phlégyas, Sisyphe, Salmonée, Ixion, Titye, Tantale et les Danaïdes.
P. Qu’avoit fait Phlégyas ?
R. Phlégyas, fils de Maris, et père de Coronis, voulut se venger de l’insulte qu’Apollon avoit faite a cette nymphe ; il alla mettre le feu au temple de Delphes. Apollon le tua à coups de flèches, et le précipita dans le Tartare, où il est dans une continuelle appréhension de la chute d’un rocher qui lui pend sur la tête.
D. Qu’étoit Sisyphe ?
R. Sisyphe, fils d’Éole, étoit un insigne brigand qui désoloit l’Attique, et faisoit mourir de divers supplices touts les étrangers qui tomboient entre ses mains. Thésée le tua, et les dieux le précipitèrent dans les enfers, ou il fut condamné à rouler au haut d’une montagne escarpée un rocher qui retomboit sans cesse.
D. Quel fut le crime de Salmonée ?
R. Salmonée, frère de Sisyphe, eut la témérité de vouloir passer pour un dieu. Pour y parvenir, il fit construire un pont d’airain, sur lequel il poussoit un chariot qui imitoit le bruit du tonnerre ; de là, il lançoit des torches allumées sur quelques malheureux. Jupiter le foudroya et le précipita dans le Tartare.
D. A quel supplice fut condamné Ixion ?
R. Les Euménides l’attachèrent avec des serpents à une roue qui tournoit sans cesse. Ixion étoit roi des Lapithes ; il refusa à Déionée les présents qu’il lui avoit promis pour épouser sa fille ; ce qui porta ce dernier à lui enlever ses chevaux. Ixion, dissimulant son ressentiment, attira chez lui son beau-père et le fit tomber dans une fournaise ardente. Bientôt il fut consumé de remords, et livré à toutes les horreurs du plus affreux délire. Jupiter, touché de son repentir, l’admit à la table des dieux ; mais il osa concevoir une passion criminelle pour Junon. Celle-ci s’en plaignit à son époux. Jupiter, d’un coup de foudre, précipita Ixion dans les enfers.
D. Titye ne s’étoit-il pas rendu coupable d’un pareil crime envers Latone ?
R. Oui. Titye, géant dont le corps étendu couvroit neuf arpents de terre, voulut attenter à l’honneur de Latone. Apollon et Diane, pour venger leur mère, le tuèrent à coups de flèches. Les poëtes ont feint qu’un insatiable vautour, attaché sur sa poitrine, lui dévore sans cesse le foie et les entrailles qui renaissent éternellement pour son supplice.
D. Qu’est-ce que la fable nous dit de Tantale ?
R. Tantale étoit fils de Jupiter, et roi de Phrygie. Pour éprouver les dieux, il leur servit les membres de son fils Pélops. Cérès, trop occupée de la douleur que lui causoit l’enlèvement de sa fille, dévora une épaule. Les autres dieux eurent horreur de cet horrible festin ; ils ressuscitèrent Pélops, et lui donnèrent une épaule d’ivoire, au lieu de celle que Cérès avoit mangée. Ils précipitèrent ensuite Tantale dans les enfers, et le condamnèrent à une soif et à une faim d’autant plus insupportables, qu’il étoit plongé dans l’eau jusqu’au cou, et avoit devant lui une branche chargée de fruits exquis. L’eau se retiroit toutes les fois qu’il vouloit boire, et la branche se redressoit toutes les fois qu’il vouloit en cueillir les fruits.
D. Racontez l’histoire des Danaïdes.
R. Danaüs, roi d’Argos, eut cinquante filles appelées Danaïdes, du nom de leur père. Égyptus, son frère, qui donna son nom au pays où il régnoit, eut cinquante fils. Les Danaïdes furent mariées à leurs cousins, et les cinquante mariages se célébrèrent le même jour ; mais Danaüs, auquel un oracle avoit prédit qu’il seroit détrôné par un de ses gendres, ordonna à ses filles d’assassiner leurs époux, la première nuit de leurs noces. Les Danaïdes obéirent toutes à leur père, à l’exception d’Hypermnestre qui sauva la vie à son époux Lyncée. Jupiter, pour punir ces filles cruelles, les condamna à remplir d’eau un tonneau percé.
Tel qu’au séjour des EuménidesOn nous peint ce fatal tonneau,Des sanguinaires DanaïdesChâtiment à jamais nouveau :En vain ces sœurs veulent sans cesseRemplir la tonne vengeresse,Mégère rit de leurs travaux :Rien n’en peut combler la mesureEt par l’une et l’autre ouvertureL’onde entre et fuit à flots égaux.( .)
D. Comment représente-t-on Pluton ?
R. On le représente communément sur un char traîné par des chevaux noirs, portant une couronne d’ébène sur la tête, et des clefs à la main.
D. Pluton est-il le même que Plutus ?
R. Non. Plutus, dieu des richesses, étoit fils de Cérès et de Jasion. On le met au nombre des dieux infernaux, parce que les richesses se tirent du sein de la terre, séjour des divinités infernales. Tantôt on le fait aveugle, pour marquer que le plus souvent il dispense mal ses faveurs ; tantôt on le représente boiteux, pour signifier que les richesses s’acquièrent lentement.
Mercure. §

D. Qu’étoit Mercure ?
12. Mercure, fils de Jupiter et de Maïa, étoit l’interprète et le messager des dieux, et en particulier de son père. Il conduisoit aux enfers les ames des morts, et les en ramenoit. Il présidoit à l’éloquence et au commerce. On le représente avec des ailes à la tête et aux pieds, et un caducée à la main.
D. Qu’étoit-ce que le caducée de Mercure ?
R. C’étoit une baguette entrelacée de deux serpents, et surmontée de deux ailerons. Mercure, ayant rencontré un jour deux serpents qui se battoient, les sépara avec sa baguette autour de laquelle ils se réunirent. Ce caducée étoit regardé comme le symbole de la paix et de l’union.
D. Quels étoient les attributs de Mercure considéré comme dieu de l’éloquence ?
R. On le représentoit avec des chaînes d’or, qui lui sortoient de la bouche, pour marquer que l’éloquence enchaîne et captive les esprits.
D. Quels étoient les attributs de Mercure, considéré comme dieu du commerce ?
R. On le peignoit avec une bourse à la main gauche, et à l’autre un rameau d’olivier et une massue. Le rameau d’olivier est l’emblème de la paix nécessaire au commerce ; la massue est le symbole de la force et de la vertu, nécessaires au trafic. On prétend que Mercure tire son nom du mot latin mercatura, qui signifie négoce.
D, Mercure n’est-il pas en même temps le dieu des voleurs ?
R. Oui ; et il étoit lui-même un voleur très-habile. Il déroba un jour à Apollon sa lyre, ses armes, et le troupeau qu’il gardoit pour le roi Admète. Un berger, nommé Battus, fut le seul témoin de ce larcin. Mercure, craignant qu’il ne le décelât, lui donna la plus belle des vaches qu’il avoit prises. Battus promit le secret. Mercure, pour s’assurer de sa discrétion, revint bientôt après, sous la forme d’un paysan, et offrit un bœuf et une vache, s’il vouloit dire où étoit le troupeau volé. Battus, tenté par une plus forte récompense, trahit Mercure, qui, pour le punir, le changea en pierre de touche. Cette pierre sert à éprouver les différents métaux.
D. Quelles inventions attribue-t-on à Mercure ?
R. II enseigna, dit-on, l’arpentage et l’usage des poids et mesures. lui attribue l’invention de la lyre. Mercure trouva une tortue sur le sable du Nil ; il la vida avec un ferrement, fit plusieurs trous à la coquille, colla du cuir à l’entour, y mit deux cornes, et la monta de cordes de fil de lin. Ces cordes étoient au nombre de neuf, en l’honneur des Muses. Mercure fit présent à Apollon de cet instrument.
Minerve. §
D. Racontez-nous la naissance de Minerve ?
R. Jupiter éprouva un jour un violent mal de tête : il ordonna à Vulcain de lui fendre la cervelle d’un coup de hache, et Minerve en sortit, armée de pied en cap. Minerve est la déesse de la sagesse et de la guerre. Lorsqu’elle préside à la guerre, elle prend le nom de Pallas ; lorsqu’elle préside à la sagesse et aux beaux-arts, on l’appelle Minerve.
D. Quel fut le fameux différent de Minerve avec Neptune ?
R. Minerve et Neptune se disputèrent l’honneur de nommer la ville d’Athènes. Les douze grands dieux, assemblés pour juger ce différent, déclarèrent qu’ils se décideroient en faveur de la divinité qui produiroit la chose la plus belle et la plus utile. Neptune frappa la terre de son trident, et en fit sortir un beau cheval. Minerve, d’un coup de lance, fit naître l’olivier, symbole de la paix, et obtint la victoire. Elle donna son nom à la ville d’Athènes, appelée auparavant Cécropie, du nom de Cécrops, son fondateur. Minerve étoit nommée par les Grecs Athéna ou Athéné. L’olivier lui étoit consacré.
D. Quelle vengeance Minerve tira-t-elle d’Arachné ?
R. Arachné prétendit surpasser Minerve dans le talent de broder sur la toile et sur ta tapisserie. Elle osa même faire un défi à la déesse. Minerve, indignée d’une telle témérité, rompit le métier et les fuseaux de cette orgueilleuse rivale, et la changea en araignée.
D. Comment représente-t-on Minerve ?
R. On la représente armée d’une cuirasse, avec un casque sur la tête, une lance à la main, l’égide au bras, et auprès d’elle un hibou, son oiseau favori. Le hibou est le symbole de la prudence et de la sagesse.
D. Qu’étoit-ce que l’Égide de Minerve ?
R. C’étoit un bouclier couvert de la peau d’un monstre nommé Égiès, qui vomissoit feu et flammes, et que Minerve tua. La déesse, pour rendre son bouclier plus effroyable, y attacha la tête de Méduse, l’une des trois Gorgones.
Mars. §
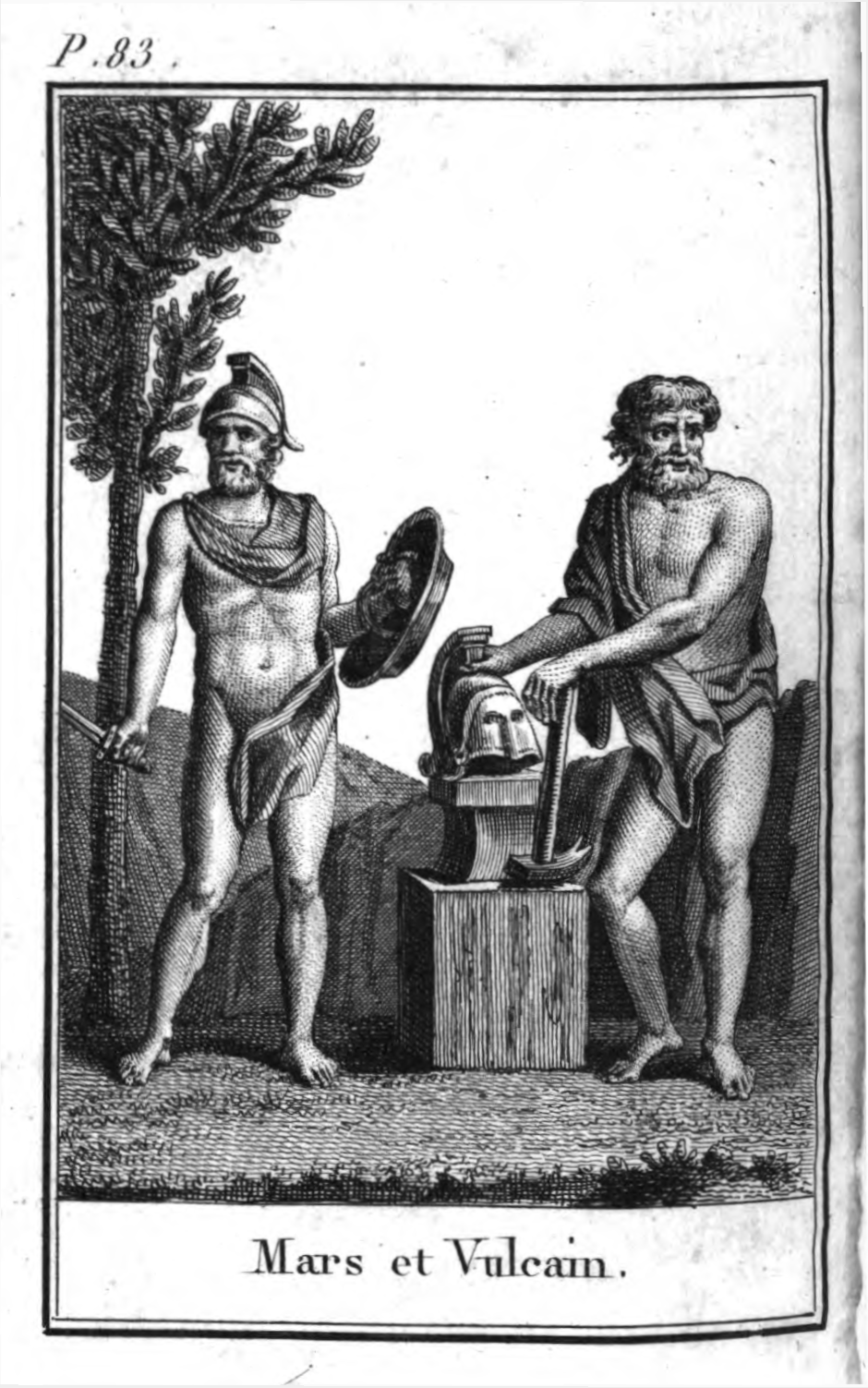
D. De qui Mars étoit-il fils ?
R. Mars étoit fils de Junon, qui lui donna seule le jour par l’attouchement d’une fleur des champs d’Olène. Ce dieu présidoit à la guerre. nous a tracé son caractère dans les vers suivants :
Loin devant lui la farouche Terreur,D’un bras sanglant, d’une voix menaçante,Chasse la Peur et la froide Epouvante.Plus près du dieu, l’intrépide Valeur,Le glaive haut, L’œil fier, l’ame rassise,Porte en touts lieux la mort qu’elle méprise.Du char d’acier, chef-d’œuvre de Vulcain,L’Activité tient les rênes en main ;Fiers tourbillons, ses coursiers indomptablesSèment au loin des feux inévitables.Ce dieu terrible, environné d’éclairs,Brise, en passant, les sceptres, les couronnes,Frappe les rois écrasés sous leurs trônes,Lance la foudre, ébranle l’univers,Et fait trembler la terre en peuplant les enfers.
D. Comment représente-t-on le dieu Mars ?
R. On le représente toujours armé de pied en cap. On place auprès de lui un coq, symbole de la vigilance nécessaire au guerrier. On dit qu’il eut de Rhéa-Sylvia, fille de Numitor, Romulus et Rémus qui furent les fondateurs de la ville de Rome.
Vulcain. §
D. De qui Vulcain étoit-il fils ?
R. Vulcain étoit fils de Jupiter et de Junon. Il naquit si difforme, que Jupiter, indigné de sa laideur, le précipita du ciel. Il roula un jour entier dans le vague des airs, et tomba le soir dans l’île de Lemnos. Il se cassa la cuisse dans cette chute, et demeura toujours boiteux.
D. Quelles fonctions la fable attribue-t-elle à Vulcain ?
R. Elle le fait dieu du feu et chef des forgerons qui fabriquoient les foudres de Jupiter. Les forges de Vulcain étoient dans les îles de Lemnos, de Lipari, et dans les cavernes du mont Etna. Ses compagnons étoient les Cyclopes, ainsi appelés, parce qu’ils n’avoient qu’un œil au milieu du front.
Vénus §

D. Racontez l’origine de Vénus.
R. Vénus, déesse de la beauté et des amours, étoit fille de Jupiter et de Dioné, l’une des nymphes de la mer. D’autres prétendent qu’elle fut formée de l’écume des eaux. Aussitôt qu’elle fut née, Zéphire la porta dans l’île de Chypre, ou les Heures se chargèrent de la nourrir ; et, bientôt après, elles la conduisirent avec pompe dans le ciel. Touts les dieux la trouvèrent si belle, que chacun d’eux voulut l’épouser. Jupiter accorda la préférence à Vulcain, pour le récompenser des services qu’il lui avoit rendus en forgeant des foudres contre les géants. Ainsi, le plus laid des dieux devint l’époux de la plus belle des déesses. Vénus, mécontente d’un tel choix, eut plusieurs amants, dont les principaux sont Mars, Bacchus, Anchise prince troyen, et Adonis jeune chasseur.
D. Quel enfant naquit des amours de Vénus et de Mars ?
R. Ce fut Cupidon ou l’Amour. On le représente sous la figure d’un enfant nu, avec un sourire malin, un bandeau sur les yeux, un arc à la main et quelquefois un flambeau. Il a des ailes, et porte un carquois rempli de flèches ardentes. Le culte que l’on rendoit à ce dieu, lui étoit commun avec sa mère.
D. Vénus eut-elle des enfants de Bacchus ?
R. Oui ; elle en eut l’Hymen, appelé aussi Hyménée, qui présidoit au mariage. On le représente sous la figure d’un jeune homme blond, couronné de roses, et tenant un flambeau à la main.
On prétend que Vénus eut encore de Bacchus, les trois Grâces, Aglaé, Thalie et Euphrosyne. D’autres les font filles de Jupiter et d’Eurynome. Elles sont les compagnes inséparables de Vénus. Elles suivent aussi assez ordinairement la cour des Muses. On les peint nues, et se tenant par la main, pour montrer que les Grâces n’empruntent rien de l’art, et qu’elles n’ont d’autres charmes que ceux de la nature.
D. Que dit la fable des amours de Vénus et d’Anchise ?
R. La fable dit que Vénus, ayant pris du goût pour Anchise, descendant de Tros, fondateur de Troie, le venoit trouver sur le mont Ida. Ce prince osa se vanter de son bonheur ; et Jupiter, pour le punir de son indiscrétion, le frappa de la foudre qui ne fit que l’effleurer. Enée fut le fruit de l’union de Vénus avec Anchise.
D. Faites-nous connoître le chasseur Adonis.
R. Adonis étoit un jeune homme d’une beauté extraordinaire. Vénus l’aima si passionnément, qu’elle quitta l’Olympe et les dieux pour le suivre. Elle l’accompagnoit dans les forêts. Mars, jaloux, employa pour se venger, le secours de Diane. Cette déesse suscita un sanglier énorme, qu’Adonis irrita, en l’attaquant. L’animal furieux se jeta sur lui, et le tua. Vénus, au désespoir, regrettoit d’être immortelle. Elle changea Adonis en anémone.
D. Racontez la vengeance que Vénus tira de Psyché.
R. Psyché étoit une princesse si belle, qu’elle fut aimée de l’Amour même. Ce dieu la fit transporter dans un palais somptueux, où elle étoit servie par des nymphes invisibles. Il venoit la visiter pendant la nuit, et se retiroit à la pointe du jour, pour éviter d’en être aperçu. Il lui recommandoit de ne point chercher à le connoître. Mais Psyché, entraînée par une funeste curiosité, se lève adroitement pendant le sommeil de son époux, prend une lampe, s’approche du lit, et voit Cupidon. Malheureusement, une goutte d’huile brûlante tombe sur le sein du dieu qui se réveille et s’enfuit sans retour. Vénus, déjà jalouse de la beauté de Psyché, fut bien plus irritée encore, lorsqu’elle sut que cette princesse lui avoit enlevé son fils. Elle la persécuta si cruellement qu’elle la fit mourir. Mais Jupiter lui rendit la vie, et lui donna l’immortalité, en faveur de Cupidon.
D. Qu’étoit-ce que la ceinture de Vénus ?
R. Cette ceinture, dont on raconte tant de merveilles, étoit un tissu mystérieux qui renfermoit toutes les grâces, et faisoit infailliblement aimer la personne qui le portoit. Venus prêta un jour cette ceinture à Junon, et la fière épouse du maître des dieux, parut plus belle aux yeux de Jupiter. nous a laissé une magnifique description de la ceinture de Vénus.
D. En quels lieux Vénus étoit-elle particulièrement honorée ?
R. Elle étoit particulièrement honorée dans l’île de Chypre, d’où lui est venu le nom de Cypris. Elle avoit, dans cette île, plusieurs temples superbes. Les plus célèbres sont ceux de Paphos, d’Amathonte, et d’Idalie. Elle avoit aussi des temples à Cythère, à Gnide, etc. Tout le monde connoît la belle description du temple de l’Amour, qui commence le neuvième chant de la Henriade.
Sur les bords fortunés de l’antique Idalie,Lieux où finit l’Europe et commence l’Asie, etc.
D. Qu’étoit-ce que le saut de Leucate ?
R. Leucate étoit un promontoire dans l’île de Leucade. On prétendoit que ceux qui se précipitoient du haut de la roche Leucadienne, étoient infailliblement guéris de leur amour. La fameuse , poëte pleine de grâces, s’exposa à cette aventure, afin d’éteindre sa malheureuse passion pour Phaon,
D. Comment Vénus est-elle représentée ?
R. Elle est ordinairement représentée sur un char traîné par des colombes ou par des cygnes, ou par des moineaux. On place à côté d’elle, son fils Cupidon. La rose lui étoit consacrée, comme ayant été teinte du sang d’Adonis, ou de Vénus elle-même blessée par une des épines de cette fleur. C’est ainsi que la rose, qui auparavant étoit blanche, changea de couleur et devint rouge.
Bacchus. §
D. Racontez la naissance de Bacchus ?
R. Bacchus eut pour père Jupiter, et pour mère Sémélé, fille de Cadmus roi de Thèbes. Junon, toujours jalouse, imagina ce moyen de punir Sémélé de la passion qu’elle avoit inspirée à Jupiter ; elle prit les traita de Béroé, nourrice de la princesse, et conseilla à sa rivale de demander à Jupiter qu’il se fît voir à elle dans tout l’éclat de sa gloire.
Exigez qu’aux Thébains lui-même il vienne apprendreUn choix pour vous si glorieux ;Qu’armé de son tonnerre il se montre à vos yeux ;Que par le Styx il jure de descendreAvec tout d’appareil du souverain des dieux,Tel qu’aux yeux de Junon il paroît dans les cieux.( .)
Sémélé fit en effet promettre à son amant de lui accorder la grâce qu’elle alloit lui demander. Jupiter jura par le Styx de faire ce qu’elle vouloit. La princesse s’expliqua, et Jupiter fut contraint malgré lui d’accomplir son serment. Sémélé fut brûlée par la foudre ; le maître des dieux prit le petit Bacchus dont elle étoit enceinte, et l’enferma dans sa cuisse jusqu’au temps marqué pour sa naissance.
D. Par qui Bacchus fut-il élevé ?
R. Il fut d’abord confié aux soins d’Ino, sa tante, qui l’éleva avec le secours des Hyades, des Heures et des Nymphes. Il fut ensuite instruit par les Muses, et par Silène, vieux satyre, qui depuis suivit son nourrissent à la conquête des Indes. Silène étoit toujours monté sur un âne, et ne passoit pas un jour sans s’enivrer.
D. Que fit Bacchus, lorsqu’il fut devenu grand ?
R. Il parcourut toute la terre, et fit la conquête des Indes avec une armée d’hommes et de femmes qui, au lieu d’armes, portoient des thyrses et des tambours. Il alla ensuite en Égypte, où il enseigna aux hommes l’agriculture, planta la vigne, et fut adoré comme le dieu du vin.
D. Comment représente-t-on Bacchus ?
R. On le peint sous la figure d’un jeune homme, avec un teint vermeil et un visage réjoui, comme il convient au dieu de la vendange. Il est assis sur un tonneau avec une coupe à la main, ou sur un char traîné par des tigres, des lynx ou des panthères, et tenant à la main un thyrse, qui est une baguette entourée de pampres et de lierre et surmontée d’une pomme de pin.
D. Comment se célébroient les fêtes de Bacchus ?
R. Elles étoient célébrées, avec de grandes clameurs, par des prêtresses nommées Bacchantes, Thyades et Ménades. On les voyoit revêtues de peaux de tigres, courir par les montagnes, et invoquer leur dieu. Elles avoient les cheveux épars, et portoient en main des flambeaux ou des thyrses. Ces fêtes s’appeloient Bacchanales ou Orgies (fureur). Les paysans de l’Attique les célébroient en sautant, un pied en l’air, sur des peaux enflées en forme de ballons, et frottées d’huile. Ceux qui se laissoient tomber, faisoient rire toute cette assemblée champêtre.
On immoloit à Bacchus une pie, parce que le vin fait parler avec indiscrétion, ou un bouc, parce que cet animal détruit les bourgeons de la vigne.
Penthée, roi de Thèbes, ayant voulu s’opposer à la célébration des Bacchanales, fut mis en pièces, sur le mont Cythéron, par les bacchantes, au milieu desquelles se trouvoient la mère et les parentes de ce prince. Les Minéides, ou filles de Minée, s’étant moquées des fêtes de Bacchus, et ayant continué de travailler pendant qu’on célébroit les orgies, furent métamorphosées par ce dieu en chauve-souris, et leurs toiles furent changées en feuilles de vigne ou de lierre.
Apollon. §

D. De qui Apollon étoit-il fils ?
R. Apollon étoit fils de Jupiter et de Latone. La jalouse Junon suscita contre Latone le serpent Python, qui la poursuivoit sans relâche. La Terre avoit juré à la reine des dieux de ne point donner d’asile, à sa rivale. Latone, arrivée au bord de la mer, ne pouvoit plus échapper aux poursuites du monstre ; mais Neptune vint au secours de l’infortunée Latone. Le dieu de la mer poussa contre le rivage l’île de Délos, qui étoit flottante, et qui fut alors rendue stable. Latone s’y réfugia, et y mit au monde Apollon et Diane. Apollon fut surnommé Délien, du lieu où il avoit pris naissance.
D. Quels sont les attributs du fils de Latone ?
R. Apollon est le dieu des arts, de la poésie et de la médecine ; il est aussi considéré comme le dieu du jour.
D. Comment Apollon délivra-t-il la terre du serpent Python ?
R. Apollon tua à coups de flèches ce serpent monstrueux, qui étoit né du limon de la terre après le déluge de Deucalion, et dont les poursuites avoient causé tant de tourments à Latone. Apollon fit couvrir de sa peau le trépied sur lequel s’asseyoit la pythonisse pour rendre ses oracles. En mémoire de cet événement, on institua les jeux Pythiens,
Chez les filles de mémoireAllez apprendre l’histoireDe ce serpent abborré,Dont l’haleine détestée,De sa vapeur empestéeSouilla leur séjour sacré.Lorsque la terrestre masseDu déluge eut bu les eaux,Il effraya le ParnassePar des prodiges nouveaux.Le ciel vit ce monstre impie,Né de la fange croupieAu pied du mont Pélion,Souffler son infecte rageContre le naissant ouvrageDes mains de Deucalion.Mais le bras sûr et terribleDu dieu qui donne le jour,Lava dans son sang horribleL’honneur du docte séjour,Bientôt de la Thessalie,Par sa dépouille ennoblie,Les champs en furent baignés ;Et du Céphise rapideSon corps affreux et livideGrossit les flots indignés.( .)
D. A quelle occasion Apollon fut-il banni du Ciel ?
R. Esculape, fils d’Apollon, avoit appris de son père et du centaure Chiron l’art de la médecine. Il y devint si habile, qu’il rendit la vie à Hippolyte, fils de Thésée, que des monstres marins avoient mis en pièces. Jupiter, indigné qu’un mortel empiétât sur ses droits, foudroya le téméraire médecin. Apollon, ne pouvant se venger contre Jupiter même, tua à coups de flèches les cyclopes qui avoient forgé la foudre. Le maître des dieux en fut si irrité, qu’il chassa Apollon du ciel.
D. Que devint Apollon pendant son exil ?
R. Apollon, dépouillé de touts ses rayons, fut contraint de se faire berger et de garder les troupeaux d’Admète, roi de Thessalie ; c’est ce qui l’a fait honorer depuis comme le dieu des pasteurs. Il aima Daphné, fille du fleuve Pénée, et la poursuivit une année entière. Daphné, épuisée de fatigue, implora le secours de son père, qui la métamorphosa en laurier. Apollon en détacha un rameau dont il se fit une couronne, et voulut que désormais le laurier lui fût consacré, et devînt la récompense des poëtes.
Aux plus savants auteurs, comme aux plus grands guerriersApollon ne promet qu’un nom et des lauriers.( .)
D. Apollon ne fut-il pas aussi malheureux dans ses amitiés que dans ses amours ?
R. Oui. Il aimoit beaucoup le jeune Hyacinthe ; mais un jour, en jouant avec lui au palet, il eut le malheur de le tuer. Il le changea en une fleur qui porté son nom. Le père et la mère d’Hyacinthe voulurent venger sur Apollon la mort de leur fils. Apollon s’enfuit dans la Troade, où Laomédon l’employa avec Neptune à bâtir les murs de Troie.
D. Comment finit la disgrâce d’Apollon ?
R. La colère de Jupiter s’apaisa. Apollon fut rappelé dans le ciel, où il reprit son rang, et fut chargé de distribuer la lumière à l’univers. Comme père de la lumière, Apollon est appelé Phébus ou le Soleil. On le représente sur un char rayonnant de feu, et tiré par quatre chevaux fougueux.
O dieu de la clarté ! vous réglez la mesureDes jours, des saisons et des ans ;C’est vous qui produisez dans les fertiles champsLes fruits, les fleurs et la verdure ;Et toute la natureN’est riche que de vos présents.La nuit, l’horreur et l’épouvanteS’emparent du séjour que vous abandonnez ;Tout brûle, tout rit, tout enchante,Dans les lieux où vous revenez,( .)
D. Quels sont les enfants du Soleil ?
R. Il en eut plusieurs, dont les plus célèbres sont l’Aurore et Phaéton.
D. Qu’est-ce que les poëtes disent de l’Aurore ?
R. Ils disent que lorsque le Soleil sort du lit de Téthys, l’Aurore monte sur un char doré, attelé de deux chevaux plus blancs que la neige. Les roues du char tracent dans l’air un léger sillon de pourpre nuancé d’or et d’azur, La déesse arrive aux portes transparentes de l’Orient, et les ouvre avec ses doigts de rose ; là, elle s’arrête sur un nuage, et d’un œil impatient elle attend le char de son père. Bientôt, au milieu de l’harmonie des sphères célestes, elle croit entendre le hennissement de ses quatre coursiers. Ensuite, elle distingue à travers une vapeur enflammée, l’ardent Pyroïs, le léger Eoüs, le fougueux Ethon, et l’indomptable Phlégon. Enfin, elle aperçoit son père lui-même, qui, de sa main immortelle, tient les rênes étincelâmes. A cette vue, la fille du jour verse des larmes de tendresse ; les zéphyrs les recueillent sur leurs ailes, et les répandent en rosée sur les fleurs.
D. Qu’est-ce que la fable raconte des amours de l’Aurore ?
R. L’Aurore aima principalement Tithon et Céphale.
Tithon étoit fils de Laomédon, et frère de Priam. L’Aurore l’enleva dans son char. Elle demanda pour lui à Jupiter l’immortalité, et l’obtint. Mais elle oublia de demander qu’il ne vieillît pas. Tithon devint si caduc, qu’il fallut l’emmaillotter comme un enfant. Ennuyé des infirmités de la vieillesse, il souhaita d’être changé en cigale. Jupiter lui accorda sa demande.
Céphale étoit fils d’Éole, et mari de Procris, fille d’Érechthée, roi d’Athènes. L’Aurore l’enleva ; mais Céphale resta fidelle à Procris. L’Aurore, après l’avoir inutilement retenu, le rendit à son épouse. Céphale résolut d’éprouver la fidélité de Procris. Il se déguisa, et séduisit son épouse par les présents qu’il lui offrit. Il se découvrit ensuite, et reprocha amèrement à Procris son infidélité. Elle alla cacher sa honte dans les bois. Céphale l’y suivit, ne pouvant vivre sans elle. Procris devint jalouse à son tour. Un jour elle se cacha dans un buisson pour épier son époux. Céphale croyant que c’étoit une bête féroce, la tua avec un dard qu’il lui lança, et qui avoit la propriété de ne manquer jamais son coup. Ayant reconnu son erreur, il se perça avec le même dard. Jupiter changea Céphale et Procris en astres.
D. Quel fils naquit des amours de Tithon et de l’Aurore ?
R. Ce fut Memnon, qui fut tué par Achille, au siége de Troie. Jupiter, pour consoler l’Aurore de la mort de ce fils chéri, lui promit que quand on brûleroit le corps de Memnon, les cendres seroient changées en oiseaux. Ces oiseaux s’appelèrent Memnonides. On érigea une statue à Memnon, dans la ville de Thèbes en Égypte. Quand le soleil levant touchoit cette statue de ses rayons, elle rendoit un son agréable. Le soir, lorsque le soleil alloit éclairer un autre hémisphère, elle rendoit un son lugubre. Ainsi, cette statue sembloit se réjouir du retour de l’Aurore, et s’attrister de son départ.
D. Quelles sont les aventures de Phaéton ?
R. Phaéton eut un différent avec Epaphus qui lui reprocha de n’être pas le fils du Soleil, comme il s’en vantoit. Phaéton alla se plaindre à sa mère, qui le renvoya au Soleil pour apprendre de sa propre bouche la vérité de sa naissance. Phaéton se rendit donc au palais du Soleil. nous a laissé une superbe description de ce palais.
Sur cent colonnes d’or, circulaire portique,S’élève du Soleil le palais magnifique.Le dôme est étoilé de saphirs éclatants.Les portes font jaillir de leurs doubles battantsL’éclat d’un argent pur, rival de la lumière :Mais le travail encor surpassoit la matière.Là d’un savant burin l’artisan de LemnosDe l’Océan mobile a ciselé les flots,Et l’orbe de la Terre environné de l’onde,Et le ciel radieux, voûte immense du monde.L’onde a ses dieux marins, et Protée, et Triton,Triton la conque en main, et l’énorme ÉgéonQui presse entre ses bras une énorme baleine.On voit au milieu d’eux, sur la liquide plaine,Les filles de Doris former cent jeux divers,Sécher leurs longs cheveux, teints de l’azur des mers,Sur le dos des poissons voguer, nager ensemble ;Leur figure diffère, et pourtant se ressemble ;Elle sied à des sœurs. La Terre offre à la foisSes hameaux, ses cités, ses fleuves et ses bois,Et les nymphes de l’onde, et les dieux du bocage.Au-dessus luit des cieux la rayonnante image ;Et le cercle des mois, sous des signes divers,D’une ceinture oblique embrasse l’univers.(Trad. de .)
D. Que demanda Phaéton au Soleil ?
R. Phaéton expliqua à son père le sujet de sa venue, et le conjura de lui accorder une grâce, sans la spécifier. Le Soleil, cédant aux mouvements de l’amour paternel, jura par le Styx de ne lui rien refuser. Alors le jeune téméraire lui demanda la permission d’éclairer le monde pendant un jour seulement, en conduisant son char. Le Soleil, engagé par un serment irrévocable, fit touts ses efforts pour détourner son fils d’une entreprise si difficile ; mais inutilement. Phaéton, qui ne connoît point de danger, persiste dans sa demande, et monte sur le char. Les chevaux du Soleil s’aperçoivent bientôt du changement de conducteur. Ne sentant plus la main de leur maître, ils se détournent de la route ordinaire ; et tantôt montant trop haut, ils menacent le ciel d’un embrasement inévitable ; tantôt descendant trop bas, ils tarissent les rivières, et brûlent les montagnes. La Terre, desséchée jusqu’aux entrailles, porte ses plaintes à Jupiter, qui, pour prévenir le bouleversement de l’univers, et apporter un prompt remède à ce désordre, renverse d’un coup de foudre le fils du Soleil, et le précipite dans l’Éridan. Ses sœurs, les Héliades, inconsolables de la mort de leur frère, furent changées en peupliers, et leurs larmes en ambre. Cygnus, parent de Phaéton, fut métamorphosé en cygne.
D. Dites un mot des oracles d’Apollon.
R. Apollon eut des oracles sans nombre. Les plus célèbres furent ceux de Délos, de Ténédos et de Claros. Son temple le plus superbe et le plus renommé étoit celui de Delphes. La prêtresse qu’il y animoit de son enthousiasme, s’appeloit Pythonisse. Elle étoit assise sur une petite table à trois pieds, qui s’appeloit trépied ou cortine. Cette table étoit couverte de la peau du serpent Python.
D. Que devons-nous savoir d’Apollon, considéré comme l’inventeur de la poésie et de la musique ?
R. Apollon, comme dieu de la poésie et des beaux-arts, est le maître des neuf Muses, avec lesquelles il habite le mont sacré : cette demeure est appelée le Parnasse, l’Hélicon, le Piérius ou le Pinde, parce que toutes ces montagnes sont consacrées à Apollon et aux Muses. On l’appelle encore le sacré vallon. Ce vallon, est arrosé par la rivière de Permesse, par les eaux de la fontaine de Castalie, et par celles de l’Hippocrène.
D. Racontez l’origine de l’Hippocrène.
R. Cette fontaine doit son origine à Pégase, qui la fit jaillir d’un coup de pied.
Pégase étoit un cheval ailé qui naquit du sang de Méduse, lorsque Persée coupa la tête à cette gorgone. Pégase passe pour être la monture des bons poëtes.
D. Quelle vengeance Apollon tira-t-il de Midas ?
R. Pan avoit eu la témérité de prétendre que sa flûte devoit l’emporter sur la lyre d’Apollon. Midas, roi de Phrygie, fut pris pour juge, et adjugea la victoire à Pan, son ami. Apollon, pour s’en venger, fît présent à Midas d’une paire d’oreilles d’âne.
Apollon ne veut pas qu’une oreille si dureDe l’oreille de l’homme ait encor la figure :Couverte d’un poil gris on la voit se dresser,S’alonger, et de honte aussitôt s’abaisser ;Et, puni du délit de son stupide organe,Midas, le roi Midas, a des oreilles d’âne.( , trad. de .)
Le roi ne put cacher sa honteuse difformité à son barbier. Midas lui promit de grandes récompenses, s’il gardoit le secret ; et le menaça des plus terribles châtiments, s’il le violoit. Le barbier, embarrassé de son secret, fit un trou dans la terre, en approcha la bouche, et dit à voix basse, que son maître avoit des oreilles d’âne. Des roseaux crûrent en cet endroit ; et, agités par le vent, ils faisoient entendre ces sons : Midas a des oreilles d’âne.
D. Quel autre trait la fable raconte-t-elle encore de Midas ?
R. La fable raconte que, lorsque Bacchus alloit faire la conquête de l’Inde, Silène s’arrêta vers une fontaine où Midas avoit fait verser du vin. Le vieux Silène s’enivra. Des paysans qui le trouvèrent, le parèrent de guirlandes, et l’amenèrent à Midas qui lui fit un magnifique accueil. Bacchus, ayant retrouvé son père nourricier, en ressentit tant de joie, qu’il promit à Midas de lui accorder le premier don que celui-ci lui demanderont. Midas demanda le privilége de changer en or tout ce qu’il toucheroit. Bacchus lui accorda sa demande. Mais bientôt Midas regretta d’avoir obtenu une telle faveur. Les aliments, en approchant de ses lèvres, se changeoient en or.
Midas se réjouit d’un nuisible bienfait,Y croit à peine, et veut en éprouver l’effet.Il détache une branche ; et sa tige et sa feuilleSe jaunit d’un or pur dans la main qui la cueille.S’il ramasse une pierre, il ramasse un trésor,Et la glèbe qu’il touche est une glèbe d’or.Il change en gerbe d’or l’épi des champs arides ;La pomme est en ses mains un fruit des Hespérides.Aux battants d’une porte applique-t-il ses doigts ?L’or pur en longs reflets rayonne sur le bois.Si d’une eau qu’on épand sa main est arrosée,On voit autour de lui l’or pleuvoir en rosée.De ses vœux insensés rien n’arrête l’essor ;Déjà dans sa pensée il change tout en or.
Tandis qu’il s’applaudit d’un don peu desirable,Des mets les plus exquis on a chargé sa table :Sa main change en métal les présents de Cérès.C’est en vain qu’il s’apprête à savourer les mets :Sa dent qui se fatigue écrase un or solide ;Sur ses lèvres le vin ruisselle en or fluide :Détrompé d’un bonheur qui le rend malheureux,Il maudit sa richesse, et condamne ses vœux.Consumé d’une faim, d’une soif sans remède,Il se trouve indigent des trésors qu’il possède ;L’or qu’il a desiré punit ses vains desirs.Il lève au ciel les mains, il pousse des soupirs,Il s’écrie : ô Bacchus ! pardonne un vœu coupable ;Délivre-moi d’un bien qui me rend misérable.( , trad. de .)
Bacchus, touché du repentir de Midas lui ordonna, pour se délivrer de cette vertu fatale, de se baigner dans les eaux du Pactole. Ce fleuve, qui traverse la Lydie6, roule depuis ce temps un sable d’or avec ses flots.
D. Dites quelle vengeance Apollon tira pareillement de Marsyas.
R. Marsyas étoit un satyre de Phrygie. Il trouva la flûte que Minerve avoit rejetée, parce que cet instrument la rendoit trop difforme, quand elle s’en servoit. Marsyas perfectionna la flûte, où il sut rassembler touts les sons qui se trouvoient auparavant partagés entre les divers tuyaux du chalumeau. Il fut le premier qui mit en musique les hymnes consacrés aux dieux. Attaché à Cybèle, il l’accompagna dans ses voyages, qui les conduisirent l’un et l’autre à Nyse, où ils rencontrèrent Apollon. Fier de ses nouvelles découvertes, Marsyas eut la hardiesse de faire au dieu un défi qui fut accepté, à condition que le vaincu seroit à la discrétion du vainqueur. Apollon l’emporta sur son rival, et l’ayant attaché à un arbre, il l’écorcha tout vif. Le sang de Marsyas fut transformé en un fleuve qui porta le même nom, et qui traversoit la ville de Célène, dans la Phrygie.
D. Comment Apollon est-il représenté ?
R. Apollon est représenté sous les traits d’un beau jeune homme avec des cheveux blonds, un carquois sur l’épaule, un arc à la main, sur la tête une couronne de laurier ; ou bien dans son char d’or traîné par quatre chevaux placés de front.
D. Quel étoit l’oiseau consacré à Apollon ?
R. C’étoit le corbeau, parce que cet oiseau présidoit aux divinations, et que son vol et son chant servoient souvent de règle aux augures. La fable dit que le corbeau avoit d’abord le plumage blanc, mais qu’Apollon le noircit pour le punir d’un rapport indiscret. L’oiseau avoit découvert à Apollon l’infidélité de Coronis que ce dieu aimoit. Apollon, dans un premier transport de jalousie, tua son amante ; mais il se repentit bientôt de sa vengeance, et changea Coronis en corneille.
Les Muses. §
D. De qui les Muses sont-elles filles ?
R. Les Muses sont filles de Jupiter et de Mnémosine, déesse de la mémoire. On en compte neuf, savoir, Calliope, Clio, Erato, Thalie, Polymnie, Uranie, Melpomène, Terpsichore et Euterpe. Elles habitoient avec Apollon sur le mont Parnasse.
D. A quoi préside chacune des neuf Muses ?
R. Calliope préside à l’éloquence et au poëme héroïque ; Clio, à l’histoire ; Erato, aux poésies amoureuses ; Melpomène, à la tragédie ; Thalie, à la comédie ; Terpsichore, à la danse ; Euterpe, aux instruments ; Polymnie, à l’ode ; Uranie, à l’astronomie.
Les divers emplois des Muses sont heureusement exprimés dans les vers suivants :
Clio, des temps passés conservant la mémoire,Des peuples et des rois nous raconte l’histoire.
Calliope, en ses vers nobles, harmonieux,Célèbre les exploits des héros et des dieux.
Un poignard à la main, la triste MelpomèneTient du malheur des grands épouvanter la scène.
La comique Thalie instruit ses spectateurs,Et nous peint, en riant, nos vices et nos mœurs.
Terpsichore, avec art règle ses pas agiles ;A la danse elle rend ses élèves habiles.
Euterpe, présidant aux leçons des bergers,De la flûte tira des sons doux et légers.
Erato sait toucher et le luth et la lyre,Et dicter aux amants des vers qu’amour inspire.
Polymnie, éloquente en ses moindres discours,Prescrit à l’orateur ses termes et ses tours.
Et la docte Uranie, étudiant la sphère,Sait mesurer les cieux et diviser la terre.
Diane. §
D. De qui Diane étoit-elle fille ?
R. Diane étoit fille de Jupiter et de Latone, et sœur d’Apollon ; on là nommoit Lune dans le ciel, Diane sur la terre, Hécate dans les enfers ; et sous ces trois différents noms, elle n’étoit qu’une même divinité : c’est pourquoi les poëtes l’appellent déesse à trois formes ou triple Hécate. Les trois fonctions qui lui sont propres, se trouvent bien expliquées dans ces vers.
Brillant astre des nuits, vous réparez l’absenceDu dieu qui nous donne le jour ;Votre char, lorsqu’il fait son tour,Impose à l’univers un auguste silence,Et touts les feux du ciel composent votre cour.En descendant des cieux, vous venez sur la terreRégner dans les vastes forêts ;Votre noble loisir sait imiter la guerre :Les monstres dans vos jeux succombent sons vos traits.Jusque dans les enfers votre pouvoir éclate ;Les manes en tremblant écoutent votre voix ;Au redoutable nom d’Hécate,Le sévère Pluton rompt lui-même ses lois.( .)
D. Comment Diane étoit-elle considérée sur la terre ?
R. Elle étoit considérée comme la déesse des chasseurs. Elle habitoit les bois et les forêts avec une troupe de nymphes qu’elle occupoit toujours à la chasse. On l’appelle la chaste Diane, parce qu’elle ne voulut jamais se marier. Elle avoit même tant de pudeur, qu’elle changea en cerf le chasseur Actéon qui avoit eu la témérité de la regarder dans le bain. Actéon fut dévoré par ses propres chiens. On dit cependant que Diane aima le berger Endymion ; mais alors elle est regardée comme divinité céleste.
D. Comment Diane punit-elle la nymphe Calisto ?
R. Calisto, fille de Lycaon, étoit la nymphe la plus chérie de Diane. Jupiter en devint amoureux, et prit la figure de Diane même pour tromper la nymphe trop crédule. La déesse, ayant connu la faute de Calisto, la chassa de sa compagnie, Junon poussa plus loin sa vengeance, et la métamorphosa en ourse ; mais Jupiter l’enleva avec son fils Arcas, et les plaça dans le ciel, où ils forment les constellations de la grande et de la petite Ourse.
D. Quelle vengeance Diane exerça-t-elle contre Niobé ?
R. Niobé, fille de Tantale et de Dioné, épousa Amphion, roi de Thèbes. Elle en eut douze enfants, six fils et six filles ; et, fière de sa fécondité, elle se préféra à Latone. Diane et Apollon, pour venger leur mère, tuèrent à coups de flèches touts les enfants de Niobé ; et cette mère infortunée, changée en rocher, conserva, pour son supplice éternel, le sentiment de sa douleur.
D. Quel étoit le plus fameux temple de Diane ?
R. C’étoit celui d’Éphèse. Toute l’Asie concourut pendant deux cent vingt-cinq ans à l’enrichir et à l’orner, et il fut compté au nombre des sept merveilles du monde. Il fut brûlé par Érostrate, le jour même de la naissance d’Alexandre. Érostrate y mit le feu, dans la seule vue de rendre son nom célèbre. Les Éphésiens défendirent par un décret de prononcer le nom de ce fou ; mais ce nom n’en est pas moins parvenu jusqu’à nous.
D. Comment Diane est-elle représentée ?
R. On la représente chaussée d’un cothurne, tenant un arc d’une main, et de l’autre une flèche ; elle porte un carquois sur l’épaule, et un croissant sur le front. Quelquefois on la peint dans un char traîné par des biches.
Génius §
D. Qu’est-ce que Génius ?
R. Génius est le dieu de la nature. On le regardoit comme la divinité qui donnoit l’être et le mouvement à tout. Les empires, les provinces, les villes et les lieux particuliers avoient leur génie tutélaire. Chaque homme avoit aussi son génie ; quelques-uns même prétendoient que les hommes en avoient deux, un bon, qui les portoit au bien, et un mauvais, qui leur inspiroit le mal. Chacun, le jour de sa naissance, sacrifioit à son génie ; on lui offroit du vin, des fleurs, de l’encens ; mais on ne répandoit point de sang dans ces sortes de sacrifices.
Seconde partie. Dieux de la seconde classe. §
Divinités champêtres. §
Pan. §

Demande. Quel dieu tenoit le premier rang parmi les divinités champêtres ?
Réponse. C’étoit le dieu Pan ; il étoit l’inventeur de la flûte, et le dieu des bergers, des bois et des prairies.
Pan trouva le premier cet art ingénieuxDe former sur la flûte un son harmonieux.Pan règne sur nos bois ; il aime nos prairies :C’est le dieu des bergers et de leurs bergeries.( .)
On le représentoit avec des cornes sur la tête, une face rubiconde et tenant en main une espèce de flûte composée de plusieurs tuyaux, qu’on appeloit syrinx.
D. Racontez l’origine de cette flûte.
R. Syrinx, fille du fleuve Ladon, étoit une des nymphes de Diane. Pan l’aima inutilement. Syrinx, fuyant ses poursuites, arriva sur les bords du Ladon, et implora le secours de son père. Celui-ci la changea en roseau. Pan joignit avec de la cire plusieurs bouts de roseau, et en forma la flûte.
D. Dites d’où vient l’expression de terreur panique.
R. Les Grecs ont attribué à leur dieu Pan l’origine de cette terreur subite dont la cause est inconnue. Brennus s’étoit avancé à la tête des Gaulois, pour piller le fameux temple de Delphes. Pan jeta l’épouvante dans cette armée qui fut taillée en pièces. De là vient l’expression de terreur panique.
D. En quels lieux Pan étoit-il principalement honoré ?
R. Pan étoit particulièrement honoré en Arcadie. Les Romains célébroient en son honneur des fêtes appelées Lupercales. Ce mot vient du nom d’une grotte située sur le mont Palatin, dans laquelle on croyoit à Rome qu’une louve avoit allaité Rémus et Romulus.
Palès §
D. Qu’étoit Palès ?
R. Palès étoit la déesse des bergers ; elle avoit les troupeaux sous sa protection. Les Romains célébroient sa fête au mois d’avril. Les bergers lui offroient du lait, du vin cuit et du millet ; puis, allumant, à des distances égales, trois grands feux de paille, ils sautoient par-dessus ; et le plus agile remportoit le prix, qui ordinairement étoit une jeune chèvre ou un agneau.
Que j’aime à revoler vers ces fêtes champêtresOù Rome célébroit les dieux de ses ancêtres,La déesse des blés et le dieu des raisins,Les nymphes des forêts, les faunes, les sylvains,Toi, sur-tout, toi, Palès, déité pastorale !A peine blanchissoit la rive orientale,Le berger, secouant un humide rameau,D’une onde salutaire arrosoit son troupeau :O Palès ! disoit-il, reçois nos sacrifices,Protège mes brebis, protège mes génissesContre la faim cruelle et le loup inhumain,Que je trouve le soir le nombre du malin ;Qu’autour de mon bercail, exacte sentinelle,Sans cesse en haletant rôde mon chien fidelle ;Que mon troupeau connoisse et ma flûte et ma voix ;Que le lait le plus pur écume entre mes doigts ;Rends mon bélier ardent, rends mes chèvres fécondes ;Puissent de frais gazons, puissent de claires ondesDans un riant pacage arrêter mes brebis ;Que leur fine toison compose mes habits ;Et quand le fuseau tourne entre leurs mains légères,Ne blesse pas les doigts de nos jeunes bergères.( .)
Flore. §
D. Qu’étoit Flore ?
R. Flore étoit la déesse des fleurs et du printemps ; elle épousa Zéphire. Les jeux que l’on célébroit en son honneur s’appeloient les jeux floraux. On la représente ornée de guirlandes et couronnée de fleurs.
Muse ! décris tes plus chères amours !Contemple ici les feuilles de veloursDont se revêt la modeste auricule !Vois s’enflammer la pleine renoncule,Et l’anémone arrondir ses atours !Vois la tulipe, autour de son caliceDe ses couleurs déployer le caprice,Et l’hyacinthe, à son pâle incarnatAssocier sa blancheur précieuse ;Et le narcisse, épris de son éclat,Pencher encor sur l’onde fabuleuse :Vois la jonquille et l’œillet moucheté,La rose enfin que Damas nous envoie,Jusqu’aux bluets qui couronnent l’été :Tout porte aux sens la surprise et la joie !Que de beauté ! quelle profusion !De toutes parts Flore étend son empire,De la colline elle court au vallon,Et son haleine embaume le zéphyre.Qui n’aimeroit ces touffes de lilas,Dont le panache émaille la verdure !Charmante fleur, dont l’agreste parureDe la bergère embellit les appas !Qui ne perdroit sous leur voûte chérie,Le souvenir des peines de la vie !On s’assoupit dans des songes dorés,Au petit bruit des sources murmurantes,Des vents émus dans les airs tempérés,Et des essaims d’abeilles bourdonnantes,Qui, suspendus en grappes éclatantes,Sucent des fleurs les esprits éthérés.( .)
Pomone §
D. A quoi préside Pomone ?
R. Pomone préside aux fruits et aux vergers. Elle étoit l’épouse de Vertumne, dieu de l’automne. On la représente une serpette à la main une couronne de fruits sur la tête, avec une corne d’abondance.
Quels parfums remplissent les airs ?Où porter mes regards avides ?Des tapis plus frais et plus vertsRenaissent dans nos champs arides :La Nature efface ses rides,Touts ses trésors nous sont ouverts,Et le jardin des HespéridesEst l’image de l’univers.C’en est fait, la Vierge céleste,En découvrant son front vermeil,Adoucit d’un regard modesteL’ardeur brûlante du soleil.Redoutable fils de Latone,Tu cesses de blesser nos yeux :Vertumne ramène Pomone,Et mille fruits délicieuxBrillent sur le sein de l’Automne.O sœur aimable du Printemps !Tu viens acquitter ses promesses,Si tes biens sont moins éclatants,Tu n’as point de fausses richesses.Pomone, avant que de périr,Semble redoubler ses caresses ;Les arbres chargés de richessesSe courbent pour vous les offrir.Lasse de ramper sur nos treilles,La vigne élève ses rameaux,Et suspend ses grappes vermeillesAu front superbe des ormeaux.L’Amour, que l’Automne rappelle,Descend du ciel dans nos vergers,Et vient offrir à la plus belleLes pommes d’or des orangers.Accourez, Naïades timides,Le fruit, sur la terre tombéBrille, s’élève en pyramides,Et remplit le trésor d’Hébé.Nymphes, enlevez vos corbeilles,Allez offrir au dieu des eaux.La pourpre qui couvre nos treilles,L’ambre qui pare nos coteaux.Un second printemps vient d’éclore,Le ciel répand des rayons d’or,L’amaranthe et le tricolor.Rappellent le règne de Flore,Et la campagne brille encorDes douces couleurs de l’Aurore.( .)
Faune. §
D. Qu’est-ce que la fable nous apprend de Faune ?
R. Faune, roi d’Italie, étoit fils de Picus ou de Mars, et petit-fils de Saturne. Il fut mis au nombre des dieux champêtres, parce qu’il introduisit dans ses états les travaux de l’agriculture.
Sylvain. §
D. A quoi présidoit Sylvain ?
R. Sylvain présidoit aux forêts. On le représente tenant un cyprès à la main. On le confond souvent avec le dieu Pan et avec le dieu Faune. C’est de son nom qu’on appela Sylvains, les dieux champêtres qui paroissent être les mêmes que les Faunes.
Satyres. §
D. Que raconte-t-on des Satyres ?
R. Les Satyres étoient des divinités champêtres, qu’on représentoit comme de petits hommes fort velus, avec des cornes et des oreilles de chèvre, la queue, les cuisses et les jambes du même animal. On prétend qu’ils poursuivoient les bergères, et leur inspiroient de grandes frayeurs.
Priape. §
D. Qu’étoit Priape ?
R. Priape étoit le dieu des jardins. On croyoit que c’étoit lui qui les gardoit et qui les faisoit fructifier. Aussi les Romains plaçoient sa statue dans les jardins, soit d’utilité, soit d’agrément.
Touts les ans, d’un lait pur une coupe t’est due,Priape, c’est assez pour un dieu tel que toi ;Si mon troupeau s’accroît, j’ornerai ta statue,Et dans touts nos jardins nous chérirons ta loi.( .)
Terme §
D. Qu’étoit Terme ?
R. Terme étoit le dieu protecteur des bornes que l’on met dans les champs, et le vengeur des usurpations. C’est un des plus anciens dieux des Romains ; ce fut Numa qui inventa cette divinité comme un frein plus capable que les lois d’arrêter la cupidité. Il n’y avoit rien de plus sacré que les limites des champs. Ceux qui avoient l’audace de les changer, étoient dévoués aux Furies, et il étoit permis de les tuer. Le maître d’un champ parle ainsi au dieu Terme :
Terme, qui que tu sois, ou de bois ou de pierre,Tu n’es pas moins un dieu que le dieu du tonnerre ;Garde que mon voisin ne me dérobe rien ;Mais, dans ton poste inébranlable,Si son avide soc empiétoit sur mon bien,Crie aussitôt comme un beau diable :Alte-là, mon voisin, voisin insatiable,C’est là ton champ, et c’est ici le mien.( , trad. libre.)
Echo. §
D. Racontez les malheurs de la nymphe Echo.
R. Echo étoit fille de l’Air et de la Terre. Junon, piquée de ce que cette nymphe l’avoit amusée par des discours adroits, et l’avoit ainsi empêchée de surprendre Jupiter qui étoit avec une de ses maîtresses, la condamna à ne plus répéter que les dernières syllabes de tout ce qu’elle entendroit dire. Echo devint amoureuse du beau Narcisse, fils de la nymphe Lyriope et du fleuve Céphise. Mais Narcisse la méprisa. Echo, consumée de douleur, se dessécha peu à peu, et ne conserva que les os et la voix. Elle fut changée en rocher,
D. Comment Narcisse fut-il puni de son indifférence ?
R. Les compagnes de la nymphe Echo prièrent l’Amour de venger leur sœur, des mépris de Narcisse. L’Amour les exauça. Il conduisit Narcisse au bord d’une fontaine. Le jeune homme s’y vit ; et, épris de sa propre figure, il ne voulut plus quitter ces eaux. Il y resta toujours occupé à se regarder, et s’y laissa mourir. Le devin Tirésias avoit prédit à ses parents, qu’il vivroit tant qu’il ne se verroit point. Narcisse fut changé en une fleur qui porte son nom.
Divinités domestiques. §
Lares, Pénates. §
D. Quels sont les principaux dieux domestiques ?
R. Ce sont les Lares et les Pénates.
Les Lares sont les dieux des maisons particulières. Les Pénates sont les dieux des villes, des pays. On confond souvent les Pénates avec les Lares. Les Lares étoient placés dans l’intérieur des maisons, derrière la porte ou bien autour des foyers. Le culte de ces dieux est venu de ce que l’on enterroit autrefois les morts dans les maisons. Les anciens crurent que les ames de leurs parents y demeuroient aussi, et ils les regardoient comme des génies secourables et propices.
Enée, prince Troyen, est célèbre par sa piété envers les dieux, et sur-tout pour avoir sauvé de l’incendie de Troie les Pénates de cette ville.
De quelques autres divinités du second ordre. §
Comus. §
D. Quel étoit l’emploi de Comus ?
R. Comus étoit le dieu des festins, et présidoit à la toilette et aux fêtes. On le représente en jeune homme gras et frais, un bonnet de fleurs sur la tête, un vase d’une main et un bassin de l’autre.
Momus. §
D. A quoi présidoit Momus ?
R. Momus, fils du Sommeil et de la Nuit, étoit le dieu de la raillerie et du badinage. Rien ne trouvoit grâce à ses yeux, et les dieux mêmes étoient l’objet de ses plus sanglantes railleries. Neptune avoit fait un taureau, Vulcain un homme, et Minerve une maison. Momus reprocha à Neptune de n’avoir point placé les cornes du taureau devant les yeux de cet animal, pour qu’il frappât plus sûrement. Il auroit voulu que l’homme de Vulcain eût une petite fenêtre au cœur, pour qu’on pût connoître ses plus secrètes pensées. Enfin, la maison de Minerve lui paroissoit mal entendue, parce qu’elle étoit trop massive, pour être transportée lorsqu’on avoit un mauvais voisin. L’humeur satirique de Momus le fit chasser du ciel : on le représente démasquant un visage ; et tenant à la main une marotte, symbole de folie.
Morphée, Songes. §
D. Qu’étoit Morphée ?
R. Morphée, le premier des Songes, est regardé comme le ministre du Sommeil, son père. Quelques-uns le prennent pour le dieu même du sommeil. On le représente avec des ailes de papillon, pour exprimer sa légèreté ; il tient à la main une plante de pavots, dont touche ceux qu’il veut endormir.
D. Qu’est-ce que les Songes ?
R. Les Songes sont aussi enfants du Sommeil. Les poëtes ont imaginé que les songes vrais passoient par une porte de corne, et annonçoient des biens ou des maux réels que les songes faux passoient par une porte d’ivoire, et n’étoient que de pures illusions, de vains fantômes de l’imagination. On les représentoit avec de grandes ailes de chauve-souris toutes noires.
Mais sur l’homme assoupi Morphée est descendu ;
Sa paupière est fermée, et son corps étendu.Qui remplira le vide où le sommeil le plonge ?Les Souvenirs portés sur les ailes d’un songe.Dans ces tableaux trompeurs, par eux seuls animés,Il reprend ses travaux, ses jeux accoutumés.Le berger endormi tient encor sa houlette,Le poëte son luth, le peintre sa palette ;L’ami des champs croit voir les prés et les vallons,Et d’un pied fantastique il foule les gazons ;Le chasseur presse et frappe un cerf imaginaire,Le guerrier d’un vain bronze affronte le tonnerre.( .)
Harpocrate. §
D. Qu’étoit Harpocrate ?
R. Harpocrate, dieu Égyptien, fils d’Osiris et d’Isis, présidoit au silence. Cette divinité allégorique est représentée sous la figure d’un homme ou d’une femme qui tient un doigt sur la bouche.
Thémis, Astrée §

D. Quelle est la déesse de la justice ?
R. C’est Thémis, fille du Ciel et de la Terre. On la représente ordinairement avec une balance à la main et un bandeau sur les yeux. Quelques-uns la représentent tenant une épée à la main.
Je vois une auguste déesse,De qui la droite vengeresseFait briller un glaive tranchant.Dans sa gauche est une balance,Que ni fraude ni violenceNe forcent au moindre penchant.C’est Thémis, oui, c’est elle-même :Orné de l’éclat le plus beau,Son front porte ce diadèmeQue Tireur prend pour un bandeau.( .)
D. Qu’étoit Astrée ?
R. Astrée, fille de Jupiter et de Thémis, est regardée comme la justice, et souvent confondue avec sa mère. Elle descendit du ciel, dans l’âge d’or, pour habiter la terre. Mais les crimes des hommes la formèrent de quitter successivement les villes, puis les campagnes. Elle retourna au ciel, où les poëtes disent qu’elle forma le signe de la Vierge dans le zodiaque.
La renommée. §
D. Quelles sont les fonctions de la Renommée ?
R. La Renommée étoit la messagère de Jupiter. Les poëtes la dépeignent comme une déesse énorme, qui a cent oreilles et cent bouches. On la représente avec des ailes au dos, et une trompette à la main.
Déjà la Renommée, en traversant les airs,En a semé le bruit chez cent peuples divers.Foible dans sa naissance, et timide à sa source,Ce monstre s’enhardit, et s’accroît dans sa course.La Terre l’enfanta, pour se venger des cieux ;Elle aime à publier les foiblesses des dieux :Digne sœur des géants qu’écrasa leur tonnerre,Son front est dans l’Olympe, et ses pieds sur la terre ;Rien ne peut égaler son bruit tumultueux,Rien ne peut devancer son vol impétueux :Pour voir, pour écouter, pour semer les merveilles,Ce monstre ouvre à la fois d’innombrables oreilles,Par d’innombrables yeux surveille l’univers,Et par autant de voix fait retentir les airs.La nuit, d’un vol bruyant, fendant l’espace sombre,Il observe le crime enseveli dans l’ombre ;Le jour, il veille assis sur les palais des rois ;Et, de là répandant son effrayante voix,A l’univers surpris incessamment raconteLa vérité, l’erreur, et la gloire, et la honte.( , trad. de .)
Entre le ciel, la terre, et l’empire des ondes,S’élève un vieux palais aux confins des trois mondes.Là, sur touts les pays l’œil se porte à la fois ;Là, de touts les humains l’oreille entend la voix.
Au sommet d’une tour qui n’est jamais fermée,C’est là que nuit et jour veille la Renommée.On y voit en tout temps cent portiques ouverts,Échos de touts les bruits qui courent l’univers.Ce palais merveilleux, bâti d’airain sonore,Rend le son, le répète, et le répète encore.La voix roule à travers cent tortueux détours ;Ce ne sont point des cris, mais des murmures sourds,Pareils au bruit lointain de la mer mugissante,Pareils aux roulements de la foudre mourante.Un peuple curieux en assiége les murs.Il vient, il va, revient ; et cent récits obscurs,Amas tumultueux de confuses paroles,Mêlent aux vérités des mensonges frivoles.L’un dit, l’autre redit ; la rumeur en son coursGrossit de bouche en bouche, et le faux croît toujours.La crédulité vaine, et l’erreur téméraire,Les paniques terreurs, la joie imaginaire,La sédition sourde, et les bruits clandestins,Enfants toujours douteux de rapports incertains,Entourent la déesse en nouveautés féconde ;Et ses yeux sont ouverts sur touts les coins du monde.( , trad. de .)
Quelle est cette déesse énorme,Ou plutôt ce monstre difforme,Tout couvert d’oreilles et d’yeux,Dont la voix ressemble au tonnerre,Et qui des pieds touchant la terre,Cache sa tête dans les cieux ?C’est l’inconstante Renommée,Qui, sans cessé les yeux ouverts,Fait sa revue accoutuméeDans touts les coins de l’univers :Toujours vaine, toujours errante,Et messagère indifférenteDes vérités et de l’erreur,Sa voix en merveilles féconde,Va chez touts les peuples du monde ;Semer le bruit et la terreur.( .)
La fortune. §
D. Qu’étoit la Fortune ?
R. La Fortune étoit une déesse qui présidoit à touts les événements, et distribuoit les biens et les maux suivant son caprice. Les poëtes la dépeignent chauve, aveugle, toujours debout, avec des ailes aux deux pieds, l’un légèrement appuyé sur une roue qui tourne sans cesse, et l’autre élancé en l’air. Le plus célèbre de ses temples étoit à Antium.
Pourquoi d’une plainte importuneFatiguer vainement les airs ?Aux jeux de l’aveugle FortuneTout est soumis dans l’univers.Ainsi de douceurs en supplicesElle nous promène à son gré.Le seul remède à ses caprices,C’est de s’y tenir préparé.( .)
Némésis ou Adrastée. §
D. A quoi présidoit Némésis ?
R. Némésis, que quelques-uns nomment aussi Adrastée, étoit la déesse de la vengeance. Elle châtioit ceux qui abusoient des faveurs de la fortune. On la représente avec des ailes, armée de serpents et de torches ardentes, et une couronne sur la tête.
Némésis vous observe, et frémit des blasphèmesDont rougit à vos yeux l’aimable vérité.N’attirez point sur vous, trop épris de vous-mêmes,Sa terrible équité.C’est elle dont les yeux certains, inévitables,Percent touts les replis de nos cœurs insensés ;El nous lui répondons des éloges coupablesQui nous sont adressés.( .)
L’Envie. §
D. Comment l’Envie est-elle représentée ?
R. L’Envie, fille de la Nuit, est représentée sous les traits d’un vieux spectre féminin, ayant la tête ceinte de couleuvres, les yeux louches et enfoncés, un teint livide, une horrible maigreur, des serpents dans les mains, et un autre qui lui ronge le sein.
Sur son front pâle et sombre habite le chagrin :Une affreuse maigreur a desséché son sein.Le fiel rouille ses dents ; son œil est faux et louche ;Le venin de son cœur distille de sa bouche.Triste de noire joie, elle ne rit jamaisQue des maux qu’elle a vus, ou de ceux qu’elle a faits ;Et la nuit et le jour un soin rongeur l’éveille.Le bruit de la louange afflige son oreille.Son supplice est de voir la gloire des talents :Elle sèche, et périt de leurs succès brillants,Veut leur nuire, et se nuit…( , trad. de .)
Là, gît la sombre Envie, à l’œil timide et louche,Versant sur des lauriers les poisons de sa bouche ;Le jour blesse ses yeux dans l’ombre étincelant ;Triste amante des morts, elle hait les Vivants.( .)
La Discorde. §
D. Dites ce qu’étoit la Discorde ?
R. La Discorde étoit une divinité malfaisante à laquelle on attribuoit les guerres et les querelles qui divisent les hommes. Jupiter l’exila du ciel, parce qu’elle ne cessoit de brouiller les dieux. On lui donne une chevelure hérissée de serpents, et attachée avec des bandelettes sanglantes. Elle a la bouche écumante, les yeux abattus ; elle grince des dents, et distille de sa langue un venin infect. Elle tient à la main un poignard ou un flambeau.
D. Quel portrait a-t-il fait de la Discorde ?
R. Il dépeint ainsi cette affreuse déesse :
Ce monstre impérieux, sanguinaire, inflexible,De ses propres sujets est l’ennemi terrible :Aux malheurs des mortels il borne ses desseins.Le sang de son parti rougit souvent ses mains.Il habite en tyran dans les cœurs qu’il déchire,Et lui-même il punit les forfaits qu’il inspire.Son baleine en cent lieux répand l’aridité :Le fruit meurt en naissant de son germe infecté ;Les épis renversés sur la terre languissent :Le ciel s’en obscurcit, les astres en pâlissent ;Et la foudre en éclats qui gronde sous ses pieds,Semble annoncer la mort aux peuples effrayés.
Bellone.
D. Qu’étoit Bellone ?
R. Bellone, déesse de la guerre, étoit sœur de Mars. C’étoit elle qui atteloit les chevaux de ce dieu, lorsqu’il partoit pour la guerre. Les poëtes la dépeignent au milieu des combats, courant de rang en rang, les cheveux épars, le feu dans les yeux, et faisant retentir dans les airs son fouet ensanglanté : on lui donne aussi pour arme un fléau, ou une verge teinte de sang.
Mars est impitoyable, et l’horrible BelloneEn l’ardeur des combats ne respecte personne ;Tout, sans distinction, sous ses coups elle abat,Et n’épargne pas plus le chef que le soldat.( .)
Troisième partie. Des demi-dieux. §
Persée. §
Demande. Racontez la naissance de Persée.
Réponse. Persée étoit fils de Jupiter et de Danaé. Acrisius, roi d’Argos, avoit appris de l’oracle, qu’il périroit de la main d’un fils que Danaé, sa fille, mettroit au monde. Pour prévenir ce malheur, il enferma la princesse dans une tour d’airain, et lui donna des gardes, afin qu’aucun homme ne pût en approcher. Mais Jupiter, changé en pluie d’or, pénétra dans la tour, c’est-à-dire, qu’il corrompit les gardes en leur présentant de l’or. Persée fut le fruit de cette entrevue clandestine.
D. Comment Persée fut-il élevé ?
R. Acrise ordonna que cet enfant fût exposé à la merci des flots avec sa mère dans une méchante barque. La nacelle fut jetée sur les côtes de la petite île de Sériphe, l’une des Cyclades. Polydecte, roi de cette île, reçut favorablement Persée, et prit soin de son éducation. Mais, dans la suite, Polydecte étant devenu amoureux de Danaé, chercha à éloigner son fils. Dans cette vue, il lui ordonna de combattre les Gorgones, et de lui apporter la tête de Méduse.
D. Faites-nous connoître les Gorgones.
R. Les Gorgones étoient trois sœurs, filles de Phorcus, dieu marin, et de Céto. Elles s’appeloient Méduse, Euryale et Sthénée. Elles n’avoient à elles trois qu’un œil et une dent dont elles se servoient tour à tour. Mais c’étoit une dent plus longue que les défenses des plus forts sangliers. Leurs mains étoient d’airain, et leurs cheveux hérissés de serpents. De leurs seuls regards elles pétrifioient les hommes. Persée, favorisé des dieux, obtint, pour cette expédition, le bouclier de Minerve, le casque de Pluton, les ailes et les talonnières de Mercure. Il vainquit les Gorgones, et coupa la tête de Méduse. Il porta depuis cette tête avec lui dans toutes ses entreprises, et s’en servit pour pétrifier ses ennemis. Du sang de Méduse naquit, dit-on, le cheval Pégase.
D. Contre qui Persée essaya-t-il d’abord le pouvoir de la tête de Méduse ?
R. Ce fut contre Atlas, roi de Mauritanie. Ce prince avoit appris d’un oracle de Thémis, qu’un fils de Jupiter devoit lui ravir des pommes d’or qu’il faisoit garder par un dragon. Il refusa l’hospitalité à Persée qui, pour s’en venger, lui montra la tête de Méduse, et le changea en montagne. Les poëtes ont feint qu’Atlas soutient le ciel sur ses épaules, soit parce que le mont Atlas est fort élevé, soit parce qu’il avoit existé un célèbre astronome de ce nom. raconte ainsi la métamorphose d’Atlas :
A cet aspect hideux, d’horreur inanimé,En un mont sourcilleux Atlas est transformé :Se taille s’agrandit, son front sombre et terribleEst la cime d’un roc neigeux, inaccessible.Sa barbe et ses cheveux se changent, en forêts ;Ses épaules, ses flancs, en coteaux, en sommets ;Ses vastes ossements se durcissent en pierre ;Ses pieds sont des rochers affermis sur la terre ;Sa hauteur est immense, et, par l’ordre des dieux,Ce colosse à jamais porte le poids des cieux.(Trad. de .)
D. Quel usage Persée fit-il encore de la tête de Méduse ?
R. Andromède, fille de Céphée roi d’Éthiopie, et de Cassiopée, avoit été exposée sur un rocher, pour être dévorée par un monstre marin. Persée, monté sur Pégase, vint la délivrer, et pétrifia le monstre en lui présentant la tête fatale. Céphée donna sa fille pour épouse à Persée. Mais Phinée, oncle de la princesse, voulut l’enlever à Persée. Celui-ci eut encore recours à la tête de Méduse, dont la vue pétrifia Phinée et ses compagnons. Persée consacra ensuite à Minerve la tête de Méduse, qui, depuis ce temps-là, fut gravée sur la redoutable égide de la déesse.
D. Comment fut accomplie la prédiction qui avoit été faite à Acrise, qu’un jour son petit-fils lui raviroit la couronne et la vie ?
R. Persée, voulant un jour faire preuve de son adresse au jeu de palet, atteignit Acrise, et l’étendit mort sur la place. Il eut tant de chagrin de cet accident, qu’il se condamna à l’exil. Jupiter le plaça dans le ciel, parmi les constellations septentrionales, avec Andromède son épouse, Cassiopée et Céphée.
Hercule. §

D. Quel a été le plus célèbre des héros de l’antiquité ?
R. C’est Hercule, fils de Jupiter et d’Alcmène femme d’Amphitrion roi de Thèbes. Jupiter vint se présenter à Alcmène, sous les traits d’Amphitrion, pendant que celui-ci étoit occupé à la guerre. Alcmène, déjà enceinte, mit au monde deux jumeaux, dont l’un nommé Eurysthée fut fils d’Amphitrion, et l’autre appelé Hercule y eut pour père Jupiter.
D. Quelles persécutions Junon fit-elle éprouver à Hercule ?
R. La reine des dieux épuisa touts les efforts de sa fureur jalouse contre ce fils de Jupiter. D’abord, elle fit naître Eurysthée avant lui afin qu’en sa qualité d’aîné, il eût le droit de commander à son frère. Elle envoya ensuite deux serpents horribles, pour le dévorer dans son berceau. Hercule saisit ces monstres et les mit en pièces. La déesse, se radoucit alors, à la prière de Pallas, et consentit même à donner de son lait à l’enfant, pour le rendre immortel. Hercule aspira si fortement le lait de Junon, qu’il en rejaillit une grande quantité, d’où se forma dans le ciel cet amas prodigieux d’étoiles qui font une longue trace du nord au sud, et qu’on appelle la voie Lactée.
D. Quel choix important Hercule eut-il à faire, lorsqu’il fut devenu grand ?
R. Hercule s’étoit retiré dans un lieu à l’écart, pour penser à quel genre de vie il se donneroit. Alors deux femmes de grande stature lui apparurent. L’une, fort belle, étoit la Vertu : elle avoit un visage majestueux et plein de dignité, la pudeur dans les yeux, la modestie dans touts ses gestes, et la robe blanche. L’autre, qu’on appelle la Mollesse ou la Volupté y avoit beaucoup d’embonpoint, et une couleur plus relevée : ses regards libres et ses habits magnifiques la faisoient connoître pour la déesse du plaisir. Chacune des deux tâcha de le gagner par ses promesses. Hercule se décida à suivre le parti de la vertu.
D. Que fit Hercule après avoir embrassé de son propre choix un genre de vie dur et laborieux ?
R. Il alla se présenter à Eurysthée, sous les ordres duquel il devoit entreprendre ses combats et ses travaux, par le sort de sa naissance. Eurysthée, excité par Junon, lui commanda les choses les plus dures et les plus difficiles : c’est ce qu’on appelle les douze travaux d’Hercule.
1°. Un lion d’une taille énorme étoit dans la forêt de Némée, et dévastoit le pays. Hercule attaqua ce monstre, l’obligea d’entrer dans une caverne d’où il ne pouvoit s’échapper, et l’étrangla. Le héros, depuis ce temps, porta toujours la peau de ce lion comme un monument de sa première victoire.
2°. Une hydre épouvantable faisoit un ravage affreux dans les campagnes des environs du marais de Lerne, près d’Argos. Ce monstre avoit sept têtes, et quand on en coupoit une, il en revenoit plusieurs autres à la place. Hercule les coupa toutes d’un seul coup. D’autres disent qu’il les brûla.
3°. Un sanglier terrible faisoit sa demeure sur le mont Erymanthe, dans l’Arcadie, et ravageoit touts les champs d’alentour. Hercule le prit, et l’apporta tout vivant à Eurysthée.
4°. Il y avoit, sur le mont Ménale, en Arcadie, une biche qui avoit des pieds d’airain et des cornes d’or. Hercule la poursuivit pendant un an, et l’atteignit, lorsqu’elle vouloit traverser le fleuve Ladon. Il la chargea sur ses épaules, et l’apporta à Mycènes, où il l’offrit à Eurysthée.
5°. Des oiseaux monstrueux couvroient les bords du lac Stymphale, en Arcadie. Ils déchiroient les passants à coups de griffes. Hercule les extermina à coups de flèches.
6°. Les Amazones étoient un peuple de femmes guerrières qui habitoient sur les rives du fleuve Thermodon, en Thrace. Elles élevoient leurs filles dans l’exercice des armes ; elles estropioient ou tuoient leurs enfants mâles. Eurysthée commanda à Hercule de lui apporter la ceinture d’Hippolyte, reine des Amazones. Le héros alla chercher ces guerrières, les défit, et enleva leur reine qu’il donna à Thésée pour prix de sa valeur.
7°. Hercule délivra la terre de deux tyrans fameux, Diomède et Busiris.
Diomède, roi de Thrace, fils de Mars et de Cyrène, avoit des chevaux furieux, qui vomissoient le feu par la bouche. Il les nourrissoit de chair humaine, et leur donnoit à dévorer touts les étrangers qui avoient le malheur de tomber entre ses mains. Hercule, par ordre d’Eurysthée, se saisit de ces chevaux, et leur abandonna Diomède, qu’ils dévorèrent aussitôt.
Busiris, roi d’Espagne, et selon d’autres, roi d’Égypte, immoloit à Jupiter touts les étrangers qui abordoient dans ses états. Il fut tué par Hercule auquel il préparoit le même sort.
8°. Gérion, roi de la Bétique, étoit un géant à trois corps, qui avoit, pour garder ses troupeaux, un chien à deux têtes, et un dragon qui en avoit sept. Il nourrissoit ses bœufs avec de la chair humaine. Hercule le tua et emmena les bœufs.
9°. Augias, roi de l’Elide et fils du Soleil, avoit des étables qui contenoient trois mille bœufs, et qui n’avoient point été nettoyées depuis trente ans. Hercule détourna le fleuve Alphée, et le fit passer à travers les étables. Les ordures qui répandoient l’infection dans toute la Grèce, furent emportées par les eaux du fleuve.
10°. Un taureau qui souffloit des flammes par les narines, avoit été envoyé par Neptune dans les états de Minos. Hercule se saisit de ce monstre, et le conduisit à son frère Eurysthée.
11°. Eurysthée commanda à Hercule de lui apporter les pommes d’or du jardin des Hespérides. Ces pommes étoient gardées par un dragon horrible qui avoit cent têtes. Hercule tua le dragon, et enleva les pommes.
12°. Thésée étoit retenu aux Enfers, où il étoit descendu avec son ami Pirithoüs pour enlever Proserpine. Hercule enchaîna Cerbère et délivra Thésée.
D. Que fit Hercule après avoir terminé glorieusement ses douze travaux ?
R. Il parcourut l’univers pour le purger des monstres et des tyrans, et pour soulager les malheureux.
Aux coupables mortels Alcide fait la guerre,Dans le sein des tyrans il porte le trépas ;Et pour en délivrer la terre,Le foudre est moins fort que son bras.( .)
D. Pourquoi Cacus fut-il mis à mort par Hercule ?
R. Cacus, fils de Vulcain, demi-homme et demi-satyre, avoit une taille colossale. Il vomissoit des tourbillons de flammes et de fumée. Il habitoit une caverne au pied du mont Aventin. Il déroba des bœufs à Hercule, et, pour n’être point trahi par les traces de leurs pas, il les traîna dans son antre, à reculons, en les tirant par la queue. Mais ces bœufs poussèrent des mugissements, lorsque le reste du troupeau passa. Hercule enfonça la porte de la caverne, et assomma le brigand.
D. Achevez le récit des faits mémorables d’Hercule.
R. Il rompit les chaînes qui tenoient Prométhée attaché sur le mont Caucase. Il défit le géant Antée, fils de Neptune et de la Terre. Ce géant massacroit touts les passants, pour accomplir le vœu qu’il avoit fait, de bâtir un temple à son père, avec des crânes d’hommes. Hercule le terrassa trois fois, mais en vain : car la Terre, sa mère, lui rendoit des forces nouvelles, chaque fois qu’il la touchoit. Le héros, s’en étant aperçu, le souleva en l’air, et l’étouffa dans ses bras. Enfin, Hercule forma le détroit de Gibraltar, en séparant deux montagnes qui se joignoient, appelée Calpé, du côté de l’Espagne, et l’autre Abyla, du côté de l’Afrique. Il introduisit ainsi les eaux de l’Océan dans la Méditerranée. Ces montagnes furent nommées les colonnes d’Hercule. Il y grava cette inscription ; On ne peut aller au-delà.
D. La gloire d’Hercule adoucit-elle la haine de Junon ?
R. Elle ne fit au contraire que redoubler les emportements de cette déesse toujours transportée de jalousie. Junon inspira à ce héros un tel excès de fureur, qu’il tua sa femme Mégare et les enfants qu’il en avoit eus. Lorsqu’il fut revenu de sa fureur, il se seroit tué lui-même de désespoir, si ses amis ne l’eussent retenu.
D. Par quelle foiblesse Hercule ternit-il l’éclat de sa gloire ?
R. Junon, voyant qu’Hercule sortoit victorieux des entreprises les plus périlleuses, eut recours à l’Amour, et le pria de blesser le héros de ses flèches. Cupidon servit à souhait les vues de la déesse. Bientôt on vit Hercule couvert d’un habit de femme, filer aux pieds d’Omphale, reine de Lydie. Il conçut ensuite une violente passion pour Déjanire, que le fleuve Achéloüs devoit épouser. Hercule vainquit Achéloüs et emmena Déjanire. Il se trouva arrêté dans sa route par le fleuve Évène, dont les eaux étoient extrêmement grossies. Le centaure Nessus vint s’offrir de lui-même pour passer Déjanire sur son dos. Hercule y consentit ; mais s’étant aperçu que le centaure vouloit lui enlever la princesse, il le tua à coups de flèches. Nessus, avant que d’expirer songea à se venger ; il donna à Déjanire une robe teinte de son sang, et lui fît accroire que si Hercule mettoit une fois cette robe, il n’aimeroit jamais d’autre femme qu’elle.
D. Déjanire fit-elle usage du présent de Nessus ?
R. Oui. Ayant su qu’Hercule étoit retenu en Eubée par les charmes d’Iole, fille d’Euryte, elle envoya à son époux la tunique de Nessus, par un jeune esclave appelé Lichas. Hercule reçut avec joie ce fatal présent ; mais il n’en fut pas plutôt revêtu, qu’il se sentit dévorer par un feu intérieur : le sang de Nessus dans lequel la tunique avoit été trempée, étoit un poison très-violent. Le héros éprouva bientôt des douleurs affreuses. Dans sa fureur, il saisit Lichas et le lança dans la mer, où il fut changé en rocher. Pour terminer son supplice, Hercule coupa des arbres sur le mont Œta, en fit un bûcher sur lequel il se plaça, et pria son ami Philoctète d’y mettre le feu. Il donna à cet ami ses flèches teintés du sang de l’hydre de Lerne, sans lesquelles la ville de Troie ne pouvoit être prise, d’après l’arrêt du Destin. Quand Déjanire eut appris la mort d’Hercule, elle en conçut tant de regret, qu’elle se tua elle-même.
D. Quels honneurs rendit-on à Hercule après sa mort ?
R. Philoctète recueillit les cendres de son ami, et les plaça dans une urne. Hercule fut reçu dans le ciel, où il épousa Hébé, déesse de la jeunesse. On le représente couvert de la peau d’un lion, et armé d’une massue. Les poëtes l’appellent souvent Alcide ; c’est le premier nom qu’il porta. Il ne fut appelé Hercule qu’après la victoire qu’il remporta dans son berceau sur les deux serpents envoyés par Junon.
Castor et Pollux. §
D. De qui Castor et Pollux étoient-ils fils ?
R. Ils eurent touts deux Léda pour mère ; mais Jupiter fut père de Pollux ; et Tyndare, roi d’Oébalie, mari de Léda, fut père de Castor. Léda eut aussi deux filles : l’une, née de Jupiter, fut la fameuse Hélène, qui causa la ruine de Troie ; et l’autre, née de Tyndare, fut Clytemnestre qui épousa Agamemnon. Castor et Pollux sont communément désignés par les poëtes sous le nom de Tyndarides.
D. Par où Castor et Pollux se firent-ils particulièrement connoître ?
R. Ils se firent connoître sur-tout par la tendre amitié qu’ils eurent l’un pour l’autre. Leur premier exploit fut de purger l’Archipel des pirates qui l’infestoient, ce qui les fit mettre au rang des dieux marins, et, par la suite, invoquer dans les tempêtes. Ils suivirent Jason dans la Colchide, et eurent beaucoup de part à la conquête de la toison d’or. De retour dans leur patrie, ils reprirent leur sœur Hélène qui avoit été enlevée par Thésée. Castor fut tué ensuite dans un combat singulier, près du mont Taygète. Pollux vengea son frère, et fut tellement affligé de sa mort, qu’il conjura son père Jupiter de lui permettre de partager son immortalité avec Castor. Jupiter y consentit, et ordonna que les deux frères vivroient et mourroient alternativement ; enfin, ils furent placés dans le ciel, et forment le signe des gémeaux : des deux étoiles qui composent ce signe, l’une est toujours cachée sous l’horizon, lorsque l’autre paroît.
Pollux, seul, parle ainsi :
Présent des dieux, doux charme des humains,O divine amitié ! viens pénétrer nos ames,Les cœurs éclairés de tes flammes,Avec des plaisirs purs n’ont que des jours sereins.C’est dans tes nœuds charmants que tout est jouissance :Le temps ajoute encore un lustre à ta beauté.L’amour te laisse la constance ;Et tu serois la volupté,Si l’homme avoit son innocence.
Le même, à Jupiter.
Ma voix, puissant Maître du monde,S’élève, en tremblant, jusqu’à toi.D’un seul de tes regards dissipe mon effroi,Et calme ma douleur profonde.O mon père ! écoute mes vœux.L’immortalité qui m’enchaîne,Pour ton fils désormais n’est qu’un supplice affreux.Castor n’est plus, et ma vengeance est vaine,Si ta voix souveraineNe lui rend des jours plus heureux.O mon père ! écoute mes vœux…Ah ! laisse-moi percer jusques aux sombres bords ;J’ouvrirai sous mes pas les antres de la terre :J’irai braver Pluton, j’irai chercher les morts,A la lueur de ton tonnerre :J’enchaînerai Cerbère ; et, plus digne des cieux,Je reverrai Castor, et mon père et les dieux.( .)
Esculape.
D. De qui Esculape étoit-il fils ?
R. Esculape étoit fils d’Apollon et de la nymphe Coronis. Il passe pour l’inventeur et le dieu de la médecine. Il accompagna Hercule et Jason dans l’expédition de la Colchide. Il fut foudroyé par Jupiter, pour avoir ressuscité Hippolyte. Peu de temps après sa mort, il reçut les honneurs divins. Son culte fut établi d’abord à Épidaure, lieu de sa naissance ; de là il se répandit dans toute la Grèce. On l’honoroit à Épidaure sous la figure d’un serpent. On lui immoloit des poules et des coqs. Esculape eut aussi un temple célèbre dans la ville de Rome.
Orphée, Aristée. §
D De qui Orphée étoit-il fils ?
R. Orphée étoit fils d’Apollon et de Clio. Il jouoit divinement de la lyre. A ses harmonieux accords, on voyoit les bêtes féroces s’adoucir, les arbres et les rochers se mouvoir, les fleuves suspendre leur cours. Orphée perdit sa femme Eurydice, le jour même de ses noces. Mortellement affligé de son infortune, il descendit aux enfers, et la redemanda à Pluton. Le dieu des enfers, touché des sons de sa lyre, lui rendit son épouse, à condition qu’il l’emmèneroit derrière lui, et ne la regarderoit qu’après être sorti du sombre empire. Orphée ne put contenir son impatience ; il tourna la tête pour voir si sa chère Eurydice le suivoit ; aussitôt Eurydice disparut. Ce malheur le fit renoncer aux femmes. Les Bacchantes, irritées de son indifférence pour leur sexe, le mirent en pièces, et jetèrent sa tête dans l’Hèbre, fleuve de Thrace7. Orphée fut métamorphosé en cygne par son père. On le représente avec une lyre ou un luth à la main,
D. Faites-nous connoître Aristée ?
R. Aristée étoit fils d’Apollon et de la nymphe Cyrène. Il aimoit Eurydice qui, fuyant ses poursuites, le jour même de ses noces avec Orphée, fut piquée d’un serpent et mourut sur le champ. Les nymphes, pour venger leur compagne, tuèrent toutes les abeilles d’Aristée. Dans sa désolation, il implora le secours de sa mère. Cyrène, partageant la douleur de son fils, lui conseilla d’aller consulter Protée. Celui-ci révéla à Aristée la cause de son infortune, et lui ordonna d’apaiser les manes d’Eurydice, par des sacrifices expiatoires. Docile à ses conseils, Aristée immola quatre jeunes taureaux et autant de génisses. Il vit avec transport sortir des entrailles de ses victimes, une nuée d’abeilles qui le dédommagèrent de ses pertes… Il est particulièrement honoré des bergers.
………………………………………………Possesseur autrefois de nombreuses abeilles,Aristée avoit vu ce peuple infortunéPar la contagion, par la faim moissonné :Aussitôt, des beaux lieux que le Pénée 8 arrose,Vers la source sacrée où le fleuve repose,Il arrive ; il s’arrête, et, tout baigné de pleurs,A sa mère en ces mots exhale ses douleurs :Déesse de ces eaux, ô Cyrène ! ô ma mère !Si je puis me vanter qu’Apollon est mon père,Hélas ! du sang des dieux n’as-tu formé ton filsQue pour l’abandonner aux destins ennemis ?Ma mère, qu’as-tu fait de cet amour si tendre ?Où sont donc ces honneurs où je devois prétendre ?Hélas ! parmi les dieux j’espérois des autels,Et je languis sans gloire au milieu des mortels !Ce prix de tant de soins qui charmoit ma misère,Mes essaims ne sont plus ; et vous êtes ma mère !Achevez ; de vos mains ravagez ces coteaux,Embrasez mes moissons, immolez mes troupeaux ;Dans ces jeunes forêts allez porter la flamme,Puisque l’honneur d’un fils ne touche point votre ame.
Cyrène entend sa voix au fond de son séjour :Près d’elle, en ce moment, les nymphes de sa courFiloient d’un doigt léger des laines verdoyantes ;Leurs beaux cheveux tomboient en tresses ondoyantes.Là, sont la jeune Opis aux yeux pleins de douceur,Et Clio toujours fière, et Béroë sa sœur,Toutes deux se vantant d’une illustre origine,Étalant toutes deux l’or, la pourpre et l’hermine ;Vous, Aréthuse, enfin, que l’on vit autrefoisPresser d’un pas léger les habitants des bois.Pour charmer leur ennui, Clymène au milieu d’ellesLeur racontoit des dieux les amours infidelles.Du malheureux berger la gémissante voixParvient jusqu’à sa mère une seconde fois.Cyrène s’en émeut ; ses compagnes timidesOnt tressailli d’effroi dans leurs grottes humides.Aréthuse, cherchant d’où partent ces sanglots,Montre ses blonds cheveux sur la voûte des flots.O ma sœur ! tu sentois de trop justes alarmes ;Ton fils, ton tendre fils, tout baigné de ses larmes,Paroît au bord de l’eau, accablé de douleurs,Et sa mère est, dit-il, insensible à ses pleurs.
Mon fils ! répond Cyrène en pâlissant de crainte,Qu’il vienne : et quel est donc le sujet de sa plainte ?Qu’on amène mon fils, qu’il paroisse à mes yeux ;Mon fils a droit d’entrer dans le palais des dieux :Fleuve, retire-toi. L’onde respectueuse,A ces mots, suspendant sa course impétueuse,S’ouvre, et, se repliant en deux monts de cristal,Le porte mollement au fond de son canal.
Le jeune dieu descend ; il s’étonne, il admireLe palais de sa mère et son liquide empire ;Il écoule le bruit des flots retentissants,Contemple le berceau de cent fleuves naissants,Qui, sortant en grondant de leur grotte profonde,Promènent en cent lieux leur course vagabonde.Le père des moissons, le riche11 Caïcus,L’Énipée12 orgueilleux d’orner la Thessalie,Le Tibre13 encor plus fier de baigner l’Italie,L’Hypanis14 se brisant sur des rochers affreux,Qui, roulant à travers des campagnes fécondes,Court dans les vastes mers ensevelir ses ondes.
Mais enfin il arrive à ce brillant palaisQue les flots ont creusé dans un roc toujours frais.Sa mère en l’écoutant sourit, et le rassure ;Les nymphes sur ses mains épanchent une eau pure,Offrent pour les sécher de fins tissus de lin ;On fait fumer l’encens, on fait couler le vin.Prends ce vase, ô mon fils ! afin qu’il nous seconde,Invoquons l’Océan, le vieux père du monde.Et vous, reines des eaux, protectrices des bois,Entendez-moi, mes sœurs. Elle dit, et trois foisLe feu sacré reçut la liqueur pétillante ;Trois fois jaillit dans l’air une flamme brillante.Elle accepte l’augure, et poursuit en ces mots :Protée, ô mon cher fils, peut seul finir tes maux.C’est lui que nous voyons, sur ces mers qu’il habiteAtteler à son char les monstres d’Amphitrite.Pallène17 est sa patrie ; et, dans ce même jour,Vers ces bords fortunés, il hâte son retour :Les Nymphes, les Tritons, touts, jusqu’au vieux Nérée,Respectent de ce dieu la science sacrée.Ses regards pénétrants, son vaste souvenir,Embrassent le présent, le passé, l’avenir ;Précieuse laveur du dieu puissant des ondes,Dont il pait les troupeaux dans les plaines profondes.Par lui tu connoîtras d’où naissent les revers.Mais il faut qu’on l’y force en le chargeant de fers :On a beau l’implorer ; son cœur sourd à la plainte,Résiste à la prière, et cède à la contrainte.Moi-même, quand Phébus, partageant l’horizon,De ses feux dévorants jaunira le gazon,A l’heure où les troupeaux goûtent le frais de l’ombre,Je guiderai tes pas vers une grotte sombreOù sommeille ce dieu sorti du sein des flots :Là, tu le surprendras dans les bras du repos.Mais à peine on l’attaque, il fuit, il prend la formeD’un tigre furieux, d’un sanglier énorme ;Serpent, il s’entrelace ; et lion, il rugit ;C’est un feu qui pétille, un torrent qui mugit.Mais plus il t’éblouit par mille formes vaines,Plus il faut resserrer l’étreinte de ses chaînes,Redoubler tes assauts, épuiser ses secrets,Et forcer ton captif à reprendre ses traits.
Sur son fils, à ces mots, sa main officieuseRépand d’un doux parfum l’essence précieuse :Cette pure ambroisie embaume ses cheveux,Rend son corps plus agile et ses bras plus nerveux.Au sein des vastes mers s’avance un mont sauvage,Où le flot mugissant, brisé par le rivage,Se divise, et s’enfonce en un profond bassinQui reçoit les nochers dans son paisible sein.Là, dans un antre obscur, se retiroit Protée.Cyrène le prévient, y conduit Aristée,Le place loin du jour dans l’ombre de ces lieux,Se couvre d’un nuage, et se dérobe aux yeux.Déjà le chien brûlant dont l’Inde est dévorée,Vomissoit touts ses feux sur la plaine altérée ;Déjà l’ardent midi, desséchant les ruisseaux,Jusqu’au fond de leur lit avoit pompé leurs eaux :Pour respirer le frais dans sa grotte profonde,Protée en ce moment quittoit le sein de l’onde :Il marche, près de lui le peuple entier des mersBondit, et fait au loin jaillir les flots amers :Touts ces monstres épars s’endorment sur la rive.Alors, tel qu’un berger, quand la nuit sombre arriveLorsque le loup s’irrite aux cris du tendre agneau,Le dieu, sur son rocher, compte au loin son troupeau.A peine il s’assoupit, que le fils de CyrèneAccourt, pousse un grand cri, le saisit et l’enchaîne.Le vieillard de ses bras sort en feu dévorant ;Il s’échappe en lion, il se roule en torrent.Enfin, las d’opposer une défense vaine,Il cède ; et, se montrant sous une forme humaine :Jeune imprudent, dit-il, qui t’amène en ce lieu ?Parle, que me veux-tu ? — Vous le savez, grand dieu ;Oui, vous le savez trop, lui répond Aristée ;Le livre des destins est ouvert à Protée :L’ordre des immortels m’amène devant vous :Daignez… — Le dieu, roulant des yeux pleins de courroux,A peine de ses sens dompte la violence ;Et, tout bouillant encor, rompt ainsi le silence :Tremble, un dieu te poursuit : pour venger ses douleurs,Orphée a sur ta tête attiré ces malheurs ;Mais il n’a pas au crime égalé le supplice.Un jour tu poursuivois sa fidelle Eurydice :Eurydice fuyoit, hélas ! et ne vit pasUn serpent que les fleurs recéloient sous ses pas.La mort ferma ses yeux, les nymphes ses compagnes,De leurs cris douloureux remplirent les montagnes ;Le Thrace belliqueux lui-même en soupira ;Le Rhodope en gémit, et l’Hèbre en murmura.Son époux s’enfonça dans un désert sauvage :Là, seul, touchant sa lyre, et, charmant son veuvage,Tendre épouse ! c’est toi qu’appeloit son amour,Toi qu’il pleuroit la nuit, toi qu’il pleuroit le jour.C’est peu : malgré l’horreur de ses profondes voûtes,Il franchit de l’enfer les formidables routes :Et, perçant ces forêts où règne un morne effroi,Il aborda des morts l’impitoyable roi,Et la Parque inflexible, et les pâles FuriesQue les pleurs des humains n’ont jamais attendries :Il chantoit ; et, ravis jusqu’au fond des enfers,Au bruit harmonieux de ses tendres concerts,Les légers habitants de ces obscurs royaumes,Des spectres pâlissants, de livides fantômes,Accouroient, plus pressés que ces oiseaux nombreuxQu’un orage soudain ou qu’un soir ténébreuxRassemble par milliers dans les bocages sombres ;Des mères, des héros, aujourd’hui vaines ombres,Des vierges que l’hymen attendoit aux autels,Les fils mis au bûcher sous les yeux paternels,Victimes que le Styx, dans ses prisons profondes,Environne neuf fois des replis de ses ondes,Et qu’un marais fangeux, bordé de noirs roseaux,Entoure tristement de ses dormantes eaux.L’Enfer même s’émut : les fières EuménidesCessèrent d’irriter leurs couleuvres livides ;Ixion immobile écoutoit ses accords ;L’Hydre affreuse oublia d’épouvanter les morts ;Et Cerbère, abaissant ses têtes menaçantes,Retint sa triple voix dans ses gueules béantes.
Enfin il revenoit, triomphant du trépas :Sans voir sa tendre épouse, il précédoit ses pas ;Proserpine, à ce prix, couronnoit sa tendresse :Soudain ce foible amant, dans un instant d’ivresse,Suivit imprudemment l’ardeur qui l’entraînoit,Bien digne de pardon, si l’enfer pardonnoit.Presque aux portes du jour, troublé, hors de lui-même,Il s’arrête, il se tourne… il revoit ce qu’il aime !C’en est fait, un coup d’œil a détruit son bonheur ;Le barbare Pluton révoque sa faveur,Et des enfers charmés de ressaisir leur proie,Trois fois le gouffre avare en retentit de joie,Eurydice s’écrie : ô destin rigoureux !Hélas ! quel dieu cruel nous a perdus touts deux ?Quelle fureur ! voilà qu’au ténébreux abymeLe barbare Destin rappelle sa victime.Adieu ; déjà je sens dans un nuage épaisNager mes yeux éteints et fermés pour jamais.Adieu, mon cher Orphée ; Eurydice expiranteEn vain te cherche encor de sa main défaillante ;L’horrible Mort, jetant son voile autour de moi,M’entraîne loin du jour, hélas ! et loin de toi.Elle dit, et soudain dans tes airs s’évapore.Orphée en vain l’appelle, en vain la suit encoreIl n’embrasse qu’une ombre ; et l’horrible rocherDe ces bords désormais lui défend d’approcher.Alors, deux fois privé d’une épouse si chère,Où porter sa douleur ? où traîner sa misère ?Par quels sons, par quels pleurs fléchir le dieu des morts ?Déjà cette ombre froide arrive aux sombres bords.
Près du Strymon glacé, dans les antres de Thrace,Durant sept mois entiers il pleura sa disgrâce :Sa voix adoucissoit les tigres des déserts,Et les chênes émus s’inclinoient dans les airs.Telle, sur un rameau, durant la nuit obscure,Philomèle plaintive attendrit, la nature,Accuse en gémissant l’oiseleur inhumainQui, glissant dans son nid une furtive main,Ravit ces tendres fruits que l’amour fit éclore,Et qu’un léger duvet ne couvroit pas encore.Pour lui plus de plaisirs, plus d’hymen, plus d’amour.Seul, parmi les horreurs d’un sauvage séjour,Dans ces noires forêts du soleil ignorées,Sur les sommets déserts des monts hyperborées,Il pleuroit Eurydice, et, plein de ses attraits,Reprochoit à Pluton ses perfides bienfaits.En vain mille beautés s’efforçoient de lui plaire,Il dédaigna leurs feux ; et leur main sanguinaire,La nuit, à la faveur des mystères sacrés,Dispersa dans les champs ses membres déchirés.L’Hèbre roula sa tête encor toute sanglante :Là, sa langue glacée et sa voix expirante,Jusqu’au dernier soupir formant un foible son,D’Eurydice en flottant murmuroit le doux nom.Eurydice ! ô douleur ! Touchés de son supplice,Les échos répétoient : Eurydice ! Eurydice !
Le devin dans la mer se replonge à ces mots,Et du gouffre écumant fait tournoyer les flots.Cyrène de son fils vient calmer les alarmes :Cher enfant, lui dit-elle, essuie enfin tes larmes ;Tu connois ton destin. Eurydice autrefoisAccompagnoit les chœurs des nymphes de ces bois :Elles vengent sa mort ; toi, fléchis leur colère ;On désarme aisément leur rigueur passagère :Sur le riant Lycée où paissent tes troupeaux,Va choisir à l’instant quatre jeunes taureaux ;Choisis un nombre égal de génisses superbesQui des prés émaillés foulent en paix les herbes :Pour les sacrifier élève quatre autels,Et, les faisant tomber sous les couteaux mortels,Laisse leurs corps sanglants dans la forêt profonde.Quand la neuvième aurore éclairera le monde,Au déplorable époux dont tu causas les maux,Offre une brebis noire et la fleur des pavots ;Enfin, pour satisfaire aux manes d’Eurydice,De retour dans les bois, immole une génisse.Elle dit. Le berger dans ses nombreux troupeauxVa choisir à l’instant quatre jeunes taureaux ;Immole un nombre égal de génisses superbesQui des prés émaillés fouloient en paix les herbes.Pour la neuvième fois quand l’aurore parut,Au malheureux Orphée il offrit son tribut,Et rentra plein d’espoir dans la forêt profonde.O prodige ! le sang, par sa chaleur féconde,Dans le flanc des taureaux forme un nombreux essaim ;Des peuples bourdonnants s’échappent de leur sein,Comme un nuage épais dans les airs se répandent,Et sur l’arbre voisin en grappes se suspendent.( , trad. de M. .)
Quatrième partie.
Des héros, des personnages célèbres, et des principaux événements de la fable. §
Thésée. §
Demande. Qui étoit Thésée ?
Réponse. Thésée, fils d’Egée, roi des Athéniens, fut parent et contemporain d’Hercule. Il se proposa de marcher sur les traces de ce héros, et entreprit de délivrer la terre des monstres qui la désoloient.
Résolu de périr par un noble trépas,Jaloux du nom d’Hercule, et marchant sur ses pas,J’entrepris de venger et d’affranchir la terreDe monstres, de méchants échappés au tonnerre.( .)
D. Racontez les grandes actions de Thésée.
R. Phalaris, tyran d’Agrigente en Sicile, avoit fait forger un taureau d’airain, dans lequel il enfermoit des hommes tout vivants, pour les y brûler à petit feu. Il prenoit un cruel plaisir à les entendre pousser des cris qui imitoient les mugissements d’un bœuf. Pérille, auteur d’une si horrible invention, en fit le premier essai. Le tyran l’y fit enfermer, au lieu de lui payer le salaire qu’il lui avoit promis. Thésée extermina Phalaris.
Procruste ou Procuste étoit un brigand qui habitoit les environs du fleuve Céphise, dans l’Attique. Ce scélérat faisoit étendre ses hôtes sur un lit de fer, leur couper les extrémités des jambes, lorsqu’elles dépassoient le lit, ou les faisoit tirailler avec des cordages, jusqu’à ce qu’elles en atteignissent la longueur. Thésée purgea la terre de ce monstre.
Scyron étoit un fameux brigand qui désoloit l’Attique. Il précipitoit touts les étrangers dans la mer. Thésée le défit, et le jeta lui-même dans la mer où il fut changé en rocher.
Cercyon, autre brigand qui dévastoit l’Attique forçoit les passants à lutter contre lui, et massacroit ceux qu’il avoit vaincus. II avoit une force de corps si prodigieuse, qu’il courboit les plus gros arbres ; il en rapprochoit la cime, et y attachoit ceux qu’il avoit terrassés. Les arbres, en se relevant, déchiroient ses victimes. Thésée l’ayant abattu, le punit du même supplice qu’il avoit fait souffrir à tant d’autres. Les poëtes donnent aussi le nom de Scinis a ce brigand.
Périphète, géant, fils de Vulcain, ne se nourrissoit que de chair humaine. Il s’étoit cantonné dans le voisinage d’Epidaure, et attaquoit touts les passants. Thésée, en allant de Trézène à l’isthme de Corinthe, le tua et s’empara de sa massue, qu’il porta toujours depuis comme un monument de sa victoire. Thésée dispersa les os de Périphète dans les champs d’Epidaure.
D. Continuez le récit des exploits glorieux de Thésée.
R. Il délivra les campagnes de Marathon d’un taureau furieux qui y faisoit de grands ravages ; il tua le sanglier de Calydon qui désoloit l’Etolie. Diane, irritée de ce qu’on avoit négligé son culte, avoit envoyé ce monstre pour punir les Étoliens et les habitants de la ville de Calydon. Enfin, Thésée fit périr le Minotaure.
dit de Thésée :
……………………… Ce héros intrépide,Consolant les mortels de l’absence d’Alcide,Procruste, Cercyon et Scyron, et Scinis,Et les os dispersés du géant d’Epidaure,Et la Crète fumant du sang du Minotaure.
D. Qu’étoit-ce que le Minotaure ?
R. Le Minotaure étoit un monstre moitié homme et moitié taureau, né, selon les poëtes, de Pasiphaé, épouse de Minos, roi de Crète. Minos le tenoit dans le labyrinthe que Dédale avoit construit pour y enfermer ce monstre. Le Minotaure ne vivoit que de chair humaine. Les Athéniens étoient obligés d’envoyer touts les ans sept jeunes garçons, tirés au sort, pour lui servir de nourriture. Minos leur avoit imposé ce tribut y après les avoir vaincus dans un combat qu’il leur livra pour venger son fils Androgée qu’ils avoient fait mourir.
D. Dites comment Thésée vainquit le Minotaure.
R. Les Athéniens avoient payé trois fois le tribut cruel et humiliant auquel ils avoient été assujettis. Thésée forma le généreux projet d’en affranchir sa patrie, et partit pour la Crète. Ariane, fille de Minos, lui fut d’un grand secours dans son entreprise. La princesse donna à ce héros un peloton de fil, à la faveur duquel il sortit du labyrinthe, après avoir tué le Minotaure. Thésée emmena Ariane avec lui ; mais bientôt il oublia le service important qu’elle lui avoit rendu, et la délaissa dans l’île de Naxos. Bacchus vint la consoler de l’infidélité de son amant, et l’épousa.
Ce monstre, homme et taureau, qu’un fol amour fit naître,Qui du sang des humains brûloit de se repaître,Sous le fer de Thésée enfin perdit le jour.Le héros tient le fil qui trace son retour ;Tandis qu’un peu plus loin Ariane tremblante,Craint que le sort ne trompe son attente ;Les yeux au labyrinthe, et les mains vers les oiseauxAu secours de Thésée elle appelle les dieux.( .)
D. Donnez-nous quelques détails sur le labyrinthe.
R. Le labyrinthe de Crète, si célèbre parmi les poëtes, est souvent appelé le Dédale, du nom de celui qui l’avoit bâti. C’étoit un composé de bosquets et de bâtiments disposés avec tant d’art, qu’il n’étoit plus possible d’en sortir dès qu’on y étoit entré. Dédale fut la première victime de son invention : car Minos le fit enfermer dans le labyrinthe, avec son fils Icare. Mais Dédale fabriqua des ailes artificielles qu’il attacha à ses épaules et à celles de son fils. Il recommanda bien à Icare de ne voler ni trop haut, ni trop bas, de peur que le soleil ne fondît la cire qui attachoit ses ailes, ou que les vapeurs de la mer ne rendissent les plumes trop humides.
Dédale cependant qu’un long exil ennuieSent le desir si doux de revoir sa patrie ;Mais la mer l’emprisonne, et ses desirs sont vains« Si la Crète, dit-il, s’oppose à mes desseins,» Si la terre et la mer me ferment le passage,» Que l’air m’ouvre un chemin pour sortir d’esclavage.» Minos possède en vain et la terre et les flots ;» L’air est libre pour moi ; je ne crains plus Minos. »Il dit, et fait céder au pouvoir du génieLes lois de la nature et de la tyrannie.Des plumes que son art assortit avec choix,Par degrés à leur rang se placent sous ses doigts.Tels, sous la main de Pan, l’Arcadie a vu naîtreLes tubes inégaux de la flûte champêtre.Une cire onctueuse, enduite aux environs,Des plumes qu’il attache, unit les avirons ;Et, par un dernier pli, leur légère courbureDans le travail de l’art, imite la nature.Icare auprès de lui l’observe, et, sans songerQu’il s’amuse, en jouant., de son propre danger,Court après le duvet qu’emporte le zéphire,De ses doigts apprentis, touche, amollit la cire,Et nuit à l’ouvrier par ses jeux enfantins ;Quand l’ouvrage eut cent fois repassé sous ses mains.Dédale, qui dans l’air en suspens se balance,De ses ailes d’abord éprouve la puissance ;Et, sûr de leur usage, il l’enseigne à son fils.« Prends le milieu des airs, et crois-en mes avis ;» N’approche point trop près des ondes infidelles,» Tu verrois leur vapeur appesantir tes ailes.» Si trop près du soleil s’élève ton essor,» Tu vois fondre la cire, et tu péris encor,» Là, tu vois Orion ; ici, le char de l’Ourse :» Vole entre l’un et l’autre ; imite, et suis ma course. »
Mêlant à ses avis mille soins inquiets,Tandis que de son vol il hâte les apprêts,Des pleurs mouillent ses yeux ; et ses mains paternelles,Ses mains tremblent deux fois, en attachant ses ailes.Il embrasse son fils : une secrète voixLui dit qu’il l’embrassoit pour la dernière fois.Il s’élève dans l’air, l’appelle sur sa trace,Et d’un vol inquiet craint pour sa jeune audace.Comme une mère instruit l’oiseau novice encorA régler les écarts de son premier essor,L’œil tourné sur son fils, d’un vol hardi, mais sage,De son art périlleux il lui montre l’usage.Le pêcheur, près des eaux, assis sur le gazon,Au moment qu’à la ligne il suspend l’hameçon,Le conducteur du soc, la main sur sa charrue,Le pasteur, immobile et les yeux vers la nue,En voyant ces mortels voyager dans les cieux,S’étonne, les admire, et les prend pour des dieux.( , trad. de .)
D. Icare suivit-il exactement les avis de Dédale, son père ?
R. Non : ce jeune téméraire voulut s’élever au haut des airs. Le soleil fondit la cire de ses ailes, et Icare tomba dans la mer qui a pris de lui le nom de mer Icarienne18. Le malheureux Dédale aborda en Sicile. Le roi Cocalus lui donna un asile. Mais il le fit ensuite étouffer dans une étuve, pour prévenir l’effet des menaces de Minos.
A droite, de leur vol avoient vu la merveille ;A gauche ils ont laissé le temple de Samos,Délos et son oracle, et le roc de Paros,Le jeune ambitieux, follement intrépide,Pour s’élever au ciel, abandonne son guide.Trop voisin du soleil, un océan de feuxDe la cire amollit les liens onctueux.Déjà la plume échappe à ses ailes fondues ;De ses bras, mais en vain, il frappe encor les nues :Il appelle son père, et tombe au fond des mersFameuses par son nom, sa chute et ses revers.Son père infortuné, qui déjà n’est plus père,Dédale cherche au loin le jeune téméraire.Icare, où te trouver ? Il appelle à grands crisIcare, et sur les eaux voit flotter ses débris.Il maudit de son art l’invention funeste ;De son malheureux fils il recueille le reste,Lui dresse dans une île un tombeau de gazon ;Et cette île21 depuis a conservé son nom.( , trad. de .)
D. Quel chagrin éprouva Thésée, à son retour de l’expédition de la Crète ?
R. Il perdit son père dont il dut se reprocher la mort. Thésée avoit mis des voiles noires au vaisseau sur lequel il s’embarquoit, et il avoit promis à Egée, de changer ces voiles noires en voiles blanches, s’il revenoit victorieux. La joie lui fit oublier cette promesse. Son père apercevant de loin les voiles noires, crut que son fils avoit péri, et se précipita dans la mer qui depuis fut appelée, de son nom, mer Égée.
D. A quelle occasion Thésée fit-il la guerre aux Centaures ?
R. Pirithoüs, roi de Thessalie, jaloux des grands succès de Thésée, vint avec une armée ravager les états de ce prince, afin de l’attirer à un combat singulier. Thésée accepta le défi. Mais quand ils furent en présence, une secrète admiration s’empara de leur esprit ; leur cœur se découvrit sans feinte, ils s’embrassèrent au lieu de se battre, et se jurèrent une amitié éternelle. Pirithoüs avoit à se plaindre des Centaures qui avoient massacré plusieurs de ses sujets le jour de son mariage avec Hippodamie. Les deux héros s’unirent pour combattre ces peuples, et en tirèrent une vengeance éclatante. Les Centaures étoient si bons cavaliers, qu’ils paroissoient ne faire qu’un même corps avec leurs chevaux. C’est ce qui a donné lieu aux poëtes, de feindre que les Centaures étoient des monstres demi-hommes et demi-chevaux.
D. Quel dessein conçurent ensuite Thésée et Pirithoüs ?
R. Ces deux amis formèrent le projet d’enlever Proserpine ; et pour cela ils descendirent aux Enfers.
On dit même, et ce bruit est par-tout répandu,Qu’avec Pirithoüs aux enfers descendu,Il a vu le Cocyte et les rivages sombres,Et s’est montré vivant aux infernales ombre ;Mais qu’il n’a pu sortir de ce triste séjour,Et repasser les bords qu’on passe sans retour.( .)
Pirithoüs fut dévoré par Cerbère ; mais Thésée fut délivré par Hercule, lorsque celui-ci descendit aux Enfers.
D. Quelle guerre Hercule et Thésée firent-ils ensemble ?
R. Ils firent la guerre aux Amazones, et Thésée épousa Hippolyte, reine de ces femmes guerrières : il en eut un fils qui porta le nom, de sa mère. Phèdre, fille de Minos, que Thésée prit depuis pour femme, devint éperdument amoureuse du jeune Hippolyte. Le prince, uniquement occupé de l’étude de la sagesse et des amusements de la chasse, n’entendit qu’avec horreur la déclaration que belle-mère osa lui faire de son infâme passion. Phèdre, outrée de dépit, se vengea d’Hippolyte, en l’accusant auprès de Thésée, d’avoir voulu attenter à son honneur. Ce père crédule chassa son fils, et appela sur lui la vengeance de Neptune.
Et toi, Neptune, et toi, si jadis mon courageD’infâmes assassins nettoya ton rivage,Souviens-toi que, pour prix de mes efforts heureux,Tu promis d’exaucer le premier de mes vœux.Dans les longues rigueurs d’une prison cruelleJe n’ai point imploré ta puissance immortelle ;Avare du secours que j’attends de tes soins,Mes vœux t’ont réservé pour de plus grands besoins :Je t’implore aujourd’hui. Venge un malheureux père :J’abandonne ce traître à toute ta colère.( .)
D. Les vœux de Thésée furent-ils exaucés par Neptune ?
R. Ils ne le furent que trop. Neptune suscita un monstre marin qui effaroucha les chevaux d’Hippolyte. Le malheureux prince fut renversé de son char, et périt, traîné par ses propres chevaux.
………………………………………………A peine nous sortions des portes de Trézène,Il étoit sur son char : ses gardes affligésImitoient son silence ; autour de lui rangés :Il suivoit tout pensif le chemin de Mycènes ;Sa main sur les chevaux laissoit flotter les rênesCes superbes coursiers, qu’on voyoit autrefoisPleins d’une ardeur si noble obéir à sa voix,L’œil morne maintenant et la tête baissée,Sembloient se conformer à sa liste pensée.Un effroyable cri, sorti du fond des flots,Des airs en ce moment a troublé le repos ;Et du sein de la terre une voix formidableRépond en gémissant à ce cri redoutable.Jusqu’au fond de nos cœurs notre sang s’est glacé ;Les coursiers attentifs le crin s’est hérissé.Cependant, sur le dos de la plaine liquideS’élève à gros bouillons une montagne humide :L’onde approche, se brise, et vomit à nos yeux,Parmi des flots d’écume, un monstre furieux.Son front large est armé de cornes menaçantes ;Tout son corps est couvert d’écailles jaunissantes :Indomptable taureau, dragon impétueux,Sa croupe se recourbe en replis tortueux ;Ses longs mugissements font trembler le rivageLe ciel avec horreur voit ce monstre sauvage ;La terre s’en émeut, l’air en est infecté,Le flot qui l’apporta recule épouvanté.Tout fuit ; et, sans s’armer d’un courage inutile,Dans le temple voisin chacun cherche un asile.Hippolyte lui seul, digne fils d’un héros,Arrête les coursiers, saisit les javelots,Pousse au monstre, et, d’un dard lancé d’une main sûre,Il lui fait dans le flanc une large blessure.De rage et de douleur le monstre bondissantVient aux pieds des chevaux tomber en mugissant,Se roule, et leur présente une gueule enflamméeQui les couvre de feu, de sang et de fumée.La frayeur les emporte ; et, sourds à cette fois,Il ne connoissent plus ni le frein ni la voix :En efforts impuissants leur maître se consume ;Ils rougissent le mors d’une sanglante écume.On dit qu’on a vu même, en ce désordre affreux,Un dieu qui d’aiguillons pressoit leurs flancs poudreux.A travers les rochers la peur les précipite ;L’essieu crie et se rompt : l’intrépide HippolyteVoit voler en éclats tout son char fracassé,Dans les rênes lui-même il tombe embarrassé.Excusez ma douleur cette image cruelleSera pour moi de pleurs une source éternelle :J’ai vu, Seigneur, j’ai vu votre malheureux filsTraîné par les chevaux que sa main a nourris.Il veut les rappeler, et sa voix les effraie ;Ils courent : tout son corps n’est bientôt qu’une plaie.De nos cris douloureux la plaine retentit.Leur fougue impétueuse enfin se ralentit :Ils s’arrêtent non loin de ces tombeaux antiquesOù des rois ses aïeux sont les froides reliques.J’y cours en soupirant, et sa garde me suit ;De son généreux sang la trace nous conduit ;Les rochers en sont teints, les ronces dégouttantesPortent de ses cheveux les dépouilles sanglantes.J’arrive, je l’appelle ; et me tendant la main,Il ouvre un œil mourant qu’il referme soudain :« Le ciel, dit-il, m’arrache une innocente vie,» Prends soin après ma mort de la triste Aricie.» Cher ami, si mon père, un jour désabusé,» Plaint le malheur d’un fils faussement accusé,» Pour apaiser mon sang et mon ombre plaintive,» Dis-lui qu’avec douceur il traite sa captive ;» Qu’il lui rende… » A ce mot, ce héros expiréN’a laissé dans mes bras qu’un corps défiguré :Triste objet où des dieux triomphe la colère,Et que méconnoîtroit l’œil même de son père.( .)
D. Quelle fut la fin de Thésée ?
R. Hippolyte fut ressuscité par Esculape. Phèdre, bourrelée de remords, se pendit de désespoir. Les sujets de Thésée se révoltèrent contre ce prince et le chassèrent de ses états. Thésée se retira dans l’île de Scyros, pour y achever tranquillement ses jours, dans une vie privée. Mais le roi Lycomède, jaloux de sa réputation, ou corrompu par ses ennemis, le fit précipiter du haut d’un rocher, où il l’avoit attiré sous prétexte de lui montrer la campagne. Longtemps après, les Athéniens, pour réparer leur ingratitude envers Thésée, rendirent des honneurs à ses cendres, et lui élevèrent des autels.
Bellérophon §
D. Racontez l’histoire de Bellérophon
R. Bellérophon étoit fils de Glaucus, roi de Corinthe. Il est le premier qui ait enseigné l’art de mener un cheval, avec le secours de la bride. Ayant eu le malheur de tuer son frère à la chasse, il se réfugia à la cour de Proetus, roi d’Argos. Sthénobée, femme de ce prince, conçut une forte passion pour Bellérophon qui s’y montra insensible. La reine, pour se venger, l’accusa auprès de son époux devoir voulu attenter à son honneur. Le roi, pour ne pas violer les lois de l’hospitalité, envoya le jeune héros en Lycie, avec des lettres adressées à Iobalte, roi de cette contrée, et père de Sthénobée. Proetus avoit dit à Bellérophon qu’il le recommandoit dans ces lettres, à son beau-père. Mais il informoit au contraire le roi de l’injure qu’il prétendoit en avoir reçue, et le prioit d’en tirer vengeance. C’est de là que vint l’usage d’appeler Lettres de Bellérophon, celles qui renfermoient quelque chose contre les intérêts de celui qui les portoit.
D. Quel accueil Bellérophon reçut-il à la cour du roi de Lycie ?
R. Le roi Iobalte lui fit un accueil hospitalier. Les neuf premiers jours de son arrivée se passèrent en fêtes et en festins. Mais le dixième jour, le roi décacheta les lettres dont son hôte étoit porteur. Ne voulant point souiller sa maison du sang du jeune prince, il l’envoya combattre les Solymes avec un foible corps de troupes. Bellérophon revint victorieux, contre l’attente d’Iobalte. Le roi l’exposa à d’autres dangers dont le héros se tira pareillement avec gloire. Enfin le roi lui ordonna d’aller combattre la Chimère.
D. Qu’étoit-ce que la Chimère ?
R. C’étoit un monstre né en Lycie. Il avoit la tête d’un lion, la queue d’un dragon, et le corps d’une chèvre. Sa gueule béante vomissoit des tourbillons de flammes et de feux. Neptune donna le cheval Pégase à Bellérophon. Le prince, monté sur ce coursier, tua la Chimère. Alors Iobalte, reconnoissant l’innocence de ce héros, et la protection spéciale dont les dieux l’honoroient, lui donna sa seconde fille en mariage, et le déclara son successeur. Sthénobée, ne pouvant supporter les remords dont elle étoit dévorée, s’empoisonna.
Jason et les Argonautes. §
D. Faites-nous connoître Jason.
R. Jason étoit fils d’Eson, roi d’Iolchos, en Thessalie. Pélias s’empara des états d’Eson, son frère ; Craignant que Jason ne cherchât à remonter sur le trône de son père, il pensa à éloigner ce prince, en lui proposant une expédition glorieuse, mais pleine de dangers. C’étoit la conquête de la Toison d’or. Pélias espéroit que son neveu périroit dans cette entreprise.
…… Retraçons la célèbre entrepriseQui conduisit Jason sur les bords de Colchos,Et montrons ce que peut la valeur d’un héros,Lorsque le ciel la favorise.( .)
D. Qu’étoit-ce que la toison d’or ?
R. C’étoit la toison d’un bélier dont les dieux avoient fait présent à Athamas, roi de Thèbes. La toison de ce bélier étoit dorée. Phryxus, fils d’Athamas, et Hellé, sœur du jeune prince, ayant pris la résolution de s’enfuir de la maison paternelle, pour se dérober aux persécutions de Néphèle, leur belle-mère, emmenèrent le bélier, et montèrent dessus pour traverser le bras de mer qui sépare l’Europe de l’Asie. Hellé, effrayée du bruit des vagues, se laissa tomber dans la mer qui pour cette raison fut appelée l’Hellespont22.
Phryxus aborda heureusement dans la Colchide, où il sacrifia son bélier pour obéir à un oracle. Il en suspendit la toison à un arbre, dans un champ consacré à Mars. Aëte, parent de Phryxus, et roi de la Colchide, lui donna sa fille en mariage. Mais ensuite il envia les trésors de son gendre, et le fit mourir pour s’en rendre maître : Jason, et un grand nombre de princes de la Grèce, informés de cette barbarie, résolurent la perte du meurtrier, et formèrent le dessein de reconquérir la toison d’or.
D. Quel nom, les poëtes ont-ils donné aux héros qui entreprirent la conquête de la toison d’or ?
R. Ils ont été appelés Argonautes, parce que le vaisseau qu’ils montoient, se nommoit Argo. On compte parmi ces héros, Hercule, Castor, Pollux, Orphée, Laërte, père d’Ulysse ; Pélée, père d’Achille ; Thésée, Pirithoüs, etc. Jason, promoteur de l’entreprise, en fut reconnu le chef.
Argonautes fameux, demi-dieux de la Grèce,Castor, Pollux, Orphée, et vous heureux Jason,Vous de qui la valeur, et l’amour et l’adresseOnt conquis la toison.( .)
D. Quelles difficultés présentoit l’expédition des Argonautes ?
R. Cette expédition présentoit des difficultés insurmontables. La toison étoit gardée par des taureaux à gueules enflammées et par un horrible dragon. Il falloit, suivant l’ordre du destin, mettre sous le joug ces taureaux, présent de Vulcain, puis les attacher à une charrue, et leur faire labourer le champ consacré à Mars ; semer dans ce champ les dents d’un dragon d’où devoient naître des hommes armés qu’il falloit exterminer jusqu’au dernier ; enfin, tuer le monstre qui veilloit à la conservation du précieux dépôt. C’est par le secours de Médée, fille d’Aëte, et qui excelloit dans l’art des enchantements, que Jason surmonta toutes ces difficultés. Il enleva la toison, et Médée abandonna son père pour s’enfuir avec le héros auquel elle avoit prêté son secours. L’expédition des Argonautes eut lieu 79 ans avant la prise de Troie.
Médée parle ainsi à Créon :
Sans moi, pour conquérir la superbe toison,Qu’auroient pu ces héros, et ce fameux Jason ?Leur bouche a-t-elle osé m’en dérober la gloire ?S’ils vous l’ont déguisée, apprenez-en l’histoire :« Dans une forêt sombre, un dragon furieux» Conservoit du dieu Mars le dépôt précieux.» Ses yeux étinceloient d’une affreuse lumière» Jamais le doux sommeil ne charma leur paupière ;» Et veillant nuit et jour, ses terribles regards» Portoient l’effroi, l’horreur, la mort de toutes parts.» Farouches défenseurs de la forêt sacrée,» Deux taureaux menaçants en occupoient l’entrée.» Il falloit mettre au joug ces taureaux indomptés ;» Des fureurs de Vulcain ministres redoutés,» Ils vomissoient au loin une brûlante haleine,» Et de torrents de flamme ils mondoient la plaine.» Il falloit, à leur aide, ouvrir d’affreux sillons» Voir des dents d’un serpent naître des bataillons,» Et vaincre ces soldats enfantés par la terre,» Qui touts ne respiroient que le sang et la guerre.» Parmi tant de périls, quel Dieu, sans mon secours» De vos tristes héros eût conservé les jours ?» Sur le Destin jaloux j’emportai la victoire :» J’empêchai leur trépas ; je les couvris de gloire ;» Et leur sacrifiai remords, crainte, pudeur,» Mon père, mon pays, ma gloire, mon bonheur. »( .)
D. Jason et Médée ne furent-ils point poursuivis par Aëte ?
R. Oui ; et Médée, pour retarder la course d’Aëte, mit en pièces son frère Absyrthe qu’elle avoit emmené avec elle, et dispersa les membres de ce malheureux enfant, le long du chemin que suivoit son père. Aëte perdit du temps à ramasser les membres de son fils. Médée parvint ainsi à se dérober à sa poursuite. Arrivée à Athènes, elle rajeunit, par la force de ses enchantements, le vieux Eson, père de Jason. Les filles de Pélias voulurent obtenir d’elle la même faveur pour leur père. Médée saisit cette occasion de se venger de Pélias qui avoit ôté le trône à Eson, et avoit voulu faire périr Jason. Elle persuada donc aux filles du roi, de couper leur père par morceau, et d’en jeter les membres dans une chaudière d’eau bouillante. Le malheureux Pélias perdit la vie par ce stratagème.
D. Jason lui-même ne fut-il pas victime des fureurs de Médée ?
R. Oui. Jason devint amoureux de Créuse, fille de Créon, roi de Corinthe. Médée fut outrée de cette infidélité.
Quoi ! mon père trahi, les éléments forcés,D’un frère dans la mer les membres dispersés,Lui font-ils présumer mon audace épuisée ?Lui font-ils présumer, qu’à mon tour méprisée,Ma rage contre lui n’ait pas où s’assouvir,Et que tout mon pouvoir se borne à le servir ?Tu t’abuses, Jason, je suis encor la même.Tout ce qu’en ta faveur fit mon amour extrême,Je le ferai par haine, et je veux, pour le moins,Qu’un forfait nous sépare, ainsi qu’il nous a joints.( .)
Médée envoya à Créuse une cassette pleine de pierres précieuses ensorcelées. Le feu prit à la cassette et consuma la princesse et le roi son père avec elle. Médée reprocha ensuite à Jason son infidélité, égorgea en sa présence les deux fils qu’elle en avoit eus, et s’élevant dans les airs sur un char traîné par des dragons ailés, elle se retira à Athènes.
D. Quelle fut la fin de Médée ?
R. Elle trouva un asile, auprès d’Egée, roi de Corinthe, qui même l’épousa. Mais Thésée revint alors à Athènes pour se faire reconnoître par son père. Médée fut soupçonnée d’avoir voulu faire périr le jeune prince par le poison. Elle fut donc encore obligée de s’enfuir d’Athènes. Elle se retira dans la Phénicie, et passa ensuite dans l’Asie supérieure. Elle épousa un des plus grands rois de ce pays-là. Elle en eut un fils appelé Médus qui succéda à son père, et donna à ses sujets le nom de Mèdes.
C’est peu que dans Corinthe on ait vu mon courageDes mépris d’un époux venger l’indigne outrage ;C’est peu que d’une cour que je remplis d’horreur,Ma fuite triomphante ail bravé la fureur ;Pour mieux jouir encor d’une entière vengeance,Je trouve une autre cour, un roi dont la naissance,Pour m’attacher à lui, me rend avec éclat,Tout ce que je perdis en suivant un ingrat.( .)
Cadmus §
D. De qui Cadmus étoit-il fils ?
R. Cadmus étoit fils d’Agénor, roi des Phéniciens. Jupiter, transformé en taureau, enleva Europe, sœur de Cadmus. Agénor enjoignit à son fils, d’aller la chercher, et de ne point revenir sans elle. Cadmus, après avoir parcouru inutilement diverses contrées, vint consulter l’oracle de Delphes, qui lui ordonna de s’arrêter dans le lieu où il seroit conduit par un bœuf, et d’y bâtir une ville. Cadmus rencontra dans la Phocide une génisse qui lui servit de guide. La ville qu’il bâtit fut appelée Thèbes, et la contrée prit le nom de Béotie.
D. Cadmus régna-t-il long-temps à Thèbes ?
R. Il y régna pendant plusieurs années. Mais il éprouva des malheurs domestiques aussi grands que multipliés. Sémélé, sa fille, mère de Bacchus, fut consumée par la foudre ; Ino, aussi sa fille, fuyant son mari Athamas, devenu furieux, se précipita dans la mer ; Agavé, autre fille de Cadmus, célébrant les Orgies avec les Ménades, mit en pièces son propre fils nommé Penthée ; Autonoé, sa quatrième fille, eut à déplorer la mort funeste de son fils Actéon. Cadmus, pour n’être pas témoin de tant de malheurs arrivés dans sa famille, se retira en Illyrie. On dit qu’il fut changé en serpent, ainsi que sa femme.
D. De quelle invention les Grecs sont-ils redevables à Cadmus ?
R. On prétend qu’il leur apprit l’art de l’écriture. Tout le monde connoît ces beaux vers de sur Cadmus.
C’est de lui que nous vient cet art ingénieuxDe peindre la parole et de parler aux yeux ;Et, par les traits divers des figures tracées,Donner de la couleur et du corps aux pensées.
Harmonie, femme de Cadmus, donna aux Grecs les premières connoissances de l’art qui porte son nom.
Amphion, Arion. §
D. Qui étoit Amphion ?
R. Amphion étoit fils de Jupiter et d’Antiope, femme de Lycus, roi de Thèbes. Il se rendit habile dans la musique, et Mercure, dont il fut le disciple, lui donna une lyre, au son de laquelle il bâtit les murs de la ville de Thèbes qui avoit été fondée par Cadmus. Les pierres, sensibles à la douceur de ses accents, venoient d’elles-mêmes se placer les unes sur les autres. Nous trouvons dans cette fiction un emblème ingénieux du pouvoir de l’éloquence et de la poésie, sur les premiers hommes épars dans les bois.
D. Faites-nous connoître Arion.
R. Arion, cet illustre rival d’Amphion et d’Orphée, étoit né à Méthymne, dans l’île de Lesbos. Il jouit long-temps de la faveur de Périandre, roi de Corinthe. Il passa ensuite en Italie où il exerça ses talents d’une manière utile à sa fortune. Il s’embarqua au port de Tarente pour revenir dans sa patrie. Les matelots formèrent le dessein de le tuer pour s’emparer de ses richesses. Arion demanda, pour toute grâce, qu’il lui fut permis de toucher encore une fois sa lyre avant que de recevoir la mort. Il l’obtint, se retira sur la poupe du vaisseau, et fit retentir l’air des accents les plus touchants. Bientôt après, il se précipita dans la mer. Plusieurs dauphins, sensibles aux charmes de sa mélodie, s’étoient rassemblés autour de son vaisseau. Un d’eux le reçut sur son dos, et le porta jusqu’au cap Ténare, en Laconie, d’où il se rendit à Corinthe. Périandre fut ravi de le revoir ; il fit punir de mort les pirates, et éleva un cénotaphe au dauphin qui avoit sauvé Arion.
D. Comment a-t-il décrit les prodiges attribués par les poëtes à la lyre d’Amphion et à celle d’Arion ?
R. Voici les vers de :
Songez par quel prodige on connoît Amphion,Quel miracle la Grèce a chanté d’Arion :Le premier, sans autre art, voit au son de sa lyreLes pierres se mouvoir et Thèbes se construire ;L’autre, près de périr par la fureur des flots,Sait trouver dans leur sein la vie et le repos :Un dauphin, traversant les plaines de Neptune,Attiré par ses chants, prend soin de sa fortune :Il l’aborde ; il l’emporte, il lui sert de vaisseau ;Et, donnant aux mortels un spectacle nouveau,Il le fait à leurs yeux sans périls et sans crainte,Naviguer sur les mers de Crète et de Corinthe.
D. Par qui fut ruinée la ville de Thèbes ?
R. Cette ville fut ruinée par Alexandre le Grand, qui n’en épargna que la maison et la famille du poëte qui y avoit pris naissance.
Viens servir l’ardeur qui m’inspire :Déesse, prête-moi la lyre,Ou celle de ce Grec vanté,Dont l’impitoyable Alexandre,Au milieu de Thèbes en cendre,Respecta la postérité.( .)
Il y eut en Egypte une autre ville de Thèbes, renommée pour ses cent portes. Le pays dans lequel elle étoit située, se nommoit Thébaïde.
Pygmalion. §
D. Qu’est-ce que la fable nous apprend de Pygmalion ?
R. Pygmalion étoit un fameux sculpteur. Il fit une statue de Vénus en ivoire, et la trouva si belle, qu’il pria la déesse d’animer cet ouvrage de son ciseau. Vénus l’exauça, et Pygmalion épousa sa statue, dont il eut Paphus, qui bâtit la ville de Paphos.
Deucalion. §
D. Qui étoit Deucalion ?
R. Deucalion, fils de Prométhée et de Pandore, épousa Pyrrha, fille d’Épiméthée son oncle. Dans le temps qu’il régnoit en Thessalie, un grand déluge inonda toute la terre, et fit périr touts les hommes ; Deucalion et Pyrrha furent sauvés dans une barque qui s’arrêta sur le mont Parnasse. Lorsque les eaux furent retirées, ils allèrent consulter l’oracle de Thémis, qui leur ordonna de sortir du temple, de voiler leur visage, et de jeter derrière eux les os de leur grand’mère. Leur piété fut d’abord alarmée de cet ordre. Mais Deucalion, après y avoir bien réfléchi, comprit que les os de leur grand’mère n’étoient autre chose que les pierres, parce que la terre est la mère commune de touts les hommes. Ils en ramassèrent donc, et les jetèrent derrière eux. Celles que jeta Deucalion se changèrent en hommes, et celles de Pyrrha en femmes.
Pyrame et Thisbé. §
D. Racontez l’histoire de Pyrame et de Thisbé.
R. Pyrame, jeune Assyrien, est célèbre par sa passion pour Thisbé. Une haine irréconciliable divisoit les parents de ces jeunes amants. Pyrame et Thisbé se donnèrent un jour rendez-vous hors des murs de Babylone, sous un mûrier blanc, au pied duquel étoit le tombeau de Ninus. Thisbé arriva la première ; elle aperçut une lionne ; la peur la fit fuir. Elle laissa tomber son voile. La lionne le déchira et l’ensanglanta. Pyrame étant arrivé, ramassa le voile, et, croyant que Thisbé avoit été dévorée, il se perça de son épée. Cependant Thisbé sortit du lieu où elle s’étoit cachée, et trouva Pyrame expirant. Elle ramassa l’épée fatale et se la plongea dans le cœur. On prétend que le mûrier fut teint du sang de ces amants, et que les mûres devinrent rouges, de blanches qu’elles étoient auparavant.
Philémon et Baucis. §
D. Qu’est-ce que la fable nous apprend de Philémon et de Baucis ?
R. Philémon et Baucis étoient deux vieux époux vertueux et pauvres. Jupiter, sous la figure humaine, accompagné de Mercure, voulut visiter la Phrygie. Il fut rebuté de touts les habitants du bourg auprès duquel demeuroient Philémon et Baucis, qui seuls le reçurent. Pour les récompenser, le maître des dieux leur ordonna de le suivre au haut d’une montagne. Lorsqu’ils y furent arrivés, ils regardèrent derrière eux, et virent tout le bourg et les environs submergés, excepté leur petite cabane qui fut changée en un temple. Jupiter promit à ces pieux époux de leur accorder ce qu’ils desireroient. Ils se demandèrent d’être les ministres du temple qui avoit remplacé leur cabane, et de ne point mourir l’un sans l’autre. Leurs vœux furent exaucés. Lorsqu’ils furent parvenus à une extrême vieillesse, Philémon s’aperçut que Baucis devenoit tilleul, et Baucis fut étonnée de voir que Philémon devenoit chêne. Ils se firent alors leurs derniers adieux.
Philomèle et Progné §
D. Racontez les malheurs de Philomèle et de Progné.
R. Philomèle et Progné étoient filles de Pandion, roi d’Athènes. Progné épousa Térée, roi de Thrace. Au bout de cinq ans, elle desira de revoir Philomèle, sa sœur, qu’elle aimoit tendrement. Elle pria Térée de partir pour Athènes, et d’en ramener Philomèle. Térée y consentit, et obtint de son beau-père la permission d’emmener Philomèle. Pendant la route, il devint amoureux de la princesse, et lui fit violence. Ensuite, il lui coupa la langue, et la laissa prisonnière dans un château. En arrivant, il dit à son épouse, que Philomèle étoit morte dans le voyage. Progné pleura sa sœur, et lui fit élever un monument.
D. Comment le crime de Térée fut-il découvert ?
R. Philomèle, enfermée dans sa prison, s’avisa de tracer sur la toile, avec une aiguille, l’attentat de Térée, et la situation où elle étoit réduite. Elle trouva le moyen de faire passer la tapisserie à sa sœur. Progné différa sa vengeance jusqu’aux fêtes de Bacchus. Elle sortit alors avec plusieurs dames habillées en bacchantes, et se rendit à la prison de sa sœur qu’elle délivra. La vue de l’état où Térée avoit mis cette infortunée, enflamma Progné d’une telle fureur, qu’elle tua son propre fils Itys, et en fit servir les membres à son mari. Philomèle parut sur la fin du repas, et jeta sur la table la tête de l’enfant. Térée, transporté de rage à cette vue, demande ses armes, et veut poursuivre les princesses ; mais les dieux changèrent Progné en hirondelle, Philomèle en rossignol, Térée en huppe, et Itys en faisan.
Autrefois Progné l’hirondelleDe sa demeure s’écarta,Et loin des villes s’emportaDans un bois où chantoit la pauvre Philomèle.« Ma sœur, lui dit Progné, comment vous portez-vous ?Voici tantôt mille ans que l’on ne vous a vue ;Je ne me souviens pas que vous soyez venue,Depuis le temps de Thrace habiter parmi nous.Dites-moi, que pensez-vous faire ?Ne quitterez-vous point ce séjour solitaire ?— Ah ! reprit Philomèle, en est-il de plus doux ?Progné lui repartit : eh quoi ! cette musiquePour ne chanter qu’aux animaux,Tout au plus à quelque rustique ?Le désert est-il fait pour des talents si beaux ?Venez faire aux cités éclater leurs merveilles :Aussi-bien, en voyant les bois,Sans cesse il vous souvient que Térée autrefois,Parmi des demeures pareilles,Exerça sa fureur sur vos divins appas.— Et c’est le souvenir d’un si cruel outrage,Qui fait, lui dit sa sœur, que je ne vous aime pas :En voyant les hommes, hélas !Il m’en souvient bien davantage. »( .)
D. Qu’est-ce que les poëtes nous apprennent des Hespérides ?
R. Les Hespérides étoient filles d’Hesper, frère d’Atlas. Ou en compte ordinairement trois, Églé, Aréthuse, et Hypéréthuse. Elles avoient des jardins dans lesquels étoient des pommes d’or, gardées par un dragon qui avoit cent têtes, et qui poussoit à la fois cent sortes de sifflements. Ce fut avec une de ces pommes, que la Discorde brouilla les trois déesses. Ce fut avec ce même fruit qu’Hippomène vainquit Atalante. Hercule enleva les pommes du jardin des Hespérides.
D. Racontez l’histoire d’Atalante.
R. Atalante, fille d’un roi de Scyros, étoit si légère à la course, qu’il étoit impossible aux hommes les plus agiles et les plus vigoureux de l’atteindre. Pour se délivrer des importunités de la foule d’amants que lui attiroit sa beauté, elle proposoit aux prétendants de courir avec elle, et promettoit sa main à celui qui seroit son vainqueur ; mais elle se réservoit le droit de mettre à mort ceux qui seroient vaincus. Plusieurs perdirent la vie de cette manière. Mais Hippomène, instruit et favorisé par Vénus, se présenta avec confiance. La déesse lui avoit fait présent de trois pommes d’or du jardin des Hespérides. Hippomène jeta ces pommes dans l’arène si à propos, qu’Atalante, s’étant amusée à les ramasser, vit son concurrent arriver au but avant elle. Atalante devint le prix du vainqueur.
Les Sibylles. §
D. Dites ce qu’étoient les Sibylles.
R. Les anciens ont appelé Sibylles certaines femmes auxquelles ils ont attribué le don de connoître et de prédire l’avenir La plus célébré de toutes a été celle de Cumes en Italie. On prétend même qu’il n’en a jamais existé d’autres. Ce qui a pu faire croire qu’il y avoit eu plusieurs Sibylles, c’est que celle de Cumes a voyagé en divers pays, et qu’elle a pris les noms des lieux qu’elle a parcourus.
D. Racontez l’origine des Livres sibyllins.
R. On dit que la Sibylle apporta à Tarquin l’Ancien neuf volumes, pour lesquels elle demanda trois cents pièces d’or. Tarquin la renvoya avec mépris. La Sibylle jeta dans le feu trois de ses livres en présence du roi, puis elle demanda le même prix pour les six volumes qui restoient. Le prince la rebuta encore. Elle en brûla trois autres, et continua à demander le même prix pour les trois derniers. Tarquin, frappé de cette persévérance, envoya chercher les augures qui engagèrent le prince à donner la somme que la Sibylle exigeoit pour ses trois volumes. Quand la Sibylle eut reçu son argent, elle conseilla au roi de garder ces œuvres avec soin, parce qu’ils contenoient des oracles qui présageoient les destinées de Rome. Tarquin les fit mettre dans un coffret de pierre qui fut placé sous une voûte du Capitole. La garde en fut confiée d’abord à deux patriciens qu’on nomma Duumvirs. Le nombre des gardiens fut porté dans la suite à quinze, qui prirent le nom de Quindécemvirs. On ne pouvoit consulter ces livres sans une autorisation spéciale du Sénat, qui ne l’accordoit que dans les grands événements.
Œdipe. §

D. De qui Œdipe étoit-il fils ?
R. Il étoit fils de Laïus, roi de Thèbes. Laïus avoit appris de l’oracle qu’il périroit de la main de son propre fils ; et ordonna à Jocaste sa femme, d’ôter la vie à l’enfant qu’elle mettroit au monde. La mère eut horreur de ce crime, et en confia l’exécution à un berger. Le berger, à son tour, touché des grâces de l’enfant, lui perça les talons et l’attacha à un arbre sur le mont Cithéron. Icare, berger de Polybe roi de Corinthe, ayant conduit par hasard son troupeau dans ce lieu, trouva le jeune prince, le détacha et l’emporta. La reine de Corinthe voulut le voir ; et, comme elle n’avoit point d’enfants, elle l’adopta et prit soin de son éducation. Elle lui donna le nom d’Œdipe, à cause de l’enflure de ses pieds.
……… Un Thébain, qui se dit votre père,Exposa votre enfance en ce lieu solitaire.Quelque dieu bienfaisant guida vers vous mes pas :La pitié me saisit, je vous pris dans mes bras ;Je ranimai dans vous la chaleur presque éteinte.Vous viviez ; aussitôt je vous porte à Corinthe ;Je vous présente au prince : admirez votre sort !Le prince vous adopte au lieu de son fils mort.Et, par ce coup adroit, sa politique heureuseAffermit pour jamais sa puissance douteuseSous le nom de son fils vous fûtes élevéPar cette même main qui vous avoit sauvé.( .)
D. Que fît Œdipe, lorsqu’il fut devenu grand ?
R. Il apprit qu’il n’étoit pas fils de Polybe. Il consulta l’oracle sur sa destinée, et reçut cette réponse : « Œdipe sera le meurtrier de son père, et l’époux de sa mère, et mettra au monde une race détestable. » Pour éviter d’accomplir cette horrible prédiction, Œdipe s’exila de Corinthe, et réglant sa marche sur les astres, il prit le chemin de la Phocide. Il rencontra Laïus dans un sentier étroit qui conduisoit à Delphes. Laïus, monté sur son char, et escorté seulement de cinq personnes, ordonna à Œdipe d’un ton de hauteur de lui laisser le passage libre ; ils en vinrent aux mains sans se connoître, et Laïus fut tué.
D. Dans quelle ville se rendit Œdipe, après avoir tué Laïus ?
R. Il alla à Thèbes, et trouva cette ville désolée par le Sphinx. C’étoit un monstre qui avoit la tête d’une fille, le corps d’un chien, les ailes et la queue d’un dragon, les pieds et les griffes d’un lion. Il proposoit une énigme aux passants, et dévoroit touts ceux qui ne pouvoient point la deviner. Tout le monde abandonnoit la contrée ; Thèbes étoit déserte.
Né parmi les rochers, au pied de Cithéron,Ce monstre à voix humaine, aigle, femme et lion,De la nature entière exécrable assemblage,Unissoit contre nous l’artifice à la rage.Il n’étoit qu’un moyen d’en préserver ces lieux.D’un sens embarrassé dans des mots captieux,Le monstre chaque jour, dans Thèbe épouvantée,Proposoit une énigme avec art concertée.( .)
D. Quelle étoit l’énigme proposée par le Sphinx ?
R. Le monstre demandoit : « Quel est l’animal qui a quatre pieds le matin, d’eux à pieds, et trois le soir ? » La destinée du Sphinx portoit qu’il perdroit la vie, dès qu’on auroit satisfait à sa question. Créon, frère de Jocaste, qui, depuis la mort de Laïus, tenoit les rênes du gouvernement à Thèbes, fit publier dans toute la Grèce, qu’il donneroit la couronne et la main de Jocaste à celui qui expliqueroit l’énigme. Œdipe se présenta, et fut assez heureux pour la deviner. Il dit au monstre, que son animal étoit l’homme lui-même qui, dans son enfance, se traîne sur les pieds et sur les mains, ensuite, parvenu à un âge plus avancé, marche debout sur les deux pieds seulement, et, dans la vieillesse, s’appuie sur un bâton qui lui sert de troisième pied. Le Sphinx, outré de dépit de se voir deviné, se cassa la tête contre un rocher, Œdipe fut proclamé roi de Thèbes, et épousa la reine Jocaste.
Le monstre, furieux de se voir entendu,Venge aussitôt sur lui tant de sang répandu,Du roc s’élança en bas et s’écrasa lui-même.La reine tint parole, et j’eus le diadème.( .)
D. Comment Œdipe reconnut-il qu’il étoit coupable de touts les crimes que l’oracle lui avoit annoncé qu’il commettroit ?
R. Les premières années du règne d’Œdipe furent heureuses. Mais ensuite le royaume fut désolé par une peste cruelle. L’oracle, consulté de nouveau, répondit que le fléau ne cesseroit que quand le meurtrier de Laïus auroit été puni. Œdipe fit des recherches pour découvrir ce meurtrier. Le berger par qui il avoit été exposé sur le mont Cithéron, lui révéla le mystère de sa naissance. Bientôt Œdipe se reconnoît coupable des deux crimes horribles qu’il a voulu éviter. Il apprend qu’il a tué son père, et qu’ils épousé sa mère.
Le voilà donc rempli cet oracle exécrable,Dont ma crainte a pressé l’effet inévitable !Et je me vois enfin, par un mélange affreux,Inceste et parricide, et pourtant vertueux.Un dieu plus fort que moi m’entraînoit vers le crime ;Sous mes pas fugitifs il creusoit un abyme,Et j’étois, malgré moi, dans mon aveuglement,D’un pouvoir inconnu l’esclave et l’instrument.Voilà touts mes forfaits ; je n’en connois point d’antres,Impitoyables dieux ! mes crimes sont les vôtres,Et vous m’en punissez !… Où suis-je ? quelle nuitCouvre d’un voile affreux la clarté qui nous luit ?Ces murs sont teints de sang ; je vois les EuménidesSecouer leurs flambeaux vengeurs des parricides ;Le tonnerre en éclats semble fondre sur moi ;L’enfer s’ouvre.… ô Laïus, ô mon père ! est-ce toi ?Je vois, je reconnois la blessure mortelleQue te fit dans le flanc cette main criminelle.Punis-moi, venge-toi d’un monstre détesté,D’un monstre qui souilla les flancs qui l’ont porté.Approche, entraîne-moi dans les demeures sombres ;J’irai de mon supplice épouvanter les ombres ;Viens, je te suis.( .)
D. Achevez le récit des malheurs d’Œdipe.
R. Ce malheureux prince, saisi horreur à la vue de ses forfaits, s’arracha les yeux, et s’exila lui-même. Jocaste, son épouse et sa mère, se pendit de désespoir. Antigone, fille, d’Œdipe, modèle de piété filiale, servit de guide à son père aveugle, et l’accompagna dans son exil.
Guerre de Thèbes, Étéocle et Polynice. §
D. Quelle fut l’occasion de la guerre de Thèbes ?
R. Œdipe, en quittant Thèbes, avoit ordonné que ses deux fils Étéocle et Polynice règneroient alternativement, chacun pendant un an. Étéocle, comme aîné, monta le premier sur le trône ; mais, quand l’année-fut finie, il ne voulut point céder la couronne à son frère. Étéocle et Polynice se firent une guerre sanglante dans laquelle toute la Grèce prit parti :
Œdipe, en achevant sa triste destinée,Ordonna que chacun règneroit son année ;Et, n’ayant qu’un état à mettre sous vos lois,Voulut que tour à tour vous fussiez touts deux rois.A ces conditions vous daignâtes souscrire,Le sort vous appela le premier à l’empire,Vous montâtes au trône, il n’en fut point jaloux ;Et vous ne voulez point qu’il y monte après vous.( .)
D. Comment se termina la guerre de Thèbes ?
R. Comme la victoire ne se déclaroit pour aucun des deux partis, les deux frères s’appelèrent à un combat singulier. Ils s’entre-tuèrent l’un l’autre, en présence des deux armées. La mort même ne put éteindre leur haine implacable. Car, lorsque leurs corps furent mis sur le même bûcher pour être brûlés, la flamme se divisa d’elle-même, et fit voir que leur mutuelle aversion subsistoit encore après leur trépas.
Vous avez vu, Madame, avec quelle furieLes deux princes sortoient pour s’arracher la vie ;Que d’une ardeur égale ils fuyoient de ces lieux,Et que jamais leurs cœurs ne s’accordèrent mieux.La soif de se baigner dans le sang de leur frèreFaisoit ce que jamais le sang n’avoit su faire :Par l’excès de leur haine ils sembloient réunis,Et prêts à s’égorger ils paroissoient amis.Ils ont choisi d’abord, pour leur champ de bataille,Un lieu près des deux camps, au pied de la muraille.C’est là que, reprenant leur première fureur,Ils commencent enfin ce combat plein d’horreur.D’un geste menaçant, d’un œil brûlant de rage,Dans le sein l’un de l’autre ils cherchent un passage ;Et, la seule fureur précipitant leurs bras,Touts deux semblent courir au-devant du trépas.………………………………………………………………………………………………………………… Sa douleur renouvelle sa rage, (De Polynice.)Et bientôt le combat tourne à son avantage.Le roi, frappé d’un coup qui lui perce le flanc,Lui cède la victoire, et tombe dans son sang.Les deux camps aussitôt s’abandonnent en proie,Le nôtre à la douleur, et les Grecs à la joie ;Et le peuple, alarmé du trépas de son roi,Sur le haut de ses tours témoigne son effroi.Polynice, tout fier du succès de son crime,Regarde avec plaisir expirer sa victime ;Dans le sang de son frère il semble se baigner :« Et tu meurs, lui dit-il, et moi je vais régner.» Regarde dans mes mains l’empire et la victoire :» Va rougir aux enfers de l’excès de ma gloire ;» Et pour mourir encore avec plus de regret,» Traître, songe en mourant que tu meurs mon sujet. »En achevant ces mots, d’une démarche fière,Il s’approche du roi couché sur la poussière,Et pour le désarmer il avance le brasLe roi, qui semble mort, observe touts ses pas ;Il le voit, il l’attend, et son ame irritéePour quelque grand dessein semble s’être arrêtée.L’ardeur de se venger flatte encor ses desirs,Et retarde le cours de ses derniers soupirs.Près de rendre la vie, il en cache le reste,Et sa mort au vainqueur est un piége funeste :Et dans l’instant fatal que ce frère inhumainLui veut ôter le fer qu’il tenoit à la main,Il lui perce le cœur ; et son ame ravie,En achevant ce coup, abandonne la vie.Polynice frappé, pousse un cri dans les airs,Et son ame en courroux s’enfuit dans les enfers.Tout mort qu’il est, Madame, il garde sa colère ;Et l’on diroit qu’encore il menace son frère :Son visage où la mort a répandu ses traits,Demeure plus terrible et plus fier que jamais.( .)
D. Que raconte-t-on d’Antigone, sœur d’Étéocle et de Polynice ?
R. Après la mort d’Étéocle et de Polynice, Créon, leur oncle, succéda à la couronne. Il fit retirer du bûcher le corps de Polynice, et lui refusa la sépulture, parce que ce prince avoit armé des étrangers contre sa patrie. Mais Antigone revint à Thèbes, pour rendre les derniers devoirs à son frère. Créon, instruit qu’on avoit transgressé ses ordres, fit veiller la nuit suivante auprès du corps. On surprit Antigone qui venoit pleurer son frère. Créon la condamna à être enterrée toute vive. Ismène, autre sœur d’Étéocle et de Polynice, déclara qu’elle avoit aidé Antigone à donner la sépulture à Polynice, et voulut subir le même supplice.
Pourquoi de vils bourreaux, dans l’empire Thébain,Dévouant Antigone aux horreurs de la faim,La plongent-ils vivante en une grotte obscure ?C’est qu’à son frère mort donnant la sépulture,Sa main religieuse à la tombe a remisCes restes qu’aux vautours la haine avoit promis.Elle savoit la loi qui la mène au supplice ;Mais elle n’a rien vu que son cher PolyniceQui, privé du tombeau, réclamoit son appui,Et, pour l’ensevelir, elle meurt avec lui.( .)
Pélops.
D. Racontez l’histoire de Pélops.
R. Pélops, fils de Tantale, demanda la main d’Hippodamie, fille d’Œnomaüs, roi d’Élide et de Pise. Œnomaüs aimoit tellement sa fille, qu’il ne pouvoit se résoudre à s’en séparer. Afin d’écarter les prétendants, il proposoit Hippodamie pour prix à celui qui le vaincroit à la course, mais à condition que le vaincu seroit mis à mort. Il vainquit, et tua jusqu’à treize concurrents. Pélops se présenta le quatorzième. Neptune, qui l’aimoit, lui avoit donné des chevaux ailés. Pélops gagna d’ailleurs Myrtile, cocher d’Œnomaüs, et l’engagea à ôter la clavette qui tenoit les roues. Le char d’Œnomaüs fut renversé, et ce prince se cassa la tête ; Pélops resta possesseur d’Hippodamie. Il étendit beaucoup ses états, qui prirent de lui le nom de Péloponèse.
D. Quels furent les enfants de Pélops et d’Hippodamie ?
R. Pélops et Hippodamie eurent un grand nombre d’enfants, parmi lesquels on distingue sur-tout Atrée et Thyeste. Ces deux frères sont fameux par les outrages qu’ils se firent l’un à l’autre. Thyeste séduisit Érope, femme d’Atrée ; il se déroba par la fuite à la fureur de son frère. Atrée feignit d’être disposé à pardonner à Thyeste l’injure qu’il en avoit reçue. Il l’invita à un festin, où les deux frères devoient se jurer une amitié réciproque. Thyeste avoit eu deux fils, de son commerce avec Erope. Atrée fit mettre ces enfants à mort, et en servit les membres à son frère. Les poëtes disent que le soleil recula d’horreur, à la vue de cet abominable festin. Thyeste, transporté de rage, trouva un vengeur dans un fils qu’il avoit eu d’une union incestueuse. Ce fils, exposé dans un bois, par ordre de Thyeste, fut sauvé par un berger qui le fit nourrir par une chèvre. C’est de là qu’il fut appelé Egisthe. Reconnu par son père, il se chargea de faire périr Atrée, et prit le temps d’un sacrifice pour l’assassiner. Egisthe, dans la suite, donna la mort à Agamemnon, fils d’Atrée, lorsque ce prince revenoit de la guerre de Troie.
Guerre de Troie. §
D. Par qui fut fondée la ville de Troie ?
R. Cette ville célèbre de l’Asie-Mineure, fut fondée sur le bord de la mer, par Dardanus, qui l’appela Dardanie. Tros, petit-fils de Dardanus, et troisième roi de Dardanie, donna son nom à la ville, fils de Tros, succéda à son père, et voulut que Troie se nommât Ilium. Ilus eut pour successeur Laomédon, son fils, qui environna Troie de sortes murailles. Hercule ôta le royaume et la vie à Laomédon, et emmena son fils prisonnier. Mais ce fils, ayant été racheté par les Troyens, reçut le nom de Priam, mot qui, dans la langue phrygienne, signifie racheté ; il s’appeloit auparavant Podarcès. Quand Priam eut pris la place de son père, il fortifia la ville de tours et de citadelles. Et, comme touts les lieux élevés s’appeloient alors Pergame, c’est pour cela que la ville de Troie fut aussi nommée Pergame.
D. Quelle fut la cause de la guerre de Troie ?
R. Pâris, fils de Priam, fut envoyé par son père, à Salamine, pour se faire rendre Hésione, fille de Laomédon. Cette princesse avoit été enlevé par Hercule, qui l’avoit donnée en mariage à Télamon, roi de Salamine. Pâris arriva à Sparte, où il fut reçu par le roi Ménélas, frère d’Agamemnon. Ménélas ayant un voyage à faire en Crète, laissa Pâris dans son palais pendant son absence. Le prince troyen se fit aimer d’Hélène, épouse de Ménélas, et fille de Jupiter et de Léda. Hélène s’enfuit avec Pâris à Troie. Priam approuva la conduite de son fils, et crut avoir un moyen de faire un échange d’Hésione avec Hélène. Mais l’événement trompa son attente. Les princes grecs refusèrent de rendre Hésione ; et, ayant fait entr’eux une ligue puissante, ils vinrent, les armes à la main, redemander Hélène devant Troie, qu’ils tinrent assiégée pendant dix ans, et qu’ils détruisirent enfin entièrement.
D. Quelles sont les fatalités auxquelles la prise de Troie étoit attachée ?
R. Les poëtes ont prétendu que la prise de Troie étoit attachée à certains événements qui devoient être accomplis avant que les Grecs se rendirent maîtres de cette ville. On compte six fatalités dont dépendoit la ruine de Troie.
1°. Il étoit nécessaire qu’un descendant d’Eaque vînt au siége de la ville ; et ce descendant étoit Achille, né de la déesse Thétis et de Pélée, fils d’Eaque.
2°. Il falloit avoir les flèches d’Hercule. Ces flèches, teintes du sang de l’hydre, avoient été enfermées dans le tombeau d’Hercule ; et Philoctète s’étoit engagé par serment, à ne jamais révéler le lieu de la sépulture du héros auquel il avoit rendu les derniers devoirs.
3°. Il falloit enlever le palladium. C’étoit une statue de Minerve, qu’on prétendoit être descendue du ciel, et s’être placée d’elle-même sur l’autel. On dit qu’elle rouloit toujours les yeux, et remuoit de temps en temps la lance qu’elle tenoit à la main. Le palladium fut enlevé par Diomède et Ulysse.
4°. Il falloit empêcher que les chevaux de Rhésus ne bussent de l’eau du Xanthe ; Rhésus étoit un roi de Thrace, qui ne vint au secours de Troie que la dixième année du siége. Il arriva de nuit, et campa près de Troie, pour y entrer le lendemain matin. Mais, Diomède et Ulysse surprirent son camp, tuèrent Rhésus pendant son sommeil, et emmenèrent ses chevaux.
5°. Troie ne pouvoit être prise pendant la vie de Troïle, fils de Priam. Ce prince fut tué par Achille. On comprend dans la cinquième fatalité la ruine du tombeau de Laomédon, qui étoit sur la porte de Scée. Les Troyens détruisirent eux-mêmes le tombeau, en faisant une brèche pour introduire dans la ville le fameux cheval de bois.
6°. Les Grecs ne pouvoient prendre Troie, s’ils n’avoient dans leur armée un fils d’Hercule. Ce fils d’Hercule étoit Télèphe, roi de Mysie. Les Grecs avoient ravagé les terres des Mysiens, et Achille avoit blessé Télèphe. Un oracle déclara que la blessure ne seroit guérie que par la main même qui l’avoit faite. Achille, regardant Télèphe comme son ennemi, lui refusoit ses secours. Mais Ulysse trouve moyen de lever cette difficulté. Il prit de la rouille qui se trouvoit à la lance d’Achille, et l’ayant appliquée à la place du roi de Mysie, il le guérit, et l’amena devant Troie.
D. Par quelle ruse les Grecs s’emparèrent-ils de Troie ?
R. A la fin de la dixième année, les Grecs, lassés d’un si long siége, et rebutés de tant d’attaques infructueuses, eurent recours à un stratagème. Ils construisirent, d’après les avis de Pallas, un cheval énorme, haut comme une montagne, composé de planches de sapin artistement jointes ensemble, et ils publièrent que c’étoit une offrande qu’ils consacroient à Minerve, pour obtenir un heureux retour. On tira ensuite au sort les noms des soldats qui devoient être renfermés dans les flancs de ce cheval. Les Grecs feignirent de partir, et se retirèrent à l’île de Ténédos, qui est vis-à-vis Troie. Les Troyens, se croyant délivrés de leurs ennemis, se livrèrent à la joie, abattirent une partie de leurs murailles, et traînèrent le cheval dans la ville. La nuit suivante, pendant que tout le monde dormoit profondément, le traître Sinon ouvrit les flancs du cheval, et en fit sortir les Grecs qui y étoient cachés. Les autres Grecs, étant revenus de Ténédos pendant la nuit, entrèrent dans Troie par la brèche que les habitants avoient faite, et bientôt cette malheureuse ville lut livrée aux flammes. La ruine de Troie eut lieu 1209 ans avant J.-C.
Énée raconte ainsi à Didon la prise de Troie.
Reine ! de ce grand jour faut-il troubler les charmes,Et rouvrir à vos yeux la source de nos larmes ;Vous raconter la nuit, l’épouvantable nuitQui vit Pergame en cendre, et son règne détruit ;Ces derniers coups du sort, ce triomphe du crime,Dont je fus le témoin, hélas ! et la victime ?…O catastrophe horrible ! ô souvenir affreux !Hélas ! en écoutant ces récits douloureux,D’Ulysse, de Pyrrhus, auteurs de nos alarmes,Quel barbare soldat ne répandroit des larmes ?…La nuit tombe ; et, déjà les célestes flambeaux,Penchant vers leur déclin, invitent au repos…Mais, si de nos malheurs vous exigez l’histoire,S’il faut en rappeler l’affligeante mémoire,Quoiqu’au seul souvenir de ces scènes d’horreurMon cœur épouvanté recule de terreur,J’obéis. Rebutés par dix ans de batailles,Las de languir sans fruit au pied de nos murailles,Las de voir par le sort, leurs assauts repoussés,Les Grecs, courbant des ais avec art enchâssés.D’un cheval monstrueux en forment l’édifice :Pallas leur inspira ce fatal artifice.C’est un vœu, disoient-ils, pour un retour heureux.On le croit. Cependant, en ses flancs ténébreuxIls cachent des guerriers, et de ses antres sombresUne élite intrépide ose habiter les ombres.
Un île, Ténédos est ton antique nom,S’élève au sein des mers, à l’aspect d’ilion.Avant nos longs malheurs, qui sont tombés sur elle,Son port fut florissant ; mais sa rade infidelleN’offre plus qu’un abri peu propice au nocher.Là, sur des bords déserts les Grecs vont se cacher.Nous les croyons partis ; sur les liquides plainesNous croyons que le vent les remporte à Mycènes :Enfin, nous respirons ; enfin, après dix ans,Ilion d’un long deuil affranchit ses enfants.Le libre citoyen ouvre toutes ses portes,Vole aux lieux où des Grecs ont campé les cohortes.On aime à voir ces champs témoins de nos revers,Ces camps abandonnés, ces rivages déserts.De cent fameux combats on recherche la trace ;Ici le fier Pyrrhus signaloit son audace ;Là le fils de Thétis rangeoit ses bataillons ;Ici c’étoit leur flotte, et là leurs pavillons.Plusieurs, pressés autour de ce colosse énorme,Admirent sa hauteur, et sa taille et sa forme.Thimète le premier, soit lâche trahison,Soit qu’ainsi l’ordonnât le destin d’Ilion,Des Grecs favorisant la perfide entreprise,Dans nos murs aussitôt prétend qu’on l’introduise.Mais les plus éclairés, se défiant des Grecs,Veulent que, sans tarder, ces présents trop suspectsSoient livrés à la flamme ou plongés dans les ondes,Ou qu’on en fouille, au moins, les cavités profondes.………………………………………………………………………………………………………………Recélant dans son sein l’appareil des batailles,La masse énorme avance et franchit nos murailles ;Un chœur nombreux d’enfants en chantant la conduit,Et se plaît à toucher les câbles qu’elle suit.Elle entre enfin, elle entre en menaçant la ville.O Troie ! ô ma patrie ! ô vénérable asile !Murs peuplés de héros ! murs bâtis par les dieux !Quatre fois près d’entrer, le colosse odieuxS’arrête ; quatre fois on entend un bruit d’armes.Cependant, ô délire ! on poursuit sans alarmes,Et dans nos murs enfin, par un zèle insensé,L’auteur de leur ruine en triomphe est placé.C’est peu : pour mieux encore assurer sa victoire,Cassandre, qu’Apollon nous défendoit de croire,Rend des oracles vains que l’on écoute pas ;Et nous, nous malheureux qu’attendoit le trémas,Nous rendions grâce aux dieux ; et notre aveugle joieFaisoit fumer l’encens dans les temples de Troie.
L’Olympe cependant, dans son immense tour,A ramené la nuit triomphante du jour ;Déjà, du fond des mers jetant ses vapeurs sombresAvec ses noirs habits et ses muettes ombres,Elle embrasse le monde ; et ses lugubres mainsD’un grand voile ont couvert les travaux des humains,Et la terre, et le ciel, et les Grecs, et leur trame.Un silence profond règne au loin dans Pergame :Tout dort. De Ténédos leurs nefs partent sans bruit,La lune en leur faveur laisse régner la nuit ;L’onde nous les ramène, et la torche fataleA fait briller ses feux sur la poupe royale.A cet aspect, Sinon, que le ciel en courroux,Qu’une folle pitié protégea contre nous,Aux Grecs impatients ouvre enfin la barrière.Dans l’ombre de la nuit la machine guerrièreRend cet affreux dépôt ; et de son vaste seinS’échappe avec transport un formidable essaim.Déjà, de leur prison empressés de descendre,Glissent le long d’un câble Ulysse avec Thessandre,Ils sont bientôt suivis de Pyrrhus, de Thoas,Du savant Machaon, du bouillant Acamas,De Sthénélus, d’Atride, et d’Epéus lui-même,Epéus, l’inventeur de l’affreux stratagème.Ils s’emparent de Troie ; et, les vapeurs du vinEt la paix du sommeil secondant leur dessein,Ils massacrent la garde, ouvrent toutes les portes,Et la mort dans nos murs entre avec leurs cohortes.(Énéide de , trad. de M. .)
D. Quels furent les principaux chefs de l’armée grecque ?
R. Ce furent Agamemnon et Ménélas, qu’on appeloit les Atrides ; Achille ; Patrocle, son ami ; Pyrrhus, son fils ; les deux Ajax ; Diomède ; Philoctète ; Ulysse, Nestor ; Calchas, très-habile devin ; Epéus, excellent ingénieur qui fabriqua le fameux cheval de bois ; Machaon et Podalire, célèbres médecins, fils d’Esculape ; etc.
D. Quels furent les chefs des Troyens ?
R. Priam ; Hector ; Pâris ; Memnon, fils de Tithon et de l’Aurore ; Penthésilée, reine des Amazones ; Rhésus, roi de Thrace ; Sarpédon, fils de Jupiter ; Enée ; Laocoon ; etc.
Nous allons faire connoître plus particulièrement les principaux d’entre les Grecs ; nous parlerons ensuite des principaux Troyens.
Personnages célèbres de l’armée grecque. §
Agamemnon, Ménélas. §

D. De qui les deux frères Agamemnon et Ménélas étoient-ils fils ?
R. Ces deux princes avoient pour père Plisthène, un des fils de Pélops. Plisthène, en mourant, recommanda ses deux fils encore jeunes à son frère Atrée, qui les fit élever comme ses propres enfants. C’est ce qui leur fit donner le nom d’Atrides.
Agamemnon fut chassé du trône d’Argos et de Mycènes par Thyeste, son oncle, et obligé de se retirer à Sparte, ou régnoit Tyndare. Le roi de Sparte avoit marié sa fille Clytemnestre à Tantale, fils de Thyeste. Mécontent de cette alliance, il offrit à Agamemnon de l’aider à recouvrer son royaume sur Thyeste, et à enlever sa fille à Tantale, à condition de l’épouser lui-même. Le prince accepta l’offre, et, avec le secours de Tyndare, reprit ses états sur Thyeste, tua Tantale, et épousa Clytemnestre dont il eut deux filles, Iphigénie et Electre, et un fils nommé Oreste.
D. Quelle princesse Ménélas prit-il pour épouse ?
R. Il épousa la belle Hélène, sœur de Clytemnestre, et succéda à son beau-père Tyndare, dans le royaume de Sparte. Lorsqu’Hélène eut été enlevée par Pâris, Ménélas, outré de cet affront, arma toute la Grèce pour venger son injure. Après la prise de Troie, les Grecs remirent Hélène entre les mains de Ménélas, et le laissèrent maître de la destinée de cette épouse infidelle. Ménélas étoit décidé à l’immoler à son ressentiment et aux manes de ceux qui avoient péri dans la guerre de Troie. Mais il se laissa fléchir par le repentir de sa femme ; il se réconcilia de bonne foi avec elle, et la ramena à Sparte.
D. Quel chef élurent les rois Grecs, ligués contre la ville de Troie ?
R. Ils mirent à leur tête Agamemnon. La flotte combinée se rassembla dans l’Elide, où elle fut long-temps retenue par des vents contraires. Le devin Calchas déclara que Diane, irritée contre le roi d’Argos de ce qu’il avoit tué une biche qui lui étoit consacrée, refusoit aux Grecs un vent favorable, et que la déesse ne pouvoit être apaisée que par le sang d’une princesse de la famille d’Agamemnon. Le roi hésita long-temps, et accorda enfin sa fille aux sollicitations des princes confédérés. Ulysse s’offrit pour l’aller retirer, sous quelque prétexte spécieux, d’entre les bras de sa mère. On disposa tout pour le sacrifice ; mais Diane, apaisée par cette soumission, mit à la place d’Iphigénie une biche qui lui fut immolée, et transporta cette princesse dans la Tauride, pour en faire sa prêtresse.
Dans la tragédie d’Iphigénie en Aulide, par
, Agamemnon attend sa fille à l’autel pour l’immoler aux dieux. Mais, comme elle tarde trop long-temps à paroître, il vient lui-même la demander. Il la trouve avec sa mère, qui l’avoit retenue auprès d’elle. Ne croyant point que Clytemnestre et sa fille soient instruites du sacrifice qui se prépare, il presse Iphigénie de se rendre à l’autel, sous prétexte de l’unir à Achille. Mais il ne peut se méprendre aux larmes que laissent échapper les princesses.
« Arcas, s’écrie-t-il, Arcas, tu m’as trahi. »
Iphigénie, à Agamemnon.
…………………………………… Mon père,Cessez de vous troubler, vous n’êtes point trahi :Quand vous commanderez, vous serez obéi.Ma vie est votre bien ; vous voulez le reprendre ;Vos ordres, sans détours, pouvoient se faire entendre ;D’un œil aussi content, d’un cœur aussi soumis,Que j’acceptais l’époux que vous m’aviez promis,Je saurai, s’il le faut, victime obéissanteTendre au fer de Calchas une tête innocente ;Et, respectant le coup par vous-même ordonné,Vous rendre tout le sang que vous m’avez donné.Si pourtant ce respect, si cette obéissance,Paroît digne à vos yeux d’une autre récompense ;Si d’une mère en pleurs vous plaignez les ennuis,J’ose vous dire ici, qu’en l’état ou je suis,Peut-être assez d’honneurs environnoient ma vie,Pour ne pas souhaiter qu’elle me fût ravie,Ni qu’en me l’arrachant, un sévère destin,Si près de ma naissance, en eût marqué la fin.Fille d’Agamemnon, c’est moi qui, la première,Seigneur, vous appelai de ce doux nom de père ;C’est moi qui, si long-temps le plaisir de vos yeux,Vous ai fait de ce nom remercier les dieux,Et pour qui, tant de fois prodiguant les caresses,Vous n’avez point du sang dédaigné les foiblesses.Hélas ! avec plaisir je me faisois conterTouts les noms des pays que vous allez dompter.Et, déjà d’llion présageant la conquête,D’un triomphe si beau je préparois la fête.Je ne m’attendois pas que, pour le commencer,Mon sang fût le premier que vous dussiez verser ;Non que la peur du coup dont je suis menacée,Me fasse rappeler votre honte passée ;Ne craignez rien : mon cœur, de votre honneur jaloux,Ne fera point rougir un père tel que vous ;Et, si je n’avois eu que ma vie à défendre,J’aurois su renfermer un souvenir si tendreMais à mon triste sort, vous le savez, Seigneur,Une mère, un amant, attachoient leur bonheur.Un roi digne de vous a cru voir la journéeQui devoit éclairer notre illustre hyménée.Déjà, sûr de mon cœur à sa flamme promis,Il s’estimoit heureux ; vous me l’aviez permis ;Il sait votre dessein, jugez de ses alarmes.Ma mère est devant vous, et vous voyez ses larmes.Pardonnez aux efforts que je viens de tenter,Pour prévenir les pleurs que je leur vais coûter.Agamemnon.
Ma fille, il est trop vrai ; j’ignore pour quel crimeLa colère des dieux demande une victime.Mais ils vous ont nommée. Un oracle cruelVeut qu’ici votre sang coule sur un autel.Pour défendre vos jours de leurs lois meurtrières,Mon amour n’avoit pas attendu vos prières.Je ne vous dirai point combien j’ai résisté ;Croyez-en cet amour par vous-même attesté.Cette nuit même encore, on a pu vous le dire,J’avois révoqué l’ordre où l’on me fit souscrire ;Sur l’intérêt des Grecs vous l’aviez emporté.Je vous sacrifiois mon rang, ma sûreté.Arcas alloit du camp vous défendre l’entrée.Les dieux n’ont pas voulu qu’il vous ait rencontrée,Ils ont trompé les soins d’un père infortuné,Qui protégeoit en vain ce qu’ils ont condamné,Ne vous assurez point sur ma foible puissance :Quel frein pourroit d’un peuple arrêter la licence.Quand les dieux, nous livrant à son zèle indiscret,L’affranchissent d’un joug qu’il portoit à regret ?Ma fille, il faut céder ; votre heure est arrivée.Songez bien dans quel rang vous êtes élevée.Je vous donne un conseil qu’à peine je reçoi ;Du coup qui vous attend vous mourrez moins que moi.Montrez, en expiant, de qui vous êtes née ;Faites rougir ces dieux qui vous ont condamnée.Allez, et que les Grecs, qui vous vont immoler,Reconnoissent mon sang en le voyant couler.Clytemnestre, à Agamemnon.
Vous ne démentez point une race funeste ;Oui, vous êtes le sang d’Atrée et de Thyeste ;Bourreau de votre fille, il ne vous reste enfinQue d’en faire à sa mère un horrible festin.Barbare ! c’est donc là cet heureux sacrificeQue vos soins préparoient avec tant d’artifice ?Quoi ! l’horreur de souscrire à cet ordre inhumainN’a pas, en le traçant, arrêté votre main ?Pourquoi feindre à nos yeux une fausse tristesse ?Pensez-vous par des pleurs prouver votre tendresse ?Où sont-ils ces combats que vous avez rendus ?Quels flots de sang pour elle, avez-vous répandus ?Quel débris parle ici de votre résistance ?Quel champ, couvert de morts, me condamne au silence ?Voilà par quels témoins il falloit me prouver,Cruel, que votre amour a voulu la sauver.Un oracle fatal ordonne qu’elle expire ;Un oracle dit-il tout ce qu’il semble dire ?Le ciel, le juste ciel, par le meurtre honoré,Du sang de l’innocence est-il donc altéré ?Si du crime d’Hélène on punit sa famille,Faites chercher à Sparte Hermione sa fille ;Laissez à Ménélas racheter d’un tel prixSa coupable moitié dont il est trop épris.Mais vous, quelles fureurs vous rendent sa victime ?Pourquoi vous imposer la peine de son crime ?Pourquoi moi-même, enfin, me déchirant le flanc,Payer sa folle amour du plus pur de mon sang ?Que dis-je ? Cet objet de tant de jalousie,Cette Hélène, qui trouble et l’Europe et l’Asie,Vous semble-t-elle un prix digne de vos exploits ?Combien nos fronts, pour elle, ont-ils rougi de fois ?Avant qu’un nœud fatal l’unît à votre frère,Thésée avoit osé l’enlever à son père ;Vous savez, et Calchas mille fois vous l’a dit,Qu’un hymen clandestin mit ce prince en son lit ;Et qu’il en eut pour gage une jeune princesseQue sa mère a cachée au reste de la Grèce.Mais non, l’amour d’un frère, et son honneur blesséSont les moindres des soins dont vous êtes pressé.Cette soif de régner, que rien ne peut éteindre,L’orgueil de voir vingt rois vous servir et vous craindre.Touts les droits de l’empire en vos mains confiée,Cruel ! c’est à ces dieux que vous sacrifiez ;Et, loin de repousser le coup qu’on vous prépare,Vous voulez vous en faire un mérite barbare :Trop jaloux d’un pouvoir qu’on peut vous envier,De votre propre sang vous courez le payer,Et voulez, par ce prix, épouvanter l’audaceDe quiconque vous peut disputer votre place !…Est-ce donc être père ? Ah ! toute ma raisonCède à la cruauté de cette trahison.Un prêtre, environné d’une foule cruelle,Portera sur ma fille une main criminelle !Déchirera son sein, et d’un œil curieux,Dans son cœur palpitant consultera les dieux !Et moi, qui l’amenai, triomphante, adorée,Je m’en retournerai seule et désespérée !Je verrai les chemins encor tout parfumésDes fleurs dont sous ses pas on les avoit semés !Non, je ne l’aurai point amenée au supplice ;Ou vous ferez aux Grecs un double sacrifice.Ni crainte, ni respect ne peut m’en détacher,De mes bras tout sanglants il faudra l’arracher.Aussi barbare époux qu’impitoyable père,Venez, si vous l’osez, la ravir à sa mère.
D. Par quels exploits les Atrides se signalèrent-ils devant Troie ?
R. Agamemnon ne montra, dans le camp des Grecs, qu’une ame également orgueilleuse et foible. Sa querelle scandaleuse et bruyante avec Achille retarda la chute de Troie. Ménélas déploya un brillant courage. Il se battit en combat singulier contre Pâris, et le vainquit. Le ravisseur d’Hélène alloit périr, lorsque Vénus, sa protectrice, l’enveloppa d’un nuage, et le déroba à la vengeance de Ménélas. Pâris, rentré dans Troie, reçut des reproches de tout le monde sur sa lâcheté, et n’échappa même pas aux railleries d’Hélène, son épouse.
D. Comment mourut Agamemnon ?
R. Agamemnon, de retour à Mycènes, après la prise de Troie, tomba sous le fer de Clytemnestre sa femme, et d’Egysthe, qui en étoit l’amant.
… Agamemnon, vainqueur de tant de rois,Revenoit triomphant jouir de ses exploits.Egysthe, en son absence ayant séduit la reine,De ses amours furtifs appréhendant la peine,Au sein de ce grand roi, digne d’un sort plus beau,Inspira Clytemnestre à porter le couteau,Prétextant, pour couvrir sa lâche perfidie,Qu’elle vengeoit sur lui le sang d’Iphigénie.( .)
D. Quel fut le sort de la famille d’Agamemnon ?
R. La sensible Electre, sa fille, ne cessa de pleurer la mort de son père. Elle sauva son frère Oreste de la fureur d’Egysthe qui vouloit le faire périr. Oreste vengea la mort de son père Agamemnon, en tuant Egysthe, et même Clytemnestre, sa propre mère. Depuis ce parricide, il fut tourmenté par les Furies qui lui représentoient continuellement l’horreur de son crime.
Oreste, à Palamède.
……………………………… Laisse-moi.Je ne veux rien, cruel, d’Électre, ni de toi !Votre cœur affamé de sang et de victimes,M’a fait souiller ma main du plus affreux des crimes.Mais quoi ! quelle vapeur vient obscurcir les airs ?Grâce au ciel, on m’entr’ouvre un chemin aux enfers !Descendons, les enfers n’ont rien qui m’épouvante ;Suivons le noir sentier que le sort me présente ;Cachons-nous dans l’horreur de l’éternelle nuit.Quelle triste clarté dans ce moment me luit ?Qui ramène le jour dans ces retraites sombres ?Que vois-je ? mon aspect épouvante les ombres !Que de gémissements ! que de cris douloureux !« Oreste !… » Qui m’appelle en ce séjour affreux !Egysthe ! ah ! c’en est trop, il faut qu’à ma colère…Que vois-je ! dans ses mains la tête de ma mère !Quels regards ! où fuirai-je ? ah ! monstre furieux,Quel spectacle oses-tu présenter à mes yeux ?Je ne souffre que trop ; monstre cruel, arrête !A mes yeux effrayés dérobe cette tête.Oh ! ma mère ! épargnez votre malheureux fils.Ombre d’Agamemnon, sois sensible à mes cris ;J’implore ton secours, chère ombre de mon père ;Viens défendre ton fils des fureurs de sa mère ;Prends pitié de l’état où tu me vois réduitQuoi ! jusque dans tes bras la barbare me suit !C’en est fait ; je succombe à cet affreux supplice :Du crime de ma main mon cœur n’est point complice ;J’éprouve cependant des tourments infinis.Dieux ! les plus criminels seroient-ils plus punis ?( .)
D. Que fit Oreste pour être délivré de la poursuite des Furies ?
R. Il consulta l’oracle d’Apollon, qui lui répondit qu’il devoit aller en Tauride enlever la statue de Diane, et délivrer sa sœur Iphigénie. Pylade, fils de Strophius, roi de Phocide, lié d’une étroite amitié avec Oreste, voulut accompagner ce prince dans son voyage. Mais, ayant été surpris touts deux, ils furent chargés de chaînes pour être immolés à Diane. Thoas, roi de la Tauride, consentit à sauver l’un des deux étrangers. Ce fut alors qu’il s’éleva une dispute célèbre entre Oreste et Pylade : l’un vouloit mourir pour l’autre. Le sort tomba sur Oreste ; mais, au moment qu’Iphigénie alloit le frapper, elle le reconnut pour son frère. Oreste et Pylade tuèrent Thoas, pour le punir de ses cruautés, enlevèrent la statue de Diane, et revinrent dans la Grèce avec Iphigénie. Oreste donna sa sœur Électre en mariage à Pylade ; ensuite il épousa Hermione, fille de son oncle Ménélas, et joignit au royaume de Mycènes celui de Sparte.
Achille.

D. De qui naquit Achille ?
R : Achille étoit fils de Thétis et de Pelée. Il fut élevé par le centaure Chiron qui ne le nourrit que de moëlle de lion. Sa mère le plongea dans le Styx, pour le rendre invulnérable. Mais le talon par où elle le tenoit, ne reçut point la même vertu que les autres parties de son corps. Thétis, instruite par les oracles, que Troie ne pouvoit être prise sans le secours de son fis, et que le jeune héros périroit sous les murs de cette ville, l’envoya en habits de fille, et sous le nom de Pyrrha, à la cour de Lycomède, roi de Scyros. Achille se fit aimer de Déidamie, fille de Lycomède, et en eut un fils nommé Pyrrhus.
D. Comment Achille fut-il amené au siége de Troie ?
R. Ulysse, déguisé en marchand, se rendit à la cour de Lycomède. Il avoit mêlé des armes parmi les bijous qu’il devoit présenter aux dames. Achille se saisit des armes, et se trahit ainsi lui-même. Il suivit Ulysse avec joie, et Thétis fut contrainte de le laisser partir. Mais elle lui fit faire auparavant des armes d’une excellente trempe par Vulcain.
D. Racontez-nous la querelle d’Agamemnon et d’Achille devant Troie.
R. Achille, dans le sac de Lyrnesse, avoit pris Chryséis, fille de Chrysès, grand-prêtre d’Apollon. Cette jeune captive échut en partage à Agamemnon. Chrysès, revêtu de ses ornements sacerdotaux, vint redemander sa fille, qui lui fut refusée. Apollon, à la prière de son grand-prêtre, désola le camp des Grecs par la peste. Calchas déclara que la contagion ne cesseroit que quand Chryséis auroit été rendue à son père. Achille pressa vivement Agamemnon de délivrer les Grecs du terrible fléau qui depeuploit leur camp. Le roi de Mycènes ne rendit Chryséis que malgré lui, et, pour se venger d’Achille qui l’obligeoit à faire ce sacrifice, il fit enlever à ce prince la jeune Briséis, qu’Achille aimoit passionnément. Le fils de Thétis, outré de l’affront qu’il recevoit, jura de ne plus combattre pour la cause commune. En effet, il se retira dans sa tente, et pendant près d’une année il ne prit plus aucune part à la guerre.
D. Quel événement décida Achille à reprendre les armes contre les Troyens ?
R. Patrocle, lié d’une étroite amitié avec Achille, ne put voir tranquillement les Troyens remporter des avantages continuels sur les Grécs. Il demanda à son ami de lui prêter du mains ses armes, et de lui permettre de conduire les Thessaliens contre les Troyens. Achille y consentit. Patrocle prit donc les armes du fils de Thétis, et réimporta de grands avantages sur les assiégés. Mais Hector s’avança pour le combattre, et lui donna la mort. Achille, pour venger son ami, retourna au combat, défit Hector, et le tua. Pour assouvir sa colère, il lia son ennemi par les talons à son char, et le traîna trois fois autour des murs de Troie. Priam vint redemander le corps de son fils à son vainqueur, pour lui rendre les honneurs de la sépulture. Achille se laissa fléchir par les larmes dès ce malheureux père, et lui rendit le cadavre d’Hector.
Priam aux pieds d’Achille.
L’horizon se couvroit des ombres de la nuit,L’infortuné vieillard qu’un dieu même a conduit,Entre et paroît soudain dans la tente d’Achille.Le meurtrier d’Hector, en ce moment, tranquille,Par un léger repas suspendoit ses douleurs.Il se détourne, il voit, les yeux baignés de pleurs,Ce roi jadis heureux, ce vieillard vénérable,Que le fardeau des ans, que la douleur accable,Exhalant à ses pieds ses sanglots et ses cris,Et lui baisant la main qui fit périr son fils.Il n’osoit sur Achille encor jeter la vue ;Il vouloit lui parler, et sa voix s’est perdue.Enfin, il le regarde, et parmi les sanglots,Tremblant, pâle et sans force, il prononce ces mots ;« Songez, Seigneur, songez que vous avez un père… »Il ne put achever. Le héros sanguinaireSentit que la pitié pénétroit dans son cœur.Priam lui prend les mains : « Ah ! Prince, ah ! mon vainqueur !» J’étois père d’Hector, et ses généreux frères» Flattoient mes derniers jours et les rendoient prospères.» Ils ne sont plus : Hector est tombé sous vos coups…» Puisse l’heureux Pélée entre Thétis et vous» Prolonger de ses ans l’éclatante carrière !» Le seul nom de son fils remplit la terre entière ;» Ce nom fait son bonheur autant que son appui ;» Vos honneurs sont les siens, vos lauriers sont à lui.» Hélas ! tout mon bonheur et toute mon attente» Est de voir de mon fils la dépouille sanglante,» De racheter de vous ces restes mutilés,» Traînés devant mes yeux sous nos murs désolés ;» Voilà le seul espoir, le seul bien qui me reste.» Achille, accordez-moi cette grâce funeste,» Et laissez-moi jouir de ce spectacle affreux ! »Le héros, qu’attendrit ce discours douloureux,Aux larmes de Priam répondit par des larmes.« Touts nos jours sont tissus de regrets et d’alarmes,» Lui dit-il ; par mes mains les dieux vous ont frappé :» Dans le malheur commun moi-même enveloppé,» Mourant avant le temps, loin des yeux de mon père,» Je teindrai de mon sang cette terre étrangère.» J’ai vu tomber Patrocle ; Hector me l’a ravi :» Vous perdez votre fils, et je perds un ami. »( .)
D. Comment mourut Achille ?
R. Achille, pendant une trêve, avoit vu Polyxène, fille de Priam, et en étoit devenu amoureux. Il la fit demander en mariage, et elle lui fut accordée. On choisit pour le lieu de la cérémonie un temple d’Apollon, qui étoit entre la ville de Troie et le camp des Grecs. A peine étoit-on assemblé, que le lâche Pâris lança une flèche empoisonnée dans le talon d’Achille. Le héros mourut sur le champ. Apollon, dit-on, avoit dirigé la flèche. Polyxène fut inconsolable d’avoir été la cause innocente de la mort d’un guerrier qu’elle aimoit. Après la prise de Troie, les Grecs immolèrent cette princesse sur le tombeau d’Achille.
Pyrrhus. §
D. Faites-nous connoître les principaux faits de Pyrrhus.
R. Pyrrhus, fils d’Achille et de Déidamie, fut élevé à la cour du roi Lycomède. Après la mort d’Achille, les Grecs, qui avoient appris de l’oracle, que Troie ne pouvoit être prise, si les assiégeants n’avoient avec eux un descendant d’Éaque, envoyèrent à Scyros chercher Pyrrhus qui n’avoit alors que dix-huit ans. A peine fut-il arrivé devant Troie, qu’on le chargea d’aller à Lemnos pour engager Philoctète à venir au camp des Grecs avec les flèches d’Hercule. Ce fut Pyrrhus qui tua le malheureux Priam, qui précipita le jeune Astyanax, fils d’Hector, du haut d’une tour, et qui demanda Polyxène pour l’immoler aux manes d’Achille.
D. Quelle princesse échut à Pyrrhus, dans le partage des esclaves troyens ?
R. Ce fut Andromaque, veuve d’Hector. Pyrrhus l’aima jusqu’à la préférer à son épouse Hermione, fille de Ménélas et d’Hélène. Cet amour fut cause de la mort de Pyrrhus. Car ce prince étant allé à Delphes, pour offrir un sacrifice à Apollon, fut tué dans le temple même par Oreste. Hermione, transportée de jalousie, avoit excité à ce meurtre Oreste dont elle avoit été aimée autrefois, et auquel il avoit promis de l’épouser, s’il vouloit la venger.
Scène entre Oreste et Hermione,
(Dans la tragédie d’Andromaque, par .)Oreste.
Madame, c’en est fait, et vous êtes servie :Pyrrhus rend à l’autel son infidelle vie.Hermione.
Il est mort !Oreste.
Il expire ; et nos Grecs irritésOnt lavé dans son sang ses infidélités.Je vous l’avois promis ; et, quoique mon courageSe fît de ce complot une funeste image,J’ai couru vers le temple, où nos Grecs dispersésSe sont jusqu’à l’autel dans la foule glissés.Pyrrhus m’a reconnu, mais sans changer de face :Il sembloit que ma vue excitât son audace ;Que touts les Grecs, bravés en leur ambassadeur,Dussent de son hymen relever la splendeur.Enfin, avec transport prenant son diadème,Sur le front d’Andromaque il l’a posé lui-même :« Je vous donne, a-t-il dit, ma couronne et ma foi ;» Andromaque, régnez sur l’Épire et sur moi.» Je voue à votre fils une amitié de père, ;» J’en atteste les dieux, je le jure à sa mère ;» Pour touts mes ennemis je déclare les siens,» Et je le reconnois pour le roi des Troyens. »A ces mots, qui du peuple attiroient le suffrage,Nos Grecs n’ont répondu que par un cri de rage ;L’infidelle s’est vu par-tout envelopper,Et je n’ai pu trouver de place pour frapper :Chacun se disputoit la gloire de l’abattre.Je l’ai vu dans leurs mains quelque temps se débattre,Tout sanglant à leurs coups vouloir se dérober ;Mais enfin à l’autel il est allé tomber.Du peuple épouvanté j’ai traversé la pressePour venir de ces lieux enlever ma princesse,Et regagner le port, où bientôt nos amisViendront couverts du sang que je vous ai promis.Hermione.
Qu’ont-ils fait !…Oreste.
Pardonnez à leur impatience ;Ils ont, je le vois bien, trahi votre vengeance ;Vous vouliez que ma main portât les premiers coups ;Qu’il sentît en mourant qu’il expiroit par vous.Mais c’est moi dont l’ardeur leur asservi d’exemple ;Je les ai pour vous seule entraînés dans le temple.Madame ; et vous pouvez justement vous flatterD’une mort que leurs bras n’ont fait qu’exécuter.Vous seule avez poussé les coups…Hermione.
Tais-toi, perfide.Et n’impute qu’à toi ton lâche parricide,Va faire chez les Grecs admirer ta fureur,Va ; je la désavoue, et tu me fais horreur.Barbare, qu’as-tu fait ? avec quelle furieAs-tu tranché le coup d’une si belle vie ?Avez-vous pu, cruels, l’immoler aujourd’hui,Sans que tout votre sang se soulevât pour lui ?Mais parle : de son sort qui t’a rendu l’arbitre ?Pourquoi l’assassiner ? qu’a-t’il fait ? à quel titre ?Qui te l’a dit ?Oreste.
Oh dieux ! quoi ! ne m’avez-vous pasVous-même, ici, tantôt, ordonné son trépas ?Hermione.
Ah ! falloit-il en croire une amante insensée ?Ne devois-tu pas lire au fond de ma pensée ?Et ne voyois-tu pas, dans mes emportements,Que mon cœur démentoit ma bouche à touts moments ?Quand je l’aurois voulu, falloit-il y souscrire ?N’as-tu pas dû cent fois te le faire redire ?Toi-même ayant le coup me venir consulter ?Y revenir encore… ou plutôt m’éviter ?Que ne me laissois-tu le soin de ma vengeance ?Qui l’amène en des lieux où l’on fuit ta présence ?Voilà de ton amour le détestable fruit :Tu m’apportois, cruel, le malheur qui te suit.C’est toi dont l’ambassade, à touts les deux fatales,L’a fait pour son malheur pencher vers ma rivale,Nous le verrions encor nous partager ses soins :Il m’aimeroit peut-être ; il le feindroit du moins.Adieu. Tu peux partir : je demeure en Épire ;Je renonce à la Grèce, à Sparte, à son empire,A toute ma famille ; et c’est assez pour moi,Traître, qu’elle ait produit un monstre tel que toi.
D. Dites encore comment décrit les fureurs d’Oreste, après l’assassinat de Pyrrhus.
R. Oreste s’exprime ainsi :
Grâce aux dieux, mon malheur passe mon espérance !Oui, je te loue, ô ciel ! de ta persévérance :Appliqué sans relâche au soin de me punir,Au comble des douleurs tu m’as fait parvenir :Ta haine a pris plaisir à former ma misère ;J’étois né pour servir d’exemple à ta colère,Pour être du malheur un modèle accompli :Hé bien ! je meurs content, et mon sort est rempli.Où sont ces deux amants ? pour couronner ma joie,Dans leur sang, dans le mien, il faut que je me noie ;L’un et l’autre en mourant je les veux regarder :Réunissons trois cœurs qui n ’ont pu s’accorder…Mais quelle épaisse nuit tout à coup m’environne !De quel côté sortir ? d’où vient que je frisonne ?Quelle horreur me saisit ? grâce au ciel, j’entrevoi…Dieux ! quels ruisseaux de sang coulent autour de moi !……… Quoi ! Pyrrhus, je te rencontre encore !Trouverai-je par-tout un rival que j’abhorre ?Percé de tant de coups, comment t’es-tu sauvé ?Tiens, tiens, voilà le coup que je t’ai réservé.Mais que vois-je ? à mes yeux Hermione l’embrasser !Elle vient l’arracher au coup qui le menace !Dieux ! quels affreux regards elle jette sur moi !Quels démons ; quels serpents traîne-t-elle après soi !Hé bien ! Filles d’enfer, vos mains sont-elles prêtes ?Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?A qui destinez-vous l’appareil qui vous suit ?Venez-vous m’enlever dans l’éternelle nuit ?Venez ; à vos fureurs Oreste s’abandonne…Mais non, retirez-vous, laissez faire Hermione.L’ingrate mieux que vous saura me déchirer ;Et je lui porte enfin mon cœur à dévorer.
Philoctète. §
D. Racontez les exploits et les malheurs de Philoctete.
R. Philoctète fut l’ami, le compagnon et presque le rival d’Hercule. Alcide, en mourant, lui ordonna d’enfermer dans sa tombe son arc et ses flèches, et lui fit jurer de ne jamais découvrir sa sépulture. Les Grecs, instruits par l’oracle, qu’ils ne pouvoient se rendre maîtres de Troie, s’ils n’avoient en leur possession les flèches d’Hercule, envoyèrent des députés à Philoctète, pour apprendre en quel lieu elles étoient cachées. Philoctète, qui ne vouloit ni violer son serment, ni priver les Grecs de l’avantage que devoient leur procurer ces flèches, frappa du pied à l’endroit qui les recéloit. Le ciel punit cruellement son parjure. Pendant qu’il alloit à Troie, une des flèches tomba sur le pied dont il avoit frappé la terre ; il s’y forma un ulcère qui jetoit une odeur infecte et insupportable. Ulysse conseilla aux Grecs d’abandonner Philoctete pendant son sommeil. Ils le laissèrent dans l’île de Lemnos, où il souffrit pendant dix ans les douleurs les plus horribles.
D. Comment Philoctète fut-il tiré de l’île de Lemnos ?
R. Après la mort d’Achille, les Grecs, voyant qu’ils ne pouvoient s’emparer de la ville, sans les flèches que Philoctète avoit gardées avec lui à Lemnos, chargèrent Pyrrhus d’aller trouver ce héros, et de l’amener devant Troie. Il étoit question de surprendre Philoctète justement irrité contre les Grecs, et de le déterminer à s’embarquer, sous prétexte de retourner en Grèce, tandis qu’on le conduiroit sur la côte d’Asie. Pyrrhus feignit d’être mécontent des Grecs, qui lui avoient refusé les armes d’Achille son père ; il dit qu’il s’en retournoit à Scyros. Philoctète le conjure de l’emmener avec lui, et déjà il a confié au jeune prince ses armes et ses flèches pour les porter au vaisseau. Le fils d’Achille sent un remords secret de tromper un malheureux : son cœur n’est point fait aux artifices : il soupire : il avoue son projet à Philoctète, lui rend ses armes, et le laisse libre. Ulysse, quoique ennemi mortel de Philoctète, se chargea de l’aller chercher, et de le ramener ; ce qu’il exécuta en effet. Philoctète, arrivé au camp, blessa Pâris d’une de ses flèches, et lui donna la mort. Bientôt Ilion fut réduit en cendres. Machaon et Podalire, fils d’Esculape, guérirent Philoctète de sa blessure.
D. Récitez les beaux vers de sur les malheurs de Philoctète.
R. Philoctète raconte ainsi à Pyrrhus comment les Grecs l’ont abandonné, et quels maux il a soufferts23.
Nous touchons à Lemnos : accablé du voyageLe sommeil me surprend sous un antre sauvage.On saisit cet instant, on m’abandonne, on part ;On part, en me laissant, par un reste d’égard,Quelques vases grossiers quelque vile pâture,Des voiles déchirés pour sécher ma blessure,Quelques lambeaux, rebut du dernier des humains ;Puisse Atride éprouver de semblables destins !Quel réveil ! quel moment de surprise et d’alarmes !Que d’imprécations ! que de cris et de larmes !Lorsqu’en ouvrant les yeux, je vis fuir mes vaisseauxQue loin de moi les vents emportoient sur les eaux !Lorsque je me vis seul sur cette plage aride,Sans appui dans mes maux, sans compagnons, sans guide !Jetant de tout côté des regards de douleur,Je ne vis qu’un désert, hélas ! et le malheur,Tout ce qu’on m’a laissé, le désespoir, la rage !Le temps accrut ainsi mes maux et mon outrage.J’appris à soutenir mes misérables jours.Mon arc, entre mes mains, seul et dernier recours,Servit à me nourrir ; et, lorsqu’un trait rapideFaisoit du haut des airs tomber l’oiseau timide,Souvent il me falloit, pour aller le chercher,D’un pied foible et souffrant, gravir sur le rocher,Me traîner en rampant vers ma chétive proie ;Il falloit employer cette pénible voiePour briser des rameaux, et pour y recueillirLe feu que des cailloux mes mains faisoient jaillir.Des glaçons dont l’hiver blanchissoit ce rivage,J’exprimois avec peine un douloureux breuvage.Enfin cette caverne et mon arc destructeur,Et le feu, de la vie heureux conservateur,Ont soulagé du moins les besoins que j’endure ;Mais rien n’a pu guérir ma funeste blessure ;Nul commerce, nul port aux voyageurs ouvert,N’attire les vaisseaux dans ce triste désert.On ne vient à Lemnos que poussé par l’orage ;Et depuis si long-temps errant sur cette plage,Si j’ai vu des rochers, malgré touts leurs efforts ;Pour obéir aux vents, descendre sur les bords,Je n’en obtenois rien qu’une pitié stérile,Des consolations le langage inutile,Des secours passagers, ou de vieux vêtements ;Mais, malgré ma prière et mes gémissements,Nul n’a sur ses vaisseaux accueilli ma misère,Ni voulu sur les flots me conduire à mon père.Depuis dix ans, mon fils, je languis dans ces lieux,Sans cesse dévoré d’un mal contagieux,Victime d’une lâche et noire ingratitude,Souffrant dans l’abandon et dans la solitude.Les Atrides, Ulysse, ainsi m’ont attachéA ce supplice lent que leur haine a cherché ;Ils m’ont surpris ainsi dans les piéges qu’ils tendent ;Ils m’ont fait touts ces maux : que les dieux les leur rendent !
Ulysse. §
D. Qui étoit Ulysse ?
R. Ulysse, fils de Laërte et d’Anticlée, étoit roi de deux petites îles de la mer Ionienne, dont l’une se nommoit Ithaque, et l’autre Dulichium. Le mot grec Ulysse veut dire, qui est craint de tout le monde. Ce prince étoit éloquent, rusé, artificieux. Il contribua bien autant par son esprit à la prise de Troie, que les autres généraux grecs par leur courage. L’amour qu’il avoit pour sa jeune épouse, la belle Pénélope, lui fit chercher plusieurs moyens pour ne point accompagner les princes grecs dans leur expédition. Il imagina de contrefaire l’insensé. Il attela à une charrue deux bêtes de différente espèce ; il traça des sillons sur le bord de la mer, et il y sema du sel au lieu de blé. Mais Palamède, qui soupçonna sa feinte, mit le petit Télémaque sur la ligne du sillon. Ulysse, pour ne point blesser son fils, détourna la charrue, et fit voir par là que sa folie n’étoit que simulée.
D. Quels services Ulysse rendit-il aux princes grecs ?
R. Il découvrit, à son tour, Achille qui étoit déguisé en fille dans l’île de Scyros. C’est lui qui enleva le palladium avec Diomède, qui tua Rhésus, et emmena ses chevaux au camp ; qui détruisit le tombeau de Laomédon ; qui força Philoctète, quoique son ennemi, à le suivre au siége de Troie, avec les flèches d’Hercule. A la mort d’Achille, les armes de ce héros furent adjugées à Ulysse, malgré les prétentions d’Ajax. Après la prise de la ville, il erra pendant dix ans, avant que de pouvoir rentrer dans son royaume.
D. Racontez les principales aventures d’Ulysse.
R. Une tempête le jeta d’abord sur les côtes de la Thrace, où régnoit Polymnestor. C’étoit à la foi de ce prince que Priam avoit confié son fils Polydore, pour le dérober à la fureur des Grecs. Lorsque la fortune eut trahi les affaires des Troyens, Polymnestor fit périr Polydore, afin de rester paisible possesseur des trésors que Priam lui avoit livrés pour les rendre à son fils. Hécube, qui étoit échue en partage à Ulysse, fut instruite de la perfidie du roi de Thrace. Voulant venger la mort de Polydore, elle feignit d’avoir encore un autre trésor à confier à Polymnestor. Ayant attiré le prince dans un lieu écarté, elle lui sauta au visage, et lui arracha les yeux :
L’infortuné Priam, dans ses tendres alarmes,Pour son malheureux fils craignant le sort des armes,L’avoit au roi de Thrace, infidelle allié,Avec de grands trésors en secret envoyé,Pour conserver ses jours et former sa jeunesse.Le lâche, tant qu’Hector humilia la Grèce,Respecta cet enfant, ses malheurs et son nom ;Mais dès que le destin servit Agamemnon,L’intérêt dans son cœur faisant taire la gloire,Oublia l’amitié pour suivre la victoire.Le cruel (que ne peut l’ardente soif de l’or !)Égorge Polydore, et saisit son trésor ;Et la terre cacha sa victime sanglante.( , trad. de M. .)
D. Que fit Ulysse, après son premier naufrage ?
R. Il se remit en mer, et fut porté par les vents au rivage des Lotophages, en Afrique. Ces peuples sont ainsi appelés de l’arbre lotos qui croît dans leur pays, et dont le fruit est si agréable, qu’il fait oublier aux étrangers leur propre patrie, ce qui fut cause qu’Ulysse y perdit quelques-uns de ses compagnons ; mais les autres, reprenant leur navigation, passèrent avec lui en Sicile, où de nouveaux dangers les attendoient.
D. Quels dangers courut Ulysse dans l’île de Sicile ?
R. Il y tomba entre les mains de Polyphème, fils de Neptune, le plus grand et le plus fort des Cyclopes. Le monstre enferma Ulysse avec touts ses compagnons dans son antre, pour les dévorer. Mais Ulysse le fit tant boire, en l’amusant par le récit du siége de Troie, qu’il l’enivra. Puis, aidé de ses compagnons, il lui creva l’œil avec un pieu. Le Cyclope, se sentant blessé, poussa des hurlements effroyables ; touts ses voisins accoururent pour savoir ce qui lui étoit arrivé. Ils lui demandèrent qui l’avoit blessé : Personne, leur répondit-il, en rugissant. (Ulysse lui avoit dit qu’il s’appeloit Personne.) Les voisins, persuadés que, dans son délire, il s’étoit aveuglé lui-même, se retirèrent pour éviter sa fureur.
D. Quels moyens prit Ulysse pour sortir de la caverne de Polyphème ?
R. Ulysse et ses compagnons, fuyant adroitement les longs bras étendus du Cyclope, se tenoient cachés parmi ses moutons, qui, comme leur maître, étoient beaucoup plus grands que les autres animaux de leur espèce. Ulysse ayant remarqué que le monstre, en marchant à tâtons, ne portoit la main que sur le dos de ses brebis, attacha sous le ventre de chacune un de ses guerriers, et s’attacha lui-même sous le bélier. Dès le point du jour, Polyphème, placé à l’ouverture de son antre, fit sortir un à un tout son troupeau. Chaque mouton, en passant entre ses jambes et sous ses mains, emporta un soldat grec, et le chef passa le dernier. Polyphème, rentré dans sa caverne, avec la soif du carnage et l’espoir de la vengeance, la trouva déserte, et frémit de fureur, lorsqu’il entendit au loin, dans la plaine, Ulysse et ses compagnons qui couroient vers le rivage. Le monstre, écumant de rage, les poursuivit, et leur lança à tout hasard, un rocher d’une grosseur énorme. Les Grecs l’évitèrent aisément, et s’embarquèrent, après n’avoir perdu que quatre d’entr’eux, que le géant avoit dévorés.
D. Que racontent les poëtes des amours de Polyphème ?
R ; Polyphème, malgré sa férocité, devint amoureux de la nymphe Galatée, éprise elle-même du berger Acis. Polyphème, jaloux de cette préférence, observa les deux amants, et les ayant surpris ensemble, écrasa d’un rocher le jeune Acis, qui fut transformé en fleuve. Galatée se jeta dans la mer, et rejoignit les Néréides ses sœurs. Cette nymphe parle ainsi, dans :
O Vénus ! quelle est donc la puissance invincible ?Ce géant redouté, ce Cyclope terrible,Monstre hideux, l’horreur des monstres des forêts,Que sans trouver la mort nul n’aborda jamais,Cet ennemi des dieux que son orgueil blasphème,Soumis à ton empire, il est sensible, il aime !Consumé de tes feux, de mes charmes épris,Il oublie et son antre, et ses chères brebis.Ce difforme géant, soigneux de sa parure,Peigne avec un râteau sa noire chevelure,Et sa barbe au poil dur tombe sous une faux.Il va se contempler dans le miroir des eaux ;Il cherche à prendre un air moins dur et moins farouche :L’ardente soif du sang n’altère plus sa bouche.Moins affamé de meurtre, il perd sa cruauté :Le nocher dans son île aborde en sûreté.(Trad. de .)
D. Continuez le récit des aventures d’Ulysse. Où alla-t-il, après avoir quitté les côtes de Sicile ?
R. Il fut jeté par les vents dans les états d’Éole. Ce dieu l’accueillit favorablement, et lui fit présent d’outres dans lesquelles il avoit renfermé les vents contraires à sa navigation ; mais les compagnons d’Ulysse, poussés par une funeste curiosité, ouvrirent ces peaux d’où les vents s’échappèrent, et causèrent une tempête furieuse. Ulysse ne se sauva de ce danger que pour retomber dans un autre plus terrible encore. Il fut rejeté sur les côtes de la Sicile, dans une contrée dont les peuples barbares et cruels se nommoient Lestrigons. Ulysse y perdit un grand nombre des siens. Il ne lui resta qu’un vaisseau, avec lequel il se rendit dans l’île d’Œa, chez Circé.
D. Faites connoître Circé.
R. Circé, fille du Soleil, étoit une magicienne si habile, qu’elle faisoit descendre les étoiles du ciel. L’art des empoisonnements lui étoit également connu. Le premier essai qu’elle fit de ses talents fut sur le roi des Sarmates, son mari. Ce crime la rendit si odieuse à ses sujets, qu’ils la forcèrent à prendre la fuite ; le Soleil la transporta dans son char, sur la côte d’Étrurie, nommée depuis le cap de Circé ; et l’île d’Œa devint sa résidence. Ce fut là qu’elle changea en monstre la jeune Scylla, parce qu’elle étoit aimée de Glaucus pour qui Circé avoit conçu une passion violente. Elle changea pareillement Picus, roi d’Italie, en pivert, parce qu’il ne voulut point quitter Canente, son épouse, pour s’attacher à la cruelle enchanteresse.
D. Ulysse sut-il se garantir des charmes de Circé ?
R. Circé fit éprouver la puissance de ses enchantements aux compagnons d’Ulysse, qu’elle changea en pourceaux par la vertu d’une liqueur magique. Mais Minerve donna à Ulysse une herbe qui le préserva des charmes de la magicienne. Circé chercha ensuite à plaire à Ulysse, et le retint pendant un an, auprès d’elle. Elle rendit à ses compagnon leur première forme. Elle procura à Ulysse les moyens de descendre aux enfers, pour y consulter le fameux devin Tirésias dont il apprit plusieurs aventures qui devoient lui arriver. Circé lui indiqua aussi les précautions qu’il devoit prendre pour échapper aux Sirènes. Après avoir évité avec le même bonheur, les gouffres de Charybde et de Scylla, il essuya une nouvelle tempête que Neptune suscita, pour le punir d’avoir aveuglé son fils Polyphème. Ulysse vit périr son vaisseau et touts ses compagnons, et se sauva seul dans l’île de Calypso.
D. Dites un mot de Calypso.
R. Calypso, fille de l’Océan et de Téthys, régnoit dans une île de la mer Ionienne, appelée Ogygie. Elle reçut Ulysse, et l’arrêta pendant sept ans, lui offrant l’immortalité, s’il vouloit l’épouser. Mais le héros préféra Pénélope et sa petite île d’Ithaque à ces brillants avantages. Mercure fut envoyé par Jupiter, pour ordonner à Calypso de laisser partir Ulysse. La déesse fit équiper un vaisseau, et le prince se remit en mer.
Pour fixer le volage Ulysse,Jouet de Neptune irrité,En vain Calypso, plus propice,Lui promet l’immortalité :Peu touché d’une île charmante,A Pluton, malgré son amante,De ses jours il soumet le fil,Aimant mieux dans sa cour déserteDescendre au tombeau de Laërte,Qu’être immortel dans un exil.( .)
D. Ulysse n’éprouva-t-il plus de malheurs après son départ de l’île d’Ogygie ?
R. Il eut beaucoup de peine à gagner l’île des Phéaciens24, où régnoit Alcinoüs. Les jardins d’Alcinoüs sont très-célèbres dans l’antiquité.
« Jamais, dit
, les arbres ne sont sans fruits, un doux zéphyr entretient leur vigueur et leur sève ; et pendant que les fruits mûrissent, il en naît toujours de nouveaux. La poire prête à cueillir, en laisse voir une autre qui commence à paroître. La grenade et l’orange déjà mûres, en montrent de nouvelles qui vont mûrir. L’olive est poussée par une autre olive, et la figue ridée fait place à une autre qui la suit. La vigne y porte des raisins en toute saison ; pendant que les uns sèchent au soleil, on coupe les autres, et on foule dans le pressoir ceux que le soleil a déjà préparés. »
Ulysse resta quelque temps à la cour voluptueuse et brillante d’Alcinoüs, et jouit des délices de ces lieux enchantés. Il en partit, chargé de présents, et arriva enfin à Ithaque, après une absence de vingt ans.
D. Comment Ulysse fut-il reçu à Ithaque ?
R. Ulysse se déguisa, pour se dérober aux piéges des amants de Pénélope : il alla descendre chez son fidelle serviteur Eumée. A la porte de son palais, il fut reconnu par un chien qu’il avoit laissé en partant, et qui mourut de joie d’avoir retrouvé son maître. Il se découvrit à Télémaque, puis à Pénélope. Cette vertueuse épouse lui raconta comment elle avoit éludé la poursuite de ses amants, en leur promettant d’épouser l’un d’eux, lorsqu’une tapisserie qu’elle avoit commencée, seroit finie. Elle défaisoit la nuit ce qu’elle avoit fait le jour. Mais, ne pouvant plus obtenir de nouveaux délais, elle s’étoit engagée à prendre pour époux celui qui le lendemain pourroit tendre l’arc d’Ulysse, et faire passer le premier sa flèche dans plusieurs bagues disposées de suite. Ulysse approuva cette résolution, dans l’espérance d’y trouver un moyen de se venger des prétendants. Touts essayèrent en vain de tendre l’arc. Ulysse, après eux, demanda qu’il lui fût permis d’essayer ses forces. Il banda l’arc très-aisément, et tira sur les poursuivants qu’il tua, avec le secours de son fils et de ses serviteurs.
D. Comment mourut Ulysse ?
R. Ce prince régnoit paisiblement dans son île, lorsque Télégone, qu’il avoit eu de Circé, vint à Ithaque pour voir son père. Pendant qu’on le repoussoit comme un inconnu, il s’éleva quelque tumulte à la porte du palais. Ulysse accourut pour voir ce qui se passoit. Dans le désordre, il fut atteint malheureusement par Télégone d’une flèche empoisonnée : Tirésias lui avoit prédit qu’il mourroit de la main de son fils. Minerve ordonna à Télégone d’épouser Pénélope, et de ce mariage naquit Italus, qui donna son nom à l’Italie.
D. Par qui les aventures d’Ulysse nous ont-elles été transmises ?
R. Par , le père de la poésie grecque. Il florissoit vers l’an 300 après la prise de Troie. Il a chanté les voyages et les malheurs d’Ulysse, dans un poëme épique appelé l’Odyssée. Il avoit fait auparavant un autre poëme encore plus beau, dans lequel il a célébré la colère d’Achille, si pernicieuse aux Grecs, et la ruine de la ville de Troie. Ce poëme a pour titre l’Iliade… L’immortel a décrit les aventures de Télémaque, fils d’Ulysse, dans un ouvrage qui renferme toutes les grandes beautés des anciens.
Ajax. §
D. L’armée des Grecs ne comptoit-elle pas plusieurs guerriers nommés Ajax ?
R, Oui. Le premier étoit fils d’Oïlée, roi des Locriens. Il étoit renommé pour sa valeur, et il rendit de grands services pendant le siége. Mais, à la prise de la ville, il outragea Cassandre qui s’étoit réfugiée dans le temple de Minerve. La déesse, irritée de ce sacrilége, submergea sa flotte, près des rochers de Capharée25. L’intrépide Ajax se sauva sur un rocher, et dit arrogamment : J’en échapperai malgré les dieux. Mais Pallas le frappa de la foudre.
D. Faites-nous connoître l’autre Ajax.
R. Le second Ajax étoit fils de Télamon, roi de Salamine. Il fut, après Achille, le plus vaillant des Grecs. Mais il étoit, comme lui, brutal, emporté. Après la mort d’Achille, Ajax et Ulysse se disputèrent les armes de ce héros. Ulysse l’emporta. Ajax en devint si furieux, que, pendant la nuit, il massacra touts les troupeaux du camp, croyant tuer son rival et les capitaines de l’armée. Revenu de son délire, il fut si honteux, qu’il se perça d’une épée dont Hector lui avoit fait présent. Son sang fut changé en hyacinthe.
raconte ainsi la dispute d’Ajax et d’Achille :
Touts les chefs sont assis : le soldat en silenceLes entoure debout, appuyé sur sa lance ;Ajax se lève, Ajax intrépide guerrier,Orgueilleux possesseur d’un vaste bouclier.Emporté malgré lui par sa fougue sauvage,Du geste et des regards attestant le rivage,Et le port de Sigée, et la flotte, et la mer,Les bras levés au ciel, il dit : O Jupiter !C’est devant les vaisseaux que la Grèce s’assemble,Et c’est Ulysse et moi que l’on compare ensemble !Le lâche ! qu’ont vu fuir nos vaisseaux menacésDevant les feux d’Hector que j’ai seul, repoussés !Ulysse est sûr de lui quand Ulysse harangue :Ma force est dans mon bras ; la sienne est dans sa langue,J’appris au champ de Mars le grand art des héros,Et n’ai point, comme lui, la science des mots.
Ulysse commence son discours d’une manière bien plus adroite.
O Grecs ! si du destin la loi dure et sévèreA vos vœux comme aux miens eût été moins contraire,On ne nous verroit point, ambitieux rivaux,Nous disputer l’honneur d’hériter d’un héros :Nous jouirions d’Achille, Achille de ses armes.Mais puisque, condamnés à lui donner des larmes,Ses beaux jours par le ciel nous furent enviés,(Ulysse essuie alors des pleurs étudiés)Qui donc aura des droits à l’armure d’Achille,Plus que celui-là même à qui l’on doit Achille ?(Trad. de .)
Nestor §
D. Qui étoit Nestor ?
R. Nestor, fils de Nélée et de Chloris, étoit roi de Pylos. Il échappa seul au fer d’Hercule qui donna la mort à touts ses frères, parce qu’ils avoient pris parti pour Augias. Il fit le voyage de la Colchide avec les Argonautes. Il se trouva aux noces de Pirithoüs, et combattit contre les Centaures, Il étoit déjà fort vieux, lorsqu’il se rendit au siége de Troie, Il fut très-utile aux Grecs par la sagesse de ses conseils. Agamemnon disoit que s’il avoit dix Nestor dans son armée, il prendroit la ville en peu de temps, Son éloquence étoit si douce et si touchante, qu’
dit que
le miel couloit de ses lèvres, quand il parloit
.
ajoute qu’
il vécut trois siècles d’homme
.
Idoménée. §
D. Raconteé l’histoire d’Idoménée.
R. Idoménée, roi de Crète, étoit fils de Deucalion, et petit-fils de Minos. Il se signala au siége de Troie. A son retour, il fut battu par une tempête affreuse. Pour échapper au naufrage, il promit à Neptune de lui sacrifier la première créature vivante qui se présenteroit à lui sur le rivage de Crète. Arrivé au port, il rencontre son fils. Le malheureux père accomplit son vœu. Les Crétois, saisis d’horreur pour l’action barbare de leur roi, le chassèrent de ses états. Il se retira sur les côtes de la grande Hespérie, où il fonda Salente. Il fit observer dans sa nouvelle ville les sages lois de Minos. L’aventure d’Idoménée a fourni à le sujet d’une tragédie, et à l’ celui d’un bel épisode.
Une effroyable nuit, sur les eaux répandue,Déroba tout à coup les objets à ma vue ;La mort seule y parut. Le vaste sein des mersNous entr’ouvrit cent fois la route des enfers.Par des vents opposés les vagues ramassées,De l’abyme profond jusques au ciel, poussées,Dans les airs embrasés agitoient mes vaisseaux,Aussi près d’y périr qu’à fondre sous les eaux.D’un déluge de feux l’onde comme allumée,Sembloit rouler sur nous une mer enflammée ;Et Neptune en courroux, à tant de malheureuxN’offroit, pour tout salut, que des rochers affreux.Que te dirai-je enfin ?… dans ce péril extrême,Je tremblai, Sophronyme, et tremblai pour moi-même…Pour apaiser les dieux, je priai… je promis…Non, je ne promis rien, dieux cruels ! j’en frémis…Neptune, l’instrument d’une indigne foiblesse,S’empara de mon cœur, et dicta la promesse.S’il n’en eût inspiré le barbare dessein,Non, je n’aurois jamais promis de sang humain.« Sauve des malheureux si voisins du naufrage,» Dieu puissant, m’écriai-je, et rends-nous au rivage !» Le premier des sujets rencontré par son roi,» A Neptune immolé satisfera pour moi. »Mon sacrilége vœu rendit le calme à l’onde ;Mais rien ne put le rendre à ma douleur profonde ;Et, l’effroi succédant à mes premiers transports,Je me sentis glacer en revoyant ces bords :Je les trouvai déserts, tout avoit fui l’orage.Un seul homme alarmé parcouroit le rivage ;Il sembloit de ses pleurs mouiller quelques débris :J’en approche en tremblant… hélas ! c’étoit mon fils !…( .)
Diomède. §
D. Que raconte-t-on de Diomède ?
R. Diomède, fils de Tydée, étoit roi d’Etolie. Il partit avec les princes grecs pour la guerre de Troie. Ses exploits l’y firent regarder comme le plus brave de toute l’armée, après Achille, et Ajax fils de Télamon. représente ce prince comme le favori de Pallas. Cette déesse le suit par-tout. C’est par son secours, qu’il tue plusieurs rois de sa main, qu’il soutient des combats singuliers contre Hector, Énée, et les autres princes troyens ; qu’il se saisit des chevaux de Rhésus, qu’il enlève le palladium ; enfin, qu’il blesse le dieu Mars, et Vénus même, qui venoit secourir son fils Énée. La déesse en conçut un tel dépit, qu’elle inspira à sa femme Égiale une violente passion pour un autre. Diomède, instruit de cet affront, ne voulut point retourner dans sa patrie. Il alla aborder sur les côtes d’Apulie ou de la Pouille, et y bâtit plusieurs villes.
Palamède. §
D. Quels sont les principaux traits de l’histoire de Palamède ?
R. Palamède, fils de Nauplius, et arrière-petit-fils de Bélus, étoit roi de l’île d’Eubée. Ce fut lui qui découvrit la feinte d’Ulysse, qui contrefaisoit l’insensé pour ne point aller à la guerre de Troie. Ulysse, pour se venger, fit enfouir une somme d’argent dans la tente de Palamède, et contrefit une lettre de Priam, qui le remercioit d’un service qu’il avoit rendit aux Troyens, et lui annonçoit l’envoi de la somme dont ils étoient convenus. La lettre fut lue dans l’assemblée des princes grecs ; on envoya dans la tente de Palamède, pour s’assurer si l’argent y avoit été déposé. La somme énoncée s’y trouva ; Palamède lut lapidé. On lui attribue le jeu des échecs, celui des dés, et l’invention des poids et mesures.
Thersite. §
D. Dites qui étoit Thersite.
R. Thersite étoit le plus laid et le plus lâche de touts les Grecs.
dit qu’
il faisoit un bruit horrible
: il disoit toute sorte de grossièretés et d’injures, et ne parloit d’Agamemnon et des autres rois, qu’avec une insolence cynique. Achille, piqué de ses injures, le tua d’un coup de poing. Thersite a donné lieu à une espèce de proverbe : quand on veut parler d’un homme mal fait, lâche et insolent, on dit : c’est un Thersite.
Sinon. §
D. Par quels faits Sinon est-il connu ?
R. Sinon, fils de Sisyphe, est connu par sa fourberie. Lorsque les Grecs feignirent de lever le siége de Troie, Sinon se laissa prendre par les Troyens, et leur dit qu’il venoit chercher un asile parmi eux. Il gagna leur confiance par ses mensonges adroits, et leur persuada d’introduire le cheval de bois dans leurs murs. Au milieu de la nuit, l’artificieux transfuge alla ouvrir les flancs du cheval, et les portes de la ville, qui tomba ainsi au pouvoir des Grecs.
Personnages célèbres de Troie. §
Priam. §

D. Racontez les malheurs de Priam.
R. Priam, roi de Troie, épousa Hécube, dont il eut un grand nombre d’enfants. Il releva les murs de la ville, et fit fleurir son empire. Mais son bonheur fut troublé par son fils Pâris, qui ravit Hélène à Ménélas. A la prise de Troie, Priam fut tué par Pyrrhus, à la vue de sa femme et au milieu de ses dieux. Énée raconte ainsi à Didon la mort de Priam.
J’ai vu Pyrrhus, j’ai vu les féroces AtridesRassasier de sang leurs armes homicides ;Hécube échevelée errer sous ces lambris ;Le glaive moissonner les femmes de ses fils ;Et son époux, hélas ! à son moment suprême,Ensanglanter l’autel qu’il consacra lui-même.De sa postérité les rejetons naissantsDont la foule chérie entouroit ses vieux ans,De ses cinquante fils les couches nuptiales.Ces dépouilles des fois, ces pompes triomphales,Trésors, enfants, grandeurs, tout périt sous ses yeux,Et le glaive détruit ce qu’épargnent les feux…
Reine ! peut-être aussi desirez-vous connoîtreComment de cet état périt l’auguste maître ?Voyant les Grecs vainqueurs au sein de ses remparts.Son antique palais forcé de toutes parts,L’ennemi sous ses yeux, d’une armure impuissanteCe vieillard charge en vain son épaule tremblante,Prend un glaive à son bras dès long-temps étranger,Et s’apprête à mourir plutôt qu’à se venger.Dans la cour du palais, de ses rameaux antiquesUn laurier embrassant ses autels domestiquesLes couvroit de son ombre ; en ces lieux révérés,Hécube et ses enfants ensemble retirés,Ainsi qu’aux sifflements des tempêtes rapidesS’attroupe un foible essaim de colombes timides,Se pressoient, embrassoient les images des dieux.Dès qu’elle voit Priam vainement furieux,Moins couvert qu’accablé d’une armure inutile :« Quelle aveugle fureur ! quel courage stérile !» Lui crie Hécube en pleurs ; où courez-vous ? hélas !» Contre un destin cruel que peut ce foible bras ?» Mon Hector même en vain renaîtroit de sa cendre.» Approchez : de nos dieux l’autel va nous défendre,» Ou sous le même fier nous expirerons touts. »Par ces mots, du vieillard désarmant le courroux,La reine enfin l’entraîne et le place auprès d’elle.Tout à coup, de Pyrrhus fuyant la main cruelle,A travers mille dards, un dernier fils du roiS’échappe, et du palais dépeuplé par l’effroiTraverse tout sanglant la longue galerie.Pyrrhus le suit ; déjà, tout bouillant de furie,Il le presse, il le touche, il l’atteint de son dard :Enfin au saint autel, asile du vieillard,Son fils court éperdu, tend les bras à son père,Hélas ! et dans son sang tombe aux pieds de sa mère.A ce spectacle affreux, quoique sûr de la mort,Priam ne contient plus son douloureux transport :« Que les dieux, s’il en est qui vengent l’innocence,» T’accordent, malheureux ! ta juste récompense ;» Toi qui d’un sang chéri souilles mes cheveux blancs,» Qui sous les yeux d’un père égorges ses enfants ;» Toi, fils d’Achille !… non, il ne fut point ton père.» D’un ennemi vaincu respectant la misère,» Le meurtrier d’Hector, dans son noble courroux,» Ne vit pas sans pitié Priam à ses genoux,» Et, pour rendre au tombeau des dépouilles si-chères,» Il me renvoya libre au palais de mes pères.» Tiens, cruel !… » A ces mots, au vainqueur inhumainIl jette un faible trait qui, du solide airainEffleurant la surface avec un vain murmure,Languissamment expire, et pend à son armure.« Eh bien, cours aux enfers conter ce que tu vois ;» A mes nobles aïeux va dire mes exploits ;» Dis au fils de Thétis que son sang dégénère ;» Mais avant, meurs !… » Il dit, et, d’un bras sanguinaire,Du monarque traîné par ses cheveux blanchis,Et nageant dans le sang du dernier de ses fils,Il pousse vers l’autel la vieillesse tremblante ;De l’autre, saisissant l’épée étincelante,Lève le fer mortel, l’enfonce, et de son flancArrache avec la vie un vain reste de sang.Ainsi périt Priam ; ainsi la destinéeMarqua par cent malheurs sa mort infortunée.Il périt, en voyant de ses derniers regardsBrûler son Ilion et tomber ses remparts.Ce potentat, jadis si grand, si vénérable,N’est plus qu’un tronc sanglant, qu’un débris déplorable,Dans la foule des morts tristement confondu,Hélas ! et sans honneur sur le sable étendu.(Énéide de , trad. de M. .)
D. Quel fut le sort d’Hécube ?
R. Hécube, épouse de Priam, étoit sœur de Théano, prêtresse d’Apollon. Elle eut cinquante fils, qui périrent presque touts sous les yeux de leur mère. Après la prise de la ville, on la chercha long-temps sans la trouver ; mais enfin, Ulysse la surprit parmi les tombeaux de ses enfants, et en fit son esclave. Avant que de partir, elle avala les cendres d’Hector. Ayant arraché les yeux à Polymnestor, roi de Thrace, elle fut poursuivie à coups de pierres par les sujets de ce prince. Hécube mordoit de rage les pierres qu’on lui lançoit ; elle fut métamorphosée en chienne.
Hector. §
D. Racontez l’histoire d’Hector.
R. Hector, fils de Priam et d’Hécube, étoit le plus fort et le plus vaillant des Troyens. Il sortit avec gloire de plusieurs combats contre les plus redoutables guerriers d’entre les Grecs, tels qu’Ajax et Diomède. Suivant les oracles, l’empire de Priam ne pouvoit être détruit, tant que le redoutable Hector vivroit. Durant la retraite d’Achille, il porta le feu jusque dans les vaisseaux ennemis, et tua Patrocle, qui vouloit s’opposer à ses progrès. Le desir de la vengeance ramena Achille au combat. Hector fut défait par le fils de Thétis, qui lui ôta la vie, et attacha à son char le corps de son ennemi, qu’il traîna plusieurs fois autour de la ville.
Dans la tragédie d’Hector, par , Polydamas raconte ainsi à Pâris la mort du héros troyen.
Dans les champs Phrygiens, l’ordre du sage ÉnéeTenoit de nos guerriers la vaillance enchaînée ;Sortis de leurs remparts jusqu’alors assiégés,Sous leurs différents chefs les Grecs étoient rangés ;Entr’eux et les Troyens s’étend un large espaceOù vont lutter la force et l’adresse et l’audace ;Les deux camps sont muets, et du combat fatalChacun desire, attend, redoute le signal.Sitôt qu’Hector parut, on ouvrit la barrière.« Le voilà, dit Achille enflammé de colère ;» Viens, ton sang va payer le sang de mon ami !» Le vainqueur de Patrocle est mon seul ennemi.» C’est Hector que je veux ! » — C’est Hector qui t’immole, »Lui répond votre frère. Il dit, et son trait vole,Atteint le bouclier, y reste suspendu.Achille est ébranlé du choc inattendu ;Il prend son javelot, dans les airs le balanceEt, de tout son effort, à son tour il le lance.Mais Hector le prévoit, et le coup est paré :Du trait de son rival chacun s’est emparé.Tandis qu’Achille, armé de la lance troyenne,Fond sur Hector, Hector le frappe de la sienne :Il brise sa cuirasse ; et le fer repoussé,Sur le céleste acier se recourbe émoussé.Leur sang, plus d’une fois, avoit rougi la terre,Ils luttoient tout couverts de sueur, de poussière,Leur javelot brisé, leur casque renversé,Et Jupiter entr’eux n’avoit point prononcé,Lorsque, suivi d’Hélène accourut votre père ;Il s’écrie : à sa vue on s’agite, on espère ;Et déjà deux hérauts plaçoient en même tempsLeur sceptre pacifique entre les combattants.Mais Achille frémit de perdre sa victime :Son courage, ou plutôt sa fureur se ranime ;Il presse Hector, Hector résiste ; mais soudainSon fer se brise, éclate, échappe de sa main…Que pouvoit sa vaillance ?… Il est atteint !… il tombe…Troie entière descend avec lui dans la tombe…La mort d’Hector n’a point désarmé le vainqueur ;Tournez les yeux, voyez un spectacle d’horreur !Voyez après son char dégouttant de carnage,Les pieds gonflés des nœuds qu’a redoublés la rage,Notre Hector suspendu ! Son front défiguré,Ce front terrible aux Grecs, des Troyens adoré,Roule, et sillonne au loin la fange qui le souille.De ses longs cheveux noirs la flottante dépouilleSème de ses débris le sol ensanglanté :Ulysse, Ulysse même en est épouvanté.Achille, l’œil terrible et la main menaçante,Presse, à coups redoublés, vers les rives du Xanthe,Ses coursiers, qui, toujours dociles à sa voix,Refusent d’obéir pour la première fois.L’impitoyable Achille, orgueilleux de son crime,Sourit, d’un air affreux, à sa pâle victime,Triomphe d’un cadavre, et, bravant touts les dieux,De son sang qui ruisselle il enivre ses yeux.
D. Que devint Andromaque, femme d’Hector ?
R. Andromaque, privée d’un époux qu’elle aimoit tendrement, vit bientôt réduire en cendres la ville dont Hector étoit le principal appui. Elle vit son fils Astyanax précipité du haut des murailles de Troie par le cruel Pyrrhus. Elle tomba en partage à ce même Pyrrhus, fils du meurtrier de son mari, et auteur de la mort de son fils. Pyrrhus l’emmena en Épire, et l’épousa.
Elle eut pour troisième époux Hélénus, frère de son premier mari, qui régna en Epire, après la mort de Pyrrhus. Elle regretta toujours Hector, auquel elle fit construire un magnifique monument.
Quelques auteurs ont prétendu qu’un enfant supposé fut précipité du haut des murs de la ville, au lieu d’Astyanax, et que ce jeune prince suivit sa mère en Épire. C’est cette tradition, que a suivie dans sa belle tragédie d’Andromaque. Le poëte a feint qu’Andromaque ne se décidoit à épouser Pyrrhus, que pour sauver la vie à son fils.
D. Rapportez les belles scènes où peint les combats d’Andromaque, entre la crainte de perdre son fils, et l’horreur de donner sa main à Pyrrhus.
R. Céphise, confidente d’Andromaque, engage cette princesse à sauver son fils, en cédant aux vœux de Pyrrhus.
Céphise.
Madame, à votre époux c’est être assez fidelle :Trop de vertu pourroit vous rendre criminelle.Lui-même il porteroit votre ame à la douceur.Andromaque.
Quoi ! je lui donnerois Pyrrhus pour successeur ?Céphise.
Ainsi le veut son fils que les Grecs vous ravissent.Pensez-vous qu’après tout ses manes en rougissent ;Qu’il méprisât, Madame, un roi victorieuxQui vous fait remonter au rang de vos aïeux,Qui foule aux pieds pour vous vos vainqueurs en colère,Qui ne se souvient plus qu’Achille étoit son pèreQui dément ses exploits et les rend superflus ?Andromaque.
Dois-je les oublier, s’il ne s’en souvient plus ?Dois-je oublier Hector privé de funérailles,Et traîné sans honneur autour de nos murailles ?Dois-je oublier son père à mes pieds renversé,Ensanglantant l’autel qu’il tenoit embrassé ?Songe, songe, Céphise, à cette nuit cruelleQui fut pour tout un peuple une nuit éternelle :Figure-toi Pyrrhus, les yeux étincelants,Entrant à la lueur de nos palais brûlants,Sur touts mes frères morts se faisant un passage,Et, de sang tout couvert, échauffant le carnage ;Songe aux cris des vainqueurs, songe aux cris des mourantsDans la flamme étouffes, sous le fer expirants ;Peins-toi dans ces horreurs Andromaque éperdue :Voilà comme Pyrrhus vint s’offrir à ma vue,Voilà par quels exploits il sut se couronner :Enfin, voilà l’époux que tu veux me donner.(Acte 3e, Scène 8e.)
Enfin Andromaque s’est décidée à se sacrifier pour conserver les jours de son fils. Elle déclare à Céphise le dessein où elle est de se donner la mort, après avoir engagé sa foi à Pyrrhus.
Andromaque.
…………………………… O ma chère Céphise,Ce n’est point avec toi que mon cœur se déguise.Ta foi dans mon malheur s’est montrée à mes yeux ;Mais j’ai cru qu’à mon tour tu me connoissois mieux.Quoi donc ! as-tu pensé qu’Andromaque infidellePût trahir un époux qui croit revivre en elle ;Et que, de tant de morts réveillant la douleur,Le soin de mon repos me fit troubler le leur ?Est-ce là cette ardeur tant promise à sa cendre ?Mais son fils périssoit, il l’a fallu défendre.Pyrrhus en m’épousant s’en déclare l’appui ;Il suffit : je veux bien m’en reposer sur lui.Je sais quel est Pyrrhus : violent, mais sincère,Céphise, il fera plus qu’il n’a promis de faire.Sur le courroux des Grecs je m’en repose encor ;Leur haine va donner un père au fils d’Hector.Je vais donc, puisqu’il faut que je me sacrifie,Assurer à Pyrrhus le reste de ma vie ;Je vais, en recevant sa foi sur les autels,L’engager à mon fils par des nœuds immortels.Mais aussitôt ma main, à moi seule funeste,D’une infidelle vie abrégera le reste ;Et, sauvant ma vertu, rendra ce que je doisA Pyrrhus, à mon fils, à mon époux, à moi.Céphise.
Ah ! ne prétendez pas que je puisse survivre…Andromaque.
Non, non, je te défends, Céphise, de me suivre ;Je confie à tes soins mon unique trésor :Si tu vivois pour moi, vis pour le fils d’Hector,De l’espoir des Troyens seule dépositaire,Songe à combien de rois tu deviens nécessaire.Veille auprès de Pyrrhus ; fais-lui garder sa foiS’il le faut, je consens qu’on lui parle de moi.Fais-lui valoir l’hymen ou je me suis rangée :Dis-lui qu’avant ma mort je lui fus engagée ;Que ses ressentiments doivent être effacés ;Qu’en lui laissant mon fils, c’est l’estimer assez.Fais connoître à mon fils les héros de sa race ;Autant que tu pourras, conduis-le sur leur trace :Dis-lui par quels exploits leurs noms ont éclaté,Plutôt ce qu’ils ont fait que ce qu’ils ont été :Parle-lui touts les jours des vertus de son père ;Et quelquefois aussi parle-lui de sa mère.Mais qu’il ne songe plus, Céphise, à nous venger ;Nous lui laissons un maître, il le doit ménager.Qu’il ait de ses aïeux un souvenir modeste :Il est du sang d’Hector ; mais il en est le reste ;Et pour ce reste enfin j’ai moi-même, en un jour,Sacrifié mon sang, ma haine, et mon amour.(Acte 4e, scène Ire.)
Pâris. §
D. Faites connoître Pâris.
R. Pâris, fils de Priam et d’Hécube, fut aussi appelé Alexandre. Pendant que sa mère le portoit dans son sein, elle rêva qu’elle accouchoit d’un flambeau qui embrasoit la ville de Troie. Les devins consultés répondirent que l’enfant causeroit un jour la ruine de sa patrie. Priam, effrayé de cet oracle, livra le jeune prince à un de ses serviteurs, et lui ordonna de le mettre à mort. Mais le serviteur, touché de la beauté de Pâris et des larmes de sa mère, le donna à des bergers du mont Ida, qui l’élevèrent. Il devint bientôt le plus beau et le plus célèbre des pasteurs. La nature le dédommagea de l’empire dont l’avoit privé la fortune. Il se fit aimer de la nymphe Œnone, et l’épousa.
D. Quel événement vint troubler le bonheur de Pâris ?
R. Ce fut la dispute qui s’éleva entre Junon, Minerve et Vénus. Touts les dieux avoient été invités aux noces de Thétis et de Pélée. La Discorde, qui en avoit été exclue, et qui vouloit venger son affront, vint, au milieu d’un nuage, et jeta sur la table du festin, une pomme d’or, avec cette inscription : à la plus belle. Junon, Vénus et Pallas prétendirent exclusivement à la pomme, et demandèrent un juge impartial. Jupiter chargea Mercure de conduire les trois déesses sur le mont Ida, pour y subir le jugement de Pâris. Junon promit au jeune berger le pouvoir et la richesse ; Minerve, le savoir et la vertu ; Vénus lui promit de le faire aimer de la plus belle femme de l’univers. Pâris adjugea la pomme à Vénus. De la vint la haine de Junon et de Minerve contre les Troyens.
Au superbe festin touts les dieux invitésPartageoient le bonheur des époux enchantés.La main de la Discorde, entr’ouvrant un nuage,Du désordre prochain fait briller le présage ;Elle tient un fruit d’or, où ces mots sont écrits :« Le sort à la plus belle a réservé ce prix. »On sait quel fut le trouble entre les immortelles,Qui toutes prétendoient à l’empire des belles,Et qu’enfin Jupiter, qui n’osa les juger,Fit dépendre ce droit de l’arrêt d’un berger.( .)
D. A quelle occasion Pâris vint-il à la cour de Priam, son père ?
R. Priam fit célébrer des jeux à sa cour. Pâris s’y rendit, combattit contre ses frères, et les vainquit. Hector, indigné d’avoir été défait par un berger, le poursuivit, et vouloit lui donner la mort. Mais Pâris se fit reconnoître de son frère qui le présenta à Priam. Le roi reçut son fils avec joie, oublia les fatales prédictions, et lui donna un appartement dans son palais. Bientôt après, il l’envoya à Salamine, pour redemander Hésione. C’est dans ce voyage, que Pâris enleva la belle Hélène, et donna lieu à la guerre qui amena la ruine de Troie. Durant la traversée, le vieux Nérée lui prédit les malheurs qui seroient la suite de ce funeste enlèvement.
D. Comment mourut Pâris ?
R. Pâris, pendant le siége de Troie, combattit contre Ménélas, et ne se déroba aux coups du héros grec, que par la protection de Vénus. Il blessa Diomède, Machaon, Antilochus, Palamède, et donna lâchement la mort à Achille. Philoctète le perça d’une de ses flèches. Pâris alla mourir entre les bras de sa chère Œnone, qui lui pardonna son infidélité.
D. Quel fut le sort de Cassandre, sœur de Pâris et d’Hector ?
R. Cassandre obtint d’Apollon qui l’aimoit, le don de prédire l’avenir. Mais ensuite ce dieu, irrité des dédains de la princesse, empêcha qu’on ne crût à ses prédictions, et la fit passer pour folle. On l’enferma dans une tour, où elle ne cessoit de chanter les malheurs de sa patrie. On n’ajouta foi à ses oracles, qu’après l’événement. Elle échut en partage à Agamemnon qui l’emmena en Grèce. Elle prévint ce prince des malheurs qui l’attendoient dans ses états. Sa prédiction eut le destin accoutumé. Clytemnestre fit massacrer Cassandre avec les enfants que l’infortunée Troyenne avoit eus d’Agamemnon.
Laocoon §
D. Qui étoit Laocoon ?
R. Laocoon, fils de Priam et d’Hécube, étoit prêtre d’Apollon et de Neptune. II fit touts ses efforts pour empêcher les Troyens d’introduire le cheval de bois dans leurs murs. Il regardoit cette machine comme une ruse qui devoit être fatale à la ville. Il lança sa javeline dans les flancs du cheval, et l’on entendit retentir le bruit des armes qui y étoient renfermées. Mais les Troyens aveuglés, ne voulurent point écouter les sages conseils de Laocoon. Ils l’accusèrent d’impiété, pour avoir violé un don offert à Minerve. Le ciel même parut bientôt punir Laocoon de sa témérité. Deux affreux serpents, sortis de la mer, vinrent droit à l’autel, où sacrifioit Laocoon, se jetèrent sur ses deux fils, et après les avoir déchirés impitoyablement, saisirent Laocoon lui-même qui venoit à leur secours, et le firent périr misérablement.
Cette aventure a donné lieu à un des plus beaux morceaux de sculpture grecque, que nous possédions. Ce chef-d’œuvre est de la main de , d’ et d’ , trois excellents maîtres de Rhodes, qui le taillèrent de concert d’un seul bloc de marbre.
D. Récitez les beaux vers dans lesquels M. décrit, d’après , les malheurs de Laocoon et de ses enfants.
R. Les voici :
Pergame, après dix ans de siége, de carnage,Bravoit encor des Grecs le superbe courage.Ces Grecs si fiers, armés sur la foi de Calchas,Comptoient en frémissant leurs stériles combats.Mais l’oracle a parlé : sous la hache abattues,L’Ida voit ses forêts à ses pieds descendues.De leurs débris formé, l’œil fixe, menaçant,Un cheval monstrueux s’élève ; et dans son flancMille guerriers cachés, contre dix ans d’offense,Méditent sans honneur une lâche vengeance.
D’Atride cependant la flotte a disparu,Ilion, à la paix tu crus ton sol rendu !Vers des bords étrangers ces voiles fugitives,Un perfide à dessein rejeté sur tes rives,Et ce coursier nouveau qu’un repentir pieux,Pour les calmer, dit-on, offre enfin à tes dieux ;Tout flattoit ta pensée, et l’heureuse PhrygieRessaisit en espoir le sceptre de l’Asie.
Déjà de ses remparts, le peuple à flots pressés,S’élance, humide encor des pleurs qu’il a versés ;Son œil sur chaque objet librement se promène.Il sourit, mais son cœur se rassure avec peine ;Et, dans ce camp désert, si long-temps redouté,Un reste de frayeur se mêle à sa gaieté.
Laocoon paroît, prêtre cher à Neptune ;Vers ce cheval hideux dont l’aspect l’importune.Il marche, tourmenté d’un noir pressentiment.Ses cheveux sur son sein descendent tristement,Et la cendre a souillé sa barbe vénérable.« Fuyez ! fuyez ! dit-il, d’une voix lamentable ;» Ce présent vient des Grecs, c’est le don de la mort. »A ces mots, de sa main qu’anime un noble effort,Un trait part… Mais quel dieu rend ce trait inutile ?Il tombe, et meurt aux pieds du colosse immobile.Un vain peuple applaudit à cet arrêt des cieux.La hache cependant porte un coup plus heureux :Le monstre est ébranlé. Ses entrailles mugissent ;Sous leur abri douteux les Grecs tremblants pâlissent.Pour la première fois dans le crime incertains,Ils redoutent la nuit, ouvrage de leurs mains ;Un moment peut les perdre… ô funeste vertige !Le malheureux Troyen crie encore au prodige.« Contre Ilion, dit-il, un prêtre criminel» Arma par son forfait la colère du ciel ?» Ce cheval est sacré ! protecteur de Pergame,» Qu’il habite en son sein, un temple l’y réclame ! »Peuple aveugle ! en tes murs, avec pompe escorté,Il s’avance, et demain tes murs auront été.
Des bords où Ténédos s’élève au sein de l’onde,Un bruit sourd est parti. La mer s’émeut et gronde ;Le flot poursuit le flot qui murmure et s’enfuit.Tel Neptune se plaint dans l’ombre de la nuit,Quand la rame docile à la main qui la guide,Fend à coups redoublés-son domaine liquide.Soudain, à nos regards, deux dragons furieuxSe présentent : la foudre étincelle en leurs yeux.Sous leurs bonds convulsifs en temps égaux presséeL’onde écume, et jaillit jusqu’aux cieux élancée.Leur crête se hérisse : à leurs mugissementsLa rive au loin répond par ses gémissements.Un triple dard s’agite en leur gueule enflammée,Et de leurs naseaux roule un torrent de fumée.Tout tremble : fruits jumeaux d’un hymen plein d’appas,Tes fils, Laocoon, avoient suivi tes pas ;Tes fils, portraits vivants d’une mère adorée,Comme toi, revêtus de la robe sacrée.Le couple affreux s’enlace ; et, l’œil rouge de sang,Sur sa double victime il s’élance en sifflant.La peur éteint leurs voix sur leurs lèvres glacées ;De replis écailleux leurs mains embarrasséesAppellent, mais en vain, un secours fraternel :Sur leurs yeux déjà pèse un sommeil éternel ;Et toi, vieillard débile ! ô trop malheureux père !Quel transport t’a poussé sous la dent meurtrière ?Pour la combattre, hélas ! tu n’as que ton amour :Ton trépas à tes fils rendra-t-il donc le jour ?…Tu tombes ! et vers Troie, à ton heure dernière,Se tourne avec douleur ta mourante paupière.
Bientôt Phébé, du haut de son char argenté,Vient colorer les airs de sa pâle clarté.Les enfants d’Ilion dormoient dans le silence ;Ils dormoient ! et bercé d’une douce espérance,Ce bon peuple revoit un heureux lendemain.Mais du cheval fécond le flanc s’ouvre, et soudainLa mort avec les Grecs dans nos mars est vomie.Leur fer, long-temps captif, s’agite avec furie.Comme, affranchi du mors, vole un coursier fougueux,L’œil fier, et de ses crins battant ses flancs poudreux :Tel, au palais des rois, affamé de carnage,Sur des monceaux de morts Pyrrhus s’ouvre un passage.Là, malgré quarante ans de gloire et de vertus,Priam expire aux pieds d’un trône qui n’est plus.Le sang troyen ruisselle ; et le glaive homicideMoissonne au même instant et la vierge timide,Et le foible vieillard, et l’enfant au berceau.Ilion n’offre plus qu’un immense tombeau ;Et l’autel même où fume une flamme sacréeFournit les feux vengeurs dont Troie est dévorée.
Énée. §
D. Quels sont les principaux traits de la vie d’Énée ?
R. Énée, fils d’Anchise et de Vénus, avoit épousé Créuse, fille de Priam. Il montra beaucoup de valeur pendant le siége de Troie. Dans la nuit où cette ville infortunée succomba, Énée chargea sur son dos son père Anchise, avec ses dieux pénates, prit son fils Ascagne par la main, et se retira sur le mont Ida, avec ce qu’il put recueillir de Troyens. Il équipa une flotte, et après avoir erré pendant sept ans sur différentes mers, toujours poursuivi par Junon, ennemie implacable du nom troyen, il aborda en Italie, où il obtint Lavinie, fille du roi Latinus. Cette princesse avoit été promise à Turnus, roi des Rutules, qui fit la guerre à Énée, fut vaincu et perdit la vie. Énée succéda à Latinus. Après quatre années d’un règne paisible, les Rutules, ligués avec les Étruriens, recommencèrent la guerre. Il se livra une sanglante bataille sur les bords du Numicius, appelé depuis Numicio. Énée disparut dans cette journée. Il se noya peut-être dans la rivière, ou bien il fut tué par les Toscans. On lui éleva un monument sur les bords du Numicius, et les Romains l’honorèrent sous le nom de Jupiter indigète.
D. Quel fut le successeur d’Énée ?
R. Ce fut son fils Ascagne ou Iule, qui, après trente ans de règne, bâtit Albe-la-Longue, dont il fit la capitale de son royaume. Cette ville est regardée comme le berceau de l’empire romain, parce que Romulus et Rémus étoient petits-fils de Numitor, roi d’Albe. Tullus-Hostilius, troisième roi des Romains, détruisit la ville d’Albe, et en transporta les habitants à Rome.
D. Quel fut le sort de Créuse, première femme d’Énée ?
R. Dans la nuit de l’embrasement de Troie, Créuse étoit réunie à son époux Énée, et au vieillard Anchise, qui ne pouvoient se fixer sur le parti qu’ils devoient prendre. Anchise ne se décidoit point à quitter la ville. Mais une flamme légère voltigea tout à coup autour de la tête d’Ascagne, sans brûler ses cheveux ; le tonnerre se fit entendre en même temps à gauche. Ces augures leur parurent favorables. Ils prirent la résolution d’aller chercher un établissement dans les pays étrangers. Créuse partit avec eux ; mais, arrivé au lieu qu’il avoit désigné à ses compagnons, Énée s’aperçut que son épouse étoit absente. Il revint à la ville, et la chercha vainement. L’ombre de Créuse lui apparut, et lui révéla que Cybèle l’avoit enlevée pour la soustraire aux insultes du vainqueur.
D. Quel poëte célèbre a chanté les malheurs d’Énée ?
R. C’est , poëte latin, qui vivoit sous Auguste. Son Énéide est le plus beau monument qui nous reste de l’antiquité. trace exactement le cours de la navigation d’Énée. Il feint qu’après le départ du héros troyen, Junon va trouver le roi des vents, et lui demande d’exciter une tempête pour faire périr le fils de Vénus et ses compagnons. Éole cède aux desirs de la reine des dieux. La flotte d’Énée auroit été submergée dans les flots, si Neptune n’eût calmé l’orage, et fait rentrer les vents dans leur antre. Cependant Vénus s’adresse à Jupiter, et lui rappelle ses promesses en faveur du pieux Énée. Jupiter assure de nouveau à Vénus que son fils arrivera heureusement en Italie, où sa postérité doit régner. Mercure est envoyé à Carthage pour disposer la reine Didon à recevoir favorablement Énée. Le prince passe quelque temps à la cour de cette reine ; il lui fait le récit du siége et de la ruine de Troie. Didon s’efforce de retenir Énée auprès d’elle. Mais Jupiter ordonne au héros de partir et de continuer sa route. Il relâche à Drépane en Italie, où il célèbre des jeux funèbres sur la tombe de son père Anchise. Il descend ensuite aux enfers, conduit par la Sibylle. Anchise lui révèle sa destinée et celle de ses descendants. De retour des enfers, il vient camper sur les bords du Tibre. Là, l’accomplissement des oracles lui fait connoître que ses courses sont terminées.
D. Didon et Énée ont-ils vécu réellement dans le même temps ?
R. Non. Énée vivoit plus de 500 ans avant Didon. n’a imaginé la passion de Didon pour Énée, qu’afin de décrire les fameux intérêts qui ont si long-temps divisé Rome et Carthage.
Didon, fille de Bélus, roi de Tyr, avoit épousé Sichée, le plus riche de touts les Phéniciens. Pygmalion, frère de Didon, entraîné par la passion des richesses, assassina Sichée au pied des autels. Il cacha long-temps son crime à sa sœur. Mais Sichée, privé des honneurs de la sépulture, apparut à Didon, lui révéla le crime de Pygmalion, et l’engagea à prendre la fuite. Didon rassembla touts ceux qui haïssoient ou craignoient le tyran, et partit avec les richesses de Sichée et celles de l’avare Pygmalion. Elle aborda en Afrique, et y bâtit Carthage. Lorsqu’Énée l’eut quittée, elle s’abandonna au désespoir, et se donna la mort. Tel est le récit de , qui a donné lieu à une épigramme du poëte latin , ainsi traduite en vers françois :
Pauvre Didon, ou t’a réduiteDe tes maris le triste sort ?L’un, en mourant cause ta fuite ;L’autre, en fuyant cause ta mort.
D. Récitez-nous les beaux vers dans lesquels le traducteur de a si bien rendu les fureurs de Didon après le départ d’Énée, et la haine qui doit diviser à jamais Rome et Carthage.
R. Les voici :
L’Aurore abandonnoit la couche de Tithon,Et la Nuit pâlissoit de son premier rayon :Didon, du haut des tours, jetant les yeux sur l’onde,Les voit voguer au gré du vent qui les seconde.Le rivage désert, les ports abandonnés,Frappent d’un calme affreux ses regards consternés.Aussitôt, arrachant sa blonde chevelure,Se meurtrissant le sein : « O dieux ! quoi ! ce parjure,» Quoi ! ce lâche étranger aura trahi mes feux,» Aura bravé mon sceptre, et fuira de ces lieux !» Il fuit ; et mes sujets ne s’arment pas encore !» Ils ne poursuivent pas un traître que j’abhorre !» Partez, courez, volez, montez sur ces vaisseaux :» Des voiles, des rameurs, des armes, des flambeaux !» Que dis-je ? où suis-je ? hélas ! et quel transport m’égare ?» Malheureuse Didon ! tu le hais, le barbare :» II falloit le haïr, quand ce monstre imposteur» Vint partager ton trône et séduire ton cœur.» Voilà donc cette foi, cette vertu sévère,» Ce fils qui se courba noblement sous son père,» Cet appui des Troyens, ce sauveur de ses dieux !» Ah ciel ! lorsque l’ingrat s’échappoit de ces lieux,» Ne pouvois-je saisir, déchirer le parjure,» Donner à ses lambeaux la mer pour sépulture,» Ou massacrer son peuple, ou de ma propre main» Lui faire de son fils un horrible festin» Mais le danger devoit arrêter ma furie…» Le danger ! en est-il alors qu’on hait la vie ?» J’aurois saisi le fer, allumé les flambeaux,» Ravagé tout son camp, brûlé touts ses vaisseaux,» Submergé ses sujets, égorgé l’infidelle,» Et son fils, et sa race, et moi-même après elle :» Soleil, dont les regards embrassent l’univers !» Reine des dieux, témoin de mes affreux revers !» Triple Hécate, pour qui dans l’horreur des ténèbres» Retentissent les airs de hurlements funèbres !» Pâles filles du Styx ! vous touts, lugubres dieux !» Dieux de Didon mourante, écoutez donc mes vœux !» S’il faut qu’enfin ce monstre, échappant au naufrage,» Soit poussé dans le port, jeté sur le rivage,» Si c’est l’arrêt du sort, la volonté des cieux ;» Que du moins, assailli d’un peuple audacieux,» Errant dans les climats où son destin l’exile,» Implorant des secours, mendiant un asile,» Redemandant son fils arraché de ses bras,» De ses plus chers amis il pleure le trépas !» Qu’une honteuse paix suive une guerre affreuse ;» Qu’au moment de régner, une mort malheureuse» L’enlève avant le temps ! qu’il meure sans secours,» Et que son corps sanglant reste en proie aux vautours !» Voilà mon dernier vœu : du courroux qui m’enflamme,» Ainsi le dernier cri s’échappe avec mon ame.» Et toi, mon peuple, et toi, prends son peuple en horreur :» Didon au lit de mort te lègue sa fureur ;» En tribut à ta reine offre un sang qu’elle abhorre :» C’est ainsi que mon ombre exige qu’on l’honore.» Sors de ma cendre, sors, prends la flamme et le fer,» Toi qui dois me venger des enfants de Teucer !» Que le peuple latin, que le fils de Carthage,» Opposés par les lieux, le soient plus par leur rage !» Que de leurs ports jaloux, que de leurs murs rivaux,» Soldats contre soldats, vaisseaux contre vaisseaux,» Courent ensanglanter et la mer et la terre !» Qu’une haine éternelle éternise la guerre !» Que l’épuisement seul accorde le pardon !» Énée est à jamais l’ennemi de Didon :Entre son peuple et toi, point d’accord, point de grâce !» Que la guerre détruise, et que la paix menace !» Que ses derniers neveux s’arment contre les miens !» Que mes derniers neveux s’acharnent sur les siens ! »(Trad. de M. .)
Des sept merveilles du monde. §
Demande. Qu’appelez-vous les sept merveilles du monde ?
Réponse. Ce sont sept édifices ou monuments, qui ont fait en tout temps l’admiration des hommes.
D. Quels sont ces monuments ?
R. Ce sont les murs et les jardins de Babylone, le phare d’Alexandrie, le mausolée, le colosse de Rhodes, le temple de Diane, le Jupiter Olympien, et les pyramides d’Égypte.
Les murs et les jardins de Babylone. §
D. A qui cette merveille est-elle attribuée ?
R. A Sémiramis, reine de Babylone, qui monta sur le trône l’an 2164 avant Jésus-Christ. Elle s’immortalisa par ces magnifiques ouvrages, encore plus que par sa valeur extraordinaire.
Que la reine en ces lieux brillants de sa splendeur,De son puissant génie imprime la grandeur !Quel art a pu former ces enceintes profondes,Ou l’Euphrate égaré porte en tribut ses ondes !Ce temple, ces jardins dans les airs soutenus,Ce vaste mausolée où repose Ninus ?( .)
D. Qu’est-ce que les jardins de Babylone avoient de remarquable ?
R. Ils étoient d’une beauté surprenante, très-vastes, et soutenus en l’air par des colonnes.
D. En quoi consistoit la beauté des murs de Babylone ?
R. Ces murs étoient d’une hauteur et d’une épaisseur étonnantes. Ils avoient quatre-vingt-sept pieds d’épaisseur, trois cent cinquante pieds de hauteur ; et quatre cent quatre-vingts stades (vingt lieues) de circuit. Ils formoient un carré parfait dont chaque côté étoit de cent vingt stades ou cinq lieues. Chaque côté avoit vingt-cinq portes : ce qui faisoit en tout cent portes. Toutes ces portes étoient d’airain massif ; d’où vient que lorsque Dieu promit à Cyrus la conquête de Babylone, il lui dit ; (Isaïe, chap. 25)
Je romprai les portes d’airain.
Le phare d’Alexandrie. §
D. Faites-nous connoître le phare d’Alexandrie.
R. C’étoit un superbe édifice qui fut élevé par le célèbre architecte , natif de Gnide, d’après l’ordre de Ptolomée Philadelphe, roi d’Égypte. Ce monument, dont il ne reste plus aujourd’hui que quelques débris, consistoit en un palais de marbre blanc, au-dessus duquel s’élevoit à une hauteur prodigieuse, une tour carrée, aussi de marbre blanc, avec des galeries placées les unes au-dessus des autres et formées par de belles colonnes. Au haut de la tour, on allumoit touts les soirs un fanal pour éclairer l’entrée du port. Quelques-uns prétendent que de là l’on découvroit touts les vaisseaux qui abordoient à l’île de Rhodes, éloignée de deux cents lieues.
Le Mausolée. §
D. Que signifie le mot mausolée ?
R. On a donné ce nom à touts les tombeaux magnifiques. Il vient du roi Mausole, à qui Artémise, son épouse, reine de Carie, fit élever un superbe tombeau, dans la ville d’Halycarnasse, capitale du royaume, entre le palais du roi et le temple de Vénus. Ce tombeau fut appelé Mausolée, du nom de celui à qui il étoit consacré. Artémise ne vit point la fin de cet ouvrage. Elle mourut du chagrin que lui causa la perte de son mari, l’an 1351 avant J.-C.
Le colosse de Rhodes. §
D. Dites ce que c’étoit que le colosse de Rhodes.
R. C’étoit une statue d’airain qui représentoit Apollon. Elle étoit placée à l’entrée du port de Rhodes, les deux pieds sur les rochers. La hauteur de cette statue étoit si prodigieuse, que les vaisseaux passoient a la voile entre ses jambes, et qu’un homme pouvoit à peine embrasser un de ses pouces. On dit qu’elle avoit cent cinq pieds de haut.
D. Comment ce colosse fut-il renversé ?
R. Il fut renversé par un tremblement de terre, cinquante-six ans après qu’il eut été construit. Un calife des Sarrasins vendit les débris à un marchand juif, qui en chargea neuf cents chameaux.
D. Par qui le colosse de Rhodes avoit-il été élevé ?
R. Par , sculpteur lydien, disciple de . Il y employa douze ans.
Le temple de Diane. §
D. Par qui fut bâti le temple de Diane ?
R. Il fut bâti par , architecte grec, et par son fils. II étoit soutenu par cent vingt-sept colonnes de soixante pieds, dont chacune avoit été donnée par un souverain. La charpente étoit de cèdre, et les portes de cyprès. Après qu’il eut été brûlé par Erostrate, il fut remplacé par un autre qui avoit quatre cent vingt-cinq pieds de longueur sur deux cent vingt de largeur, et qui surpassoit, dit-on, le premier en magnificence. Il reste de ce temple quelques fragments qui donnent l’idée d’une sculpture riche et de bon goût.
Le Jupiter Olympien. §
D. Qu’entendez-vous par le Jupiter Olympien ?
R. C’est la statue de ce dieu, qui étoit placée dans le temple d’Olympie, ville d’Élide, située entre le mont Ossa et le mont Olympe.
D. Qui avoit fait cette statue ?
R., sculpteur d’Athènes, fit cette statue qui fut regardée comme un prodige. Il n’oublia rien pour lui donner la dernière perfection. Avant que de l’achever entièrement, il l’exposa aux yeux du public, se tenant caché derrière une porte, d’où il entendoit le jugement des connoisseurs ou de ceux qui croyoient l’être. Il profita de toutes les critiques judicieuses, persuadé que plusieurs yeux valent mieux qu’un seul.
D. Faites-nous la description de ce monument.
R. La statue étoit d’or et d’ivoire, haute de soixante pieds et d’une grosseur proportionnée. Elle représentoit le dieu assis sur un trône d’or et d’ivoire enrichi de pierres précieuses. Il portoit sur la tête une couronne qui sembloit être de branches d’olivier. Il tenoit à la main droite une victoire d’or et d’ivoire ; à la gauche, un sceptre surmonté d’un aigle. La chaussure et le manteau étoient d’or.
Le temple pouvoit lui-même passer pour une merveille. Il étoit enrichi de tout ce que la peinture et la sculpture pouvoient offrir de plus rare et de plus précieux ; les plus beaux marbres, le bronze, l’or et l’ivoire décoroient l’intérieur de ce superbe édifice.
Les pyramides d’Égypte. §
D. Par qui les pyramides d’Égypte furent-elles élevées ?
R. Par les rois d’Égypte. Ce sont des colosses d’architecture, que l’on voit à quelque distance de Memphis et dans le voisinage du grand Caire. Les pyramides subsistent depuis 4000 ans ; elles servoient de sépulture aux rois d’Égypte. Il y en a trois qui étonnent l’imagination.
Les sept sages de la Grèce. §
Demande. Dites-nous les noms des sept sages de la Grèce.
Réponse. Le premier étoit ; le deuxième ; le troisième ; le quatrième , le cinquième ; le sixième ; le septième Périandre.
. §
D. Faites connoître .
R., le premier des sept sages de la Grèce, naquit à Milet, vers l’an 640 avant Jésus-Christ, d’une famille illustre. Pour profiter des lumières de ce qu’il y avoit alors de plus habiles gens, il fit plusieurs voyages, selon la coutume des anciens. Il s’arrêta long-temps en Égypte, où il étudia, sous les prêtres de Memphis, la géométrie, l’astronomie, et la philosophie. Il fonda une secte de philosophes, appelée la secte Ionique.
Il recommandoit sans cesse à ses disciples de vivre dans une douce union.
« Ne vous haïssez point, leur disoit-il, parce que vous pensez différemment les uns des autres ; mais aimez-vous plutôt, parce qu’il est impossible que, dans cette variété de sentiments, il n’y ait quelque point fixe ou touts les hommes viennent se réunir. »
On attribue à , plusieurs sentences dont les principales sont :
I. Il ne faut rien dire à personne dont il puisse se servir pour nous nuire ; il faut vivre avec nos amis, comme s’ils pouvoient devenir nos ennemis.
II. Ce qu’il y a de plus ancien, c’est Dieu, car il est incréé ; de plus beau, le monde, parce qu’il est l’ouvrage de Dieu ; de plus grand, l’espace, car il contient tout ce qui a été créé ; de plus prompt, l’esprit ; de plus fort, la nécessité ; de plus sage, le temps, car il apprend à le devenir ; de plus constant, l’espérance, qui reste seule à l’homme, quand il a tout perdu ; de meilleur, la vertu, sans laquelle il n’y a rien de bon,
III. La chose la plus difficile du monde est de se connoître soi-même ; la plus facile, de conseiller les autres ; et la plus douce, l’accomplissement de ses desirs.
IV. Pour bien vivre, il faut s’abstenir des choses que l’on trouve répréhensibles dans les autres.
V. La félicité du corps consiste dans la santé, et celle de l’esprit dans le savoir.
mourut à quatre-vingt-dix ans, sans avoir été marié. Sa mère le pressa en vain de prendre une femme. Il lui répondit, lorsqu’il étoit encore jeune :
Il n’est pas encore temps
; et lorsqu’il fut sur le retour :
Il n’est plus temps.
. §
D. Que sait-on de ?
R. étoit éphore de Sparte, vers l’an 556 avant Jésus-Christ. Il mena une vie toujours conforme à ses préceptes : il pensoit avec une grande justesse. Il répondit à quelqu’un qui lui demandoit ce qu’il y avoit, de plus difficile : —
Garder le secret, savoir employer le temps, et souffrir les injures sans murmurer
.
Il avoit coutume de dire que,
« comme les pierres de touche servent à éprouver l’or, de même l’or répandu parmi les hommes, étoit la pierre de touche des gens de bien et des méchants. »
Voici encore quelques-unes de ses maximes : —
Honore les vieillards.
—
Ne médis jamais des morts.
—
Sois plutôt jaloux d’être estimé que craint.
C’est lui qui fit graver en lettres d’or ces maximes au temple de Delphes :
Connois-toi toi-même, et ne desire rien de trop avantageux.
On dit que mourut de joie, en embrassant soit fils qui avoit remporté le prix du ceste aux jeux olympiques.
. §
D. Que nous apprendrez-vous de ?
R. naquit à Athènes vers l’an 639 avant Jésus-Christ. Après avoir acquis les connoissances nécessaires à un philosophe et à un politique, il se mit à voyager dans toute la Grèce. De retour dans sa patrie, il la trouva déchirée par la guerre civile. Athènes tourna les yeux sur , et le nomma archonte et souverain législateur. Il publia alors ces lois que la postérité a toujours regardées comme le plus beau monument d’Athènes.
Les gens de bien devroient avoir continuellement dans le cœur et sur les lèvres cette maxime de
:
Laissons-en partage au reste des mortels les richesses ; mais que les vertus soient le nôtre.
, voyant un de ses amis plongé dans une mortelle tristesse, le mena sur la citadelle d’Athènes, et l’invita à promener ses yeux sur touts les bâtiments de la ville.
« Figurez-vous maintenant, lui dit-il, si vous le pouvez, combien de deuils et de chagrins logèrent autrefois sous ces toits, combien il y en séjourne aujourd’hui, et combien dans la suite des siècles il y en doit habiter. Cessez donc de pleurer vos disgrâces, comme si elles vous étoient particulières, puisqu’elles vous sont communes avec touts les hommes »
. §
D. Quand vécut ?
R., fils d’Evagoras, étoit contemporain et ami de
. On ne le connoît guère que par ses maximes. Il recommandoit
de ne point s’enorgueillir dans la prospérité ; de ne point s’abattre dans l’affliction ; d’obliger ses amis pour se rattacher davantage, et ses ennemis pour en faire des amis
. Il dit aussi :
Heureux le prince qui ne croit rien de ce que lui disent les courtisans !
Il mourut vers l’an 560 avant Jésus-Christ, dans sa soixante-dixième année.
. §
D. Qu’est-ce que l’histoire nous raconte de ?
R. Il étoit de Mytilène, ville de l’île de Lesbos. Il chassa de sa patrie le tyran Méléagre. Ses concitoyens lui donnèrent la souveraineté de leur ville. Il les gouverna en philosophe et en père, leur donna des lois sages qu’il mit en vers, et se démit ensuite du souverain pouvoir.
Ses maximes étoient celles-ci :
I. Il ne faut point publier ce qu’on a dessein de faire, afin que si l’on n’en vient point à bout, on n’ait pas le chagrin de se voir moqué.
II. Qui ne sait pas se taire, ne sait pas parler.
III. Prévoyez les malheurs pour les empêcher ; mais dès qu’ils sont arrivés, sachez les supporter.
IV. En temps de prospérité, acquérez des amis, et faites-en l’essai dans l’adversité.
V. Tel vous serez envers votre père, tels seront envers vous vos enfants
mourut l’an 579 avant Jésus-Christ, à soixante-dix ans.
. §
D. Dans quelle ville étoit-il né ?
R. étoit né à Priène, ville de Carie. Il florissoit vers l’an 608 avant Jésus-Christ. Quelqu’un lui ayant demandé, ce qu’il y avoit de plus difficile à faire ? Il répondit que
c’étoit de supporter un revers de fortune
.
« L’espérance, disoit-il encore, est un pavot qui endort nos peines ; mais l’amour du gain les réveille. »
On rapporte que, durant le siége de Priène sa patrie, il répondit à quelqu’un qui lui demandoit pourquoi il étoit le seul qui se retiroit de la ville sans rien emporter ? —
Je porte tout avec moi.
Périandre. §
D. Que nous direz-vous de Périandre ?
R. Périandre étoit un tyran de Corinthe. Il fut mis par la flatterie au nombre des sept sages de la Grèce. Ce sage étoit un monstre. Mais les historiens n’ont vu en lui que le politique, le savant, le protecteur des gens de lettres ; ils n’ont pas vu le meurtrier, le débauché, le tyran. Il vivoit environ 630 ans avant Jésus-Christ.
Fin de la mythologie.
Exercice sur l’apologue §
Demande. Qu’est-ce que l’apologue ?
R. L’apologue ou la fable est une instruction déguisée sous l’allégorie d’une action. On peut regarder l’apologue comme une espèce de petit drame qui a son exposition, son nœud, son dénouement.
D. Quels sont les acteurs employés dans l’apologue ?
R. Ce sont des animaux, des dieux, des hommes, des arbres, etc. Le Fabuliste peut aussi personnifier les vertus et les vices, et animer, selon ses besoins, touts les êtres.
D. Quelle est l’utilité de l’apologue ?
R. L’apologue a dû plaire, et a plu en effet en tout temps et en tout pays. L’amour propre est ménagé dans l’instruction, et l’esprit est exercé par l’allégorie. Les hommes n’aimant point les préceptes directs, on ne doit leur annoncer la vérité qu’avec précaution. La fable est donc une philosophie déguisée, qui ne badine que pour instruire, et qui instruit toujours d’autant mieux qu’elle amuse.
nous a donné sur ce sujet une très-jolie fable que je vais rapporter ici :
La Fable et la Vérité.
La Vérité toute nueSortit un jour de son puits,Ses attraits par le temps étoient un peu détruits ;Jeunes et vieux fuyoient sa vue.La pauvre Vérité restoit là morfondue,Sans trouver un asile où pouvoir habiter.A ses yeux vient se présenterLa Fable, richement têtue,Portant plumes et diamants,La plupart faux, mais très-brillants.— Eh ! vous voilà ! bonjour, dit-elle :Que faites-vous ici seule sur un chemin ?— La Vérité répond : vous le voyez, je gèle ;Aux passants je demande en vain.De me donner une retraite,Je leur fais peur à touts. Hélas ! je le vois bien,Vieille femme n’obtient plus rien.— Vous êtes pourtant ma cadette,Dit la Fable, et, sans vanité,Par-tout je suis fort bien reçue.Mais aussi, dame Vérité,Pourquoi vous montrer toute nue ?Cela n’est pas adroit. Tenez, arrangeons-nous ;Qu’un même intérêt nous rassemble :Venez sous mon manteau ; nous marcherons ensemble.Chez le sage, à cause de vous,Je ne serai point rebutée ;A cause de moi, chez les fouxVous ne serez point maltraitée.Servant par ce moyen chacun selon son goût,Grâce à votre raison et grâce à ma folie,Vous verrez, ma sœur, que par-toutNous passerons de compagnie.
D. Quel doit être le style de la fable ?
R. Le style de la fable doit être simple, familier, riant, gracieux, naturel, et sur-tout naïf. C’est principalement par la naïveté du récit et du style, que
l’emporte tant sur les autres Fabulistes.
« Non-seulement, dit
,
a ouï dire ce qu’il raconte, mais il l’a vu, il croit le voir encore. Ce n’est pas un poëte qui imagine, ce n’est pas un conteur qui plaisante ; c’est un témoin présent à l’action, et qui veut vous y rendre présent vous-même : son érudition, son éloquence, sa philosophie, sa politique, tout ce qu’il a d’imagination, de mémoire, de sentiment, il met tout en œuvre de la meilleure foi du monde, pour vous persuader : et c’est cet air de bonne foi, c’est le sérieux avec lequel il mêle les plus grandes choses avec les plus petites, c’est l’importance qu’il attache à des jeux d’enfants, c’est l’intérêt qu’il prend pour un lapin et une belette, qui font qu’on est tenté de s’écrier à chaque instant : le bon homme ! »
D. Voulez-vous nous dire quels sont les plus célèbres Fabulistes ?
R. Les Fabulistes les plus célèbres sont, parmi les anciens, , esclave phrygien, qui passe pour l’inventeur des fables, et , qui fut esclave aussi-bien qu’ ; parmi les modernes, tient le premier rang. On peut placer après lui, mais à une grande distance, , , , , l’abbé et quelques autres.
D. Les leçons de la fable peuvent-elles être pareillement utiles à la jeunesse ?
R. Oui ; les jeunes gens trouvent dans la fable des préceptes également propres à former l’esprit et le cœur. nous dit :
Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons.Ce qu’ils disent s’adresse à touts tant que nous sommes :Je me sers d’animaux pour instruire les hommes.
Et s’exprime ainsi :
Nous pouvons touts tant que nous sommes,Trouver ici de quoi corriger nos défauts,Et, disciples des animaux,En apprendre à devenir hommes.
Ainsi, le paresseux peut lire ses devoirs dans la fable de la Fourmi et de la Cigale ; la nécessité du travail et le besoin d’acquérir des connoissances, se prouvent par l’apologue du différent survenu entre un savant et un ignorant. Écoutons :
L’Avantage de la science.
Entre deux bourgeois d’une villeS’émut jadis un différent.L’un étoit pauvre, mais habile ;L’autre riche, mais ignorant.Celui-ci sur son concurrentVouloit emporter l’avantage ;Prétendoit que tout homme sageÉtoit tenu de l’honorer.C’étoit tout homme sot : car pourquoi révérerDes biens dépourvus de mérite ?La raison m’en semble petite.Mon ami, disoit-il souvent.Au savant,Vous vous croyez considérable ;Mais, dites-moi, tenez-vous table ?Que sert à vos pareils de lire incessamment !Ils sont toujours logés à la troisième chambre,Vêtus au mois de juin comme au mois de décembre,Ayant pour tout laquais leur ombre seulement,La république a bien affaireDe gens qui ne dépensent rien !Je ne sais d’homme nécessaire,Que celui dont le luxe épand beaucoup de bien.Nous en usons, Dieu sait : notre plaisir occupeL’artisan, le vendeur, celui qui fait la jupe,Et celle qui la porte, et vous, qui dédiezA messieurs les gens de financeDe méchants livres bien payés.Ces mots remplis d’impertinenceEurent le sort qu’ils méritoient.L’homme lettré se tut : il avoit trop à dire.La guerre le vengea bien mieux qu’une satire.Mars26 détruisit le lieu que nos gens habitoient.L’un et l’autre quitta sa ville,L’ignorant resta sans asile,Il reçut par-tout des mépris ;L’autre reçut par-tout quelque faveur nouvelle.Cela décida leur querelle.
Laissez dire les sots, le savoir a son prix.
D. Continuez de nous faire, connoître le profit que les jeunes gens peuvent tirer des fables.
R. La jeunesse est imprudente, téméraire, et ne sait point prévoir le danger. Souvent elle contracte des liaisons qui la conduisent à sa perte. La fable du Renard et du Bouc est bien propre à corriger les jeunes gens de ce défaut. La voici :
Le Renard et le Bouc.
Capitaine Renard alloit de compagnieAvec son ami Bouc des plus haut encornés.Celui-ci ne voyoit pas plus loin que son nez ;L’autre étoit passé maître en fait de tromperie.La soif les obligea de descendre en un puits.Là, chacun d’eux se désaltère.Après qu’abondamment touts deux en eurent pris,Le Renard dit au Bouc : Que ferons-nous, compère ?Ce n’est pas tout de boire, il faut sortir d’ici.Lève tes pieds en haut, et tes cornes aussi :Mets-les contre le mur. Le long de son échineJe grimperai premièrement ;Puis, sur tes cornes m’élevant,A l’aide de cette machine,De ce lieu ci je sortiraiAprès quoi je t’en tirerai.— Par ma barbe, dit l’autre, il est bon ; et je loueLes gens bien sensés comme toi.Je n’aurois jamais, quant à moi,Trouvé ce secret, je l’avoue.Le Renard sort du puits, laisse son compagnon ;Et vous lui fait un beau sermonPour l’exhorter à patience.Si le ciel t’eût, dit-il, donné par excellence.Autant de jugement que de barbe au menton,Tu n’aurois pas, à la légère,Descendu dans ce puits. Or, adieu, j’en suis hors :Tâche de t’en tirer, et fais touts tes efforts ;Car, pour moi, j’ai certaine affaireQui ne me permet pas d’arrêter en chemin.
En toute chose il faut considérer la fin.( .)
D. Le danger des mauvaises compagnies est donc bien à redouter pour la jeunesse ?
R. Oui. nous dit encore à ce sujet :
Il faut faire aux méchants, guerre continuelle.(Liv. 3, fab. 12.)
On acquiert des mœurs avec les personnes qui en ont : ou prend des manières polies et gracieuses avec les gens aimables et bien élevés : on étend son esprit et ses connoissances avec les hommes spirituels et savants. Les jeunes gens doivent donc s’attacher aux personnes qui ont de la vertu et du mérite, s’entretenir avec elles le plus souvent qu’ils pourront, fixer continuellement sur elles leurs regards. C’est à l’aspect des chefs-d’œuvre de et de , que les jeunes peintres s’enflamment et redoublent leurs efforts. De même, la jeunesse, en contemplant les modèles qu’une société choisie offrira sans cesse à ses yeux, sentira son cœur s’échauffer d’une douce émulation, et brûler du desir de les imiter.
D. Dites-nous la fable dans laquelle nous enseigne très-ingénieusement le respect que nous devons à nos parents et à la vieillesse.
R. La voici.
La Carpe et les Carpillons.
Prenez garde, mes fils, côtoyez moins le bord,Suivez le fond de la rivière ;Craignez la ligne meurtrière,Ou l’épervier plus dangereux encor.C’est ainsi que parloit une Carpe de SeineA de jeunes poissons qui l’écoutoient à peine.C’étoit au mois d’avril : les neiges, les glaçons,Fondus par les zéphyrs, descendoient des montagnes ;Le fleuve enflé par eux s’élève à gros bouillons,Et déborde dans les campagnes.Ah ! ah ! crioient les Carpillons,Qu’en dis-tu, Carpe radoteuse ?Crains-tu pour nous les hameçons ?Nous voilà citoyens de la mer orageuse ;Regarde : on ne voit plus que les eaux et le ciel ;Les arbres sont cachés sous l’onde ;Nous sommes les maîtres du monde ;C’est le déluge universel.— Ne croyez pas cela, répond la vieille mère ;Pour que l’eau se retire il ne faut qu’un instant :Ne vous éloignez point, et, de peur d’accident,Suivez, suivez toujours le fond de la rivière.— Bah ! disent les poissons, tu répètes toujoursMêmes discours.Adieu, nous allons voir notre nouveau domaine.Parlant ainsi, nos étourdisSortent touts du lit de la Seine,El s’en vont dans les eaux qui couvrent le pays.Qu’arriva-t-il ? les eaux se retirèrent,Et les Carpillons demeurèrent ;Bientôt ils furent pris,Et frits.Pourquoi quittoient-ils la rivière ?Pourquoi ? Je le sais trop, hélas !C’est qu’on se croit toujours plus sage que sa mère,C’est qu’on veut sortir de sa sphère,C’est que… c’est que… je ne finirois pas.
D. Que remarquez-vous sur l’obligation où sont les enfants d’honorer leurs parents ?
R. Je remarque que ce devoir a été gravé dans nos cœurs par la nature même, et que Dieu nous en a fait un commandement exprès. C’est même le seul commandement à l’observation duquel il ait attaché une récompense dès cette vie.
Père et mère honorerasAfin que tu vives longuement.
Rien n’est plus particulièrement recommandé dans l’Écriture-Sainte que l’amour des parents. L’Ecclésiastique, l’un des plus beaux livres de morale, nous dit :
« Écoutez, enfants, les avis de votre père, et suivez-les, afin que vous soyez sauvés : car Dieu a rendu le père vénérable aux enfants, et il a affermi sur eux l’autorité de la mère. Celui qui honore sa mère, est comme un homme qui amasse un trésor : celui qui honore son père, recevra lui-même de la joie de ses enfants, et il sera exaucé au jour de sa prière. Celui qui craint le Seigneur, honore son père et sa mère, et il servira comme ses maîtres les auteurs de ses jours. »
D. Comment devons-nous honorer nos parents ?
R. Nous devons à nos parents le respect, l’amour, l’obéissance et les services. A quelque dignité qu’on soit élevé, on doit toujours avoir du respect pour ceux de qui on a reçu la vie, et il faut leur en donner des marques extérieures, en les saluant avec honneur, en leur parlant avec soumission, en les visitant avec amitié, en les prévenant par de certaines attentions qui les flatteront d’autant plus, qu’elles seront des hommages libres et publics.
Mais c’est sur-tout dans leur vieillesse que les parents ont le plus besoin du secours de leurs enfants ; et c’est alors que ceux-ci doivent redoubler de zèle et d’affection
. « Mon fils, dit le Sage, prenez soin de votre père dans sa vieillesse, et ne l’attristez pas durant sa vie. Si sa raison s’affoiblit, supportez-le, et ne le méprisez point : car la charité que vous aurez eue pour votre père, ne sera pas mise en oubli ; et Dieu vous récompensera pour avoir supporté les défauts de votre mère. Il vous établira dans sa justice ; il se souviendra de vous au jour de l’affliction ; et vos péchés seront anéantis comme la glace qui se fond en un jour serein. Que celui qui abandonne son père, s’acquiert un mauvais renom ! et combien est maudit de Dieu celui qui aigrit l’esprit de sa mère ! »
D. Récitez le joli conte de sur l’amour filial.
R. Le voici.
La Mère et ses deux fils.
Écoutez un mot, mes amis,Qui me paroît beau de tendresse :D’une veuve entre ses deux filsL’un de huit ans, l’autre de dix,Les soins se partageoient sans cesse.A leur tour, ces objets chérisA celle qui les intéresseRendoient caresse pour caresse.Maman, lui dit un jour l’aîné,Vous m’avez sûrement donnéDes preuves d’un amour extrême ;Malgré tout votre attachement,Vous ne pouvez pas cependantM’aimer autant que je vous aime.— Quoi ! mon fils, de mes sentimentsMéconnois-t u le caractère ?— Non ; mais vous avez deux enfants ;Moi, je n’ai qu’une mère !
D. Nos obligations envers nos parents se terminent-elles avec leur vie ?
R. Non. Si l’on doit honorer et assister ses parents durant leur vie, il ne faut pas non plus les oublier, lorsqu’ils ont cessé de vivre. Faites-leur des obsèques selon votre rang et votre état, pour honorer leur mémoire ; mais ne vous en tenez pas là. Les magnifiques funérailles sont pour les vivants, les prières seules soulagent les morts.
Discours d’Énée à ses compagnons pour célébrer l’anniversaire de la mort de son père.
Troyens, l’année entière a terminé son cours,Depuis que, dans ces lieux, de l’auteur de mes jours.J’ai déposé la cendre, et qu’à cette ombre chèreJ’ai dressé de mes mains un autel funéraire.Voici même, je crois, ce jour infortuné,Où mon père… Grands dieux, vous l’avez ordonné !Jour à jamais funeste, à jamais vénérable !Oui, que le sort pour moi toujours inexorable,Me jette dans les fers, m’exile sur les flots,Dans les sirtes déserts ou sur les mers d’Argos,Ce grand jour reverra mes mains religieusesHonorer son retour par des pompes pieuses,Et des dons solennels acquitteront mes vœux.Enfin, bénissons touts la volonté des dieux !Nous voici, sur sa tombe, et sur sa cendre même ;Nous sommes dans les ports d’un prince qui nous aime :Honorez donc Anchise, implorez donc les vents ;Et qu’ils souffrent qu’un fils, en de plus heureux temps,Dans des temples pompeux consacrés à sa gloire,Puisse ainsi touts les ans célébrer sa mémoire.Il dit, et ceint son front du myrte maternel.Chacun suit son exemple : ensuite vers l’autelIl marche environné des flots d’un peuple immense ;Au cercueil de son père il arrive en silence ;Deux fois de sang sacré, deux fois de vin nouveau,Et deux fois d’un vin pur arrose son tombeau.Il fait pleuvoir les fleurs ; il soupire et s’écrie :Salut, objet sacré ! salut, ombre chérie !Je puis donc voir encor ton pieux monument,De ma douleur, hélas ! trop vain soulagement !…Quels que soient ces états où le destin m’appelleQue m’importe sans toi ma fortune nouvelle ?Que m’importe un empire où tu ne seras pas ?Le ciel n’a pas voulu qu’en ces heureux climats,Où m’attend, me dit-on, un destin plus prospère.( , trad. de l’Énéide.)
D. Quelles sont les obligations des jeunes gens envers les vieillards ?
R. Les jeunes gens doivent respecter et honorer les vieillards.
Suspends tes pas, jeune homme, arrête,Au nom des dieux et de la loi ;Baisse profondément la tête,Un vieillard passe devant toi.
Le vieillard, dit monsieur de , est un Dieu consolateur laissé au milieu de ses enfants pour y être une image vivante du Dieu qu’ils adorent, pour leur transmettre ses bénédictions, pour les aider par ses conseils, pour les soutenir par le secours de ses encouragements et de sa tendresse touchante, lorsqu’il reçoit de leur amour et de leur reconnoissance touts les secours que ses maux peuvent réclamer. Et quel est le cœur qui ne sera pas déchiré, si le vieillard auguste et respectable est obligé de courber sa tête défaillante sons le poids de la misère ou sous celui de l’infortune ?
Jeunes gens, faites l’aumône ; mais faites-la sur-tout aux vieillards.
D. Récitez-nous le bel apologue de , intitulé le Vieillard et les trois Jeunes Hommes.
R. Le voici.
Un octogénaire plantoit.Passe encor de bâtir ; mais planter à cet âge !Disoient trois jouvenceaux, enfants du voisinage :Assurément il radotoit.Car, au nom des dieux, je vous prie,Quel fruit de ce labeur pouvez-vous recueillir ?Autant qu’un patriarche il vous faudroit vieillir.A quoi bon charger votre vieDes soins d’un avenir qui n’est pas fait pour vous ?Ne songez désormais qu’à vos erreurs passées,Quittez le long espoir et les vastes pensées :Tout cela ne convient qu’à nous.— Il ne convient pas à vous-mêmes,Repartit le vieillard. Tout établissementVient tard et dure peu. La main des parques blêmes.De vos jours et des miens se joue également.Nos termes sont pareils par leur courte durée.Qui de nous des clartés de la voûte azuréeDoit jouir le dernier ? Est-il aucun momentQui vous puisse assurer d’un second seulement ?Mes arrière-neveux me devront cet ombrage :Hé bien ! défendez-vous au sageDe se donner des soins pour le plaisir d’autrui ?Cela même est un fruit que je goûte aujourd’hui.J’en puis jouir demain, et quelques jours encore ;Je puis enfin compter l’aurorePlus d’une fois sur vos tombeaux.Le vieillard eut raison : l’un des trois jouvenceauxSe noya dès le port, allant à l’Amérique ;L’autre, afin de monter aux grandes dignités,Dans les emplois de Mars servant la république,Par un coup imprévu vit ses jours emportés ;Le troisième tomba d’un arbreQue lui-même il vouloit enter :Et pleurés du vieillard, il grava sur leur marbreCe que je viens de raconter.
D. Les jeunes gens doivent-ils commencer de bonne heure à s’appliquer au bien ?
R. Oui. Rien n’importe tant à la jeunesse que de se plier au bien dès ses plus tendres années et de contracter de bonnes habitudes. Les premiers penchants se perdent difficilement ; et lorsqu’une fois on est entré dans la voie du bien ou du mal, on en sort rarement.
Tant le naturel a de force :Il se moque de tout ; certain âge accompli,Le vase est imbibé, l’étoffe a pris son pli.En vain de son train ordinaire,On le veut désaccoutumer.Quelque chose qu’on puisse faire,On ne sauroit le réformer.( , liv. 2, fab. 16.)
D. Les jeunes demoiselles ont-elles pareillement intérêt de s’appliquer à l’étude ; et l’instruction leur est-elle aussi nécessaire qu’aux garçons ?
R. L’instruction est le besoin de touts ; elle est nécessaire aux femmes comme aux hommes. L’éducation des personnes du sexe, dit l’ , n’est pas moins importante que l’autre. Car on ne sauroit dire combien les femmes influent en bien ou en mal sur la société.
Cependant les hommes, autant par dédain que par supériorité, condamnoient autrefois les femmes à l’ignorance.
a dit que
le livre de
Don Quichotte
avoit perdu la monarchie d’Espagne, parce que le ridicule qu’il a répandu sur la valeur que cette nation possédoit auparavant dans un degré si éminent, en a amolli et énervé le courage
.
, en France, a produit un mal presque aussi grand par sa comédie des Femmes savantes. Depuis ce temps-là, on avoit attaché presque autant de honte au savoir des femmes qu’aux vices qui leur sont les plus défendus. Le ridicule paroît plus redoutable que le déshonneur même. De là l’ignorance et l’inutilité auxquelles les femmes étoient condamnées, et qui ont si souvent excité les plaintes et les reproches des hommes sages et des bons législateurs.
Ce sexe que nous élevons si mal, et qui écrit si bien !
disoit
. Mais c’est sur-tout
qu’il faut entendre sur ce sujet.
« Les femmes, dit-il (liv. 23, c. 9), ont un esprit qui n’ose penser, un cœur qui n’ose sentir, des yeux qui n’osent voir, des oreilles qui n’osent entendre ; elles ne se présentent que pour se montrer stupides ; elles sont condamnées sans relâche à des bagatelles et à des préceptes. »
, dans les Avis d’une mère à sa fille, s’exprime ainsi :
« On a dans touts les temps négligé l’éducation des filles : l’on n’a d’attention que pour les hommes ; et, comme si les femmes étoient une espèce à part, on les abandonne à elles-mêmes, sans secours, sans penser qu’elles composent la moitié du monde ; qu’on est uni à elles nécessairement par les alliances ; qu’elles font le bonheur ou le malheur des hommes, qui toujours sentent le besoin de les avoir raisonnables ; que c’est par elles que les maisons s’élèvent ou se détruisent ; que l’éducation leur est confiée dans la première jeunesse, temps où les impressions sont plus vives et plus profondes… Rien n’est donc si mal entendu que l’éducation qu’on donne aux jeunes personnes. »
Et dans son Traité de la vieillesse,
dit encore :
« On ne travaille que pour les hommes ; mais pour les femmes, dans touts les âges, on les abandonne à elles-mêmes : on néglige leur éducation dans la jeunesse ; dans la suite de leur vie, on les prive de soutien et d’appui pour leur vieillesse : aussi la plupart des femmes vivent sans attention et sans retour sur elles-mêmes ; dans leur jeunesse, elles sont vaines et dissipées ; et dans leur vieillesse, elles sont foibles et délaissées… Chacun perd en avançant dans l’âge, et les femmes plus que les hommes. Comme tout leur mérite consiste en agréments extérieurs, et que le temps les détruit, elles se trouvent absolument dénuées : car il y a peu de femmes dont le mérite dure plus que la beauté. Voyons s’il n’est pas possible de les remplacer, etc. »
Depuis quelques années, le besoin de mieux élever les jeunes personnes a été généralement reconnu. Déjà même la société goûte les fruits de cet heureux changement, et se réjouit de trouver dans les femmes la réunion des agréments extérieurs avec touts les charmes d’un esprit délicat et cultivé. Sans doute il ne faut point de Femmes savantes. Ainsi, l’on ne doit point se proposer pour but, dans l’éducation des jeunes personnes, d’en faire des pédantes. Mais elles doivent acquérir les connoissances nécessaires pour bien remplir les fonctions auxquelles la nature et la société les ont destinées. Elles sont appelées à être épouses et mères. Or, l’instruction leur est également nécessaire sous ce double rapport. Quel est l’homme qui pourra ne point préférer une compagne instruite à une compagne ignorante ? Une femme, il est vrai, ne doit point négliger les soins de sa maison pour ne s’occuper que d’étude et de science. Mais moins il doit lui rester de temps pour s’instruire, lorsqu’elle sera épouse et mère, plus elle doit s’occuper de son instruction dans sa jeunesse. L’ignorance est la mère du vice. Une femme instruite connoîtra toujours mieux ses devoirs, aura toujours plus de facilité pour les remplir, et fixera plus sûrement un époux, qui trouvant réunis dans sa maison les charmes du cœur et ceux de l’esprit, sera moins porté à se répandre au dehors.
La première éducation des enfants est certainement de la plus haute importance. C’est sur cette base essentielle que portera ensuite l’édifice entier de l’instruction, et par conséquent du bonheur ou du malheur de toute la vie. Or, à quelles mains plus sûres cette première éducation peut-elle être confiée qu’aux mains d’une mère ? Un père, entraîné par le soin de ses affaires, ou les devoirs de son emploi, ne peut s’en occuper. Il faut donc qu’une mère soit en état de le suppléer à cet égard. Les femmes ont donc besoin d’être instruites pour devenir des épouses vertueuses, de bonnes mères de famille.
D. Puisque vous avez établi d’une manière si incontestable la nécessité de l’instruction pour les jeunes personnes, voulez-vous nous dire maintenant quel est pour elles le meilleur mode d’éducation ? Pensez-vous que l’éducation des pensions soit préférable pour les demoiselles à l’éducation particulière et domestique ?
R. La question proposée s’écarte sans doute de notre sujet ; mais elle est si importante, qu’elle mérite bien que nous la discutions ici sérieusement.
C’est avec beaucoup de sagesse que la nature a inspiré aux parents l’amour de leurs enfants. Mais si la raison ne modère cette tendresse naturelle, elle dégénère aisément en une indulgence excessive ; les parents perdent toute espèce d’autorité sur leurs enfants, et se rendent ainsi eux-mêmes incapables de les bien élever. Figurons-nous une mère idolâtre de ses enfants, qu’elle aime pour elle-même, et qu’elle tourmente en les aimant ; un père sans cesse contredit par sa femme dans le peu qu’il ose leur dire ; l’un et l’autre n’ayant à leur égard aucune règle fixe, ni aucun principe qui leur soit commun ; les moindres paroles de ces enfants, reçues comme des oracles et répétées cent fois devant eux à qui veut les entendre, ornées de toutes les fades interprétations d’une gouvernante ; une mère toujours aux expédients pour se faire obéir, animant ses enfants, les excitant, les récompensant ou les punissant par tout ce qui peut intéresser en eux la vanité, la gourmandise, l’amour du luxe et de la parure ; tantôt les grondant, les maltraitant ; le moment d’après, les apaisant, les caressant : et par tout ce manège, leur apprenant tout à la fois, et à se révolter contre les châtiments, et à dédaigner les caresses ; cette mère ne gagnant auprès d’eux d’un côté que pour perdre encore plus de l’autre ; ne les portant à céder pour le moment que de manière à les rendre bien plus opiniâtres et plus volontaires par la suite ; ne leur ôtant un caprice que pour satisfaire une fantaisie d’une autre espèce ; et, de caprice eu caprice, de fantaisie en fantaisie, les amenant au point de ne plus rien trouver qui puisse les satisfaire ; cette mère n’exigeant presque rien en genre de devoir, et sur toute autre chose les contrariant, les gênant hors de propos, et leur demandant au-delà de leur pouvoir ; tel est le tableau que nous présente le plus souvent l’éducation domestique. A mesure que l’éducation des demoiselles se perfectionnera, les mères deviendront plus propres à élever leurs enfants, et ces tristes exemples seront moins fréquents.
D. Les inconvénients de l’éducation particulière sont graves et nombreux. Ceux de l’éducation des pensions ne le sont-ils pas autant ?
R. L’éducation des pensions a aussi ses inconvénients ; mais ils sont bien moins grands, sur-tout lorsqu’il s’agit de pensions de demoiselles. Pour justifier la préférence que nous donnons à l’éducation des pensions, et mettre quelque ordre dans la question qui nous occupe, envisageons cette question sous trois rapports différents ; sous le rapport du développement des forces du corps, sous celui de l’innocence des mœurs, et enfin sons celui des progrès de l’instruction. L’éducation publique des demoiselles, considérée sous ces trois rapports, l’emporte sur l’éducation domestique et particulière.
Trois choses paroissent sur-tout nécessaires à la santé des enfants et au développement de leurs forces, savoir, des heures réglées pour les repas et le sommeil, un air pur, et l’exercice. Or, les enfants trouvent difficilement la réunion de ces avantages dans la maison paternelle. Les affaires et les plaisirs y font varier également les heures des repas et du sommeil. Quant à un air pur, ce n’est point dans les rues sales et infectes de nos cités qu’ils peuvent en jouir. Les parents qui veulent voir les forces du corps croître et se développer promptement dans leurs enfants, ne sauroient trop se hâter de les retirer de cette atmosphère pestilentielle, pour les placer dans des maisons éloignées du centre des villes, où ils respireront un air sain, et pourront en outre se livrer, dans un jardin, à touts les exercices propres à fortifier leurs membres délicats. L’exercice est d’une indispensable nécessité pour l’accroissement des forces physiques. Vous retenez un enfant dans votre appartement, et vous voulez qu’il y soit dans un absolu repos ! Ses mouvements vous incommodent, vous donnent de l’impatience. Vous ignorez donc que le mouvement lui est aussi nécessaire que la respiration,
veut que les enfants jouent fréquemment au grand air, et il étend ce précepte aux filles comme aux garçons. Voici comme il s’explique :
« j’ose même dire ici que quoiqu’on doive avoir plus d’égard pour la beauté des filles, plus elles seront exposées à l’air, en sorte que leur visage n’en souffre aucun préjudice, plus elles seront saines et vigoureuses pour tout le reste de leur vie. »
Combien de jeunes personnes, pâles et languissantes, auroient le teint et la vigueur convenables à leur âge, si leurs parents les avoient aimées d’un amour véritable, et eussent pu se séparer d’elles, les retirer de l’intérieur des villes, pour les placer dans des maisons bien aérées, où une nourriture saine et réglée, et un exercice modéré auroient facilité en elles le développement et l’accroissement du corps !
L’éducation publique des demoiselles est plus favorable à l’innocence des mœurs. Une femme vertueuse est le plus grand des biens qu’un homme puisse obtenir sur la terre. Elle embellit pour lui les dons de la fortune, et lui en adoucit des revers. Le malheur d’être uni à une femme vicieuse est au contraire le plus grand de touts les maux qu’un homme ait à redouter. Une femme vicieuse est l’opprobre et le fléau de son époux ; elle porte le trouble et le déshonneur dans les familles ; elle rompt les nœuds les plus doux et les plus sacrés de la nature et de la société.
Mais si la vertu des femmes est si importante au bonheur des époux et au repos des familles, combien les parents ne doivent-ils pas prendre de soins pour en faire naître l’amour dans le cœur de leurs filles, dès leur plus tendre jeunesse ! De combien de précautions ne doivent-ils pas user pour empêcher que le souffle impur du vice ne ternisse la candeur de leur ame !
On doit le plus grand respect à un enfant
, a dit
. Et cependant les parents confient leurs enfants à des domestiques corrompus et grossiers, qui leur communiquent bientôt touts leurs vices. Et cependant il se permettent à eux-mêmes devant leurs enfants des discours et des actions blâmables. Sur quoi, dit
, vous devez tenir pour une vérité constante, que quelques instructions que vous donniez à vos enfants, quelques maîtres que vous mettiez auprès d’eux, rien n’aura tant d’influence sur leurs actions, que les compagnies qu’ils fréquenteront, et les exemples que vous leur donnerez. Les enfants agissent par imitation, vous ne devez point faire devant eux ce que vous ne voulez point qu’ils fassent à votre exemple. C’est des parents mêmes, a dit le vertueux
, que vient le mal, par le mauvais exemple qu’ils donnent à leurs enfants. Ceux-ci voient touts les jours et entendent des choses qu’ils devroient ignorer toute leur vie. Tout cela passe en habitude, et bientôt après en nature ; et les pauvres enfants se trouvent vicieux avant que de savoir ce que c’est que le vice.
Il faut donc éloigner de bonne heure les jeunes personnes d’un monde trop libre, dont le langage et la conduite ne peuvent que porter les plus fâcheuses atteintes à leur innocence27. C’est après avoir été formées à la vertu pendant plusieurs années dans les maisons d’éducation ; c’est après avoir été instruites des préceptes de la religion, et avoir contracté l’heureuse habitude d’en remplir les devoirs, qu’elles pourront reparoître dans la société avec moins de danger ; qu’elles se feront au contraire admirer, respecter par leur décence et leur sagesse.
Enfin, l’éducation des pensions est plus favorable aux progrès de l’instruction. L’émulation est la mère des talents. Elle féconde le génie, et porte l’ame aux plus généreux efforts. Sans émulation, point d’études, point d’instruction. Or, l’émulation ne peut exister que dans les maisons d’éducation. Ce n’est que là qu’on peut attendre des enfants un travail constamment soutenu. Là seulement, la crainte des reproches, le desir des louanges, l’exemple der compagnes studieuses, les récompenses accordées au travail et au succès entretiennent l’ardeur des élèves.
Dans la maison paternelle, les enfants sont sans cesse détournés de leurs études. Tantôt c’est un bal, tantôt c’est un festin ; aujourd’hui un spectacle, demain une visite, une promenade à la campagne, la perte d’un jour amène la perte d’une semaine ; les parents s’ennuient de gronder leurs enfants ; les maîtres se dégoûtent ; rien ne ranime le courage des élèves. Le temps de l’éducation se passe ; on arrive au terme ; et la jeune personne est condamnée pour le reste de sa vie à une honteuse ignorance.
L’éducation des pensions doit donc être préférée pour les demoiselles à l’éducation particulière.
D. Quelles sont les études auxquelles les jeunes personnes doivent particulièrement appliquer ?
R. Cette question n’est ni moins délicate, ni moins importante que la question précédente. Nous n’oserions point la résoudre d’après notre propre sentiment. Mais l’immortel a fait un traité de l’éducation des filles. Nous ne craindrons point de nous égarer en prenant pour guide le sage auteur de Télémaque. C’est donc sur cette grande autorité que sera fondée notre réponse.
« Apprenez à une fille à lire, à écrire correctement. Il est honteux, mais ordinaire, de voir des femmes qui ont de l’esprit et de la politesse, ne savoir pas bien prononcer ce qu’elles lisent ; ou elles hésitent, ou elles chantent en lisant, au lieu qu’il faut prononcer d’un ton simple et naturel, mais ferme et uni : elles manquent encore plus grossièrement pour l’orthographe, ou pour la manière de former ou de lier des lettres en écrivant. Au moins accoutumez-les à faire leurs lignes droites, à rendre leur caractère net et lisible. »
Ajoutons à ces sages préceptes, qu’il importe beaucoup de former une jeune personne à bien lire à haute voix. Ce point est trop négligé. Aussi trouve-t-on peu de personnes qui lisent bien. Une demoiselle peut être invitée à lire quelque chose dans une société. Combien il est honteux pour elle d’être forcée de s’y refuser, ou de s’en tirer mal ! Souvent elle aura besoin de faire des lectures au chevet d’un père malade, d’un parent, d’un époux. Elle doit donc se mettre en état de leur procurer ce doux soulagement dans leurs maux et leurs ennuis.
Pour ce qui est de l’écriture, on s’en occupe bien plus aujourd’hui qu’on ne s’en occupoit autrefois. On peut même dire que la plupart des jeunes personnes écrivent bien. Mais pourquoi l’écriture angloise est-elle tant à la mode ? Elle est difficile à lire, lorsqu’elle n’est pas très-bien exécutée. Ne vaudroit-il pas mieux nous en tenir à notre écriture ?
« II faudroit aussi qu’une fille sût la grammaire… Vous les mettrez en état d’apprendre un jour à leurs, enfants à bien parler sans aucune étude. On sait que dans l’ancienne Rome, la mère des Gracque contribua beaucoup, par une bonne éducation, à orner l’éloquence de ses enfants, qui devinrent de si grands hommes. »
L’étude de la grammaire est un peu aride ; mais elle est absolument nécessaire. II est trop honteux de ne savoir point parler sa langue, ou de l’écrire mal.
« Elles devroient aussi savoir les règles de l’arithmétique. On sait assez que l’exactitude de compter souvent fait le bon ordre dans les maisons. »
On enseigne l’arithmétique dans les pensions, on l’enseigne dans les leçons particulières, mais souvent on l’enseigne mal. Beaucoup de maîtres font faire les opérations par routine, sans en expliquer les principes, sans les démontrer. On ne sait bien que ce que l’on a appris avec raisonnement. Aussi les opérations de calcul sont-elles promptement oubliées.
« Donnez-leur des histoires grecques et romaines ; elles y verront des prodiges de courage et de désintéressement ; ne leur laissez pas ignorer l’histoire de France, qui a aussi ses beautés ; mêlez celle des pays voisins, et les relations des pays éloignés, judicieusement écrites. Tout cela sert à agrandir l’esprit, et à élever l’ame à de grands sentiments, pourvu qu’on évite la vanité et l’affectation. »
La mémoire est la faculté qu’il faut cultiver la première dans les enfants. C’est pourquoi
conseille de leur faire apprendre d’abord des fables, puis des histoires choisies. Il recommande sur-tout de leur faire apprendre les histoires saintes, et de leur en inspirer de bonne heure le goût. Il indique le Catéchisme historique, comme le meilleur livre sur cette matière. Plusieurs beaux traits de l’Écriture-Sainte ont été mis en vers, tels que l’histoire de Ruth, celle de Tobie, le sacrifice d’Abraham, etc. Les enfants retiendront plus aisément ces vers.
« Les vers sont excellents, dit l’auteur de l’
École des mœurs
, pour commencer à exercer la mémoire ; ils ont sur la prose l’avantage d’entrer plus facilement dans le dépôt de nos connoissances. Leur cadence et leur harmonie triomphent de la mémoire la plus dure et la plus obstinée. »
On pourra donner aussi aux jeunes personnes d’autres morceaux de poésie à apprendre, pourvu que le choix en soit bien fait28.
Lorsqu’une demoiselle saura bien l’histoire sainte, que nous mettons au premier rang, parce qu’elle sert de base à notre religion, on devra lui donner successivement l’histoire grecque, l’histoire romaine, celle de France, et les autres histoires. Nous pensons que pour bien enseigner l’histoire d’un peuple, le professeur doit mettre entre les mains de ses élèves un livre élémentaire qui contienne les grandes divisions de cette histoire et les faits principaux. Il doit ensuite donner plus d’étendue au récit des événements, soit de mémoire, soit par la lecture, et exiger que les élèves fassent des extraits de ce qu’il aura lu ou raconté. Par là, les faits se gravent mieux dans la mémoire des jeunes personnes, et les rédactions qu’elles en font, les accoutument à mettre de l’ordre dans leurs idées et à écrire en leur langue avec facilité. Il n’est pas moins utile, lorsqu’on a lu un événement à un enfant, ou même lorsqu’il en a écrit l’extrait, d’exiger qu’il le raconte tout haut. On lui fait alors remarquer doucement la meilleure manière de faire une narration, qui est de la rendre courte., simple et naïve, par le choix des circonstances qui représentent mieux le naturel de chaque chose. On doit, en étudiant l’histoire, étudier la géographie et la chronologie, qui sont les deux yeux de l’histoire.
« Je leur permettrois aussi, mais avec un grand choix, la lecture des ouvrages d’éloquence et de poésie. »
Les femmes doivent connoître les éléments de la littérature françoise. Il faut qu’elles puissent lire avec goût nos bons auteurs. Cette lecture peut même, dit encore , exciter dans leur ame des sentiments vifs et sublimes pour la vertu.
D. Vous ne nous avez point parlé des arts d’agrément. Dites-nous si les demoiselles doivent aussi s’y appliquer, et quels sont ceux qu’elles doivent cultiver de préférence.
R. On ne doit point interdire aux jeunes personnes les arts d’agrément. Mais il faut qu’elles ne s’y appliquent qu’avec précaution et réserve. La danse sert à développer leurs grâces ; cependant des parents sages ne permettront point que leur fille porte trop loin ses prétentions dans cet art. La musique est une ressource pour toute la vie. Celui qui n’a point appris la musique, ne sauroit en sentir toute la beauté. C’est le plus honnête et le plus pur de touts les plaisirs : il est de touts les âges, de touts les états, de touts les lieux, de presque touts les goûts. Une demoiselle doit donc apprendre la musique. Mais les parents ont encore besoin de mettre de sages bornes à cette étude. Combien d’années perdues sur des instruments dont on ne fait plus aucun usage deux mois après le mariage ! Ne vaudroit-il pas mieux, cultiver davantage la voix, qui est l’instrument que nous tenons de la nature ? Qu’une jeune personne sache ensuite jouer du piano assez bien pour s’accompagner lorsqu’elle chante, c’est tout ce que l’on peut desirer29. Voulez-vous aller au-delà, prétendez-vous la faire briller dans les sociétés, vous n’y parviendrez qu’en lui faisant perdre beaucoup de temps ; et peut-être même cet avantage lui fera-t-il perdre et sa modestie et l’innocence de ses mœurs.
Le dessin est très-utile : il apprend à bien juger d’un tableau, à crayonner une tête, une fleur, un arbuste. Mais on occupe trop les jeunes personnes à dessiner la figure. Il conviendroit mieux de les appliquer davantage à dessiner les fleurs, le paysage. Ce genre est plus conforme à celui de leurs occupations et de leurs goûts. Leurs progrès par conséquent y seroient plus grands.
Les travaux à l’aiguille, la couture, la broderie doivent être la principale occupation de toute la vie des personnes du sexe. Elles doivent donc s’y exercer de bonne heure. Mais l’excès nuit même dans ce qui est bon. On doit craindre de donner trop de temps à ces ouvrages dans les maisons d’éducation. L’instruction en souffiroit, et le mal seroit presque irréparable. Il est fâcheux pour des parents d’être obligés de donner des maîtres à leurs enfants, après qu’ils les ont retirés des pensions où ils ont passé plusieurs années. Les jeunes personnes sont moins propres à l’étude, et elles y apportent moins de bonne volonté : au lieu qu’elles se prêtent plus facilement à acquérir ce qui leur manque pour les ouvrages à l’aiguille.
Nous ne parlons point de l’étude des langues étrangères. Quelques parents donnent à leurs filles des maîtres de langue angloise, de langue allemande, de langue italienne, etc. Si les jeunes personnes doivent avoir besoin un jour de la connoissance de ces langues, les parents ont raison de les leur faire apprendre. Dans le cas contraire, c’est une véritable perte de temps. Les enfants réussissent rarement à apprendre l’anglois, l’allemand ; et jamais ils ne parviennent à bien parler ces langues. L’italien est plus aisé à apprendre, peut-être plus agréable pour les demoiselles. Mais, disons-le franchement : avant que d’apprendre une langue étrangère, il faut d’abord bien connoître la langue nationale.
D. Ne suffit-il pas à une jeune personne d’être belle ? La beauté ne peut-elle point lui tenir lieu d’instruction et de talents ?
R. Non ; et le bon nous avertît de ne point nous laisser prendre aux apparences. Un renard voyant une belle tête :
Belle tête, dit-il, mais de cervelle point !« La beauté, dit , a de grands avantages. C’est, suivant un ancien, une courte tyrannie, et le premier privilége de la nature ; les belles personnes portent sur le front des lettres de recommandation ; la beauté inspirr un sentiment de douceur qui prévient… Mais rien n’est plus court que le règne de la beauté ; rien n’est plus triste que la suite de la vie des femmes qui n’ont su qu’être belles. »
Écoutons encore sur ce sujet :
Pourquoi s’applaudir d’être belle ?Quelle erreur fait compter la beauté pour un bien ?A l’examiner, il n’est rienQui cause tant de chagrins qu’elle.Je sais que sur les cœurs ses droits sont absolus ;Que tant qu’on est belle, on fait naîtreDes desirs, des transports, et des soins assidus’ :Mais on a peu de temps à l’être,Et long-temps à ne l’être plus.
La beauté est donc un trésor fragile, qui ne dispense point les jeunes personnes de faire provision de mérite. Les talents et les vertus ne vieillissent point.
D. La fortune ne dispense-t-elle pas une jeune demoiselle d’acquérir du mérite ?
R. Non. dit :
Être riche n’est rien ; le tout est d’être heureux.
Or, l’homme qui n’a que de la richesse, sans esprit, sans talents, ne peut être heureux. Il s’ennuie par-tout et ne sauroit trouver nulle part de vraies jouissances. Écoutons M. .
Ce riche, qui d’avance usant touts ses plaisirs,Ainsi que son argent tourmente ses desirs,S’écrie à son lever : Que la ville m’ennuie !Volons aux champs ; c’est là qu’on jouit de la vie,Qu’on est heureux. Il part, vole, arrive ; l’ennuiLe reçoit à la grille, et se traîne avec lui.A peine a-t-il de l’œil parcouru son parterre,Et son nouveau kiosk, et sa nouvelle serre,Les relais sont mandés : lassé de son château,Il part, et court bâiller à l’opéra nouveau.Ainsi, changeant toujours de dégoûts et d’asile,Il accuse les champs, il accuse la ville ;Touts deux sont innocents, le tort est à son cœur :Un vase impur aigrit la plus douce liqueur.
On peut donc être malheureux au sein même des richesses, quand on ne sait point se plaire dans l’étude des lettres et des arts. D’ailleurs,
Il n’est point sous le ciel de fortune assurée.( .)
On peut tomber de l’opulence dans la détresse. Rappelons-nous l’apologue du différent survenu entre le savant et l’ignorant. Et combien de tristes exemples les derniers temps ne nous ont-ils point fournis de l’inconstance de la fortune ! Combien de personnes se sont trouvées dans la nécessité de tirer parti des connoissances et des talents qu’elles devoient au travail de leur jeunesse ! Et combien celles qui n’avoient aucune ressource en elles-mêmes ont dû être malheureuses ! Il importe donc de faire dans la jeunesse des provisions qui nous aident à supporter les revers que la fortune peut nous avoir destinés.
D. Comment les jeunes personnes doivent elles se prémunir contre les louanges et la flatterie ?
R. Les jeunes personnes doivent penser sans cesse qu’elles sont environnées de piéges ; qu’on cherche à les tromper par des soins intéressés, de fausses louanges, une flatterie perfide. Leur amour propre est presque toujours d’intelligence avec le flatteur. Elles ne sauroient donc prendre trop de précautions pour ne pas devenir les victimes de la flatterie. Tout le monde connoît le charmant apologue de
Le Corbeau et le Renard.
Maître Corbeau, sur un arbre perché,Tenoit en son bec un fromage.Maître Renard, par l’odeur alléché,Lui tint à peu près ce langage :Hé ! bonjour, Monsieur du Corbeau !Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau !Sans mentir, si votre ramageSe rapporte à votre plumage,Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois.A ces mots, le Corbeau ne se sent pas de joie ;Et, pour montrer sa belle voix,Il ouvre un large bec ; laisse tomber sa proie.Le Renard s’en saisit, et dit : Mon bon Monsieur,Apprenez que tout flatteurVit aux dépens de celui qui l’écoute :Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute.Le Corbeau, honteux et confus,Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendroit plus.(Liv. 1, fab. 2.)
D. La modestie ne peut-elle pas servir beaucoup à garantir les jeunes personnes des piéges de la flatterie ?
R. Oui. La modestie est une juste modération de l’esprit et du cœur, une sage retenue qui tient les passions en bride, qui arrête les saillies de l’amour propre, qui empêche de se prévaloir aux dépens des autres, des dons de la nature ou de la fortune, et qui fait qu’on évite les louanges avec autant de soin, que l’orgueil les recherche avec avidité.
Lorsque Jupiter prit le soinD’assigner aux Vertus leur rang auprès de l’homme,Celle qui méritoit la pomme,La Modestie, étoit demeurée en un coin :Elle fut oubliée ; on ne la voyoit point.O vous que la grâce accompagne,Lui dit le Dieu, les rangs sont déjà pris ;Mais des autres Vertus vous serez la compagne,Vous en rehausserez le prix.
Cet apologue nous fait voir que la modestie est la compagne inséparable des autres vertus.
D. Dans quel apologue a-t-il montré aux femmes la nécessité de la discrétion ?
R. C’est dans la fable intitulée : Les Femmes et le Secret. Voici le début :
Rien ne pèse tant qu’un secret :Le porter loin est difficile aux dames ;Et je sais même, sur ce fait,Bon nombre d’hommes qui sont femmes.(Liv. 8, fab. 6.)
Une personne indiscrète est une lettre décachetée que tout le monde peut lire.
Être discret, n’est pas chose facile ;C’est un talent plus précieux que l’orLa garde d’un secret est souvent plus utile,Que n’est la garde d’un trésor.Ce qu’un ami discret nous cache ;Loin de le vouloir déterrer,Aimons toujours à l’ignorer ;C’est perfidie à qui l’arrache.Mais s’il faut que dans notre seinOn dépose quelque mystère,Soyons toujours, jusqu’à la fin,Fidelle et sûr dépositaire.
Les jeunes personnes doivent prendre de bonne heure l’habitude d’être scrupuleusement exactes à garder un secret confié. Cette exactitude doit être portée jusque dans les petites choses.
D. Quelle horreur cherche-t-il à inspirer de la fourberie ?
R. s’exprime ainsi dans la fable de l’Aigle, la Laie et la Chatte.
Que ne sait point ourdir une langue traîtresse,Par sa pernicieuse adresse ?Des malheurs qui sont sortisDe la boîte de Pandore,Celui qu’à meilleur droit tout l’univers abhorre,C’est le fourbe, à mon avis.(Liv. 3, fab. 7.)
La fourberie dégrade l’homme, lui fait perdre l’estime de ses semblables, et le rend le fléau de la société. Le fourbe prend touts les titres, se couvre de toute les masques pour parvenir à ses fins. M. nous a donné le bel apologue suivant :
Le Chien et le Chat.
Pataud jouoit avec Raton,Mais sans gronder, sans mordre, en camarade, en frère :Les chiens sont bonnes gens ; mais les chats, nous dit-onSont justement tout le contraire.Raton, bien qu’il jurât toujoursAvoit fait patte de velours,Raton, et ce n’est point une histoire apocryphe,Dans la peau d’un ami, comme fait maint plaisant,Enfonçoit, tout en s’amusant,Tantôt la dent, tantôt la griffe.Pareil jeu dut cesser bientôt.— Hé quoi ! Pataud, tu fais 1a mine ?Ne sais-tu pas qu’il est d’un sot,De se fâcher quand on badine ?Ne suis-je pas ton bon ami ?— Prends le nom qui convient à ton humeur maligne,Raton, ne sois rien à demi :J’aime mieux un franc ennemi,Qu’un bon ami qui m’égratigne.
Celui qui s’est fait connoître une fois par quelque fourberie, mérite qu’on ne le croie pas, même quand il dit la vérité. La fourberie est souvent fatale à l’homme qui l’emploie. a dit :
La ruse la mieux ourdiePeut nuire à son inventeur ;Et souvent la perfidieRetourne sur son auteur.(Liv. 4, fab. 9.)
nous donne encore la même leçon dans la fable suivante :
Le Lion, le Loup et le Renard.
Un Lion décrépît, goulteux, n’en pouvant plus,Vouloit que l’on trouvât remède à la vieillesse.Alléguer l’impossible aux rois, c’est un abus.Celui-ci parmi chaque espèceManda des médecins : il en est de touts arts.Médecins au Lion viennent de toutes parts ;De touts côtés lui vient des donneurs de recettes.Dans les visites qui sont faites,Le Renard se dispense, et se tient clos et coi.Le Loup en fait sa cour, daube, au coucher du roi,Son camarade absent. Le prince tout à l’heureVeut qu’on aille enfumer Renard dans sa demeure,Qu’on le fasse venir. Il vient, est présenté ;Et, sachant que le Loup lui faisoit celle affaire :Je crains, Sire, dit-il, qu’un rapport peu sincèreNe m’ait à mépris imputéD’avoir différé cet hommage ;Mais j’étois en pèlerinage,Et m’acquittois d’un vœu fait pour votre santé.Même j’ai vu dans mon voyageGens experts et savants ; leur ai dit la langueurDont votre majesté craint à bon droit la suite.Vous ne manquez que de chaleur,Le long âge en vous l’a détruite :D’un Loup écorché vif appliquez-vous la peauToute chaude et toute fumante :Le secret sans doute en est beauPour la nature défaillante.Messire Loup vous servira,S’il vous plaît, de robe de chambre.Le roi goûta cet avis-là :On écorche, on taille, on démembreMessire Loup. Le monarque en soupa,Et de sa peau s’enveloppa.
Messieurs les courtisans, cessez de vous détruire ;Faites, si vous pouvez, votre cour sans vous nuire :Le mal se rend chez vous au quadruple du bien.Les daubeurs ont leur tour, d’une ou d’autre manière :Vous êtes dans une carrièreOù l’on ne se pardonne rien.
D. Quelle idée les jeunes personnes doivent-elles se faire du mensonge ?
R. Elles doivent regarder le mensonge comme le plus bas et le plus honteux de touts les vices. La candeur est au contraire le plus bel ornement de l’ame. Voici un apologue de à ce sujet.
Le Bûcheron et Mercure.
Un Bûcheron perdit son gagne-pain,C’est sa cognée ; et, la cherchant en vain,Ce fut pitié là-dessus de l’entendre.Il n’avoit pas des outils à revendre :Sur celui-ci rouloit tout son avoir.Ne sachant donc où mettre son espoir,Sa face étoit de pleurs toute baignée :O ma cognée ! ô ma pauvre cognée !S’écrioit-il ; Jupiter, rends-la-moi ;Je tiendrai l’être encore un coup de toi.Sa plainte fut de l’Olympe entendue.Mercure vient. Elle n’est pas perdue,Lui dit ce dieu ; la connoîtras-tu bien ?Je crois l’avoir près d’ici rencontrée.Lors une d’or à l’homme étant montrée,Il répondit : je n’y demande rien.Une d’argent succède à la première :Il la refuse. Enfin une de bois.Voilà, dit-il, la mienne cette fois.Je suis content si j’ai cette dernière.— Tu les auras, dit le dieu, toutes trois :Ta bonne foi sera récompensée.— En ce cas-là je les prendrai, dit-il.L’histoire en est aussitôt dispersée ;Et boquillons de perdre leur outil,Et de crier pour se le faire rendre.Le roi des dieux ne sait auquel entendre.Son fils Mercure aux criards vient encor :A chacun d’eux il en montre une d’or.Chacun eût cru passer pour une bêteDe ne pas dire aussitôt : la voilà !Mercure, au lieu de donner celle-là,Leur en décharge un grand coup sur la tête.
Ne point mentir, être content du sien,C’est le plus sûr : cependant on s’occupeA dire faux pour attraper du bien.Que sert cela ? Jupiter n’est pas dupe.(Liv. 5, fab. 1.)
D. Comment doit-on supporter les défauts des autres ?
R. Lorsque nous voulons juger les autres, nous devons, par un sentiment d’équité bien naturel, faire un retour sur nous-même. Plus nous avons besoin d’indulgence, plus il est de notre intérêt d’étendre sur les foiblesses de nos semblables le voile bienfaisant, qui doit en dérober la connoissance à la malignité.
Croyez que tout mortel a besoin d’indulgence.( , trag. de Fénelon.)
Chacun a ses défauts : hélas ! il n’est personneQui n’ait sur quelque point besoin qu’on lui pardonne.A l’humaine faiblesse il faut donc se prêter ;Et, puisqu’on vit ensemble, il faut se supporter.( , Le Misanthrope.)
Rapportons ici la fable suivante de :
La Besace.
Jupiter dit un jour : Que tout ce qui respireS’en vienne comparoître aux pieds de ma grandeur ;Si dans son composé quelqu’un trouve à redire,Il peut le déclarer sans peur ;Je mettrai remède à la chose.Venez, Singe ; parlez le premier, et pour cause ;Voyez ces animaux, faites comparaisonDe leurs beautés avec les vôtres.Êtes-vous satisfait ? — Moi ! dit-il ; pourquoi non,N’ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres ?Mon portrait jusqu’ici ne m’a rien reproché ;Mais pour mon frère l’ours, on ne l’a qu’ébauché ;Jamais, s’il me veut croire, il ne se fera peindre.L’ours venant là-dessus, on crut qu’il s’alloit plaindre.Tant s’en faut : de sa forme il se loua très-fort ;Glosa sur l’éléphant, dit qu’on pourroit encorAjouter à sa queue, ôter à ses oreilles ;Que c’étoit une masse informe et sans beauté.L’éléphant étant écouté,Tout sage qu’il étoit, dit des choses pareille ;Il jugea qu’à son appétitDame baleine étoit trop grosse.Dame fourmi trouva le ciron trop petit,Se croyant, pour elle, un colosse.Jupin les renvoya s’étant censurés touts,Du reste, contents d’eux. Mais parmi les plus fouxNotre espèce excella : car tout ce que nous sommes,Lynx envers nos pareils, et taupes envers nous,Nous nous pardonnons tout, et, rien aux autres hommes.On se voit d’un autre œil, qu’on ne voit son prochain.Le fabricateur souverainNous créa besaciers, touts de même manièreTant ceux du temps passé que du temps d’aujourd’hui :Il fit pour nos défauts la poche de derrière,Et celle de devant pour les défauts d’autrui.(Liv. 1, fab. 7.)
D. Quel cas devons-nous faire de l’amitié ?
R. M. de
s’adresse en cette sorte à l’amitié :
« Passion sublime, sentiment des grandes ames, bonheur du monde, devant lequel touts les maux disparoissent ou s’affoiblissent, et touts les biens s’embellissent et s’accroissent : ô divine amitié ! ton nom seul me rappelle touts les charmes de ma vie. Passion héroïque, dont le feu toujours pur est allumé par le sentiment et animé par l’intelligence ; vertu consolatrice, que le souverain Être a accordée à l’homme pour le dédommager des suites funestes d’une raison égarée ; sentiment bienfaisant, sans lequel il ne peut exister aucun bien pour nous ; c’est toi que nous avons maintenant à peindre. »
L’amitié sème de fleurs les routes de la vie ; elle embellit la prospérité, fournît des ressources dans le besoin, et des consolations dans le malheur. La véritable amitié est sincère, indulgente, généreuse. nous fournit un beau modèle d’une parfaite amitié dans l’apologue des deux Amis.
Deux vrais amis vivoient au Monomotapa :L’un ne possédoit rien qui n’appartint à l’autre.Les amis de ce pays-làValent bien, dit-on, ceux du nôtre.
L’un des deux, amis rêve, pendant la nuit, que son camarade est dans la peine ; il se lève, et vole à son secours. L’autre, étonné de voir son ami à pareille heure, se hâte de lui offrir sa bourse, son bras.
Qui d’eux aimoit le mieux ? Que t’en semble lecteur ?Cette difficulté vaut bien qu’on la propose.Qu’un ami véritable est une douce chose !Il cherche vos besoins au fond de votre cœur ;Il vous épargne la pudeurDe les lui découvrir vous-mêmeUn songe, un rien, tout lui fait peur,Quand il s’agit de ce qu’il aime.
D. Que faut-il penser de la reconnoissance ?
R. La reconnoissance est la première de toutes les vertus.
… L’honnête homme à la reconnoissanceSur toute autre vertu donne la préférence.( .)
Écoutons cet apologue de .
La Colombe et la Fourmi.
La Colombe, qui s’égayoitAu bord d’une fontaine où l’onde étoit fort belle,Vit se démener auprès d’elleUne Fourmi qui se noyoit.Sensible à son malheur, mais encor plus activeA lui prêter secours par quelque bon moyen,Elle cueille un brin d’herbe, et l’ajuste si bien,Que la Fourmi l’attrappe, et regagne la rive.Quand elle fut hors de danger,Sur le mur le plus près la Colombe s’envole.Un manant à pieds nus, qui la vit s’y ranger,Fait d’abord vœu de la manger,Et ne croit pas son vœu frivole.Assuré de l’arc qu’il portoit,De sa flèche la plus fidelleIl alloit lui donner une atteinte mortelle ;Mais la Fourmi, qui le guettoit,Voyant sa bienfaitrice en cet état réduite,Le mord si rudement au pié,Que, se croyant estropié,Il fait un si grand bruit que l’oiseau prend la fuite.Par la foible Fourmi, ce service renduA la Colombe bienfaisante,Est une preuve suffisanteQu’un bienfait n’est jamais perdu.
a aussi traité ce sujet. Sa fable du Lion et du Rat, a encore le même but. Peu de gens sont reconnoissances. dit :
Que chacun parle bien de la reconnoissance !Et que peu de gens en font voir !D’un service rendu la flatteuse espérance,Fait porter à l’excès les soins, la complaisance :A peine est-il rendu, qu’on cesse d’en avoir.De qui nous a servis, la vue est importune :On trouve honteux de devoirLes secours que, dans l’infortune,On n’avoit point trouvé honteux de recevoir.
D. Quels soins les personnes du sexe doivent-elles prendre, pour garantir leur réputation des atteintes de la critique ?
R.Les femmes, dit
, ne doivent pas abandonner l’approbation publique, parce que du mépris de la réputation naît le mépris de la vertu.
Il ne suffit donc pas à une femme de remplir ses devoirs ; il faut encore qu’on ne puisse pas même la soupçonner de s’en écarter. César répudia sa femme à cause de quelques bruits qui s’étoient répandus contre son honneur, parce que, disoit-il, la femme de César ne doit pas être soupçonnée.
L’honneur, dit
, ressemble à l’œil, qui ne sauroit souffrir la moindre impureté sans s’altérer : c’est une pierre précieuse, dont le moindre défaut diminue beaucoup le prix.
L’honneur est comme une île escarpée et sans bords ;On n’y peut plus rentrer quand on en est dehors.( .)
La réputation, bonne ou mauvaise, dépend sur-tout du choix des personnes que l’on fréquente. On ne sauroit être trop circonspect dans ses liaisons.
La renoncule un jour dans un bouquetAvec l’œillet se trouva réunie.Elle eut le lendemain le parfum de l’œilletOn ne peut que gagner en bonne compagnie.( .)
D. Suffit-il à une femme, pour être estimable, de s’assujettir extérieurement aux bienséances, et d’échapper à la censure du monde ?
R. Non. Ce sont les sentiments qui forment le caractère, qui conduisent l’esprit, qui gouvernent la volonté, qui répondent de la réalité et de la durée de toutes les vertus des femmes.
« Et quel sera, dit
, le principe de ces sentiments ? La religion. Quand elle sera gravée dans notre cœur, alors toutes les vertus couleront de cette source, touts les devoirs se rangeront chacun dans leur ordre… Rien n’est plus heureux et plus nécessaire, que de conserver un sentiment qui nous fait aimer et espérer, qui nous donne un avenir agréable, qui accorde touts les temps, qui assure touts les devoirs, qui répond de nous à nous-mêmes, et qui est notre garant envers les autres. »
D. Les femmes doivent-elles s’assujettir entièrement à l’empire de la mode ?
R. Non. Écoutons à ce sujet l’auteur du Comte de Valmont.
« Les femmes croient avoir tout dit, quand elles ont dit : C’est la mode ; mais elles devroient faire attention que le goût est avant la mode, et doit servir à la régler ; qu’il y a telle bizarrerie, qui ne peut que rendre une mode souverainement ridicule ; que, pour paroître aimable, et pour plaire, il y a du moins, dans toutes ces nouvelles inventions, de certains rapports qu’il est essentiel de consulter ; des rapports d’âge, de traits, de physionomie, d’état, de dignité, de bienséance, qu’on ne peut violer sans courir le risque d’inspirer la pitié, le dégoût, le mépris, à ceux mêmes dont on cherche le plus à s’attirer les hommages. »
Le roi de Salé30 avoit ordonné à un peintre, de représenter dans sa galerie toutes les nations, si naturellement, qu’on pût distinguer chacune à l’air et à l’habillement. Le peintre habilla chaque peuple à la mode du pays, qu’il habitoit, et peignit le François tout nu,
Portant uniquement sur son bras qu’il replie,Une pièce d’étoffe. Où sont donc tes esprits,Dit le monarque la peintre ; et par quelle foliePeins-tu le François sans habits ?— Seigneur, répondit-il, n’en soyez point surpris :Il change si souvent de mode,Que mon art, ne sachant où se déterminer,Lui donne de l’étoffe, afin qu’il s’accommodeComme il voudra l’imaginer.
La mode est un tyran dont rien ne nous délivre,A son bizarre goût il faut s’accommoder ;Et sous ses folles lois étant forcé de vivre,Le sage n’est jamais le premier à les suivre,Ni le dernier à les garder.( , conseils à une demoiselle.)
Voici un apologue de M. :
La Nouveauté.
FableAu bourg où règne la Folie,Un jour la Nouveauté parut.Aussitôt chacun accourut ;Chacun disoit : Qu’elle est jolie !
Ah ! Madame la Nouveauté,Demeurez dans notre patrie :Plus que l’esprit et la-beauté,Vous y fûtes toujours chérie.
Lors la déesse à touts ces fouxRépondit : Messieurs, j’y demeure,Et leur donna le rendez-vousLe lendemain à la même heure.
Le lendemain elle parut,Aussi brillante que la veille ;Le premier qui la reconnut,S’écria : Dieux ! comme elle est vieille !
D. Que doit-on penser de l’orgueil ?
R. L’orgueil est une passion qui fait qu’on n’estime que soi dans le monde.
Rien de si révéré que l’orgueil ne profane ;Il n’est rien de si pur que l’orgueil ne condamne ;Vil scrutateur des cœurs qu’il n’a point avilis,En serpent tortueux il sonde leurs replis.Si parmi leurs vertus une foiblesse erranteTernit de ce miroir la glace transparente,Il la suit sourdement de détour en détour,L’annonce avec éclat, et l’expose au grand jour ;Mais si la vérité, démasquant l’artifice,De ses projets obscurs ébranle l’édifice,Quels attentats affreux ! quels crimes ! quelle horreur !L’orgueil humilié devient bientôt fureur.Ce n’est plus un serpent qui rampe sur la terre,C’est un géant armé qui brave le tonnerre,Qui, pour anéantir l’auguste vérité,Iroit, jusques au sein de la divinité,Percer de mille coups sa rivale étonnée,Et blasphémer le dieu dont elle est émanée.( .)
Du premier coup d’œil on hait l’orgueilleux ; du second on le plaint.
Un enfant s’admiroit monté sur une table,Je suis grand, disoit-il. Quelqu’un lui répondit :Descendez, vous serez petit.Quel est l’enfant de cette fable ?Le riche qui s’enorgueillit.( .)
Les orgueilleux ne prospèrent jamais.( , Nanine.)
D. Que nous direz-vous de la présomption ?
R. La présomption est fille de l’orgueil ; d’autres la disent fille de l’ignorance. Elle fait que nous nous flattons d’un vain espoir. Le présomptueux porte son espérance audacieuse jusqu’à la chimère. Hardi à entreprendre, il s’imagine pouvoir venir à bout de tout.
…………………… Cette présomptionQui prétend tout ranger à sa décision,Est d’un fat ignorant la marque la plus sûre :L’homme éclairé suspend l’éloge et la censure ;Il sait que sur les arts, les esprits et les goûts,Le jugement d’un seul n’est point à la loi de touts ;Qu’attendre est, pour juger, la règle la meilleure,Et que l’arrêt public est le seul qui demeure.( , le Méchant.)
D. La vanité n’est-elle pas encore une fille de l’orgueil ?
R. Oui. La vanité est une seconde fille de l’orgueil. C’est l’amour propre qui se montre. Les passions les plus violentes-nous laissent quelquefois du relâche ; mais la vanité nous agite toujours.
Écoutons :
La Grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf.
fable.Une Grenouille vit un BœufQui lui sembla de belle taille ;Elle, qui n’étoit pas grosse en tout comme un œuf,Envieuse, S’étend, et s’enfle, et se travaille,Pour égaler l’animal en grosseur,Disant : regardez bien, ma sœur,Est-ce assez ? dites-moi, n’y suis-je point encore ?— Nenni. — M’y voici donc ? — Point du tout. — M’y voilà ?— Vous n’en approchez point. La chétive pécoreS’enfla si bien, qu’elle creva.
Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages :Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs :Tout petit prince a des ambassadeurs :Tout marquis veut avoir des pages.(Livre 1, fab. 3.)
Les hommes hauts et vains sont semblables aux épis de blé : ceux qui lèvent le plus la tête, sont les plus vides.
D. Ne doit-on pas éviter aussi les airs de hauteur ?
R : Oui.
La hauteur ne sied à personne.
L’air de hauteur, loin d’imposer une sorte de respect, comme l’air grand, ou de préparer à l’estime, comme l’air noble, met en garde et indispose l’amour propre des autres contre les prétentions sèches de l’orgueil, qui font que l’on vous craint et que l’on vous évite. Écoutons cet apologue :
Un frêle cerf-volant,Bien doré, bien luisantBouffi d’impertinenceEncor plus que de vent,Voulant passer dans l’air pour oiseau d’importance,Caracoloit, planoit, se perdoit dans les cieux,Alloit, venoit, brilloit, faisoit flotter sa queueEt jaune et rouge et bleue,Sur le bec de l’oiseau du souverain des dieux.L’aigle rit, et lui dit ; Étranger assez leste,Je t’aurois cru né dans ces lieux ;Mais ce ton insolent que le vrai grand détesteCe fil un peu terreux à ta suite emporté,Ont démenti ton air céleste ;Et m’ont appris la vérité.( .)
D. Quelle idée faut-il se faire de l’ambition ?
R. L’ambition est un desir immodéré de remplir des places supérieures à ses talents.
L’espoir de parvenir aux dignités suprêmesRend esclave de la faveur ;Rien d’un ambitieux ne rebute le cœur :Son repos et ses amis mêmesSont des biens qu’il immole au soin de la grandeur.( .)
« Un homme livré à l’ambition se laisse-t-il rebuter par les difficultés qu’il trouve sur son chemin ? Il se refond, il se métamorphose, il force son naturel et l’assujettit à sa passion. Né fier et orgueilleux, on le voit, d’un air timide et soumis, essuyer les caprices d’un ministre, mériter, par mille bassesses, la protection d’un subalterne en crédit, et se dégrader jusqu’à vouloir être redevable de sa fortune à la vanité d’un commis ou à l’avarice d’un esclave. Vif et ardent pour le plaisir, il consume ennuyeusement, dans des antichambres et à la suite des grands, des moments qui lui promettoient ailleurs mille agréments. Ennemi du travail et de l’embarras, il remplit des emplois pénibles, prend non-seulement sur ses aises, mais encore sur son sommeil et sur sa santé, de quoi y fournit. Enfin, d’une humeur serrée et épargnante, il devient libéral, prodigue même ; tout est inondé de ses dons, et il n’est pas jusqu’à l’affabilité et aux égards d’un domestique qui ne soient le prix de ses largesses. »
( .)
……………… Les cœurs remplis d’ambitionSont sans foi, sans honneur et sans affection.Occupés seulement de l’objet qui les guide,Ils n’ont de l’amitié que le masque perfide ;Prodigues de serments, avares des effets,Le poison est caché même sous leurs bienfaits,La gloire d’un grand homme est pour eux un supplice,Et pour lui, tôt ou tard, devient un précipice.( , Triumvirat.)
Que vous vous tourmentez, mortels ambitieux,Désespérés et furieux,Ennemis du repos, ennemis de vous-mêmes !A modérer vos vœux mettez touts vos plaisirs ;Régnez sur vos propres desirs ?C’est le plus beau des diadèmes.( , Daphné.)
D. En quoi l’avarice diffère-t-elle de l’ambition ?
R. L’avarice et l’ambition a différent en ce que l’une est agitée par l’espérance, et l’autre par la crainte. L’ambitieux espère de proche en proche parvenir à tout ; l’avare craint de tout perdre : ni l’un ni l’autre ne savent jouir. nous a laissé sur la passion de l’avarice deux fables. Voici la première :
Le Trésor et les deux hommes.
Un homme n’ayant plus ni crédit ni ressource,Et logeant le diable en sa bourse,C’est-à-dire n’y logeant rien,S’imagina qu’il feroit bienDe se pendre, et finir lui-même sa misère,Puisqu’aussi bien sans lui la faim le viendroit faire :Genre de mort qui ne duit pasA gens peu curieux de goûter le trépas.Dans cette intention, une vieille masureFut la scène où devoit se passer l’aventure.Il y porte une corde, et veut avec un clouAu haut d’un certain mur attacher le licou.La muraille, vieille et peu forteS’ébranle aux premiers coups, tombe avec un trésor.Notre désespéré le ramasse, et l’emporte ;Laisse là le licou, s’en retourne avec l’or,Sans compter : ronde ou non, la somme plut au sire,Tandis que le galant à grands pas se retire,L’homme au trésor arrive, et trouve son argentAbsent.Quoi ! dit-il, sans mourir je perdrai cette somme !Je ne me pendrai pas ! eh ! vraiment si ferai,Ou de corde je manquerai.Le lacs étoit tout prêt, il n’y manquoit qu’un hommeCelui-ci se l’attache, et se pend bien et beau.Ce qui le consola, peut-être,Fut qu’un autre eût, pour lui, fait les frais du cordeau.Aussi bien que l’argent le licou trouva maitre,
L’avare rarement finit ses jours sans pleurs :Il a le moins de part au trésor qu’il enserre,Thésaurisant pour les voleurs,Pout ses parents, ou pour la terre.
Mais que dire du troc que la fortune fit ?Ce sont-là de ses traits, elle s’en divertit :Plus le tour est bizarre, et plus elle est contente.Cette déesse inconstanteSe mit alors en l’espritDe voir un homme se pendre :Et celui qui se penditS’y devoit le moins attendre.(Liv. 9, fab. 16.)
D. Quelle est la seconde fable dont vous nous avez parlé ?
R. C’est celle-ci.
L’Avare qui a perdu son trésor.
L’usage seulement fait la possession.Je demande à ces gens, de qui la passionEst d’entasser toujours, mettre somme sur somme.Quel avantage ils ont que n’ait pas un autre homme.là-bas est aussi riche qu’eux ;Et l’avare ici-haut, comme lui vit en gueux.L’homme au trésor caché qu’ nous propose,Servira d’exemple à la chose.Ce malheureux attendoit,Pour jouir de son bien, une seconde vie,Ne possédoit pas l’or, mais l’or le possédoit.Il avoit dans la terre une somme enfouie,Son cœur avec, n’ayant d’autre déduit,Que d’y ruminer jour et nuit,Et rendre sa chevance à lui-même sacrée.Qu’il allât ou qu’il vînt, qu’il bût ou qu’il mangeât,On l’eût pris de bien court, à moins qu’il ne songeâtA l’endroit où gisoit cette somme enterrée ;Il y fit tant de tours qu’un fossoyeur le vit,Se douta du dépôt, l’enleva sans rien dire.Notre avare, un beau jour, ne trouva que le nid.Voilà mon homme aux pleurs : il gémit, il soupire,Il se tourmente, il se déchire.Un passant lui demande à quel sujet ses cris.— C’est mon trésor que l’on m’a pris.— Votre trésor ? où pris ? — Tout joignant cette pierre.— Eh ! sommes-nous en temps de guerre,Pour l’apporter si loin ? N’eussiez-vous pas mieux faitDe le laisser chez vous en votre cabinet,Que de le changer de demeure ?Vous auriez pu sans peine y puiser à toute heure.A toute heure, bons dieux ! ne tient-il qu’à cela ?L’argent vient-il comme il s’en va ?Je n’y touchois jamais. — Dites-moi donc, de grâce,Reprit l’autre, pourquoi vous vous affligez tant ?Puisque vous ne touchiez jamais à cet argent,Mettez une pierre à la place,Elle vous vaudra tout autant.(Liv. 1, fab. 19.)
Souvent l’avare, pour vouloir trop avoir, perd même ce qu’il a. C’est ce que nous prouve dans l’apologue suivant :
La Poule aux œufs d’or.
L’avarice perd tout en voulant tout gagner.Je ne veux, pour le témoigner,Que celui dont la poule, à ce que dit la fable,Pondoit touts les jours un œuf d’or.Il crut que dans son corps elle avoit un trésor.Il la tua, l’ouvrit, et la trouva semblableA celles dont les œufs ne lui rapportoient rien,S’étant lui-même ôté le plus beau de son bien.Belle leçon pour les gens chiches !
Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vus,Qui du soir au matin sont pauvres devenus,Pour vouloir trop tôt être riches !
D. Quelle est la vertu dont il importe sur-tout de faire contracter de bonne heure l’habitude aux jeunes gens ?
R. C’est celle de la bienfaisance. Une belle ame ne goûte pas de grand plaisir que celui de soulager les malheureux ; sa noble ambition la porte à se faire autant de sujets qu’il y a de gens persécutés de la fortune : c’est en cela qu’elle approche de plus près de Dieu, qui fait lever son soleil sur touts les hommes.
Tel repousse aujourd’hui la misère importuneQui tombera demain dans la même infortune :Il est beau de prévoir ces retours dangereux,Et d’être bienfaisant alors qu’on est heureux.………………………………………………Le bien que l’on a fait la veille,Fait le bonheur du lendemain.
a dit :
Le soin de soulager les mauxEst une charité que je préfère aux autres.
Un aveugle qui demandoit l’aumône dans le passage des Feuillants à Paris, avoit affiché sur sa porte d’assez mauvais vers. On lui conseilla de s’adresser à , pour en avoir de meilleurs. Le poëte étoit aveugle aussi. Il promit au mendiant les vers que celui-ci lui demandoit. Au retour de la promenade, il lui remit les vers suivants.
Chrétiens, au nom du Tout-Puissant,Faites-moi l’aumône en passant :Le malheureux qui la demandeNe verra point qui la fera ;Mais Dieu, qui voit tout, le verra ;Je le prîrai qu’il vous la rende.
L’homme bienfaisant doit répandre ses grâces dans le secret. Publier ses bienfaits, c’est en perdre le mérite.
En répandant ses dons, une ame vertueuseSait cacher avec soin une main généreuse ;D’un cœur né vraiment grand, c’est la première loi :La vertu pour témoin n’a besoin que de soi ;Et sans s’inquiéter de la reconnoissance,Le plaisir du bienfait devient sa récompense.( .)
D. La douceur de caractère n’est-elle pas encore une qualité que la jeunesse doit s’efforcer d’acquérir ?
R. Oui. La douceur de caractère est nue des plus aimables qualités ; et ceux qui ne l’ont point reçue de la nature, doivent faire touts leurs efforts pour l’acquérir. Quoi qu’elle coûte, on ne l’achette jamais trop cher. Les avantages, qui la suivent sont d’un prix inestimable.
« La parole douce, dit le Sage, acquiert beaucoup d’amis et adoucit les ennemis. Mon fils, ajoute-t-il, montrez de la douceur dans tout ce que vous faites, et vous serez plus aimé que si vous faisiez les actions les plus éclatantes. — Heureux les doux, dit Jésus-Christ, parce que ce sont eux qui posséderont la terre. »
Et comment ne la possèderoient-ils pas ? C’est la douceur qui fait les délices de la société et les charmes de la conversation.
On aime une personne douce, on la recherche, tout le monde seroit charmé de vivre avec elle. On évite, au contraire, celle qui a le caractère dur, violent, impérieux ou inflexible. La colère est peut-être de toutes les passions violentes, celle qui nuit le plus au corps même ; rien n’altère plus la santé que les emportements : ils corrompent le sang, bouleversent les humeurs, changent totalement la constitution, et conduisent précipitamment au tombeau. Les personnes sujettes à la colère, ne l’appellent que vivacité ; mais qu’importe quel nom on lui donne, si cette vivacité dégénère presque toujours en brusqueries et en boutades, et si elle porte à des excès de folie ou de fureur ?
Les femmes qui sont nées vives et colères doivent s’appliquer encore plus que les hommes à corriger ce défaut. La nature leur a donné là douceur en partage : on diroit qu’une femme qui s’irrite, change de sexe. La colère ne fait pas seulement qu’elles deviennent odieuses et insupportables, elle les dénature et les rend hideuses. Si les femmes savoient combien les emportements défigurent les personnes les plus aimables, elles s’en garantiroient pour toujours.
nous recommande la douceur dans l’apologue ingénieux qui suit :
Phébus et Borée.
Fable.Borée et le Soleil virent un voyageur,Qui s’étoit muni, par bonheur,Contre le mauvais temps. On entroit dans l’automne,Quand la précaution aux voyageurs est bonne :Il pleut ; le soleil luit ; et l’écharpe d’IrisRend ceux qui sortent avertisQu’en ces mois le manteau leur est fort nécessaire.Les Latins les nommoient douteux, pour cette affaire.Notre homme s’étoit donc à la pluie attendu.Bon manteau bien doublé, bonne étoffe bien forte.Celui-ci, dit le Vent, prétend avoir pourvuA touts les accidents ; mais il n’a pas prévuQue je saurai souffler de sorte,Qu’il n’est boulon qui tienne : il faudra, si je veux,Que le manteau s’en aille au diable.L’ébattement pourvoit nous en être agréable :Vous plaît-il de l’avoir ? — Eh bien, gageons-nous deux,Dit Phébus, sans tant de paroles,A qui plutôt aura dégarni les épaulEsDu cavalier que nous voyons.Commencez : je vous laisse obscurcir mes rayons.Il n’en fallut pas plus. Notre Souffleur à gageSe gorge de vapeurs, s’enfile comme un ballon,Fait un vacarme de démon,Siffle, souffle, tempête, et brise, en son passage,Maint toit qui n’en peut mais, fait périr maint bateau,Le tout au sujet d’un manteau ;Le cavalier eut soin d’empêcher que l’orageNe se put engouffrer dedans.Cela le préserva : le vent perdit son temps :Plus il se tourmentoit, plus l’autre tenoit ferme ;Il eut beau faire agir le collet et les plis.Sitôt qu’il fut au bout du termeQu’à la gageure on avoit mis,Le Soleil dissipe la nue,Récrée, et puis pénètre enfin le cavalier ;Sous son balandias fait qu’il sue,Le contraint de s’en dépouiller ;Encor n’usa-t-il pas de toute sa puissance.
Plus fait douceur que violence.(Liv. 6, fab. 2.)
D. Après les désordres que causent la colère, la vivacité, ne faut-il pas craindre encore les maux qu’entraîne l’impatience ?
R. Oui. L’impatient nuit toujours à ce qu’il veut faire.
a dit :
la vie est si courte que ce n’est pas la peine de s’impatienter
.
Voici un bel apologue de .
Un Pêcher, les amours et l’espoir de son maître,Du jardin l’arbre favori,Le printemps ne faisant que naître,S’applaudissoit d’être déjà fleuri :II avise un Mûrier, tout aussi sec encoreQue dans les froids les plus cuisants :Aucun signe de vie ; on n’y voit rien éclore,Feuilles ni fleurs ; ses rameaux languissantsSont encor tout transis, à la honte de Flore.L’ami, dit le Pêcher, que te sert le printemps ?Ta paresse la déshonore.Déjà de sa touchante voixPhilomèle l’annonce aux échos de ces bois :Toute la nature s’éveille ;Dès le matin, une aurore vermeilleVient nous arroser de ses pleurs,Nectar délicieux des arbres et des fleurs ;Cependant, paresseux, le zéphyr a beau faire,Tu dors, quand tout est éveillé ;Que ne m’imites-tu ? Regarde, considèreComme j’ai déjà travaillé ;Me voilà tout fleuri ; d’une belle espéranceVoilà déjà mon maître régalé.Je lui tiendrai parole ; il peut compter d’avanceQu’au nombre de mes fleurs, mon fruit est égalé.A peine l’arbre a-t-il parlé,Qu’un vent de bise souffle et détruit tout l’ouvrage ;Du Pêcher la fleur déménage,Et tout espoir de fruit avec elle envoléLui laisse à peine attendre un stérile feuillage.— Eh bien ! dit le Mûrier, avais-je donc grand tortDe ne me pas presser si fort ?Zéphire a beau souffler, je crains encor la bise ;Sache qu’il faut à temps commencer l’entreprise,Quand on veut en venir à bout :L’impatience gâte tout.(Liv. 4, fab. 2.)
D. Quel est le défaut que l’on appelle suffisance ?
R. C’est une sotte vanité qui fait que l’on se croit propre à tout, que l’on se mêle de tout. On dit d’un homme qu’il fait le suffisant, qu’il fait l’important, pour dire qu’il se fait trop valoir, qu’il croit avoir plus de capacité qu’il n’en a réellement.
Sur les cornes d’un bœuf revenant du labeur,Une fourmi s’étoit nichée.D’où viens-tu ? lui cria sa sœur,Et que fais-tu si haut perchée ?— D’où je viens ? Peux-tu l’ignorer ?Répondit-elle ; ma commère,Nous revenons de labourer.
Que de gens, en plus d’une affaire,Comme elle, inaperçus, ont l’air de se fourrer,Et feroient bien mieux de se taire.( .)
D. Faites-nous connoître la nécessité de réprimer de bonne heure le penchant à la raillerie.
R. Il faut éviter la raillerie ; elle blesse souvent celui qui en est l’objet. Un railleur de profession est le fléau de la société ; tout le monde le redoute et le fuit. Ne sacrifiez personne à la fureur de dire un bon mot. Semblable à une flèche aiguë, ce mot perce le cœur de celui contre lequel il est lancé.
Une raillerie fine et délicate est l’ame de la conversation, et en fait tout le sel ; mais combien peu de gens la savent manier, et qu’il est difficile de ne la pas pousser trop loin ! Voulez-vous une règle sûre à cet égard ? La voici. Dès que vous voyez que la plaisanterie déplaît à celui que vous attaquez, et qu’il commence à se fâcher, vous devez cesser sur le champ votre badinage. Souvenez-vous d’ailleurs de ne jamais hasarder la plaisanterie, même la plus permise, qu’avec des gens polis et qui ont de l’esprit. Les provinciaux et les sots sont toujours prêts à se fâcher, quand on les raille. a dit :
On cherche les rieurs, et moi je les évite ;Cet art veut sur tout autre un suprême mérite :Dieu ne-créa que pour les sotsLes méchants diseurs de bons mots.
Les jeunes gens ne doivent jamais se permettre le ton de la raillerie avec les personnes âgées ou avec celles qui sont dans le malheur. Voici un apologue :
Le Lièvre et la Perdrix.
Fable.Il ne se faut jamais moquer des misérables :Car, qui peut s’assurer d’être toujours heureux ?Le sage dans ses fables.Nous en donne un exemple ou deux.Celui qu’en ces vers je propose,Et les siens, ce sont même chose.
Le Lièvre et la Perdrix, concitoyens d’un champ,Vivoient dans un état, ce semble, assez tranquille,Quand une meute s’approchant,Oblige le premier à chercher un asile.Il s’enfuit dans son fort, met les chiens en défaut,Sans même en excepter Brifaut.Enfin il se trahit lui-mêmePar les esprits sortant de son corps échauffé.Miraut, sur leur odeur ayant philosophé,Conclut que c’est son lièvre ; et d’une ardeur extrêmeIl le pousse ; et Rustaut, qui n’a jamais menti,Dit que le lièvre est reparti.Le pauvre malheureux vient mourir à son gîte.La perdrix le raille et lui dit :Tu te vantois d’être si vite ;Qu’as-tu fait de tes pieds ? Au moment qu’elle rit,Son tour vient, on la trouve. Elle croit que ses ailesLa sauront garantir à toute extrémitéMais la pauvrette avoit comptéSans l’autour aux serres cruelles.(Liv. 5, fab. 17.)
L’ironie est la manière de railler la plus piquante. Le style ironique marque ordinairement l’estime de soi-même et le mépris des autres. a dépeint son méchant comme un homme qui ne parle que le langage de l’ironie.
……………… Au ton dont il s’explique,A son air, où l’on voit, dans un rire ironique,L’estime de lui-même, et le mépris d’autrui,Comment peut-on savoir ce qu’on tient avec lui ?Jamais ce qu’il vous dit n’est ce qu’il veut vous dire.Pour moi, j’aime les gens dont l’ame se peut lire :On lui croit de l’esprit, vous dites qu’il en a ;Mais je ne voudrois point de tout cet esprit-là,Quand il seroit pour rien. Je n’y vois, je vous jure,Qu’un style qui n’est pas celui de la droiture ;Et sous cet air capable où l’on ne comprend rien,S’il cache un honnête homme, il le cache très-bien.
D. Quelle est la nécessité de bien employer le temps ?
R. Le temps est le plus précieux de touts les biens, et la perte en est irréparable.
………… Apprends que notre âge s’écouleComme un torrent pressé qui s’enfuit et qui roule ;Qu’un jour dévore l’autre, et que l’autre est détruitSans interruption par celui qui le suit ;Que le temps que l’on perd jamais ne se répare ;Qu’avec juste sujet on en doit être avare.( , sur Perse.)
Soyons avares du temps ; ne donnons aucun de nos moments sans en recevoir la valeur ; ne laissons sortir les heures de nos mains qu’avec épargne, qu’avec fruit, qu’avec autant de regret que quand nous cédons notre or ; ne souffrons pas qu’aucun de nos jours s’écoule sans avoir grossi le trésor de nos connoissances et de nos vertus.
Mais c’est sur-tout le temps de la jeunesse qu’il importe de bien employer. Dès qu’on a passé le premier âge de la vie, destiné par la nature presque tout entier pour le corps, et que la raison commence à se dégager des ténèbres de l’enfance, le temps devient d’un prix infini. C’est alors qu’il faut faire des provisions pour l’âge mûr et pour la vieillesse. Le temps de la jeunesse est le temps de semer, si l’on veut recueillir. Du bon emploi de ce temps dépend pour l’ordinaire le bonheur du reste de la vie.
, voulant faire sentir la nécessité de bien employer le premier âge de la vie, a, suivant le goût des Orientaux, enveloppé cette vérité sous le voile transparent d’une allégorie ingénieuse.
« Un étranger, dit-il, jeté par la tempête dans une île inconnue, y fut proclamé roi. Étonné d’abord de sa brillante fortune, il se familiarisa bientôt avec elle, et il ne songeoit qu’à jouir des plaisirs qu’elle lui offroit, lorsque le chef de la religion vint le trouver et lui dit : Prince, rien n’est plus chancelant que le trône où vous êtes placé ; au moment où vous y penserez le moins, on vous en fera descendre ; vous serez dépouillé des ornements royaux, et revêtu d’habits grossiers ; des soldats impitoyables vous traîneront sur le bord de la mer, et vous jetteront presque nu sur un vaisseau qui vous conduira dans une autre île fort éloignée de celle-ci. Telle est la loi immuable de cet état, et aucun de vos prédécesseurs n’a pu la changer ni s’y soustraire. Mais quoiqu’ils ne l’eussent pas ignorée, la plupart d’entr’eux n’ont pas eu le courage de fixer sur l’avenir leurs yeux éblouis par l’éclat qui environne le trône ; ils n’ont pas su prévenir la fin qui les menaçoit ; et le jour fatal est venu, sans qu’ils eussent rien fait pour adoucir leur sort. Les plus sages ont agi autrement : ils ont fait passer dans l’île qui leur étoit destinée, toute sorte de provisions et de secours, pour y mener une vie agréable et heureuse ; imitez leur exemple : le temps presse, et l’instant échappé ne renaîtroit plus. Souvenez-vous sur-tout que vous ne trouverez dans cette île que ce que vous y aurez fait transporter d’ici, dans le peu de jours peut-être qui vous restent. Le monarque suivit un si sage conseil, et vécut heureusement dans la nouvelle île où il fut conduit. »
Et vous aussi, jeunes gens, vous êtes dans une île où vous devez amasser des provisions et des secours pour couler des jours heureux dans une autre île où vous serez un jour transférés. Vous ne trouverez dans cette dernière île, vous ne porterez dans la société que ce que vous aurez acquis dans les maisons d’éducation. C’est dans ces maisons, que vous asseyez les fondements de votre bonheur futur. Vous êtes dans l’âge heureux où tout est facile, où l’esprit dévore les difficultés, où la mémoire ne laisse rien échapper de ce que le jugement lui confie. Tout vous fait une loi de profiter de ce temps précieux.
Lorsqu’on proposoit à une princesse de beaucoup d’esprit le jeu ou quelque autre partie de plaisir, elle refusoit, disant que cela n’apprenoit rien. Mais que ferez-vous ? lui dit-on. Je lirai, répondit-elle, ou je me ferai lire chez moi. En effet, la lecture est le plus utile des amusements : lorsqu’on a du temps de reste, il faut le consacrer à la lecture.
D. Quels sont les avantages que l’on retire de la lecture ?
R. La lecture est d’une nécessité indispensable : elle enrichit la mémoire, embellit l’imagination, rectifie le jugement, forme le goût, apprend à penser, élève l’ame, et inspire de nobles sentiments. Les livres nous offrent les richesses les plus précieuses de l’esprit humain, et les découvertes de touts les siècles. Ils sont une source d’agrément dans touts les états, dans toutes les situations de la vie : ils procurent mille plaisirs-dans touts les âges : ces plaisirs se renouvellent sans cesse, nous les trouvons par-tout, nous pouvons à touts les instants nous les procurer.
Mais il importe extrêmement de faire un bon choix des livres qu’on veut lire. Il ne faut pas seulement écarter les livres qui attaquent la religion, ou qui blessent ouvertement les mœurs. Il faut encore rejeter les livres qui n’apprennent rien, les livres qui amollissent l’ame et l’énervent.
dit que
jamais fille chaste n’a lu de romans
. En effet, ces livres font perdre un temps précieux pour l’instruction ; ils ne présentent que des pensées fausses, des maximes qu’il seroit dangereux de suivre dans la pratique, et des exemples qu’on se repentiroit toute sa vie d’avoir imités. Les romans flattent les passions, gâtent le jugement, embellissent les préjugés, peignent le vice sous des couleurs agréables qui le déguisent, effacent par le brillant coloris des fausses vertus l’éclat des vertus réelles, et mettent un honneur chimérique à la place du véritable honneur.
D. Ne faut-il pas inspirer à la jeunesse le goût du travail en même temps que celui de la lecture ?
R. Oui. L’homme est né pour le travail Le travail est le noble soutien de notre indépendance ; c’est le seul bien que l’injustice des hommes et l’inconstance de la fortune ne sauroient nous ravir. Il nous délivre du malheur de l’oisiveté, et nous fait goûter les douceurs du repos.
Trop de loisir aux vertus est contraire :Qui ne fait rien, n’est pas loin de mal faire.( .)
Écoutons cet apologue de .
Le Laboureur et ses enfants.
Fable.Travaillez, prenez de la peine,C’est le fonds qui manque le moins.
Un riche laboureur, sentant sa fin prochaine,Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins.Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l’héritageQue nous ont laissé nos parents ;Un trésor est caché dedans.Je ne sais pas l’endroit ; mais un peu de courageVous le fera trouver, vous en viendrez à bout.Remuez votre champ dès qu’on aura fait l’oût ;Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle placeOù la main ne passe et repasse.Le père mort, les fils vous retournent le champ,Deçà, delà, par-tout : si bien qu’au bout de l’anIl en rapporta davantage.D’argent, point de caché. Mais le père fut sageDe leur montrer avant sa mort,Que le travail est un trésor.(Liv. 5, fab. 9.)
D. Je vois que l’apologue nous fournit un cours de morale aussi complet qu’agréable. Voulez-vous terminer cet exercice, en nous récitant les vers de M. sur l’apologue ?
R. Volontiers ; les voici :
Après les grands travaux de l’art brillant des vers,Des genres plus bornés savent encor nous plaire.Du Parnasse françois législateur sévère,les peignit touts ; épigramme, sonnet,Madrigal, vaudeville, et jusqu’au triolet.Sa muse cependant, je l’avoue avec peine,Oublia l’Apologue, oublia .Ma muse, en le blâmant, contrainte à l’admirer,Peut venger son oubli, mais non le réparer.L’Imagination, dans cet auteur qu’elle aime,Du modeste Apologue a fait un vrai poëme :Il a son action, son nœud, son dénouement.Chez lui, l’utilité s’unit à l’agrément ;Le vrai nous blesse moins en passant par sa bouche,Il ménage l’orgueil qu’un reproche effarouche,Sous l’attrait du plaisir il cache la leçon,Et par d’heureux détours nous mène à la raison.Cet art ingénieux, que la crainte a fait naître,Qu’inventa le sujet pour conseiller son maître,Par l’esclave, et l’affranchi,A Rome et chez les Grecs fut sans faste enrichi.Il reçut le bon sens, l’élégante justesse ;Mais, né dans l’esclavage, il en eut la tristesse.y jeta sa naïve gaieté.Quel instinct enchanteur ! quelle simplicité !Il ignore son art, et c’est son art suprême ;Il séduit d’autant plus qu’il est séduit lui-même.Le chien, le bœuf, le cerf, sont vraiment ses amis ;A leur grave conseil par lui je suis admis.Louis, qui n’écoutoit, du sein de la victoire,Que des chants de triomphe et des hymnes de gloire,Dont peut être l’orgueil goûtoit peu la leçonQue reçoit dans ses vers l’orgueil du roi lion,Dédaigna , et crut son art frivole.Chantre aimable ! ta muse aisément s’en console.Louis ne te fit point un luxe de sa cour ;Mais le sage t’accueille en son humble séjour ;Mais il te fait son maître, en touts lieux, à tout âge,Son compagnon des champs, de ville, de voyage ;Mais le cœur te choisit ; mais tu reçus de nous,Au lieu du nom de grand, un nom cent fois plus doux,Et qui voit ton portrait, le quittant avec peine,Se dit avec plaisir : C’est le bon .(Poëme de l’Imagination.)
FIN.