Avant-propos. §
Il est généralement reconnu qu’on ne peut voyager utilement, apprécier les chefs-d’œuvre des arts, et lire avec fruit les ouvrages des poëtes et des auteurs anciens, sans avoir des notions suffisantes et générales sur la mythologie. Le gouvernement français, regardant cette partie de la littérature comme indispensable à connaître, en a prescrit l’étude dans toutes les écoles du royaume de France. Mais pour rendre cette étude convenable à tous les âges, il a fallu se prescrire l’attention la plus sévère dans la manière de la présenter. C’est principalement pour remplir dignement ce devoir que l’auteur a réuni tous ces efforts.
Il ne pouvait obtenir un suffrage plus désirable et plus éclairé que celui que lui ont accordé MM. les Commissaires du Gouvernement, et ensuite le Conseil de l’Université, en classant cet ouvrage au nombre de ceux que MM. les Professeurs emploieront pour l’instruction de la jeunesse.
Le but principal de ce travail ayant été de donner l’ensemble de la mythologie et de faire connaître l’origine de l’idolâtrie, il a fallu nécessairement présenter un tableau général, et par conséquent remonter jusqu’aux premiers âges du monde.
Un abrégé, par demandes et par réponses, aurait suffi pour donner la connaissance des dieux de la fable ; mais il existe tant d’ouvrages de ce genre, qu’il aurait été plus qu’inutile de les multiplier ; et l’auteur encouragé par l’espoir d’avoir pour juge une nation grande et éclairée, a cherché à s’élever au-dessus de la routine ordinaire.
Si quelques personnes, se croient autorisées à nous reprocher que nous avons omis beaucoup de détails et de noms célèbres dans le nombre immense des divinités, des héros, et des personnages que citent les anciens poëtes, nous répondrons que la seule liste complète de ces noms aurait exigé des volumes, et qu’elle n’aurait pu que fatiguer la mémoire, sans procurer une véritable instruction. Ce sera dans les chefs-d’œuvre des grands maîtres que l’on trouvera tous ces noms ; et les charmes qu’ils ont su répandre dans leurs ouvrages dédommageront des efforts de mémoire.
Si l’on trouve que les réflexions contenues dans les commencemens de cet ouvrage dépassent la portée ordinaire de l’esprit et de l’entendement, dont la première jeunesse est susceptible, les parens et les maîtres auront la faculté de juger, d’après l’âge et les progrès de leurs élèves, l’instant où il sera utile de les ramener à ces premières lectures, et ils pourront commencer par leur faire apprendre les divisions des dieux du paganisme, et les histoires particulières des divinités. Plus on avancera dans l’étude du tableau général que nous avons essayé de tracer, plus ces commencemens cesseront de paraître obscurs ; et pour peu que l’on soit doué d’intelligence et de l’esprit de rapprochement, sans lesquels on ne peut mettre aucun ordre dans ses connaissances, on sentira que nous n’avons pu nous dispenser de donner ces premières notions sur l’origine de la mythologie.
Nous avons multiplié, le plus possible, les rapprochemens de la fable avec l’histoire et les explications des fables, afin de concourir de tout notre pouvoir aux soins que l’on consacre partout à l’instruction de la jeunesse. Les instituteurs s’attachant à profiter de l’heureuse mémoire du premier âge pour lui faire retenir les chronologies des empires et les principaux événemens de l’histoire, l’étude de la mythologie deviendra, par le moyen que nous avons adopté, une suite naturelle de l’étude de l’histoire. Le juste hommage et la reconnaissance que méritent les travaux de M. l’abbé nous imposent le devoir de déclarer qu’après avoir consacré nos soins laborieux à consulter les auteurs les plus estimés, c’est principalement l’ouvrage de cet habile maître qui nous a servi de guide.
Le Dictionnaire de la Fable par , enrichi par les recherches et les travaux de M. , est non-seulement excellent, il est même indispensable ; on aura toujours besoin de le consulter pour soulager la mémoire, et pour connaître tous les noms consacrés par la fable. On pourra se servir avec plus d’avantage encore du Dictionnaire de Mythologie universelle, rédigé par M. ; mais ces deux ouvrages étant rangés par ordre alphabétique, et ne contenant pas les rapprochemens historiques, ils ne peuvent remplir le but que nous nous sommes efforcés d’atteindre en donnant un tableau général de la mythologie.
Les Métamorphoses d’ et les ouvrages des poëtes ne formant point un corps complet de mythologie, et les détails qu’ils contiennent n’étant point à la portée de tout le monde, nous avons pensé qu’un nouveau travail pouvait être utile : puisse celui que nous offrons au public obtenir son suffrage !
Pour remplir plus complètement le but que nous nous sommes proposé, nous avons joint à cet ouvrage des détails historiques sur les Druides ; il nous a semblé convenable et même indispensable de donner les notions que l’on a pu conserver sur l’existence, les lois et les cérémonies de ces pontifes si célèbres et si puissans.
Le même motif nous a fait joindre un extrait des savantes recherches de M. , historien du Danemark, sur la religion des anciens habitans du Nord. Ces deux supplémens achèveront de faire connaître dans quelles erreurs les hommes peuvent tomber, lorsque, oubliant les préceptes et les instructions qu’ils avaient reçus de la Divinité, ils ont voulu se former un culte au gré de leurs passions et de leurs caprices.
Réflexions préliminaires sur l’origine de l’idolâtrie. §
Si l’on veut remonter à l’origine de l’idolâtrie, il faut remonter jusqu’à l’origine des passions. Les livres saints peuvent seuls nous apprendre la véritable cause des malheurs et des désordres du genre humain. Cette lumière céleste a seule le pouvoir de dissiper les ténèbres ; et c’est en la prenant pour guide que l’homme, reconnaissant à la fois son impuissance et son orgueil, cesse enfin d’être le jouet de ses incertitudes. Nous ne répéterons pas les instructions dictées par Dieu même ; elles sont connues de tous nos lecteurs. C’est dans cette source pure et sacrée que l’éloquent a puisé les premiers principes et les premiers élémens de son immortel Discours sur l’Histoire Universelle. Bornons-nous à le suivre, lorsqu’appuyé sur l’Écriture Sainte il s’empare du burin majestueux de l’Histoire, et trace le tableau rapide, mais sublime, de l’enfance du monde.
« Tout commence, et il n’est point d’histoire, quelque ancienne qu’elle soit, où l’on ne trouve des vestiges manifestes de la nouveauté du monde. On voit les lois s’établir, les mœurs se polir, les empires se former ; le genre humain sort peu à peu de l’ignorance : l’expérience l’instruit. Les arts sont inventés, les hommes se multiplient, la terre se peuple, les précipices, les montagnes, les mers, les fleuves, ne sont plus des obstacles, on les franchit, les bois abattus font place aux champs, aux hameaux, aux bourgades, aux villes ; l’homme plie jusqu’aux métaux à son usage, et peu à peu il y fait servir toute la nature.
« Mais, à mesure qu’on s’éloignait des origines, les hommes brouillaient les idées qu’ils avaient reçues de leurs ancêtres ; le sens humain abruti ne pouvait plus s’élever ; les hommes ne voulant plus adorer que ce qu’ils voyaient, l’idolâtrie se répandait par tout l’univers. Cependant une idée obscure de la puissance divine se soutenait par sa propre force, mais confondue avec les images venues par les sens ; on adorait tout ce qui paraissait avoir quelque activité, quelque puissance : ainsi le soleil, les astres, qui se faisaient sentir de si loin ; le feu, les élémens, dont les effets étaient si universels, furent les premiers objets de l’adoration publique. Les hommes portèrent la peine de s’être soumis à leurs sens ; les sens décidèrent de tout, et firent, malgré la raison, tous les dieux qu’on adore, sur la terre.
« Du temps d’Abraham et peu après, la connaissance du vrai Dieu paraissait encore subsister dans la Palestine et dans l’Égypte. Melchisedech, roi de Salem, était le pontife du Dieu très-haut qui a fait le ciel et la terre. Abimelech, roi de Gérar, et son successeur, qui portait le même nom, craignaient Dieu, juraient en son nom, et admiraient sa puissance. Les menaces de ce grand Dieu étaient redoutées par Pharaon, roi d’Égypte ; mais, dans le temps de , les nations étaient perverties ; le vrai Dieu n’était plus connu en Égypte comme le Dieu de l’univers, mais seulement comme le Dieu des Hébreux, on adorait jusqu’aux animaux, jusqu’aux reptiles : tout était Dieu, excepté Dieu même ! »
Dans ce tableau, tracé par le génie, on voit l’histoire profane, toujours incertaine lorsqu’elle veut percer l’obscurité des siècles, soumettre ses récits à l’autorité de l’Écriture Sainte, et les puiser dans cette source infaillible qui peut seule nous éclairer sur la formation de l’univers. On voit la cause des premières erreurs, des premiers désordres, et l’on cesse de s’étonner
« en voyant l’esprit humain, poussé par une aveugle impression, s’enfoncer dans l’idolâtrie sans que rien put le retenir.
« L’homme, regardant comme divin tout ce qui était puissant, et se sentant entraîné vers le vice par une force irrésistible, crut que cette force était hors de lui : il s’en fit un Dieu ; c’est de là que le crime eut des autels, et que l’homme, troublé par ses remords, regarda la divinité comme ennemie, et crut ne pouvoir l’apaiser par les victimes ordinaires. La frayeur poussa les pères jusqu’à immoler leurs enfans, et à les briller au lieu d’encens à leurs dieux. »
Après avoir fixé nos regards sur ces premières causes, considérons comment les hommes purent tomber dans une barbarie qui s’accrut sans cesse, à mesure qu’ils s’éloignèrent davantage de leur berceau.
Les premières familles se multiplièrent. La terre ne souriait plus à l’homme ; elle ne produisait plus d’elle-même. La nécessité des subsistances força les premières émigrations. Il fallut chercher de nouveaux fruits, de nouveaux champs : et les familles, en s’éloignant, emportèrent avec elles des souvenirs que rien ne pouvait détruire. Elles n’avaient point vu ce jardin délicieux, séjour de l’innocence, où le premier homme avait été placé pendant les premières années de sa vie : mais sa description avait passé d’âge en âge, et le besoin d’être heureux, ce besoin le plus constant et le plus impérieux de tous, en éternisait la mémoire ; peut-être même fut-ce un vague espoir de retrouver ce lieu si cher et si regretté, qui décida ces familles errantes à diriger leurs pas, vers des plages inconnues. Bientôt la plus triste réalité vint remplacer les douces illusions de l’espérance. En pénétrant plus avant dans les terres, on ne rencontra plus en quelque sorte que les débris du globe, que le déluge universel avait bouleversé, et les dangers qui menaçaient à chaque pas en imprimèrent le souvenir en caractères ineffaçables.
Après de vaines et pénibles recherches, la nécessité de subsister commanda de s’arrêter et de se livrer au travail : mais cruels obstacles ne fallut-il pas surmonter ? Des forêts immenses qui interceptaient les rayons du soleil, et qu’infectaient des reptiles venimeux ou des animaux féroces ; des marais que l’art n’avait point encore appris à dessécher, des plaines arides ou qui ne produisaient que des ronces : tels étaient les nouveaux domaines réservés à l’homme. La nature entière semblait armée contre lui : partout il cherchait la sûreté, le repos, partout il trouvait la fatigue et la mort ; et peur combler son malheur, il conservait la mémoire de son bonheur primitif. Cependant il fallut travailler ou périr : quelques portions de terre furent cultivées ; mais celui dont les sueurs suffisaient à peine à le nourrir avec sa famille ne songea pas d’abord à être généreux ; il entoura ses champs, il défendit ses récoltes ; et, leur conservation pouvant seule assurer son existence, il menaça de la mort quiconque essaierait de les ravir. Ce fut ainsi que s’établit le droit de propriété parmi des hommes que la crainte de périr de misère et de faim arma bientôt les uns contre les autres.
Un seul père de famille, entouré de ses enfans, aurait pu long-temps conserver la paix, mais pressé par d’autres hommes que poursuivaient les mêmes besoins, et dont l’industrie ou les travaux étaient inégaux aux siens, il fut promptement réduit à se servir de la force pour s’opposer à leurs rapines. Les instrumens qui servaient à féconder la terre devinrent des instrumens de mort ; la guerre naquit, et, lorsque ce fléau terrible eut déployé ses fureurs, les meurtres, les vengeances, la cupidité, l’injustice, vinrent inonder la terre. L’homme, alors tout entier à ses besoins, à ses passions, songea d’autant moins à conserver les préceptes et le culte du vrai Dieu, qu’il en avait déjà perdu la connaissance lorsqu’il s’était éloigné de sa terre natale. Chaque génération qui suivit s’écarta de plus en plus de la lumière ; l’empire du crime s’établit : lui seul donna les lois, ou plutôt plongea dans la plus horrible barbarie, en ne laissant plus pour guide que les désirs et les mouvemens déréglés des passions.
Abandonnons ces hordes sauvages, leur histoire ne pourrait qu’effrayer, nous la reprendrons par la suite, aux époques où des colonies policées, et conduites par des chefs habiles et courageux, vinrent les arracher à cet état déplorable, en leur apportant des lois plus sages et des mœurs plus douces.
Revenons vers les lieux qu’habitèrent les premiers hommes.
« La tradition du déluge universel, dit , se trouve par toute la terre : l’arche où se sauvèrent les restes du genre humain a de tout temps été célèbre en Orient, principalement dans les lieux où elle s’arrêta après le déluge. Plusieurs circonstances de cette fameuse histoire se trouvent marquées dans les annales et les traditions des anciens peuples. C’est en Orient qu’arriva la confusion des langues à la tour de Babel, premier monument de l’orgueil et de la faiblesse des hommes. C’est là que se fit le partage des trois enfans de Noé et la première distribution des terres.
« La mémoire de ces trois premiers auteurs des nations et des peuples s’est conservée parmi les hommes. Japhet, qui a peuplé la plus grande partie de l’Occident, y est demeuré célèbre sous le fameux nom de Japhet. Cham et son fils n’ont, pas été moins connus parmi les Égyptiens et les Phéniciens, et la mémoire de Sem a toujours duré parmi le peuple hébreu qui en est sorti.
« Un peu après ce premier partage du monde, Nemrod, homme farouche et violent, devint le premier des conquérans (telle est l’origine des conquêtes) ; il établit son royaume à Babylone, au même lieu où la tour de Babel avait été commencée, et déjà élevée très-haut, mais non pas autant que le souhaitait la vanité humaine.
« Environ dans le même temps, Ninive fut bâtie, et quelques anciens royaumes établis. Ils étaient petits dans les premiers temps. On trouve dans la seule Égypte quatre principautés : celle de Thèbes, celle de Thin, celle de Memphis et celle de Thanis, capitale de la basse Égypte. On peut rapporter à ces temps le commencement des lois et de la police des Égyptiens, celui de leurs pyramides, qui durent encore, et celui de leurs observations astronomiques, ainsi que de celles des Chaldéens. Voilà les commencemens du monde, continue , tels que nous les représente : commencemens heureux d’abord, pleins ensuite de maux infinis. Depuis ce temps, l’ambition s’est jouée sans bornes de la vie des hommes ; ils en sont venus à ce point de s’entre-tuer sans se haïr : le comble de la gloire et le plus beau des arts a été celui de se détruire les uns les autres. »
Ces rapprochemens historiques de suffisent pour nous faire connaître quels furent les premiers établissemens des hommes, et comment ils oublièrent les préceptes qu’ils avaient reçus de Dieu même. Ils prouvent aussi que le souvenir des plus grands événemens ne dut jamais se perdre, et qu’aussitôt que la corruption eut conduit jusqu’à imaginer des dieux, on dut confondre ensemble les vérités historiques de l’histoire fabuleuse des divinités. L’observation fait concevoir aussi que les Orientaux ne durent point tomber dans la même barbarie qui déshonora les peuples qui s’étaient enfoncés le plus avant dans les terres. Les patriarches avaient transmis aux premiers leurs arts et de grandes idées ; aussi voit-on leurs ouvrages étonner encore aujourd’hui l’univers, malgré les ravages des siècles. Nous n’en ferons point la description, elle nous écarterait trop de notre sujet ; mais nous engageons nos lecteurs à lire lui-même, à l’article des réflexions sur les empires, dans son Discours sur l’Histoire Universelle. Cet ouvrage, le plus éloquent que la langue française ait produit, ne peut être abrégé, et ceux qui le liront nous sauront gré de les avoir mis dans la nécessité de payer à ce morceau sublime le tribut d’admiration qu’il mérite.
Pour concevoir quelque ordre dans les temps obscurs, et pour faire connaître la différence qui existe entre les dieux de l’Orient et les dieux de l’Occident, nous allons donner les principales notions qui restent sur les traditions des Chaldéens, des Phéniciens et des Égyptiens. On verra que ce fut parmi ces peuples que l’idolâtrie prit naissance ; et la suite de cet ouvrage prouvera que ce furent des colonies de ces mêmes peuples qui portèrent aux Grecs et aux peuples de l’Occident des lois, des coutumes, des mœurs plus douces, et la plus grande partie de leurs arts. Par la suite des temps, les Grecs les transmirent aux Romains ; et c’est pour ne pas confondre les époques, que l’on a séparé les dieux du paganisme en deux classes : celle des dieux de l’Orient, et celle des dieux de l’Occident.
Tradition des Chaldéens. §
C’est parmi les peuples de l’Asie qu’il faut chercher l’origine de l’idolâtrie. On ne peut disputer aux Chaldéens d’être un des plus anciens peuples de la terre. Nemrod en fut le premier roi. Il est regardé comme l’auteur du dessein insensé de la tour de Babel, et vivait du temps même de Phaleg.
Malgré la difficulté de remonter jusqu’à des temps aussi reculés, il existe toujours quelques traces qui servent à faire reconnaître la vérité. Les historiens, en se succédant d’âge en âge, ont eu besoin d’autorités pour garantir leurs écrits ; ils ont cité des fragmens des historiens qui les avaient précédés ; c’est en les recueillant avec soin, qu’un observateur attentif appuie ses réflexions sur des bases solides, et qu’il peut éviter de s’égarer, quoique les premiers écrits des hommes soient perdus.
L’historien rapporte que les Chaldéens avaient eu soin, dans les temps les plus anciens, de conserver par des inscriptions publiques et par d’autres monumens, le souvenir de ce qui s’était passé. Il dit qu’ils avaient fait écrire leurs annales par les plus sages de leur nation. On peut ajouter à ce témoignage que rien ne prouve mieux leur antiquité que le rapport de leur opinion sur l’origine du monde avec ce qu’en a dit . On le remarque surtout dans leurs récits sur les dix premières générations qui précédèrent le déluge, et sur les dix qui le suivirent.
Quatre auteurs anciens1 avaient écrit l’histoire des Chaldéens. Leurs ouvrages sont perdus ; mais il en reste des fragmens que l’on retrouve dans , dans et dans : c’est ce dernier qui nous a conservé le morceau de que nous allons donner.
« Un homme, ou plutôt un monstre moitié homme et moitié poisson, sorti de la mer Érythréenne, parut près de Babylone. Il avait deux têtes ; une supérieure, semblable à celle d’un homme, et une inférieure, semblable à celle d’un poisson. Il avait des pieds d’homme, l’on apercevait une queue de poisson ; du reste, sa voix et sa parole étaient semblables à celles d’un homme : on conserve encore son image.
« Ce monstre, selon , demeurait le jour avec les hommes sans manger ; il leur donnait la connaissance des lettres et des sciences ; il leur enseignait la pratique des arts, la manière de bâtir des villes, des temples, d’établir des lois ; il leur donnait des principes de géométrie, leur apprenait à semer, à recueillir les fruits, en un mot, tout ce qui pouvait contribuer à les polir et à leur donner d’autres mœurs. Au soleil couchant, il se retirait dans la mer et passait la nuit dans les eaux. Il en parut d’autres semblables à lui, et avait promis de révéler ces mystères dans les histoires des rois ; mais il ne nous en est rien resté. Ce poisson se nommait . Il avait laissé quelques écrits sur les origines, dans lesquels il enseignait qu’il y avait eu un temps où tout n’était que ténèbres et eau ; que cette eau et ces ténèbres renfermaient des animaux monstrueux, des hommes avec deux ailes, et d’autres avec quatre. On voyait des hommes avec deux têtes, une d’homme, une de femme ; tous les animaux enfin, et tous les êtres étaient d’une forme irrégulière, tels qu’on en voyait les représentations dans le temple de Bel.
« Une femme, nommée Omorca, était la maîtresse de l’univers. Bel la divisa en deux : une de ces parties forma le ciel, et l’autre la terre ; alors les monstres de formes irrégulières disparurent. Bel partagea ensuite les ténèbres, sépara le ciel d’avec la terre, et arrangea l’univers. Après avoir détruit les animaux qui ne pouvaient soutenir l’éclat de la lumière, et voyant le monde désert, il ordonna à un des dieux de lui couper la tête à lui-même, de mêler avec de la terre le sang qui coulerait, et d’en former les hommes et les animaux ; après quoi il forma les astres, les planètes, et acheva ainsi la production de tous les êtres. »
Voilà ce que renfermait le premier livre de ; et quelque singulière que soit cette fable, elle paraît n’être qu’une tradition défigurée de la création du monde, tirée des écrits de . On doit le remarquer surtout à l’endroit où il est dit que les ténèbres couvraient alors la terre mêlée avec l’eau. Les monstres dont on vient de lire la description ne sont qu’une allégorie pour peindre d’une manière sensible la confusion qui régnait dans le monde au moment de la création.
La formation de l’homme est prise aussi de la narration de
,
lorsqu’il dit que Dieu, après s’être comme exhorté lui-même à la production de ce chef-d’œuvre, prit de la terre qu’il détrempa avec de l’eau, et lui souffla un esprit de vie
. Voilà sans doute ce qui fait dire à
que Bel s’était fait couper la tête.
conclut ensuite que ce fut par ce moyen que l’homme fut doué d’intelligence.
Il est de même aisé de juger que la fiction des hommes à deux têtes, une d’homme et une de femme, est tirée de l’histoire de
,
lorsqu’il rapporte que la femme fut tirée d’une des côtes d’Adam, et qu’en la voyant il s’écria : voilà la chair de ma chair, et les os de mes os
. L’esprit humain fait en vain des efforts pour corrompre la vérité ; elle laisse toujours quelque trace lumineuse qui la fait reconnaître. On s’aperçoit que
était à la fois trop rapproché de l’origine du monde, pour n’être point convaincu de sa nouveauté, et trop éloigné de la source sacrée où il aurait pu s’instruire, pour en avoir la connaissance. Il n’existait plus autour de lui que des traditions défigurées et confuses ; mais le bel ordre de l’univers avait tellement frappé ses regards, qu’il lui avait été plus facile de croire à des traditions altérées, qui peignaient un Dieu tout-puissant, formateur de tout ce qui existe, que de croire que tout ce qui l’environnait était éternel, ou qu’il s’était formé par sa seule force.
Observons de plus que, si l’on veut remonter à l’étymologie du mot , il paraît qu’il est formé du mot syriaque onedo, qui signifie voyageur. Alors on aperçoit que, dans un temps qu’on ne saurait déterminer, il arriva par mer un homme qui donna aux Chaldéens quelques connaissances des anciennes traditions, et leur laissa des mémoires sur ce sujet. On le représenta comme moitié poisson, parce qu’il venait de la mer, et qu’il était couvert de peaux de poissons. Tous les soirs il se retirait dans son vaisseau ; de là on a dit qu’il rentrait dans la mer. Il ne prenait ses repas que sur son bord ; on a dit qu’il ne mangeait pas. Un fragment d’ , qui a été conservé, rapporte toute l’histoire d’ , et donne cette explication sur sa prétendue forme de poisson.
Telle était la tradition des Chaldéens sur l’origine du monde : on y voit que les dieux étaient antérieurs à sa formation ; mais il n’y est point parlé du moment de leur naissance, ni des attributs qui les distinguaient.
On parle si souvent et avec tant d’étonnement des anciennes observations astronomiques des Chaldéens, et du grand nombre de siècles qu’ils se plaisaient à citer, que, pour donner une explication de ce mystère historique, nous croyons devoir rapporter la manière dont ils comptaient les temps et les règnes.
Les Chaldéens comptaient les générations et les règnes par sares. Ils divisaient aussi les temps par nères et par soses. Le sare marquait trois mille six cents ans, le nère six cents, et le sose soixante.
Cette manière de compter semble donner à la durée des premiers règnes un nombre infini d’années, car chacun de leurs premiers rois avait vécu plusieurs sares. Mais l’Histoire Universelle, par une société d’Anglais, et les plus habiles observateurs, se sont réunis pour nous apprendre que les Chaldéens donnaient le nom d’années à leurs jours ; de sorte qu’en réduisant le calcul de trois mille six cents ans, qui composaient un sare, à trois mille six cents jours, il se trouve que le nombre d’années rapporté par ces anciens auteurs est presque entièrement le même que celui donné par à la durée de la vie des anciens patriarches.
Ce rapprochement est d’autant plus exact, qu’il se trouve absolument conforme aux observations astronomiques. M. , dans son Histoire de l’Astronomie ancienne, donne la preuve de ce calcul ; il remonte d’éclipse en éclipse, et parvient, en comptant par jours au lieu d’années, jusqu’aux éclipses citées par les Chaldéens. C’est ainsi que la vanité a souvent jeté un voile sur les anciens temps, parce que chaque nation a voulu reculer le plus possible l’époque de son origine.
Les Chaldéens rapportent l’histoire de leurs dix premiers rois, dont le dernier fut Xixutrus. Ils racontent que ce fut dans son temps qu’arriva le déluge ; nous allons citer ce qu’ils en ont dit, pour mieux prouver combien leur tradition avait de rapport avec l’histoire sainte : ce morceau démontrera en même temps que les anciennes fables sont fondées sur les anciens souvenirs, et ne sont pas de simples jeux de l’imagination.
« Chronus ou Saturne, étant apparu en songe à Xixutrus, l’avertit que, le quinzième du mois Doessius, le genre humain serait détruit par un déluge, et lui ordonna de mettre par écrit l’origine, l’histoire et la fin de toutes choses ; de cacher ses mémoires sous la terre dans la ville du soleil, nommée Sippara ; de construire ensuite un vaisseau, d’y mettre les provisions nécessaires, et d’y entrer, lui, ses parens et ses amis ; d’y enfermer aussi les oiseaux et les animaux à quatre pieds. Xixutrus exécuta ponctuellement ces ordres, et fit un navire qui avait deux stades de largeur et cinq de longueur ; il n’y fut pas plus tôt entré que la terre fut inondée. Quelque temps, après, voyant les eaux diminuées, il lâcha quelques oiseaux, qui, ne trouvant ni nourriture ni lieu où se reposer, retournèrent au vaisseau. Quelques jours après, il en lâcha d’autres qui revinrent avec un peu de boue aux pâtes ; la troisième fois qu’il les laissa aller, ils ne revinrent plus ; ce qui lui fit juger que la terre commençait à être suffisamment découverte. Il fit alors une ouverture au vaisseau, et voyant qu’il s’était arrêté sur une montagne, il en sortit avec sa femme, sa fille et le pilote ; il adora la terre, éleva un autel, sacrifia aux dieux ; ensuite lui et tous ceux qui l’avaient accompagné disparurent. Ceux qui étaient restés dans le vaisseau, ne les voyant pas revenir, en sortirent et les cherchèrent vainement. Une voix se fit entendre, et leur annonça que la piété de Xixutrus lui avait mérité d’être enlevé dans le ciel, et d’être mis au rang des dieux avec ceux qui l’accompagnaient. La même voix les exhorta à être religieux et à se transporter à Babylone, après avoir déterré à Sippara les mémoires qui y avaient été déposés. La voix ayant cessé de se faire entendre, ils allèrent bâtir la ville que l’on vient de nommer et quelques autres. »
Telle est la célèbre tradition des Chaldéens, où l’on voit déjà la fable se mêler à l’histoire sainte. Il est bon d’observer que
, en donnant son fragment, ne dit rien du moment où parut
. Il commença son histoire en disant :
La première année, parut cet homme extraordinaire.
Il est donc évident qu’
ne commence pas les temps, mais qu’il fut le premier qui apporta des instructions aux Chaldéens, et leur laissa cette tradition.
Tradition des Phéniciens. §
, prêtre de Béryte, qui vivait avant la guerre de Troie, avait écrit sur la religion des Phéniciens ; l’ouvrage de cet ancien auteur est perdu : il subsistait encore vers le règne des Antonins. Ce fut alors que le traduisit en grec : mais en cherchant à l’accommoder aux idées de son pays, il l’altéra considérablement. en a conservé un fragment ; c’est tout ce qui en reste. On croit que lui-même avait puisé ses écrits dans ceux de ou , auteur égyptien que les Grecs ont nommé , et qui passe pour avoir été le premier inventeur des lettres.
Le nom de est si célèbre parmi les savans, que nous croyons devoir donner une partie de ce fragment ; elle suffira pour prouver combien les idées religieuses des Phéniciens étaient déjà altérées.
Selon
,
« le premier principe de l’univers a été un air ténébreux et spiritueux, un chaos plein de confusion et sans clarté, éternel et d’une durée sans fin. Cet esprit produisit Mot ou Mob, c’est-à-dire un limon ou un mélange aqueux, qui fut le principe de toutes les créatures et la génération de l’univers. Il y eut d’abord les animaux qui n’avaient aucun sentiment ; ils en engendrèrent d’intelligens et contemplateurs des cieux. Immédiatement après Mob, le soleil, la lune, les étoiles et les autres astres commencèrent à paraître et à luire. Un violent degré de chaleur communiqué à la terre produisit des vents et des nuées qui tombèrent en pluie : cette pluie attirée par le soleil forma les orages, et le bruit du tonnerre réveilla les animaux intelligens qui commencèrent à se mouvoir sur la terre et dans la mer, etc., etc. »
Cette portion du fragment de suffit pour faire voir que le véritable auteur de l’univers était déjà méconnu par les Phéniciens. Il rapporte ensuite l’histoire du premier homme et de la première femme.
« Le premier père des hommes se nommait Protogone, et la première mère Aéòn ; ce fut elle qui trouva que les fruits des arbres étaient bons, et pouvaient servir à la nourriture des hommes. Les enfans de ces premiers parens du genre humain, nommés Genae et Genus, habitèrent la Phénicie. Une grande sécheresse étant survenue, ils étendirent leurs mains vers le soleil, qu’ils regardèrent comme le seul Dieu et le maître des cieux. Genus engendra d’autres hommes, qui furent nommés Lumière, Feu et Flamme. Ce furent eux qui trouvèrent l’usage du feu, en frottant deux morceaux de bois l’un contre l’autre. Leurs enfans, qui furent d’une grandeur démesurée, donnèrent leurs noms aux montagnes ; de là les noms du mont Cassius, du Liban, Antiliban, etc., etc. »
Il est facile d’apercevoir sous cette enveloppe l’histoire défigurée de la création de l’homme, peut-être même celle du fruit défendu ; et l’on trouve les géans dont parle l’Écriture Sainte. On doit aussi remarquer parmi ces peuples l’origine de l’idolâtrie, puisqu’il est dit qu’ils adoraient le soleil. On les voit déjà mêler à leur religion l’invention des arts utiles. Nous ne suivrons pas plus au long le fragment de , puisqu’il est évident qu’il a puisé sa tradition, ou ses écrits, dans d’autres traditions plus anciennes et déjà corrompues. Il paraît, au rapport des savans, comme nous l’avons déjà dit, qu’il a pris ses idées dans l’Égyptien. Les observations les plus exactes servent à prouver que les Phéniciens avaient adopté les idées religieuses et les dieux des Égyptiens. Quelques auteurs croient que les Phéniciens avaient précédé les Égyptiens ; mais cette question ne peut intéresser que les savans, dont l’opinion est partagée sur ce point. Ce qu’il nous importe de savoir, c’est que l’un et l’autre peuples avaient déjà mêlé des systèmes aux souvenirs qu’ils conservaient de la tradition des premiers patriarches.
Tradition des Égyptiens. §
, en rapportant la tradition des Égyptiens, dit :
« Au commencement le ciel et la terre n’avaient qu’une forme, étant mêlée ensemble par leur nature ; mais ensuite ayant été séparés, le monde commença à prendre la forme que nous lui votons. Par le mouvement de l’air, les parties du feu s’élevèrent et donnèrent au soleil, à la lune et aux autres astres, leur mouvement circulaire. La matière solide tomba en bas et forma la terre et la mer, d’où sortirent les animaux et les poissons, à peu près comme on voit encore en Égypte sortir de la terre, détrempée par les eaux du Nil, une infinité d’insectes et d’autres animaux. »
Il n’est pas besoin de citer plus au long cette tradition pour faire apercevoir ses défauts, puisque le créateur n’a aucune part dans cette formation de l’univers. Les auteurs de ce système ne paraissent pas même sentir la nécessité d’une première cause. Il faut cependant rendre aux Égyptiens la justice de dire qu’en étudiant leur langue sacrée, dont les hiéroglyphes étaient les emblèmes, on voit qu’ils croyaient généralement qu’une nature inanimée et confuse ne pouvait être l’origine de toutes choses.
Quelques hommes, parmi les Égyptiens, croyaient qu’il existait une intelligence suprême qui avait créé le monde, et que dans l’homme il existait de même une intelligence supérieure au corps, et qui était l’âme. Mais cette idée grande et sublime n’était admise et conservée que par quelques êtres plus éclairés que la multitude. Or, comme ils attachaient le plus grand prix à cette opinion, qui les élevait au-dessus des autres hommes, ils l’enveloppaient de mystères impénétrables. On n’était admis à la connaissance de ces mystères qu’après avoir passé par les épreuves les plus terribles. Ces épreuves se nommaient initiations. La religion des peuples n’était qu’une idolâtrie grossière. Frappés à la vue du soleil et des autres astres, ils s’imaginaient que ces corps lumineux étaient les maîtres du monde et les seuls dieux qui le gouvernaient.
« Ils nommèrent le soleil Osiris, et la lune Isis. Osiris, disaient-ils, signifie plein d’yeux, très-clairvoyant ; Isis signifiait l’antique, parce qu’ils croyaient la lune éternelle. Ils ne s’en tinrent pas là : dès que l’on a fait le premier pas dans les ténèbres, on s’égare à mesure que l’on s’avance. Les Égyptiens adoptèrent huit grands dieux : le Soleil, Saturne, Rhéa, Jupiter, Junon, Vulcain, Vesta et Mercure ou Hermès. Chronos ou Saturne, ayant épousé Rhéa, devint père d’Osiris et d’Isis, ou, selon d’autres, de Jupiter et Junon. Selon ces derniers, Jupiter enfanta cinq autres dieux : Osiris, Isis, Typhon, Apollon, et Aphrodite ou Vénus. Ils ajoutaient qu’Osiris était le même que Bacchus, et Isis la même que Cérès. »
Nous venons de citer les noms de ces dieux, parce qu’on les retrouvera sans cesse parmi les dieux de l’Occident, c’est-à-dire les dieux adoptés par les Grecs et les Romains, ce qui prouvera d’une manière incontestable que les Grecs reçurent leur culte et leurs dieux des colonies égyptiennes et phéniciennes qui, par la suite du temps, allèrent les policer.
Il faut remarquer aussi que, comme dans les apothéoses, on changeait souvent les noms des personnes déifiées, Osiris fut appelé Sérapis, Dionysius, Pluton, Jupiter, Pan ; de même Isis sa femme fut honorée sous les noms de Séléné, de la Lune, de Héra ou de Junon. Orus, fils d’Isis, est celui que les Grecs nommèrent depuis Apollon.
« La mythologie égyptienne, dit , a deux sens, l’un sacré et sublime, l’autre sensible et palpable. C’est pour cela que les Égyptiens placent des sphinx à la porte de leurs temples. Ils veulent par-là nous faire entendre que leur théologie contient les secrets de la sagesse, sous des paroles énigmatiques. On peut supposer le même but à l’inscription qu’on lit à Saïs, sur une statue de Minerve ou Isis : Je suis tout ce qui est ; tout ce qui a été, tout ce qui sera, et jamais mortel n’a levé le voile qui me couvre. »
La théologie des Égyptiens avait donc deux significations, l’une sainte et symbolique, l’autre vulgaire et littérale. Les figures des animaux représentés dans les temples, et qu’ils semblaient adorer, n’étaient que des hiéroglyphes destinés à représenter les attributs divins.
« Toutes les nations orientales, dit , les Perses, les Indiens, les Syriens, cachent des mystères secrets sous leurs fables religieuses. Le sage de toutes ces religions en pénètre aisément le sens, mais le vulgaire n’en voit que l’écorce. »
C’est en rapprochant ces diverses observations qu’on pourra comprendre comment les Égyptiens, si grands dans leurs ouvrages, si sages dans leurs lois, leurs coutumes, et si célèbres dans les sciences, ont paru en même temps assez aveuglés pour adorer des insectes, des reptiles, des plantes, des animaux. Les historiens sacrés et profanes parlent de ce peuple comme de la plus sage des nations, et l’un des éloges que l’esprit saint donne à et à Salomon, est
qu’ils étaient instruits dans toutes les sciences des Égyptiens
.
Il faut donc bien distinguer l’ignorance qui régnait parmi la multitude, d’avec les connaissances profondes que possédaient ceux qui cultivaient les sciences et qui avaient lu les livres attribués à
, ou trois fois grand. Selon cet homme si célèbre,
« Dieu exista dans son unité solaire avant tous les êtres. Il est la source de tout ce qui est intelligent, le premier principe incompréhensible, suffisant à lui-même, et père de toutes les essences. »
Nous ne croyons point fatiguer nos lecteurs en faisant de pareilles citations. Tout être qui a reçu la raison en partage doit désirer de connaître l’idée que les premiers philosophes du monde avaient adoptée sur la divinité. Nous allons aussi rapporter la définition qu’en a donnée le célèbre ; c’est la plus belle qu’ait produite l’antiquité. l’a conservée dans sa Préparation évangélique ; il l’avait extraite mot pour mot d’un livre de , qui existait encore de son temps, et qui avait pour titre : Recueil sacré des monumens persans.
« Dieu est le premier des incorruptibles, éternel, non engendré. Il n’est point composé de parties ; il n’y a rien de semblable ni d’égal à lui. Il est auteur de tout bien, le plus excellent de tous les êtres excellens, et la plus sage des intelligences ; le père de la justice et des bonnes lois, instruit par lui seul, suffisant à lui-même, et premier producteur de la nature entière. »
Ces définitions sublimes de la Divinité prouvent qu’il existait quelques hommes supérieurs à leurs siècles, et qui avaient recueilli les lumières conservées par les anciennes traditions ; mais ces hommes étaient si rares, qu’ils ne pouvaient arrêter les progrès de l’ignorance et de l’idolâtrie la plus absurde.
Il ne faut donc point confondre les dieux et les fables des poëtes avec les traditions conservées par quelques sages. Les poëtes passent rapidement du sens littéral à l’allégorie, et de l’allégorie au sens littéral ; c’est ce qui cause le mélange de leurs images, l’absurdité de leurs fictions, et souvent l’indécence de leurs descriptions.
Plus nous avancerons dans la connaissance de la mythologie, plus nous apercevrons que la plupart des dieux notaient que des hommes que leurs actions avaient illustrés, ou des êtres absolument fabuleux. Un examen réfléchi nous fera reconnaître que la plupart des fictions doivent leur naissance à l’ignorance on à la flatterie ; mais, pour les consacrer, il fallait leur supposer une origine céleste, il fallait les revêtir de couleurs qui les fissent aimer, et les poëtes s’abandonnèrent d’autant plus sûrement aux écarts de leur imagination, qu’ils savaient bien que les penchans et les passions des hommes leur serviraient d’appui. La vérité fut couverte d’un voile ; le mensonge vint en quelque sorte lui prêter ses vêtemens, et, pour mieux assurer son usurpation, il conserva quelques-unes des formes qu’on aimait en elle ; il prit même le perfide soin de les embellir. Ce fut en s’abandonnant sans réflexion et sans réserve à cette méthode, que les poëtes altérèrent dans leurs ouvrages les récits des anciens événemens, dont la tradition et les cantiques religieux avaient conservé les souvenirs.
Dans le temps qu’on élevait des autels aux fausses divinités, on honorait du nom de théologie tout ce qui avait rapport à leur histoire. Ce mot dérive de theos, Dieu, et logos, discours. Depuis que la religion a dissipé les ténèbres de l’idolâtrie, on a senti qu’il fallait donner un nouveau nom à ces recueils de fables, qui conservaient toujours un grand charme, parce que la poésie les avait embellis de ses couleurs les plus brillantes et les plus séduisantes : on appela ces histoires fabuleuses du nom de mythologie, mot dérivé de mythos, fabuleux, et logos, discours.
Après avoir établi la différence qui existe entre les poëtes et les philosophes, nous devons encore observer que ce fut parmi les Orientaux, et surtout chez les Égyptiens, que les hommes les plus célèbres de l’Occident allèrent puiser leurs plus grandes lumières. Ce fut à leur école que se formèrent , et . , le premier maître des Pythagoriciens, qui vivait long-temps avant et , avait été s’instruire en Égypte. C’est delà qu’il avait rapporté la définition suivante de la Divinité.
« Il y a un être inconnu, qui est le plus anciens de tous les êtres et le producteur de toutes choses. Cet être sublime est vie, lumière, sagesse. Ces trois noms marquent la même puissance qui a tiré du néant tous les êtres visibles et invisibles. »
Dans un second passage non moins éloquent, il donne un nom à cet être inconnu.
« L’univers a été produit par Jupiter. L’empirée, le profond tartare, la terre et l’océan, les dieux immortels et les déesses, tout ce qui est, tout ce qui sera, était contenu originairement dans le sein fécond de Jupiter, et en est sorti. Jupiter est le premier et le dernier, le commencement et la fin. Tous les êtres émanent de lui. Il est la vie, la cause de toutes choses ; il est le père primitif : il n’y a qu’une seule puissance, un seul dieu, un seul roi universel de tout… »
Telles étaient les idées sublimes qu’ avait reçues des Égyptiens ; mais elles ne lui avaient été communiquées que parce qu’il était parvenu à se faire initier dans la langue sacrée et dans la connaissance des mystères que l’on cachait à la multitude.
La suite de cet ouvrage nous fera connaître, à l’article des demi-dieux et des héros, quels furent les chefs qui conduisirent en Grèce des colonies égyptiennes et phéniciennes. Nous apprendrons en même temps que, lorsqu’ils y portèrent leurs lois, leurs coutumes, leurs arts et leurs dieux, ils conservaient encore eux-mêmes des souvenirs des anciennes traditions.
Ces rapprochemens doivent suffire pour prouver que l’origine des fables est fondée sur la mémoire altérée des grands événemens qui les avaient précédées.
Première origine de l’idolâtrie. §
Le mot idolâtrie dérive de deux mots grecs, qui signifient culte et représentation.
Il paraît que c’est dans la famille de Cham qu’il faut chercher le premier germe de l’idolâtrie. Les enfans malheureux d’un père maudit oublièrent en peu de temps les sages conseils de Noé ; et, s’abandonnant à leurs passions, ils cherchèrent des objets sensibles pour leur offrir un culte superstitieux. Les deux fils de Cham, Chanaan et Mysraïm, s’étant établis dans la Phénicie et l’Égypte, c’est dans ces deux royaumes qu’on peut croire que l’idolâtrie prit naissance.
dit formellement que
les Égyptiens furent les premiers qui rendirent un culte solennel aux dieux
.
, au commencement de son histoire, dit avec assurance :
Les Égyptiens furent les premiers qui connurent les noms des douze grands dieux, et c’est d’eux que les Grecs les ont appris.
L’Écriture Sainte peint elle-même l’Égypte comme le centre de l’idolâtrie. Là, dit-elle en plusieurs endroits,
régnaient la magie, la divination, les augures, l’interprétation des songes, malheureux fruits d’un culte superstitieux
. Dès le temps de , l’idolâtrie était à son plus haut point ; il ne semble même avoir donné un si grand nombre de préceptes aux Juifs que pour les opposer en tout aux cérémonies égyptiennes.
Voilà sans doute le pays où commença l’idolâtrie ; delà elle se répandit en Orient, dans les lieux où habitaient les descendans de Sem, dans la Chaldée, la Mésopotamie et les lieux voisins ; ensuite elle passa dans l’Occident, parmi les enfans de Japhet, c’est-à-dire dans l’Asie mineure, dans la Grèce et dans les îles. L’Égypte et la Phénicie sont donc les lieux où l’idolâtrie a pris naissance.
Premier objet de l’idolâtrie. §
Si nous en croyons le célèbre
,
la plus ancienne idolâtrie a été celle des deux principes, l’un bon, et l’autre mauvais
.
Les hommes, ayant vu le monde rempli de biens et de maux, et n’ayant plus la tradition sacrée pour guide, ne purent croire qu’un être, qui est essentiellement bon, pût être l’auteur du mal ; ils inventèrent deux divinités égales en puissance et éternelles. Ils crurent que tout le bien venait du bon principe, et tout le mal du mauvais.
ignore l’époque de cette erreur ; mais il assure avec raison qu’elle est très-ancienne.
fait une longue énumération de ceux qui ont enseigné cette doctrine, et
assure que
la trouva établie chez les Perses
.
On ne sait point qui était ce , ni le temps précis où il a vécu. Quelques savans, d’accord, avec , ont cru que c’était Mysraïm lui-même, fils de Cham, qui, après la mort de son père, fut appelé , c’est-à-dire astre vivant, parce qu’il avait porté les Égyptiens à rendre aux astres un culte religieux ; mais cette assertion ne s’accorde nullement avec la sublime définition de la Divinité, que nous avons citée plus haut, et qui a été tirée des ouvrages mêmes de .
Un Anglais très-savant, , qui connaissait mieux que la religion des anciens Perses, a pleinement justifié , en prouvant que cet homme célèbre, bien loin d’avoir introduit l’idolâtrie chez les premiers Égyptiens, n’avait jamais vécu parmi eux, et qu’il n’avait paru que chez les Perses, du temps de Darius Hystapes. Il dit qu’il employa tous ses efforts pour détruire cette absurde conception des hommes, et pour ramener les plus raisonnables à la connaissance d’un seul principe, créateur du ciel et de la terre ; mais ayant trouvé que le culte des astres et des planètes était la religion dominante, et ne voulant pas trop effaroucher les esprits, il prescrivit à l’égard du soleil, principe de la fécondité de la terre, quelques cérémonies religieuses, telles qu’elles se pratiquent encore aujourd’hui dans les Indes, parmi les mages, descendans des anciens Perses. ajoute qu’ils n’adorent qu’un seul dieu, principe de tous les êtres, et que s’ils honorent le feu et le soleil, c’est qu’ils le regardent comme l’image la plus pure du créateur, et le temple où il a établi son trône. Au reste ces mages sont en très-petit nombre.
Quoi qu’il en soit, l’idolâtrie des deux principes existait très-anciennement en Égypte, et c’était pour l’exprimer que les Égyptiens, dans leur théologie remplie de symboles, disaient qu’Osiris avait enfermé dans l’œuf primitif d’où ce monde a été tiré, douze figures pyramidales blanches, pour marquer les biens infinis dont il voulait combler les hommes ; mais que Typhon son frère, auteur du mal, ayant ouvert cet œuf, y avait introduit douze autres pyramidales noires, source de tous les maux répandus sur la terre.
Les Perses donnaient au bon principe le nom d’Oromase, et celui d’Arimane au mauvais principe. Les Chaldéens les représentaient par leurs planètes bienfaisantes ou nuisibles.
Par la suite des temps, alla prendre cette opinion dans l’Égypte, et la répandit dans la Grèce, qui la transmit aux Romains. Le fameux l’adopta, et voulut la mêler au christianisme vers le quatrième siècle de l’église.
Second objet de l’idolâtrie. §
Quelque ancienne que paraisse être l’opinion des deux principes, un grand nombre de savans croient que l’adoration des astres est encore plus ancienne. L’idée de la divinité n’ayant pu s’effacer entièrement, il est probable que les hommes, faibles mais orgueilleux, ne commencèrent point par adorer leurs semblables. Il fallut de plus grands objets pour les séduire. Le soleil, par sa beauté, le vif éclat de sa lumière, la rapidité de sa course, sa régularité à éclairer tour-à-tour la terre entière, et à porter partout la fécondité, fit croire à des hommes ignorans et déjà corrompus qu’il n’y avait point d’autre dieu que lui, ou que du moins cet astre était le trône de la Divinité.
Les hommes n’ayant pu s’élever jusqu’à l’idée d’une substance immatérielle et invisible, ne trouvèrent rien dans la nature de plus beau que le soleil ; peut-être même que la reconnaissance les y attacha : ils ne pouvaient douter qu’il ne fût la source de la fécondité ; ils l’adorèrent comme le dispensateur de tous les biens, de tous les fruits, et de tout ce qui était agréable ou utile au genre humain.
dit :
« Les premiers hommes, frappés de la beauté de l’univers, de l’éclat et de l’ordre qui brillent de toutes parts, ne doutèrent point qu’il n’y eût quelque divinité qui y présidât. Ils adorèrent le soleil et la lune sous les noms d’Osiris et d’Isis. »
Ce passage de prouve à la fois que, de son temps, on regardait le culte des astres comme le plus ancien, et que ce fut en Égypte qu’il commença.
On trouve dans que les premiers hommes qui habitèrent la Grèce ne reconnaissaient point d’autres dieux que ceux qu’adorent encore aujourd’hui les barbares, savoir, le soleil, la lune, la terre, les astres et le ciel. C’est aussi le sentiment de ; mais rien ne prouve mieux l’antiquité de cette idolâtrie, que le soin que prenait de la proscrire.
Prenez garde, disait-il aux Israélites, qu’élevant vos yeux vers le ciel, et y voyant le soleil, la lune et tous les autres astres, vous ne tombiez dans l’erreur, et que vous ne rendiez un culte d’adoration à des créatures que le Seigneur votre Dieu a faites pour le service de toutes les nations qui sont sous le ciel.
C’était après la sortie d’Égypte et dans le désert que donnait ce précepte ; on voit donc que c’était pour faire oublier au peuple de Dieu les superstitions dont il avait été le témoin, et pour le garantir de celles qu’il rencontrerait parmi les autres peuples ; car dès lors le culte des astres était presque universel. Il avait passé de l’Égypte dans les pays voisins. Les Ammonites adoraient le soleil sous le nom de Moloch ; les Chaldéens, sous le nom de Bélus ou de Baal, ou de Baal Semen, qui veut dire seigneur du ciel. Les Arabes lui offraient chaque jour de l’encens, des parfums, et l’appelaient Adonée ; les Mohabites, Beelphegor ; les Perses, Mythras. Il était nommé Azabinus par les Éthiopiens, Liber par les Indiens, enfin Apollon ou Phœbus par les Grecs et les Romains.
, dans ses Commentaires, dit aussi que
les anciens Germains n’avaient d’autres dieux que ceux dont ils recevaient quelque bien, comme le soleil, la lune, le feu
. Depuis la découverte de l’Amérique, on a reconnu que presque tous les peuples de ce vaste continent adoraient le soleil. Les Incas s’appelaient ses fils, comme les héros grecs se disaient les fils de Jupiter ou d’Hercule. On peut même assurer que tous les peuples dont la religion nous a été connue ont adoré cet astre ; il n’en faut excepter que les habitans de la zone torride, qui, sans cesse brûlés par ses rayons, le maudissent comme une puissance malfaisante.
avait entrepris de prouver que tous les dieux du paganisme pouvaient se réduire au soleil et à la lune. Dans les détails qu’il en fait, non-seulement il trouve ceux que nous avons déjà nommés ; mais encore Cœlus, Saturne, Jupiter, Mars, Apollon, Mercure, Ammon, Bacchus, Sérapis, Adonis, Esculape, Atys, Pan et plusieurs autres. De même, selon lui, toutes les déesses servaient à représenter la lune ; il nomme Cérès, Diane, Lucine, Vénus-Uranie, la grande déesse de Syrie, Cybèle, Isis, Vesta, Astarté, Junon, Minerve, Proserpine, Hécate, et plusieurs autres qui n’étaient que l’Isis des Égyptiens, nom qui veut dire l’ancienne, et qui parmi ce peuple était le symbole de la lune. Tels paraissent avoir été les premiers objets de l’idolâtrie et les fondemens de la théologie païenne.
On donna le nom de Sabisme au culte qui a pour objet les astres et les planètes. Les savans ne conviennent pas entre eux de ce qui peut avoir donné lieu à cette dénomination ; mais l’essentiel est de savoir que cette secte est la plus ancienne et la plus générale, plus même que celle des deux principes, et qu’elle existe encore aujourd’hui parmi plusieurs peuples de l’Amérique. L’Écriture Sainte nous apprend qu’elle a commencé peu de temps après le déluge, puisqu’elle était connue d’Abraham, de Tharé, et de Sarug.
Progrès de l’idolâtrie. §
Les premiers hommes, en se séparant, tombèrent bientôt dans la barbarie la plus grossière. Les Grecs, qui par la suite devinrent si spirituels et si polis, ne durent leurs lumières qu’aux colonies qui vinrent les policer. Cependant le commencement de l’idolâtrie ne fut point un système raisonné ; rien n’était plus simple que la religion et les cérémonies des premiers idolâtres. Du temps de Cécrops, les Athéniens ils offraient à Jupiter que de simples gâteaux. Les premiers Scythes adoraient un cimeterre ; les Arabes, une pierre brute. Dans l’île d’Orcade, l’image de Diane était un morceau de bois non travaillé. A Chyteron, Junon-Thespia n’était qu’un tronc d’arbre coupé ; celle de Samos une simple planche. Mais l’invention des arts rendit rapides les progrès de l’idolâtrie. Des statues bien faites attirèrent le respect ; on commença à croire que les dieux qu’elles représentaient se plaisaient à les habiter. Par exemple, on ne comptait que trois Muses. Trois sculpteur différens les ayant représentées, leurs statues parurent si belles, que les neuf furent consacrées, et ce fut ainsi que l’on augmenta le nombre de ces déesses.
Du culte des astres on passa à celui du ciel, des élémens, des mers, des fleuves, etc. ; l’on parvint enfin jusqu’à placer les grands hommes parmi les dieux. L’invention d’un art utile, la beauté d’un ouvrage, la reconnaissance pour des bienfaits, la tendresse d’une épouse pour son époux, firent élever des temples, des autels, honorer des portraits, consacrer des bois, des asiles ; cette sorte de culte commença dans l’Égypte peu de temps après la mort d’Osiris et d’Isis. L’un et l’autre s’étant extrêmement distingués par leurs belles actions, par l’invention de plusieurs arts utiles, on ne crut pouvoir reconnaître les biens qu’on leur devait qu’en les élevant au rang des dieux ; mais comme on ne pouvait, sans ridicule, nommer immortels des êtres qui venaient de mourir, on publia que leurs âmes avaient été se réunir aux astres, d’où elles étaient sorties pour venir animer leur corps ; ce fut ainsi qu’ils furent regardés comme le soleil et la lune, et l’on confondit leur culte avec celui de ces deux astres. Il paraît que c’est jusque-là qu’il faut remonter pour trouver l’origine de la métempsycose, idée dont on abusa si étrangement dans la suite.
Presque dans le même temps, les Chaldéens mirent leur Bélus au rang des dieux. Les Phéniciens, les Syriens, et, après eux, les Grecs et les Romains, imitèrent les Égyptiens, de sorte que le ciel se trouva peuplé de mortels déifiés ; on publiait que leurs âmes étaient attachées à quelques étoiles qu’elles choisissaient pour leurs demeures.
Après avoir adoré les astres, on voulut adorer la nature en détail. On fit présider une divinité à chacune de ses parties. La terre fut adorée sous les noms du Rhéa, de Tellus, d’Ops, de Cybèle, de Proserpine, de Maïa, de Flore, de Faune, de Palès, etc. ; le feu, sous ceux de Vulcain, de Vesta ; l’eau de la mer et des fleuves, sous ceux d’Océan, de Neptune, de Nérée, des Néréides, des Nymphes, des Naïades ; l’air et les vents, sous ceux de Jupiter et d’Éole ; le soleil, sous ceux d’Osiris, d’Apollon, etc. ; la lune, sous ceux de Diane, d’Isis, etc. Bacchus fut le dieu du vin ; Cérès, la déesse des récoltes ; chaque fleuve, chaque fontaine eut sa divinité tutélaire ; les montagnes eurent leurs nymphes, leurs satyres ; Pluton fut le dieu des enfers, etc., etc. On divinisa les passions, les affections, la jeunesse, la clémence, la concorde, la justice, la miséricorde, la sagesse, la pudeur, l’honneur, le courage, la vérité, la paix, la liberté, dont les noms désignent assez les emplois. Ces détails suffisent pour indiquer la marche et les progrès de l’idolâtrie.
Division des différentes fables. §
On peut distinguer les fables inventées par les poëtes en six sortes : les historiques, les philosophiques, les allégoriques, les morales, les mixtes, et celles inventées à plaisir.
Les historiques sont d’anciennes histoires auxquelles ont été mêlées des fictions ; telles sont celles qui parlent d’Hercule, de Jason. Au lieu de dire que le premier dessécha le marais de Lerne que mille ruisseaux inondaient, on représenta ce marais sous la figure de l’hydre dont Hercule fut le vainqueur. Au lieu de dire que Jason alla redemander les trésors que Phryxus avait emportés dans la Colchide, on imagina la fable de la toison d’or. Cependant les Grecs, malgré leur penchant pour les fictions, ne s’en contentaient pas ; souvent ils ne voulaient qu’embellir leurs histoires, en leur prêtant les ornemens de la poésie.
Les plus grands hommes de l’antiquité ont toujours regardé les anciens poëtes comme les premiers historiens. Alexandre n’eut point autant admiré , et n’aurait point envié le sort d’Achille d’avoir eu un pareil panégyriste, s’il ne l’eût regardé que comme un conteur de fables. Il savait très-bien que le poëte conservait les récits des événemens principaux, et peignait le véritable caractère de ses héros.
Les fables philosophiques sont celles que les anciens ont inventées comme des paraboles propres à envelopper les mystères de leur philosophie ou de leur physique. Ainsi l’on disait que l’Océan était le père des fleuves, et que la lune, en épousant l’air, devint mère de la rosée.
Les allégoriques étaient aussi des paraboles qui avaient des sens cachés, comme la fable où il est dit que le plaisir naquit des richesses et de la pauvreté, pour exprimer que la pauvreté n’exclut point le bonheur, et que la richesse ne suffit pas pour l’assurer.
Les fables morales sont celles qui servent à donner quelques préceptes propres à régler les mœurs. Telle est celle qui dit que Jupiter envoie les étoiles sur la terre, pendant le jour, pour s’informer des actions des hommes et lui en rendre compte. Les fables d’ , de , et généralement les apologues, sont de ce genre.
Les fables mixtes sont mêlées d’allégories et de morale, sans avoir rien d’historique, comme celle d’Até, rapportée par
. Elle était fille de Jupiter, mais elle ne s’occupait qu’à faire du mal. Objet de la haine des dieux et des hommes, Jupiter la saisit par les cheveux, la précipita du haut des cieux, et jura qu’elle n’y rentrerait jamais. Le poëte a voulu par cette fable représenter la pente des hommes vers le mal.
Cette fille, dit-il, parcourt toute la terre avec une célérité incroyable ; ses sœurs, filles de Jupiter comme elle, et que l’on nomme les Prières, vont toujours après elles, pour corriger, autant qu’elles le peuvent, ses détestables œuvres ; mais, étant malheureusement boiteuses, elles vont moins vite que leur sœur
: ce qui signifie que le mal est toujours plus prompt et plus réel que la réparation et le repentir.
Les fables inventées à plaisir sont celles qui n’ont d’autre but que celui de plaire ou de faire briller l’imagination et l’esprit. Celles que l’on nommait milésiennes étaient de ce nombre, ainsi que les sybaritides, qui prenaient leur nom des habitans de Sybaris, peuple le plus occupé de ses plaisirs.
Telles sont à peu près les différentes sortes de fables ; mais il faut se souvenir qu’il y en a très-peu dans les anciens poëtes, qui ne renferment quelques traits historiques. Lorsque dit qu’Éole donna à Ulysse les vents renfermés dans une peau, et que ses compagnons les laissèrent échapper, c’est un trait d’histoire qui nous apprend que ce prince avait averti Ulysse de se garantir du vent qui devait souffler violemment dans quelques jours ; mais les compagnons d’Ulysse voulurent poursuivre leur route, et firent naufrage, pour n’avoir pas cédé aux conseils d’Éole. De même Atlas était un prince astronome, qui se servait d’une sphère pour étudier le mouvement des astres ; la fable le représenta portant le ciel sur ses épaules. Protée était un prince sage, prévoyant, éloquent, artificieux ; on peignit son caractère en disant qu’il avait le pouvoir de changer à son gré de figure.
Dédale inventa les voiles pour les vaisseaux au lieu de rames, et il évita par ce moyen la vengeance de Minos ; on a dit qu’il s’était fabriqué des ailes ; expression vive qui désigne la légèreté des vaisseaux à voiles. C’est ainsi que les poëtes ont défiguré les histoires, en cherchant à les embellir par les charmes de la poésie. Telle a été surtout le génie des Orientaux, d’où nous sont venues la plupart des fables. Cet esprit règne encore parmi eux ; et même aujourd’hui leurs livres, remplis de paraboles, prouvent qu’ils sont ce qu’étaient les Grecs dans les temps les plus fabuleux. N’oublions point cependant que les poëtes ne se bornaient point à peindre des chimères. Ils trouvaient dans la mémoire des hommes et dans l’histoire du monde des événemens étonnans à raconter ; ils en faisaient le fondement de leurs ouvrages ; mais ils y joignaient tous les ornemens qu’ils croyaient capables de les embellir et d’intéresser.
Conjectures sur l’origine des fables. §
En voyant tous les peuples de la terre, à l’exception du peuple de Dieu, adopter avidement les fables, et les faire servir de base à leur religion, à leur morale, à leurs gouvernemens, il est indispensable de chercher à connaître l’origine d’une erreur aussi générale et aussi fatale au genre humain.
L’étude de la vérité n’est ni plus longue ni plus difficile que celle de l’erreur, et ce serait être coupable envers la jeunesse que de ne point employer ses premières facultés et sa première attention à lui donner des idées justes sur la pente que les hommes ont vers le mal. Elle a besoin d’un flambeau qui puisse l’aider à distinguer le prestige. Ce n’est qu’en lui donnant l’habitude d’appuyer ses raisonnemens et ses résultats sur de grandes autorités, sur des principes sûrs et des bases solides, qu’elle pourra se mettre à l’abri des conceptions hasardées et des systèmes trompeurs.
En vain la prétendue philosophie moderne a voulu profiter des ténèbres qui couvrent les premiers âges du monde, pour en faire la source de ses incertitudes et de ses sophismes, les vestiges qui restent des temps les plus obscurs prouvent, jusqu’à l’évidence, que tous les hommes ont senti la nécessité d’un dieu suprême, ordonnateur et créateur de toutes choses. La même nécessité les a forcés de reconnaître qu’ils étaient dans la dépendance de ce grand être, et qu’ils lui devaient un culte. Les livres saints nous ont instruits que ce culte avait été prescrit par la divinité même, et les rapprochemens que nous avons faits dans les chapitres précédens suffisent pour démontrer que la tradition sainte a été altérée à mesure que la corruption s’est répandue sur la terre. Dès que le premier anneau de cette chaîne sacrée a été rompu, on s’est précipité d’erreurs en erreurs ; l’imagination des hommes n’a pu suppléer à la sagesse éternelle.
La vanité fut une des premières sources des fables. On ne trouva point la vérité assez surprenante, assez belle ; on la para d’ornemens étrangers ; et l’on crut agrandir les héros en leur supposant des actions qu’ils n’avaient jamais faites. Peut-être même crut-on porter plus puissamment vers la vertu, en proposant de grands exemples imaginaires ; mais on se laissa tellement entraîner par le goût du merveilleux, que l’on finit par ôter aux hommes célèbres tout le mérite qu’ils pouvaient avoir. Par exemple, lorsque Persée tue Méduse, il la surprend pendant son sommeil ; s’il délivre Andromède, il a les ailes de Mercure. Achille est couvert d’armes invulnérables forgées par Vulcain. On alla jusqu’à prodiguer aux héros tous les attributs des dieux. C’est ainsi que la vanité et les autres passions humaines nous aveuglent, et par leurs excès dépassent le but qu’elles veulent atteindre.
Avant que l’usage des lettres fut introduit, les grands événemens et les belles actions n’avaient d’autres monumens que la mémoire des hommes, ou tout au plus quelques hiéroglyphes obscurs. La tradition conservait donc le souvenir des grandes actions ; mais l’expérience nous prouve combien il est rare de ne point mêler aux récits les plus simples des circonstances qui les embellissent. Lorsque, par la suite des temps, on a voulu écrire ces actions, on n’a plus trouvé que des traditions confuses ; et, en les consacrant dans les histoires, on a, en quelque sorte, éternisé les fables.
La fausse éloquence et l’envie de louer les morts ont aussi produit des fables. Si l’on composait aujourd’hui l’histoire de la plupart des grands hommes d’après les seuls éloges de leurs panégyristes, on verrait souvent la fable l’emporter sur la vérité. Ces fables cependant étaient d’autant plus dangereuses dans les premiers temps, qu’elles s’unissaient presque toujours à des devoirs religieux ; de sorte qu’une fois admises elles devenaient sacrées, et l’on n’osait plus les combattre.
Les poëtes et les peintres sont certainement ceux qui ont produit le plus de fables. Cherchant à plaire beaucoup plus qu’à instruire, ils préféraient d’ingénieux mensonges à des vérités communes. Si quelque prince pleurait la mort d’un fils, la poésie plaçait ce fils parmi les astres. Les écrits restaient, ils étaient imités, et la fable était consacrée. Le succès encouragea les poëtes ; on lut leurs ouvrages avec plaisir, leurs fictions furent aimées, et la vérité simple parut sans charmes. Ce fut de là que les bergères furent transformées en nymphes, en naïades ; les vaisseaux en chevaux ailés, comme dans Bellérophon ; en dragons, comme dans Médée. Les musiciens furent des Apollons, les grands médecins des Esculapes, les belles voix des Muscs, les oranges des pommes d’or, etc.
Fables produites par le goût du merveilleux. §
L’expérience nous apprend combien le merveilleux a de pouvoir sur l’esprit humain. Il est facile d’en apercevoir la cause. L’homme espère s’agrandir en croyant à tout ce qui est au-dessus de lui ; aussi il trouve des charmes à tout ce qui l’étonne. Le repos et le silence absolu ressemblent à la mort ; l’homme s’en effraie, il a besoin de mouvement. Le spectacle d’un événement extraordinaire satisfait sa curiosité toujours active, et son amour-propre lui fait croire qu’il participe en quelque sorte aux actions héroïques dont il lit ou entend les récits. Celui qui prend ces actions dans sa fertile imagination cherche à faire croire qu’il n’aurait pu les inventer, s’il n’avait pas été capable de les exécuter ; et celui qui les entend ou les lit avec enthousiasme se persuade à lui-même qu’elles n’auraient point été au-dessus de ses forces. L’un et l’autre ne voient qu’un éminent degré sur lequel ils espèrent qu’ils pourront s’élever. Le s’occupait bien plus de sa propre gloire que de celle de son héros : et, si les poëmes les plus célèbres étaient dépouillés de leur parure, on serait étonné de la médiocrité des événemens. L’Iliade, l’Odyssée, l’Énéide, ne seraient presque rien sans la présence des dieux et sans le mélange des fictions ingénieuses et attachantes, avec des vérités fort peu intéressantes par elles-mêmes.
Les peintres voulurent imiter les poëtes, et ce fut en réalisant sur les toiles les brillantes images de la poésie, qu’ils augmentèrent les progrès des fables et le nombre des divinités.
L’ignorance de la physique a donné lieu aussi à beaucoup de fables. Dans les siècles barbares, on animait tout ce qui frappait les sens : les fleuves, les fontaines, les astres ; et, comme on ne pouvait avoir une idée bien nette de ces derniers, on craignait leur influence ; on leur rendait un culte pour les apaiser quand on les croyait irrités. Ce fut ainsi que l’on multiplia les divinités physiques et les fables astronomiques. Lorsqu’un homme plus éclairé que les autres voulait rectifier ces erreurs, on l’accusait d’impiété. Le malheureux fut puni de mort pour avoir dit que le soleil n’était point animé, et qu’il n’était qu’une lame d’acier.
Il faut remarquer attentivement que la Syrie, la Palestine, l’Arabie et l’Égypte, furent habitées long-temps avant les climats d’Occident. Les premiers habitans de la Grèce vivaient sans arts, sans lois, sans coutumes réglées ; les rochers, les cavernes, leur servaient de demeure, et tous leurs soins se bornaient à se défendre des bêtes féroces. Lorsque le désir d’étendre le commerce y conduisit des colonies phéniciennes et égyptiennes, elles apprirent aux Grecs à se couvrir de la peau des animaux qu’ils tuaient à la chasse ; elles leur firent connaître que la terre étant cultivée rapporte des fruits propres à nourrir. Quelques maisons furent construites, et bientôt l’imitation et l’amour du bien-être firent élever des bourgades et des villes. On renonça à la brutale coutume de vivre sans lois dans le mariage. On régla les devoirs de la vie civile, on fixa des limites pour reconnaître les propriétés. La grandeur de ces biens se fit tellement sentir, qu’on crut ne pas pouvoir porter assez loin la reconnaissance ; les chefs de ces colonies bienfaisantes furent regardés comme des envoyés du ciel ; on finit par les placer au rang des dieux, et c’est dans les histoires altérées de ces chefs que l’on trouve l’origine des premiers demi-dieux et des premiers héros de la Grèce.
L’une des sources les plus favorables à l’introduction des fables était l’ignorance de l’histoire ancienne et de la chronologie. L’usage des lettres commença très-tard parmi les Grecs ; plusieurs siècles s’écoulèrent pendant lesquels on ne connaissait les événemens remarquables que par tradition. Lors même que l’écriture fut employée, on n’écrivit pas d’abord des histoires suivies. Elle servit à conserver des éloges, des cantiques et quelques généalogies remplies de fables ; de sorte que la confusion régnait partout ; et, dès que l’on voulait approfondir ces généalogies, après avoir remonté trois ou quatre générations, on se trouvait à l’histoire des dieux, où l’on rencontrait toujours Jupiter, Saturne, le Ciel, la Terre. Les Grecs ne savaient rien de plus sur leur origine la plupart croyaient sortir des fourmis de la forêt d’Égine. Cependant, comme ils voulaient passer pour anciens, ils se plaisaient à citer des dieux, des héros, des rois, qui n’avaient jamais existé ; et, lorsqu’ils parlaient des premiers temps, dont ils avaient reçu quelques notions par les colonies qui étaient venues s’établir dans leur pays, ils substituaient des fables à la vérité. S’il était question de la création, ils citaient leurs peintures du chaos. Cérès et Triptolème étaient, selon eux, les premiers inventeurs de l’agriculture. Pan, au lieu d’Abel, avait le premier mené la vie pastorale. Apollon avait inventé la musique, que l’on doit attribuer à Jubal. Vulcain, au lieu de Tubalcaïn, avait le premier forgé les métaux. Bacchus, au lieu de Noé, avait appris à cultiver la vigne. On retrouvait dans leurs fables toutes les traces des anciennes traditions ; mais elles étaient si confuses, qu’
lui-même leur reprochait d’être
de véritables enfans lorsqu’ils voulaient parler de temps éloignés
.
La prétention des Grecs allait jusqu’à croire que leurs colonies avaient peuplé le reste du monde. L’Europe, disaient-ils, tirait son nom d’Europe, sœur de Cadmus ; ils ignoraient, selon , que ce continent devait son nom à la blancheur de ses habitans. L’Arménie avait été peuplée par les descendans d’Arménus ; la Médie, par ceux de Médus ; la Perse, par ceux de Perse, etc. Ce n’est donc point parmi les Grecs qu’il faut chercher l’origine des anciens peuples, des premiers dieux et des premières fables. Leur histoire ne commence à mériter quelque confiance qu’aux temps des olympiades. L’Écriture Sainte a seule conservé des monumens certains sur la véritable antiquité, et il faut remarquer que les historiens profanes n’ont commencé à paraître qu’au temps d’Esdras.
Division des temps, d’après . §
Pour mieux éclaircir en quel temps les fables ont pris naissance, il faut suivre , et distinguer avec lui trois sortes de temps : les temps inconnus, les temps fabuleux, et les temps historiques.
Les premiers, qui sont en quelque sorte l’enfance du monde, comprennent ce qui s’est passé depuis le chaos ou la création, jusqu’au déluge d’Ogygès, arrivé environ seize cents ans avant Jésus-Christ.
Les temps fabuleux renferment ceux qui se sont écoulés depuis ce déluge jusqu’à la première olympiade. A cette dernière époque commencent les temps historiques.
Cette célèbre division de ne peut regarder que l’histoire des Grecs et des Romains, car les Égyptiens, les Chaldéens, les Phéniciens et les anciens peuples de l’Orient, connaissaient beaucoup mieux les temps reculés. Ils avaient leurs traditions, leurs annales ; elles étaient, il est vrai, très-mélangées de fables.
Les Grecs n’avaient aucune connaissance positive sur les premiers siècles du monde, et, lorsqu’ils arrivaient aux temps héroïques, ils les obscurcissaient tellement, qu’ils en défiguraient absolument l’histoire. Le siècle de Troie surtout, si fécond en héros, produisit un nombre infini de fables.
Cette ville célèbre fut prise deux fois : la première par Hercule, et la seconde, environ trente ans après, par l’armée des Grecs, sous la conduite d’Agamemnon. Ce fut au temps de la première prise qu’on vit paraître Hercule, Télamon, Thésée, Jason, Orphée, Castor et Pollux (noms que leur amitié mutuelle a rendus inséparables), ce fut alors que brillèrent tous les héros qui avaient participé à la conquête de la toison d’or.
A la seconde prise de Troie parurent les fils ou petits-fils des premiers héros : Agamemnon, Ménélas, Achille, Diomède, Ajax, Hector, Ulysse, Priam, Pâris, Énée, etc. Dans l’intervalle de ces deux prises on doit placer les deux guerres de Thèbes, où parurent Adraste, Œdipe, Étéocle, Polynice, Capanée, et nombre d’autres, objets éternels des fables des poëtes. Ce ne fut qu’au rétablissement des olympiades que l’histoire grecque prit enfin une forme certaine, et que les événemens furent rangés à leurs véritables époques.
Les jeux olympiques. §
On ne convient pas trop du temps où les jeux olympiques furent institués. Leur origine est très-obscure. dit seulement que ce fut Hercule de Crète qui les institua, sans nous apprendre ni en quel temps, ni à quelle occasion. L’opinion la plus commune parmi les savans est que Pélops en fut l’auteur, et que la première célébration en fut faite dans l’Élide, la vingt-neuvième année du règne d’Acrise, la trente-quatrième du règne de Sicyon, dix-neuvième roi de Sicyone ; et, pour concilier les époques profanes avec l’Écriture Sainte, ce fut pendant la vingt-troisième année de la judicature de Débora.
Atrée, fils de Pélops, les renouvela et en ordonna la seconde célébration, quatorze cent dix-huit ans avant Jésus-Christ. Enfin Hercule, au retour de la conquête de la toison d’or, assembla les Argonautes dans l’Élide, pour y célébrer ces mêmes jeux en action de grâce de l’heureux succès de leur voyage, et l’on promit de s’y rassembler tous les quatre ans pour cet objet.
Ces jeux cependant furent discontinués jusqu’au règne d’Iphitus dans l’Élide, c’est-à-dire quatre cent quarante-deux ans après ; ce fut alors que la Grèce en fit son époque principale. On ne compta plus que par olympiades, et c’est depuis ce temps qu’on ne trouve plus autant de fables dans l’histoire des Grecs.
Cette division des temps, il faut bien le remarquer, nous vient des Grecs et des Romains, qui ne connaissaient pas l’antiquité. Quoi qu’il en soit, ce sont les olympiades qui ont répandu le plus grand jour sur le chaos de l’histoire.
Effets que produisit dans la Grèce et dans l’Occident l’arrivée des colonies orientales. §
Lorsque les Phéniciens ou les Égyptiens vinrent s’établir dans la Grèce, ils furent forcés d’apprendre la langue générale du pays ; mais ils durent conserver beaucoup de mots de leur langue, surtout ceux qui désignaient les lois nouvelles, les coutumes et le culte qu’ils apportaient aux Grecs. Ces derniers, en les adoptants, s’approprièrent ces mots, et bientôt il se fit un mélange des deux langues. Lorsque, par la suite des temps, les Grecs voulurent lire leur ancienne histoire, ils la trouvèrent remplie de mots phéniciens, qu’ils ne manquèrent pas d’expliquer d’après leur goût pour les fictions et les fables ; et souvent ils abusèrent des équivoques que l’on trouve fréquemment dans la langue phénicienne. Par exemple, le mot alpha ou ilpha signifiait également un taureau ou un navire. De là les Grecs publièrent que Jupiter changé en taureau avait enlevé la jeune Europe, au lieu de dire qu’il l’avait transportée sur un vaisseau dans l’île de Crète où il régnait.
La fable de la fontaine Aréthuse et du fleuve Alphée est également fondée sur une équivoque. Les Phéniciens étant arrivés en Sicile, trouvèrent une fontaine environnée de saules, qu’ils nommèrent Alphaga, c’est-à-dire fontaine des saules. Par la suite des temps, les Grecs, se souvenant de leur fleuve Alphée qui coule dans l’Élide, dirent que les eaux du fleuve passaient sous la mer pour se rejoindre à la fontaine Aréthuse. De même le mot drako, qui signifie à la fois clairvoyant et dragon, a fait imaginer la fable du dragon qui gardait le jardin des Hespérides. L’architecte du temple de Delphes se nommait Ptera : ce nom signifie une plume. Les Grecs dirent que ce temple avait été bâti avec de la cire et les ailes des abeilles qu’Apollon avait fait venir des pays hyperboréens. Plus on étudie les origines, plus on est forcé de reconnaître que la plupart des fables grecques étaient une imitation de celles des colonies orientales.
Les arts et la politesse régnaient en Égypte, dans le temps que les peuples de l’Occident vivaient encore dans la barbarie. Ce furent les Égyptiens et les Phéniciens qui leur apprirent à bâtir des villes, à s’habiller, à vivre en société ; c’est d’eux qu’ils reçurent les cérémonies de la religion ; le culte des dieux, les sacrifices ; et les Grecs, en adoptant leur religion, s’approprièrent leurs fables. Le culte de Bacchus fut formé sur celui d’Osiris. La fable de Vénus et d’Adonis était originaire de Syrie ; le culte de cette déesse était arrivé à Chypre, à Cythère, et dans les îles de la Grèce, par des vaisseaux étrangers : on publia que Vénus était sortie de l’écume de la mer. La nymphe Io, changée en vache, est la même qu’Isis adorée par les Égyptiens sous cette forme. Tout le système d’ sur les enfers venait de l’Égypte ; c’était là que avait puisé son idée de la métempsycose.
Ces preuves sont plus que suffisantes pour démontrer que les fables grecques et romaines devaient leur origine à l’Égypte et à la Phénicie ; si on y trouve des changements, c’est que les Grecs joignaient à leur goût pour les fictions le désir de passer pour très-anciens. Ils cherchaient à voiler à la fois leur ignorance et leur nouveauté. Ils rougissaient de tout devoir à des peuples étrangers ; et l’espoir de faire croire que tout avait commencé par eux leur faisait changer les noms, les aventures et jusqu’aux cérémonies de la religion. Voilà pourquoi leurs poëtes ont tellement défiguré les fables égyptiennes, qu’on ne peut plus les reconnaître sans le secours des langues orientales. Voilà pourquoi le langage de leurs poëtes, en parlant d’Io, de Bacchus, de Diane, etc., est si différent de celui de leurs historiens, tels que et . L’Égypte et la Phénicie doivent donc être regardées comme le premier théâtre des fables.
D’ et d’ . §
Le nom d’ ne s’offre jamais à la pensée sans que l’admiration ne lui paie un tribut.
« Quel est donc cet homme étonnant (dit ) dont la gloire est telle que les siècles, en se succédant, ne font que-l’augmenter, et dont l’esprit humain n’imagine pas plus d’être jaloux, qu’on ne l’est de la lumière du soleil ? »
et ne sont point les inventeurs des fables grecques ; ils n’ont fait que les embellir ; l’idolâtrie avait précédé le siècle pendant lequel ils écrivaient. Il est probable que des poëtes plus anciens leur avaient laissé des modèles qu’ils ont surpassés ; car il serait difficile de croire que la poésie grecque eût commencé par des chefs-d’œuvre. Avant , la prise de Troie était généralement chantée, et les dieux de la Grèce étaient honorés avant l’histoire de ces poëmes. et s’étaient bornés à suivre les principes de la théologie de leur pays, dont le système avait été apporté par Cécrops, Cadmus et les autres chefs de colonies. En remontant plus haut, on peut aller jusqu’à croire que la poésie orientale ressemblait à celle dont s’est servi dans les cantiques, où il célèbre avec tant de majesté les victoires du dieu des armées sur les ennemis de son peuple.
n’a donc été que le chantre et non pas l’inventeur de ses dieux ; il se soumet à la théologie de son temps ; et, comme il veut à la fois n’être point obscur et plaire, il ne sort point du système de religion que son pays adoptait. Il ne faut donc point le regarder comme l’inventeur et le père de tant de dieux et d’usages bizarres.
Des dieux des Grecs, des Romains, et des autres peuples de l’Occident. §
Les réflexions précédentes suffisent pour démontrer que l’origine de l’idolâtrie se trouve parmi les Orientaux ; voilà ce qui a fait distinguer les divinités du paganisme en deux classes : les dieux de l’Orient et les dieux de l’Occident.
Nous n’étendrons pas plus loin nos recherches sur les dieux de l’Orient, quoique cette partie de la mythologie soit très-intéressante, nécessaire même à connaître pour faire apercevoir l’origine de l’idolâtrie et des fables. Le principal but de notre ouvrage étant de mettre nos lecteurs en état de voyager avec fruit, et d’apprécier les chefs-d’œuvre des poëtes et des arts, nous allons principalement faire connaître les détails qui tiennent à la mythologie des Grecs et des Romains ; le reste de cet ouvrage y sera consacré ; mais nous aurons soin de faire tous les rapprochemens historiques, et de donner toutes les explications utiles pour lier cette seconde partie avec la première. Ce que nous avons dit précédemment suffit pour indiquer les sources où l’on pourra puiser, lorsque l’on voudra faire une étude approfondie de l’histoire générale des dieux du paganisme.
Jamais religion ne fut chargée d’un plus grand nombre de dieux que celle des Grecs et des Romains, puisque, outre ceux des Orientaux, ils en adoptèrent une infinité d’autres. Nous allons nous efforcer de débrouiller ce chaos le plus brièvement possible, et nous chercherons surtout à être clairs.
Il n’est pas douteux que l’Asie mineure, les îles de l’Archipel et la Grèce, ont d’abord été peuplées par les descendans de Japhet. Mais en quel temps y arrivèrent-ils, et quelle fut la religion qu’ils y établirent ? Ce sont des questions impossibles à décider aujourd’hui.
On sait, par , que les premiers Grecs étaient très-grossiers, qu’ils vivaient sans religion. Ces premiers habitans ne connaissaient point le grand nombre de dieux que leurs descendans adorèrent par la suite, et tous les auteurs profanes anciens s’accordent entre eux pour assurer que les premiers habitans de la Grèce et des îles voisines n’avaient qu’une religion très-peu chargée de cérémonies.
est le seul historien qui entre dans quelques détails :
« Les Pélasges, dit-il, peuple le plus ancien de la Grèce, honoraient leurs dieux sans les connaître et sans leur donner de noms. Ils les appelaient les dieux, et les regardaient comme les maîtres de toutes choses. Ce ne fut que dans un temps très-éloigné de leur origine, qu’ils surent que les noms des dieux étaient venus d’Égypte : ils allèrent alors consulter l’oracle de Dodone, le plus ancien de la Grèce, et lui demandèrent s’ils recevraient les noms des dieux qui leur venaient des barbares. Sur la réponse de l’oracle qu’ils devaient les recevoir, ils sacrifièrent en invoquant les dieux par leurs noms, et ce fut des Pélasges que les Grecs reçurent ces mêmes noms. On ignore jusqu’à présent d’où chaque dieu est venu, s’il existe de tout temps, quelle est sa forme ; pour moi, (poursuit cet historien), je crois qu’ils sont venus d’Égypte ; et, si l’on me dit que les Égyptiens ne connaissaient point Neptune, Castor, Vesta, Thémis, les Grâces, les Néréides, je répondrai que les Pélasges avaient appris ces noms des Samothraces, parmi lesquels ils avaient vécu. Quant à tous les autres dieux, leurs noms étaient venus de l’Égypte. »
nous apprend que le culte de Bacchus ou Dionysius fut introduit dans la Grèce par Mélampus et par Cadmus.
D’autres auteurs se réunissent pour assurer que Cécrops, en venant s’établir à Athènes, y porta le culte de Minerve, qui était honorée à Saïs, sa patrie. Ce fut le même prince, selon , qui régla le culte des dieux et les cérémonies de la religion avec beaucoup de sagesse. Il fut le premier qui appela Jupiter le dieu suprême, le très-haut. Il défendit qu’on sacrifiât aux dieux rien qui fût animé, et il régla les lois et les cérémonies du mariage.
On n’a rien d’aussi positif sur les changemens que firent dans la religion les autres chefs des colonies ; mais il n’est pas douteux qu’Inachus, qui fut le premier de tous, Danaüs, et ceux qui sont venus par la suite, n’aient apporté avec eux et la connaissance et le culte de leurs dieux. En effet, des chefs de colonies ne changent point de religion parce qu’ils changent de pays ; et lorsqu’ils deviennent les maîtres des contrées où ils veulent s’établir, il est probable que leur premier soin est d’y faire adopter leur culte. Souvent ils y trouvent de la résistance. Cadmus, avant essayé d’introduire le culte de Bacchus dans la Béotie, fit naître la guerre qui coûta la vie à Penthée : il fut même obligé de se retirer dans l’Illyrie ; mais, s’étant enfin rendu maître du pays, il y établit sa religion.
Il est facile de concevoir tous les changemens que l’arrivée des colonies égyptiennes et phéniciennes dut causer dans la religion de la Grèce. Il faut observer en outre que les Grecs, en recevant des dieux étrangers, changeaient leurs noms. Nous savons, par , que l’Apollon des Grecs était l’Oms des Égyptiens ; Bacchus ou Dionysius, leur Osiris ; Hermès ou Mercure, leur Thaut ou Thot ; Pan, leur Mendes, Diane, leur Bubaste ; Déméter, leur Isis ; Zeus ou Jupiter, leur Ammon ; Vénus ou Aphrodite, leur Astarté. Ces changemens furent très-ordinaires dans les apothéoses qui donnèrent tant de nouveaux dieux aux Grecs et aux Romains.
nous apprend que l’on changeait aussi les fonctions et les généalogies des dieux. Par exemple, Vulcain tenait le premier rang parmi les dieux d’Égypte. Les Grecs en firent un fils de Jupiter et de Junon, qui, chassé du ciel à cause de sa difformité, se cassa la jambe en tombant sur la terre, et gagna sa vie en exerçant le métier de forgeron dans l’île de Lemnos. Les Grecs, en général, ont mêlé tant de fables dans l’histoire de leurs dieux, ils ont tellement défiguré les traditions orientales, qu’il faut une attention extrême pour découvrir la vérité.
Nous allons faire nos efforts pour répandre quelque lumière sur une matière aussi obscure, et nous allons nous servir des divisions qui paraissent les plus naturelles.
Les dieux du paganisme peuvent se diviser en dieux du ciel, dieux de la mer, dieux de la terre, et dieux des enfers. Nous viendrons ensuite aux dieux subalternes, sur le séjour desquels on n’avait pas d’idée bien positive.
Les dieux du ciel. §
, le plus grand théologien du paganisme, en fait monter le nombre jusqu’à trente mille : ce qui ne surprendra pas, en considérant qu’on en avait inventé pour présider à toutes les parties de l’univers, aux passions, aux besoins de la vie. D’ailleurs, lorsque des nations ou des villes différentes adoraient le même dieu sous le nom de Jupiter, chacune de ces nations ou de ces villes prétendait avoir son Jupiter particulier : en compte plus de trois cents. Il en était de même des autres dieux et des demi-dieux. On comptait plus de quarante Hercules : mais, comme tant de dieux différens pouvaient cesser de s’accorder entre eux, les païens avaient senti la nécessité de croire et d’établir qu’il y avait une divinité supérieure aux autres. Elle se nommait le Destin ou Fatum. Ce dieu, que l’on supposait aveugle, gouvernait toutes choses par une nécessité absolue. Jupiter lui-même, le premier et le plus grand des dieux, était soumis à ses décrets. Le destin avait son genre de culte ; mais, comme il ne pouvait être compris par l’intelligence humaine, on n’osait point déterminer quelle était sa figure, de sorte que jamais on n’adorait sa statue comme celle des autres dieux. On essayait cependant de le représenter sous la forme d’un vieillard, tenant entre ses mains l’urne qui renferme le sort des humains. On plaçait devant lui un livre dans lequel l’avenir était écrit. (Voyez la fig. 1.) Tous les dieux, sans exception, devaient consulter ce livre, parce qu’ils ne pouvaient rien changer à ses décrets. Ce n’était même qu’en le lisant qu’ils pouvaient prévoir l’avenir. C’est à cela que l’on doit rapporter l’obscurité des oracles, dont les réponses pouvaient s’interpréter de mille manières différentes.
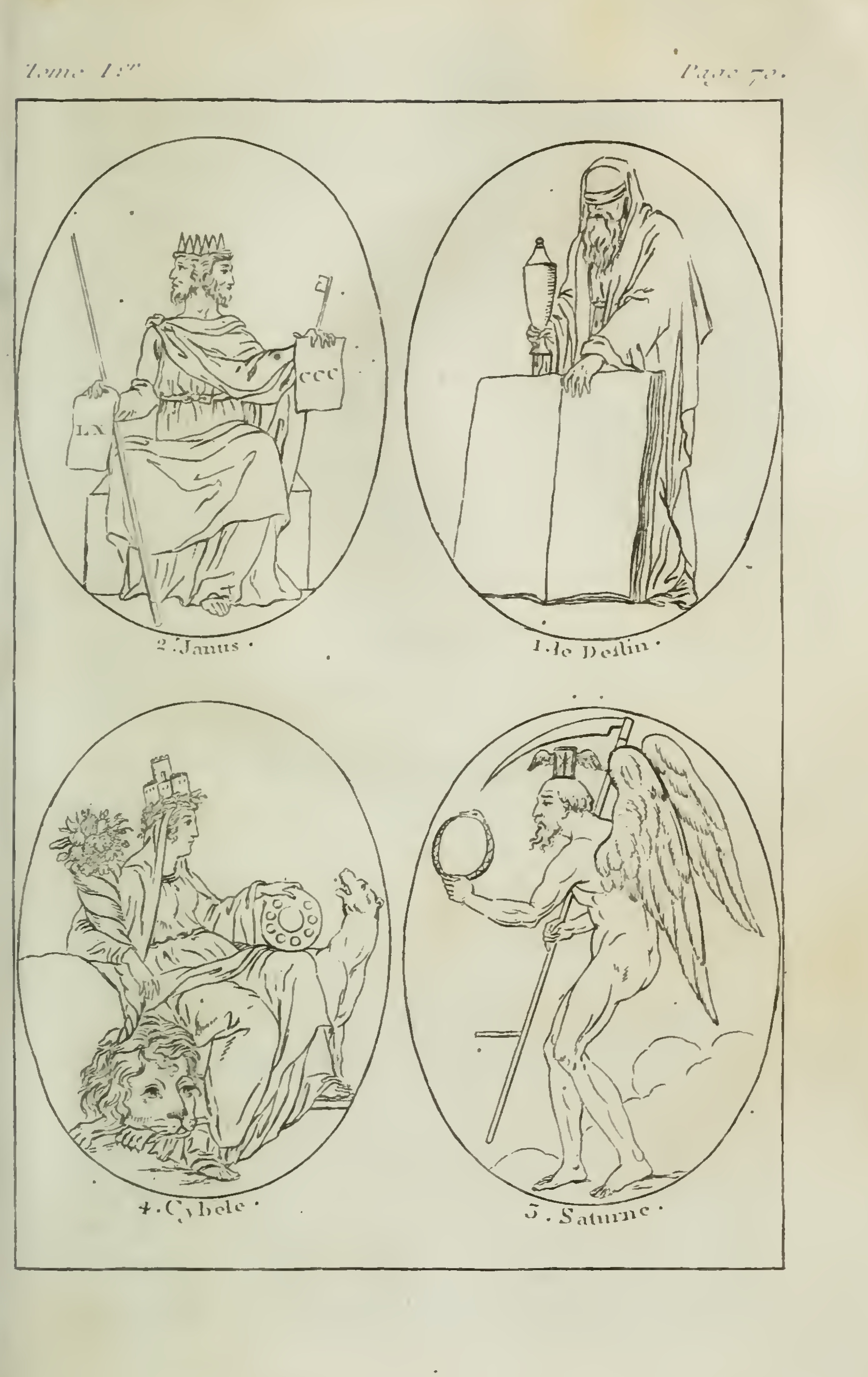
Cette idée du destin est le plus bel aveu que les hommes aient fait de la nécessité d’un dieu suprême et unique ; mais il n’était plus en leur pouvoir de le définir et de le comprendre, depuis qu’ils avaient oublié les instructions que Dieu avait données aux premiers patriarches.
Différens ordres des dieux. §
Les dieux étaient partagés en quatre ordres différens.
Le premier ordre comprenait les dieux suprêmes, que l’on nommait aussi dieux des nations, parce qu’ils étaient connus et révérés par toutes les nations. Ils étaient au nombre de vingt, dont Jupiter était le premier.
Dans le second ordre étaient compris les dieux qu’
appelait
le peuple dieu
. Ils se nommaient, dieux moindres des nations. Ils n’avaient point de place dans le ciel, et n’étaient point du conseil de Jupiter. Pan, Pomone, Flore et les autres divinités champêtres, étaient dans cet ordre.
Le troisième ordre était composé des demi-dieux, qui tiraient leur origine d’un dieu et d’une mortelle, ou d’une déesse et d’un mortel. Tels étaient Hercule, Esculape, Castor et Pollux, etc., etc. On admettait aussi parmi ces dieux les héros que leurs belles actions avaient élevés au rang des immortels.
Le quatrième ordre contenait les vertus qui avaient formé les grands hommes, comme la fidélité, la concorde, le courage, la prudence, etc. ; ou même les misères de la vie, comme la pauvreté, la douleur, etc.
Les vingt dieux du premier ordre étaient séparés en deux classes.
La première formait le conseil de Jupiter ; elle était composée de six dieux et de six déesses.
Les six dieux étaient : Jupiter, Neptune, Mercure, Apollon, Mars et Vulcain.
Les six déesses étaient : Junon, Cérès, Minerve, Vesta, Diane et Vénus.
La seconde classe était composée de huit divinités, qui n’assistaient point au conseil suprême. On les nommait dii selecti : dieux choisis. Leurs noms étaient : Cœlus, Saturne, Génius, le Soleil, Pluton, Bacchus, la Terre et la Lune.
On donnait les noms Indigètes et Semones aux divinités qui n’étaient point de la première et de la seconde classe. Le mot indigètes signifie agissant comme des dieux ; et le mot semones signifie demi-hommes, parce qu’ils étaient fils d’un dieu et d’une mortelle, ou d’une déesse et d’un mortel.
Histoires particulières des dieux. §
Avant de donner l’histoire de Jupiter, nous croyons devoir parler de Saturne son père, et de Cybèle sa mère. Le rang de ces deux divinités était très-inférieur à celui de Jupiter, le premier et le plus grand des dieux. Cybèle et Saturne n’étaient point comptés parmi les dieux du ciel ; mais les notions que nous allons donner serviront à éclaircir l’histoire de Jupiter leur fils.
Saturne, Janus, Age d’or. §
Cœlus, ou le Ciel, que les Grecs nommaient Uranus, était, selon eux, le plus ancien des dieux. De même Vesta prisca, ou Titée, ou Tellus, noms qui tous désignent la terre, était la plus ancienne des déesses. Ils eurent pour fils Titan et Saturne, qui était le même que le Temps. Le droit d’aînesse assurait la succession du royaume à Titan ; mais ce dernier, pour condescendre au désir de sa mère, céda son droit à son cadet, à la condition qu’il n’élèverait aucun enfant mâle. Saturne, pour obéir à cette convention, dévorait ses fils à l’instant de leur naissance.
Remarquons, avant de poursuivre, que le mot phénicien Balah, employé dans la tradition de cette histoire, signifie également enfermer et dévorer. Cette équivoque a pu suffire pour donner lieu à la fable cruelle d’un père qui dévore ses enfans ; mais il existe une autre explication plus naturelle, qui nous vient de . Les Grecs regardaient Saturne et le Temps comme le même Dieu. Le nom Chronos, qu’ils lui donnaient, signifie Temps ; or, le temps étant regardé comme éternel et détruisant tout, il dut voir périr ses enfans : c’est de là qu’on a tiré l’allégorie barbare de Saturne dévorant ses fils.
Cependant Cybèle, ayant mis au monde Jupiter en même temps que Junon, trouva moyen de le cacher, et le remplaça par une pierre que Saturne dévora. L’explication précédente suffit ; nous nous bornerons à dire que cette prétendue pierre devint par la suite un objet de vénération : on lui rendit même quelquefois les honneurs divins, et on la nomma Abadir ou Abdir. Cybèle, voulant soustraire Jupiter à la vue de Saturne, le fit transporter secrètement dans l’île de Crète, et le fit élever par les Corybantes, ou Curètes. La chèvre Amalthée l’allaita, et les deux nymphes Adrastée et Ida, autrement nommées les Mélisses, prirent soin de sa première enfance.
Les poëtes racontent que, pour empêcher Saturne d’entendre les cris de Jupiter, les prêtres de Cybèle inventèrent une sorte de danse, pendant laquelle ils frappaient sur des boucliers d’airain. Ces précautions n’empêchèrent point Titan d’être instruit de ce qui se passait, et, voulant conservera ses enfans leur droit de succession au trône, il déclara la guerre à Saturne, le vainquit et le fit enfermer, ainsi que Cybèle, dans une étroite prison, où ils restèrent jusqu’au temps où Jupiter, devenu grand, combattit pour eux, et leur rendit la liberté. Jupiter, avant de délivrer son père, s’était emparé du royaume ; et, craignant que Saturne n’employât tous les moyens pour remonter sur son trône, il le chassa du ciel. Le roi détrôné vint se réfugier en Italie, auprès de Janus, roi du pays, qui l’accueillit favorablement. La contrée soumise à Janus prit son nom de cette aventure, et fut appelée Latium, nom qui vient du mot latere, cacher.
En mémoire du séjour de Saturne dans le Latium, on célébrait tous les ans à Rome, au mois de décembre, les fêtes des saturnales. Pendant leur durée, le sénat, les écoles publiques, étaient en vacance. On s’envoyait des présens, et les maîtres servaient leurs esclaves. Cette dernière coutume était destinée à conserver le souvenir de l’âge d’or, pendant lequel le bonheur avait été universel. Cet heureux temps, que les poëtes ont peint avec leurs couleurs les plus séduisantes, n’eut, hélas ! de durée que celle des règnes de Saturne et de Janus. Les âges suivans furent nommés d’argent, d’airain et de fer. Tant il est vrai de dire qu’un gouvernement sage, sous la conduite d’un bon prince, est le plus grand bien que le ciel puisse accorder à la terre ! II n’est que trop nécessaire de le redire aux hommes ; et, pour appuyer cette vérité sur une plus forte autorité que celle de la fable, rappelons-nous que les Égyptiens ne furent jamais plus grands, plus heureux, que sous leur roi Sésostris. Athènes ne devint la plus brillante des cités qu’au temps de Périclès, qui n’avait aucun titre, il est vrai, mais qui jouissait de toute la puissance des rois ; et, lorsque dans les annales du monde on veut chercher les véritables époques du bonheur des hommes, tous les souvenirs et tous les cœurs à la fois nomment les Antonins, les Marc-Aurèle, les Trajan, les Titus.
Nous avons précédemment observé que le besoin du bonheur ne peut abandonner l’homme. Ce fut même pour suppléer à son irréparable perte qu’il imagina l’espérance. Remarquons, en même temps, que les poëtes, dans leurs tableaux de l’âge d’or, s’attachaient encore plus à peindre l’innocence et les vertus primitives que l’abondance qui régnait sur la terre. Nous serons alors portés à croire qu’ils devaient leurs descriptions aux souvenirs les plus chers, et par conséquent les mieux conservés, de la plus sainte et de la plus ancienne des traditions.
Saturne, voulant récompenser Janus de son bon accueil, et d’avoir partagé avec lui le souverain pouvoir, le doua d’une rare prudence, à laquelle il joignit le privilège de découvrir l’avenir et de ne jamais oublier le passé, ce que l’on voulut désigner en le représentant avec un double visage ; c’est de là que le nom de Bifrons lui fut donné.
L’histoire nous apprend que Janus fut représenté avec deux visages (Voy. fig. 2), parce qu’il commandait à deux peuples différens, et parce qu’il partagea son empire avec Saturne. Elle dit aussi que ce prince fit frapper des médailles à deux faces, pour annoncer que la totalité de ses états serait gouvernée par les conseils de Saturne et les siens.
Mois de l’année. §
Janus présidait à l’année ; il avait douze autels, parce qu’elle était composée de douze mois ; ce fut lui qui donna son nom au mois de janvier.
Le nom de février vient de februare, faire des purifications, cérémonie que l’on pratiquait pendant ce mois en l’honneur des morts.
Le mois de Mars s’appelait ainsi du dieu Mars, dont Romulus prétendait descendre, et sous la protection duquel ce prince avait mis son peuple belliqueux.
Le nom du mois d’avril vient du mot latin aperire, ouvrir, parce que dans ce mois la terre ouvre son sein pour produire toutes choses. Quelques étymologistes le tirent aussi du mot grec aphrodite, surnom de Vénus, à qui ce mois était particulièrement consacré.
Le nom du mois de mai vient de majores, les plus grands, parce qu’il était consacré aux personnes avancées en âge.
De même, juin vient de juniores, les plus jeunes : il était consacré aux jeunes gens.
Juillet tire son nom de Jules-César.
Auguste donna le sien au mois d’août.
Septembre, octobre, novembre et décembre, prirent leur nom du rang qu’ils occupaient dans l’année ; avant Jules-César et Auguste, juillet et août se nommaient par la même raison quintilis, cinquième, et sextilis, sixième.
L’année, telle que Romulus la disposa d’abord, n’avait que dix mois, et commençait par mars et avril ; mais Numa Pompilius y joignit les mois de janvier et février, et fit commencer l’année par le mois de janvier.
Fin de l’histoire de Saturne et de Janus, avec les rapprochemens historiques. §
Janus reçut les honneurs divins ; mais Saturne et lui ne furent jamais au rang des grands dieux qui formaient le conseil de Jupiter. On doit placer Janus parmi les dieux indigètes. Dans ses tableaux, on plaçait une baguette dans sa main, parce qu’il présidait aux chemins publics ; il tenait aussi une clef, parce qu’il avait inventé les portes. Numa Pompilius lui fît élever un temple qu’on laissait ouvert pendant la guerre ; il n’était fermé que pendant la paix : ce qui fit regarder Janus comme le dieu de la paix.
Il est bon de remarquer que ce temple fut fermé trois fois seulement par les Romains ; la première sous Numa, la seconde après la deuxième guerre Punique, et la troisième sous le règne d’Auguste, après la bataille d’Actium.
Les statues de Janus marquent souvent de la main droite le nombre de trois cents, et de la gauche celui de soixante, pour signifier la mesure de l’année. C’est à lui qu’on attribue l’invention des couronnes et des barques. Il fut aussi le premier qui frappa des monnaies de cuivre.
Il paraît que c’est à Janus bien plus qu’à Saturne qu’il faut attribuer les lois douces et sages qui firent donner à leur règne le nom d’âge d’or. Ce prince quitta Perrhèbes, ville de Thessalie, environ cent quarante-six ans avant la prise de Troie. Il vint par mer dans le Latium ; et quelques-unes de ses médailles, sur lesquelles on voit des proues de vaisseau, sont une preuve de navigation. Lorsqu’il arriva dans le Latium, les habitans de ce pays sauvage vivaient sans lois et presque sans religion. Ce prince adoucit la férocité de leurs mœurs, les rassembla dans des villes, et leur donna des lois. Il avait probablement apporté avec lui des souvenirs des premiers âges du monde. Il parvint à faire sentir tous les charmes de l’innocence et la grandeur des biens attachés à la pratique de la justice ; il opposa l’image du bonheur à celle des maux qui suivent la barbarie ; il contraignit en quelque sorte à devenir heureux ; et, quand le succès eut couronné ses efforts, la reconnaissance lui éleva des autels.
Janus, tel que le peint la poésie dans ses descriptions de l’âge d’or, était trop bon, trop généreux pour refuser un asile à Saturne malheureux et détrôné par Jupiter. Il fit plus que l’accueillir, il voulut partager avec lui son empire ; mais, jaloux de conserver des lois, des coutumes et un gouvernement doux, qui faisaient le bonheur de ses sujets et le sien, il ne céda une portion de son pouvoir à Saturne qu’après s’être assuré que sa manière de gouverner serait entièrement la même que la sienne. Telle est l’origine de ce temps si célèbre parmi les Grecs.
Si l’on s’étonne de voir Saturne occuper parmi les dieux et dans la mémoire des hommes un rang supérieur à celui de Janus, son bienfaiteur et le véritable restaurateur de l’âge d’or, il faut l’attribuer à l’éclatante renommée de Jupiter, fils de Saturne, dont nous verrons bientôt l’histoire, et qui devint le plus puissant et le premier des dieux du paganisme. La réputation de Saturne devint si grande dans le Latium, que la montagne qui fut par la suite nommée le mont Capitolin s’appelait Saturnin ; et nous trouvons dans et dans , que l’Italie entière se nommait Saturnie. Les statues antiques de Saturne portent des chaines pour rappeler celles dont son fils l’avait chargé ; on avait soin de les ôter les jours de ces fêtes, pour mieux marquer que son règne avait été celui du bonheur et de la liberté.
On le représente souvent sous la forme d’un vieillard armé d’une faux, pour désigner qu’il gouverne le temps et les saisons ; lorsqu’il était représenté sous cette forme, on le nommait Chronos, le Temps. (Voyez la figure 3.)
Histoire de Cybèle. §
Quoique Cybèle soit au nombre des divinités de la terre, nous allons donner son histoire, parce qu’elle était femme de Saturne et mère de Jupiter.
Cybèle était généralement regardée comme la mère de la plupart des dieux ; ce qui lui fit donner le nom de Magna Mater, la Grande Mère.
On lui donna beaucoup de noms ; les plus connus sont Dindymène, Idea, Berrescynthya. Ils viennent de différentes montagnes où on lui rendait un culte particulier. On l’appelait aussi Ops et Tellus, parce qu’elle présidait à la terre, comme Saturne, son époux, présidait au ciel ; elle eut aussi le nom de Rhea, qui dérive du grec et signifie couler, parce que c’est de la terre que toutes choses proviennent.
Ordinairement on représente Cybèle assise, pour montrer la stabilité de la terre. (Voyez la fig. 4) Elle porte un tambour ou un disque, symbole des vents que la terre renferme : on lui voit sur la tête une couronne formée avec des tours. Sa figure est celle d’une femme forte ; et, pour mieux désigner la fertilité de la terre, on lui donne la grosseur d’une femme près d’accoucher. On place des clefs dans ses mains, pour exprimer que pendant l’hiver elle conserve dans son sein les semences de tous les fruits. Enfin, ses temples étaient d’une forme ronde, pour les rendre conformes à la rondeur de la terre.
Les fêtes de Cybèle se nommaient Megalizia, et ses prêtres se nommaient Galli, noms qu’ils tiraient d’un fleuve de Phrygie. On prétend que, dès qu’ils avaient bu de l’eau de ce fleuve, ils entraient dans une telle fureur, qu’ils se frappaient à coups d’épée : ce qui leur fit donner (à ce que prétendent quelques auteurs), le nom de Corybantes, qui signifie frapper ; mais nous verrons qu’on peut encore lui opposer une autre origine. Ces prêtres étaient quelquefois nommés Curètes. Ce nom leur était donné à cause de l’île de Crète, où ils avaient élevé Jupiter. On les appelait aussi Dactyle, d’un mot grec qui veut dire doigts, parce qu’ils étaient au nombre de dix comme les doigts de la main. Les fêtes de la grande déesse se célébraient au bruit des tambours, avec des hurlemens et des cris extraordinaires. A Rome, elle avait un temple nommé Opertum, dans lequel les hommes n’étaient jamais admis ; et la fête des lavations en l’honneur de Cybèle y avait une grande célébrité.
Pendant cette fête, on portait sur un char, et dans la plus grande pompe, la statue de la déesse. Un immense cortége l’accompagnait jusqu’à l’endroit où le fleuve Almon tombe dans le Tibre. Lorsqu’on était parvenu à ce lieu, on lavait la statue de la déesse dans les eaux du fleuve. Cette solennité, qui arrivait le 25 de mars, fut instituée en mémoire du temps où le culte de Cybèle fut apporté de Phrygie à Rome.
Les Romains, ayant lu dans les vers des Sibylles (dont nous parlerons dans la suite de cet ouvrage), qu’ils devaient honorer Cybèle comme étant la mère des dieux, ils envoyèrent une brillante ambassade en Phrygie, pour demander la statue de la déesse, qui était d’une pierre noire. La demande ayant été accordée, on la fit transporter par mer ; mais, dès que l’on fut à l’embouchure du Tibre, le vaisseau s’arrêta sans que rien pût le faire avancer. L’oracle, ou le livre des Sibylles, fut consulté de nouveau, et la réponse fut qu’une vierge aurait seule le pouvoir de le faire entrer dans le port.
Le désir de plaire est toujours dangereux, lorsqu’on s’y livre avec imprudence et sans réserve. Il avait eu jusqu’alors trop d’empire sur la jeune et belle Claudia ; des doutes injurieux commençaient à s’élever contre elle, et vainement elle versait des larmes amères envoyant sa réputation se flétrir. Instruite de la réponse de l’oracle, elle sollicita, comme une grâce, l’ordre d’être soumise à cette épreuve ; elle l’obtient, et se présente au milieu du peuple romain, parée de toute sa beauté. Sa démarche, à la fois modeste et fière, annonce qu’elle est au-dessus de la crainte ; indignée des soupçons dont elle connaît l’injustice, sûre de sa vertu, elle adresse hautement sa prière à la déesse, attache sa ceinture au vaisseau, et, dans l’instant même, on le voit avancer sans résistance.
L’histoire nous apprend que Cybèle était fille d’un roi de Phrygie ; elle quitta ce pays pour venir dans le Latium, où elle épousa Saturne. Ce fut elle qui, la première, fit fortifier les murailles des villes avec des tours ; ce qui a donné lieu à la représenter avec une couronne de tours sur la tête. Cybèle, avant d’être destinée à devenir l’épouse de Saturne, avait vu Atys, jeune Phrygien ; elle désira se l’attacher ; mais il lui préféra la nymphe Sangaride, fille de Sangar, roi de Phrygie. La fable dit que la déesse se vengea d’Atys sur la personne de Sangaride : la vie de cette nymphe était attachée au sort d’un arbre ; il fut abattu à coups de coignée, et la nymphe périt. Atys, au désespoir, ne put modérer ses fureurs ; sa frénésie le conduisit dans les montagnes de Phrygie, où il se donna un coup de couteau. Il était prêt de perdre la vie, lorsque Cybèle, ayant pitié d’un mortel qu’elle avait tant aimée, le changea en pin, arbre qui lui fut consacré depuis ce temps. Cette fable d’Atys et de Sangaride est fondée sur ce que Midas, roi de Pessinunte, promit sa fille en mariage au jeune Atys. Cybèle, avertie qu’elle avait une rivale, rassembla des troupes, courut à Pessinunte, fit enfoncer les portes de la ville à coups de coignée. Atys voulut en vain résister à cette attaque ; il y fut dangereusement blessé ; ce qui causa le désespoir et la mort de Sangaride.
Les seuls renseignemens de l’histoire sur la naissance et le nom de Cybèle, sont qu’elle fut exposée au moment de sa naissance, sans en dire la cause, ni comment elle fut reconnue par son père, roi de Phrygie, et on l’appela Cybèle, du nom de la montagne sur laquelle elle avait été exposée.
Quelques étymologistes croient que ce nom vient d’un mot hébreu qui signifie enfanter avec douleur, et que la tradition d’Ève, condamnée à enfanter avec douleur, est cachée sous cette fable.
Le culte de Cybèle et de la Terre est extrêmement ancien. Plusieurs auteurs disent que ce fut Cadmus qui l’apporta en Europe. Ils disent que Dardanus, contemporain de Cadmus après la mort de son frère Jasion, conduisit Cybèle sa belle-sœur, et Corybas son neveu, jusque dans la Phrygie, où ils introduisirent les mystères de la Terre et de la mère des dieux. Ils assurent que Cybèle donna son nom à cette déesse, et que les corybantes, ses prêtres, prirent leur nom de Corybas. Voilà ce qui, par la suite, a fait croire que Cybèle était la mère des dieux. Ce qu’il y a de certain, c’est que la grande déesse de Syrie est la même que Rhéa. La déesse Astergatis était le symbole de la terre, et les Égyptiens l’honoraient en même temps que la lune, sous le nom d’Isis.
Telle paraît être l’origine du culte de la terre, qui passa, avec les autres cérémonies des Égyptiens, d’abord dans la Syrie et la Phénicie, ensuite dans la Phrygie, qui est une partie de l’Asie-Mineure, d’où il arriva dans la Grèce et dans l’Italie. On trouvera que l’idolâtrie et les fables ont presque toutes suivi la même marche. Les Romains se distinguèrent extrêmement par le culte qu’ils rendaient à la mère des dieux.
On donne souvent à Cybèle le nom de Vesta prisca ou Vesta tellus ; mais il faut la distinguer de la seconde Vesta, fille de Saturne, qui était la déesse du feu, et qui présidait à la virginité. Nous allons donner son histoire.
Des vestales ; de Vesta, déesse du feu et de la virginité. §
Numa Pompilius éleva un autel à Vesta, fille de Saturne, et institua les célèbres prêtresses qui portèrent le nom de Vestales ; il n’en avait d’abord institué que quatre ; mais par la suite, leur nombre fut augmenté jusqu’à sept.
Les vierges romaines destinées au culte de Vesta étaient choisies depuis l’âge de six ans jusqu’à dix. Leur naissance devait être sans tache, et leurs corps sans défauts.
Le temps de leur consécration à Vesta durait trente années, pendant lesquelles elles étaient vouées à la virginité ; ce n’était qu’après ce terme qu’elles étaient libres de leur sacerdoce, et pouvaient se marier.
Pendant les dix premières aimées, on les instruisait des fonctions de leur ministère ; elles les exerçaient pendant les dix secondes, et pendant les dix dernières elles instruisaient les novices.
Le principal emploi des vestales consistait à entretenir sans cesse le feu sacré qui brûlait en l’honneur de Vesta. (Fig. 5.) Tous les ans, aux calendes de mars, ce feu se renouvelait aux rayons du soleil.
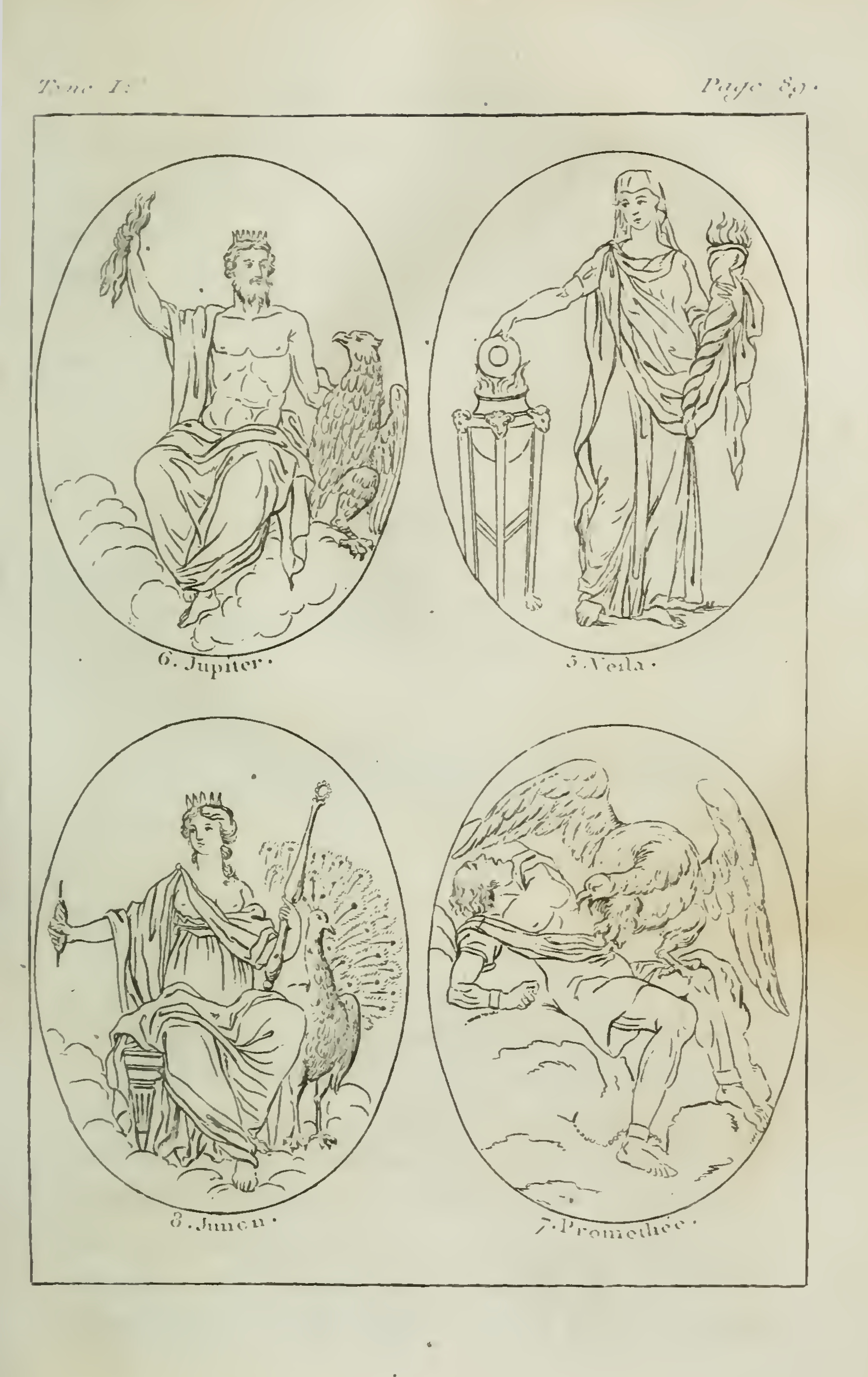
On attachait une telle importance à la conservation du feu sacré, que, lorsqu’il venait à s’éteindre, on interrompait tous les exercices publics. Cet événement causait un deuil général ; on en tirait les plus tristes présages, tous les yeux cherchaient attentivement la cause de ce malheur public ; on se livrait à tous les soupçons, et quelquefois ils tombaient sur les vestales. Il était difficile d’échapper aux recherches ; et, si l’une d’elles avait manqué à ses vœux, rien ne pouvait la soustraire à la mort : on l’enterrait vivante. Ce fut dans une de ces occasions qu’Émilie, l’une des vestales, ayant été soupçonnée, jeta son voile au milieu de la cendre sacrée, et le feu se ralluma sur-le-champ.
On croit qu’Énée fut le premier instituteur des vestales, et que Numa Pompilius ne fit que les rétablir. L’opinion commune était qu’outre le feu sacré on conservait dans le temple de Testa le Palladium, les dieux pénates et d’autres images des dieux que le pieux Énée avait rapportés de Phrygie, et qu’il avait sauvés des ruines de Troie.
Ces dépôts précieux étaient regardés comme nécessaires à la conservation de Rome : et ce fut pour les préserver, que Cécilius Métellus se précipita dans les flammes qui consumaient le temple des vestales, tandis que ces timides prêtresses s’enfuyaient. Les Romains récompensèrent son généreux dévouement, en lui faisant élever dans le Capitole une statue sur laquelle était une inscription honorable.
Il est certain que le culte de Vesta et du feu avait été apporté de Phrygie par Énée et par les Troyens qui l’accompagnaient ; mais les Phrygiens eux-mêmes l’avaient reçu de l’Orient. Les Chaldéens avaient une grande vénération pour le feu, qu’ils regardaient comme une divinité. Il existe dans la province de Babylone une ville consacrée à cet usage, que l’on nommait la ville d’Ur ou de feu. Les Perses étaient encore plus superstitieux sur ce point que les Chaldéens ; ils avaient des temples nommés Pyrées, uniquement destinés à conserver le feu sacré.
fait remarquer le soin que prit Énée d’emporter avec lui le feu sacré, avant de quitter le palais de Priam son père. Il ajoute que le nom Vesta est le même que celui Esta, donné par les Grecs au feu.
Le savant M. nous apprend que ce fut ce nom qui porta le fameux à donner le titre d’Avesta, ou garde du feu, à celui de ses livres où il parle du culte du feu.
Jupiter. §
On s’effraie lorsqu’on veut approfondir l’idée que les païens avaient de ce premier des dieux. La plus grande partie de leurs philosophes croyaient que Jupiter était l’air le plus pur, l’æther, et que Junon, son épouse, était l’air grossier qui nous environne.
Ceux qui le regardaient comme un dieu animé, ou comme l’un de ces hommes à qui des actions brillantes avaient mérité les honneurs divins, ne craignaient point de se contredire de la manière la plus forte, en lui attribuant des actions indignes et des crimes énormes. Ils le peignaient à la fois comme le maître absolu des dieux et des hommes, comme le principe de toute justice, et souvent comme le plus faible et le plus coupable des hommes. Quelle idée avaient donc de la divinité ces Grecs et ces Romains, si vantés pour la délicatesse de leur esprit ?
Ce qui obscurcit encore davantage l’histoire de Jupiter, c’est qu’il y en a eu beaucoup de ce même nom, et que leurs différentes actions ont été attribuées à celui qui avait été roi de Crète, comme étant le plus connu de tous.
Les anciens ne sont nullement d’accord sur le nombre des Jupiter. en reconnaît deux : le premier était un prince Atlantide ; le second, beaucoup plus célèbre, était son neveu, qui fut roi de Crète, et qui poussa les limites de son empire jusqu’aux extrémités de l’Europe et de l’Afrique. en comptait trois. Le premier, né en Arcadie, était fils de l’Æther, père de Proserpine et de Bacchus ; le second était fils du Ciel et père de Minerve, à laquelle attribue l’invention de la guerre ; le troisième était fils de Saturne : il était né dans l’île de Crète, et l’on y voyait son tombeau.
Le nom de Jupiter est beaucoup plus ancien que ne paraissent le croire et . Le premier de tous est le Jupiter Ammon des Libyens ; il y a tout lieu de croire que cet Ammon était Cham lui-même, que son fils Mysraïm ou Mesraïm plaça au rang des dieux. On sait que ce patriarche et sa famille allèrent s’établir dans l’Égypte, que l’Écriture Sainte nomme la terre de Mesraïm ou d’Ammon ou Noammon. Jupiter Sérapis, adoré dans le même pays, est aussi très-ancien. Jupiter Bélus, dont parle , était le Jupiter des Assyriens. Selon , le ciel était le Jupiter des Perses. Les Grecs, au contraire, regardaient le Ciel, ou Uranus, comme le grand-père de Jupiter.
On doit aussi placer au nombre des plus anciens Jupiter celui de Thèbes en Égypte, puisqu’au rapport d’ , ce fut une prêtresse de ce dieu qui alla dans la Grèce établir le premier oracle.
Les Scythes avaient leur Jupiter ; chaque peuple lui donnait un nom particulier. Les Éthiopiens le nommaient Assabinus , les Gaulois, Taranus ; les habitans du bas du Nil, Apis ; les Arabes, Chronos ; les Assyriens, Belus ou Zeus.
Nous ne donnerons pas la liste complète de tous ces noms, ni l’histoire de ceux qui l’ont porté, puisque, suivant , leur nombre s’élevait jusqu’à trois cents. Dans les premiers temps, la plupart des rois prenaient ce nom auguste. Cet usage ne cessa qu’après la prise de Troie. De là vient que tant de peuples différens se vantaient que Jupiter était né parmi eux, et presque tous montraient des monumens qui semblaient l’attester. Nous allons distinguer ceux qui ont eu le plus de célébrité.
Celui qui enleva Europe est Jupiter Astérius, père de Minos ; il était roi de Crète, et vivait du temps de Cadmus, quatorze siècles avant l’ère chrétienne.
Celui qui épousa la fille d’Atlas vivait environ cent quarante ans avant la prise de Troie. Celui qui entra dans la tour de Danaé était le Jupiter Proëtus, oncle de cette princesse. Celui qui fut père d’Hercule vivait environ soixante-dix ans avant la prise de Troie ; enfin, celui qui eût de Léda les deux Dioscures, Castor et Pollux, n’était pas éloigné de cette même époque.
Nous ne donnerons pas l’histoire de tous ces Jupiter : il est probable que les événemens arrivés à chacun d’eux ont été les matériaux que l’on a réunis pour en former l’histoire particulière d’un seul Jupiter. Nous nous bornerons à faire connaître ce que la mythologie a cru devoir conserver, et nous abandonnerons aux recherches des savans les différences qui existent entre ces différens dieux.
L’histoire de Jupiter se trouvant sans cesse mêlée avec celle des autres dieux, il nous paraît indispensable de la donner avec ses principaux détails. Nous allons, en conséquence, rapporter ce que la fable a conservé ; nous citerons ensuite les événemens que la tradition et l’histoire nous ont transmis. Nous dirons les noms les plus connus de Jupiter, la manière dont on le représentait, et le culte qu’on lui rendait. En donnant cette étendue à son histoire, nous faciliterons infiniment celle des autres dieux, et l’on saisira beaucoup mieux l’ensemble de la mythologie.
Fable de Jupiter. §
La fable de Saturne et de Cybèle nous a déjà fait connaître la naissance de ce dieu. Cybèle, après avoir présenté la pierre nommée Abdir à Saturne, qui la dévora sur-le-champ, confia aux Curètes le soin de l’enfance de Jupiter ; et c’était pour empêcher qu’on n’entendît ses cris, qu’ils dansaient en frappant sur leurs boucliers avec leurs lances. Avant la naissance de Jupiter, Saturne avait déjà dévoré Vesta, sa fille aînée, Cérès, Junon, Pluton et Neptune. Rhéa, sentant qu’elle portait Jupiter dans son sein, le sauva comme nous venons de le dire, et le fit ensuite transporter secrètement dans l’île de Crète ; on le cacha dans un antre nommé Dicté ; deux nymphes du pays, nommées Adrastée et Ida, autrement appelées les Mélisses, prirent soin de son enfance, et le lait de la chèvre Amalthée lui servit de nourriture.
Aussitôt que Jupiter fut devenu grand, il s’associa avec Métis, nom qui signifie providence, c’est-à-dire que depuis ce temps il montra beaucoup de prudence. Métis lui conseilla de faire prendre à son père Saturne un breuvage qui lui fit rendre la pierre Abdir, et aussitôt tous les enfans que Saturne avait dévorés revirent le jour.
C’est ici le cas de rappeler l’explication que nous avons donnée, dans l’histoire de Saturne, du mot phénicien Balah, qui signifie également enfermer et dévorer. Nous apercevrons alors que Jupiter, conseillé par la prudence, trouva le moyen de délivrer de leurs prisons ses frères et ses sœurs, avec lesquels il se réunit pour faire la guerre à son père Saturne et aux Titans ses parens.
Après cette guerre, qui dura dix années, la Terre prédit à Jupiter qu’il remporterait une victoire complète sur ses ennemis, s’il pouvait mettre en liberté ceux des Titans que son père tenait renfermés dans le Tartare, et s’il pouvait les engager à combattre avec lui. Il entreprit cette périlleuse aventure, tua Campé qui gardait la prison, et délivra ses parens. Ce fut alors que les Cyclopes, dont nous parlerons dans la suite, donnèrent à Jupiter la foudre, qui depuis a été son symbole ordinaire ; ils donnèrent en même temps un casque à Pluton, et un trident à Neptune. Avec ces armes, ils vainquirent Saturne, que Jupiter traita comme le même Saturne avait traité Uranus, son père. Il le précipita dans le fond du Tartare avec les Titans, sous la garde des Hécatonchires, géans qui avaient cent mains. Ce fut après cette victoire que les trois frères, se voyant les maîtres du monde, le partagèrent entre eux. Jupiter eut le ciel pour sa part, Neptune eut la mer, et Pluton les enfers.
Explication du partage du monde. §
Avant de poursuivre la fable de Jupiter, nous allons dire la manière dont les savans expliquent ce célèbre partage du monde.
Presque tous se réunissent pour le regarder comme un souvenir confus des premiers temps et comme une tradition à peu près conforme à ce que rapporte la Genèse. Noé, disent-ils, partagea la terre entre ses trois enfans, Cham, Japhet et Sem.
L’Afrique fut le partage de Cham : il y a beaucoup d’apparence que ce fut lui qui fut désigné par la suite sous le nom de Jupiter, car il y avait en Égypte une ville consacrée en son honneur. D’ailleurs les noms de Cham ou Ham ont beaucoup d’affinité avec celui d’Ammon, si célèbre dans l’Afrique.
Japhet, second fils de Noé, eut en partage tous les lieux maritimes de l’Asie, avec l’Archipel de l’Europe, ce qui servit par la suite à le faire regarder comme le dieu de la mer.
Sem, troisième fils de Noé, hérita du reste de l’Asie, où le culte du feu devint presque général, et où plusieurs villes furent consumées par les flammes, ce qui lui fit donner le nom de dieu des enfers.
Nous reviendrons encore à ce partage, lorsque nous rapporterons ce que l’histoire a conservé sur Jupiter.
Suite de la fable de Jupiter. §
Les Titans et les Géans ayant résolu de se venger de Jupiter, entreprirent de l’assiéger jusque dans le ciel, c’est-à-dire sur le mont Olympe, où il faisait sa résidence ordinaire. Ils entassèrent le mont Ossa sur le mont Pélion. Jupiter, effrayé à la vue de ses ennemis, appela tous les dieux et toutes les déesses à son secours. La déesse Styx, fille de l’Océan et de Téthys, arriva la première, accompagnée de ses enfans : la Victoire, la Puissance, l’Émulation et la Force. Jupiter lui sut si bon gré de sa diligence, qu’il ordonna que tous les sermens faits au nom de la déesse Styx (que l’on confondit depuis avec un des fleuves de l’enfer) seraient inviolables pour tous les dieux et pour lui-même. Ils ne pouvaient manquer à ce serment, sans être déchus des privilèges divins pendant un siècle.
Les Géans, enfans du Ciel et de la Terre, étaient d’une taille monstrueuse et d’une force proportionnée ; ils avaient le regard effrayant et farouche ; la partie basse de leur corps ressemblait à celle des serpens. Leur demeure ordinaire était aux champs Phlégréens. Dans l’assaut qu’ils donnèrent au ciel, ils lançaient des rochers énormes, des chênes, des pins et d’autres arbres enflammés. Les plus redoutables d’entre eux étaient Porphyrion et Alcionée : celui-ci devait être immortel tant qu’il demeurerait dans le lieu de sa naissance.
Ce qui effrayait le plus Jupiter, c’est qu’il était dit que les Géans seraient invincibles, et qu’aucun des dieux ne pourrait leur ôter la vie si quelque mortel ne venait au secours du Ciel. Jupiter alors défendit à l’Aurore, au Soleil et à la Lune, de paraître et de découvrir ses desseins ; il devança la Terre qui voulait soutenir ses enfans, et, d’après le conseil de Pallas, il fit venir Hercule pour combattre avec lui. Ce héros avec ses flèches renversa plusieurs fois le redoutable Alcionée ; mais celui-ci, comme un autre Anthée, reprenait de nouvelles forces toutes les fois qu’il touchait la terre. Pallas le saisit au milieu du corps, et le transporta au-dessus du cercle de la lune, où il expira.
Pendant ce temps, Porphyrion attaquait à la fois Hercule et Junon ; mais ce redoutable géant, surpris de la beauté de la déesse, suspendit un instant ses coups pour la considérer ; les flèches d’Hercule et les foudres de Jupiter lui firent perdre la vie.
Ephilate et Otus son frère, fils d’Aloëus et d’Iphimédie, que l’on surnommait les Aloïdes, attaquaient le dieu de la guerre ; mais le premier fut mis hors de combat par les flèches d’Apollon et d’Hercule qui lui crevèrent les yeux. Eurytus ayant osé combattre Hercule fut tué par ce héros avec une massue de bois de chêne, pendant que Vulcain, avec une massue de fer rouge, terrassait Clytius.
Encelade, voyant les dieux victorieux, commençait à prendre la fuite, lorsque Minerve l’arrêta en lui opposant l’île de Sicile. Polybotès, poursuivi par Neptune, fuyait à travers les flots de la mer, et touchait à celle de Cos, lorsque ce dieu, arrachant une partie de cette île, en couvrit le corps de ce géant, ce qui en forma une nouvelle sous le nom de Nysiros. Minerve, de son côté, ayant vaincu le géant Pallas, l’écorcha et s’arma de sa peau. Mercure, qui avait pris le casque de Pluton, donna la mort au géant Hippolyte ; Diane tua Gration, et les Parques ôtèrent la vie à Agrius et à Thaon.
La Terre, irritée de cette victoire, redoubla d’efforts, et fit sortir de son sein le redoutable Typhon, qui seul donna plus de peine aux dieux que tous les autres Géans ensemble. De sa tête il atteignait le ciel ; il était demi-homme et demi-serpent ; la vue de ce monstre épouvanta tellement les dieux qui étaient venus au secours de Jupiter, qu’ils s’enfuirent du ciel et se sauvèrent en Égypte.
Cette retraite ayant considérablement affaibli le parti de Jupiter, donna lieu de dire que Typhon lui avait coupé les mains avec la même faux de diamant dont Jupiter s’était armé contre lui. Ce formidable ennemi ne laissant aucun relâche aux dieux, les poursuivit en Égypte, où ils se métamorphosèrent en animaux : Apollon en corbeau, Bacchus en bouc, Diane en chatte, Junon en vache, Vénus en poisson, et Mercure en cygne ; c’est-à-dire qu’ils s’embarquèrent sur des vaisseaux qui portaient ces diverses figures à leurs proues.
Typhon ayant coupé les mains et les jambes de Jupiter avec la faux de diamant, le porta dans la Cilicie et l’enferma dans un antre, sous la garde d’un monstre moitié fille et moitié serpent. Mercure et Pan ayant surpris la vigilance de ce gardien, rendirent à Jupiter ses mains et ses jambes, c’est-à-dire sa liberté ; et ce dieu, étant monté sur un char tiré par des chevaux ailés, poursuivit Typhon à coups de foudre jusqu’au fond de l’Arabie. De là, il le ramena en Thrace, où le géant ayant déraciné une montagne, la lança contre Jupiter, qui, d’un coup de foudre, la repoussa contre lui. Enfin Typhon, s’étant enfui en Sicile, y fut accablé par Jupiter sous le mont Etna. Les tremblemens de terre, dit la fable, sont les efforts de Typhon pour soulever la montagne qui F écrase.
Après la défaite des Titans et des Géans, Jupiter ne songea plus qu’à gouverner l’univers et à veiller au bonheur des hommes.
dit que Jupiter se maria sept fois
. Ses épouses furent Méthis, Thémis, Eurynome, Cérès, Mnémosyne, Latone, et Junon qui paraît avoir été la dernière de ses femmes, et qui fut la plus célèbre. Il eut un grand nombre d’enfans de ces diverses femmes, et souvent il s’allia avec des mortelles, dont il eut aussi des enfans. Quoique tous ceux nommés par la fable n’appartiennent pas au même Jupiter, nous allons la suivre en les faisant connaître, parce qu’on les retrouvera sans cesse parmi les dieux, les demi-dieux et les héros.
Métamorphosé en cygne, il eut de Léda Castor et Pollux. D’Europe, fille d’Agénor, il eut Minos et Rhadamanthe ; de Calisto, Arcas ; de Niobé, Pélasgus ; de Sardane, Sarpédon et Argus ; d’Alcmène, femme d’Amphitryon, Hercule ; d’Antiope, Amphion et Zéthus ; de Danaé, Persée ; d’Iodamé, Deucalion ; de Carné, fille d’Eubulus, Britamarte ; d’une nymphe Sithnide, Mégare ; de Protogénie, Ethlie, père d’Endymion, et Memphis qui dans la suite épousa Lydie ; de Torrébie, Arcésilas ; d’Ora, Colaxès ; de Thalie, les dieux Palices ; de Garamantis, Hiarbas, Philée et Pilumnus ; de Cérès, Proserpine ; de Mnémosyne, pour laquelle il s’était métamorphosé en berger, les neuf Muses ; de Junon, Mars ; de Maïa, fille d’Atlas, Mercure ; de Latone, Apollon et Diane ; de Dioné, Vénus ; de Métis ou la Providence, Minerve, déesse de la sagesse ; de Sémélé, fille de Cadmus, Bacchus.
Cette longue liste des enfans de Jupiter ne doit pas surprendre, en se rappelant qu’un très-grand nombre de personnages différens ont porté ce même nom. Le Jupiter de Crète ayant été le plus célèbre de tous, les poëtes et les auteurs anciens se sont principalement occupés de lui ; ils ont réuni dans son histoire les traits les plus brillans des autres Jupiter. Il serait impossible de rapporter à chacun d’eux les aventures et les faits qui leur appartiennent, mais nous allons faire quelques citations qui suffiront pour prouver que ces nombreuses aventures doivent être attribuées à divers personnages.
Par exemple, l’histoire de Niobé, fille de Phoronée, appartient à Jupiter Apis, roi d’Argos, petit-fils d’Inachus, qui vivait près de dix-huit cents ans avant Jésus-Christ.
Ce fut Jupiter Asterius, roi de Crète, qui enleva Europe ; il régnait du temps de Cadmus, environ quatorze cents ans avant l’ère chrétienne ; il fut père de Minos, premier du nom.
Celui qui enleva Ganymède est Jupiter Tantale, qui régnait treize cent vingt ans avant Jésus-Christ. Ces époques et ces preuves établissent suffisamment la différence des Jupiter.
Histoire de Jupiter et des princes Titans. §
L’histoire que nous allons rapporter a été conservée principalement par , qui l’avait prise lui-même dans . Le père l’a mise dans le plus beau jour, en rapprochant, pour la soutenir, tous les passages épars dans les anciens auteurs.
Les Scythes, descendans de Magog, second fils de Japhet, s’établirent d’abord dans les provinces septentrionales de la haute Asie. Partagés ensuite en différentes branches, quelques-unes allèrent habiter la Margiane, la Bactriane, et la partie la plus orientale de la Sogdiane, pendant que les autres allèrent dans l’Ibérie et l’Albanie, entre la mer Caspienne et le Pont-Euxin. Devenus trop nombreux pour le pays qu’ils habitaient, ils cherchèrent de nouvelles demeures. L’Arménie, selon , fut la première province dans laquelle ils se jetèrent ; ils s’avancèrent ensuite vers la Cappadoce, et, tirant toujours du côté de l’occident, ils s’établirent dans les contrées qu’arrosent le Thermodon et l’Iris, où ils bâtirent la ville d’Acmonie, du nom d’Acmon, fils de Phané leur chef. Le désir des conquêtes conduisit Acmon dans la Phrygie, où il bâtit une seconde ville du même nom d’Acmonie : et, après s’être rendu maître de la Phénicie et de la Syrie, il mourut pour s’être trop fatigué à la chasse. On le mit au rang des dieux, sous le nom de Très-Haut.
Uranus, dont le nom en grec signifie ciel, fils et successeur d’Acmon, épousa Titée ou la Terre, et en eut plusieurs enfans, qui prirent de leur mère le nom de Titans : nom si célèbre dans les anciennes histoires, et qui les a fait regarder comme les enfans de la Terre. Ces princes, étant plus grands et plus robustes que les autres hommes, furent appelés Géans ; et depuis ce temps on a souvent confondu ensemble les Géans et les Titans, quoiqu’il faille bien les distinguer.
Uranus, selon les anciens, ne fut appelé de ce nom que parce qu’il s’appliquait beaucoup à la connaissance du ciel et des astres ; ses descendans, habiles à profiter de tout ce qui pouvait élever leur race illustre, saisirent l’avantage que leur donnaient les noms d’Uranus et de Titée, pour publier qu’ils étaient les enfans du Ciel et de la Terre.
Uranus surpassa tellement son père Acmon et ses prédécesseurs, qu’il semble avoir presque effacé dans le souvenir de la postérité les noms de ceux dont il descendait. Ce prince passa le Bosphore, porta ses armes dans la Thrace, et conquit plusieurs îles, entre autres celle de Crète, dont il donna le gouvernement à l’un de ses frères, qui eut des enfans mâles que l’on nomma Curètes. Uranus se jeta ensuite sur les autres provinces d’Europe, pénétra jusqu’en Espagne, et, passant le détroit qui la sépare de l’Afrique, il parcourut la côte de cette partie du monde, d’où revenant sur ses pas, il alla vers le nord de l’Europe, et soumit tout le pays à sa puissance.
Ce prince eut plusieurs enfans : Titan, Océan, Hypérion, Japet, Chronos ou Saturne ; devenus grands, ils cabalèrent contre leur père, qui les fit tous enfermer, à l’exception d’Océan : celui-ci resta toujours soumis. Saturne, délivré par sa mère Titée, rendit la liberté à ses frères, qui, s’étant à leur tour emparés de leur père Uranus, déférèrent, par reconnaissance, l’empire à Saturne leur libérateur. Quelques-uns furent bientôt mécontens et jaloux du pouvoir de Saturne ; mais ils furent vaincus : tout plia, et Uranus, réduit à la condition de simple particulier, mourut de chagrin. Saturne, devenu le maître d’un vaste empire, épousa Rhéa sa sœur, et prit avec le nom de roi la couronne et le diadème.
Uranus, avant de mourir, et Titée, indignés de la conduite de Saturne leur fils, lui annoncèrent que ses enfans le traiteraient comme il avait traité son père. Ce prince, épouvanté d’une menace qu’il sentait mériter, la regarda comme une prédiction ; et, pour s’y soustraire, il fit enfermer successivement tous ses enfans, sans aucune distinction de sexe. Rhéa, désolée de cette cruauté, eut l’adresse de sauver Jupiter, et de l’envoyer de l’Arcadie, où elle était alors, dans l’île de Crète, où les Curètes, ses oncles, l’élevèrent dans les antres du mont Ida.
Telle est l’origine de la fable qui représente Saturne dévorant ses enfans, et celle de la pierre qui lui fut présentée au lieu de Jupiter ; fable expliquée par l’équivoque du mot phénicien Balah. On peut encore y ajouter que le mot Elben, qui est aussi phénicien, et qui est employé dans cette fable, signifie à la fois un enfant et une pierre.
Cependant les Titans, qui voyaient d’un œil jaloux la grandeur de Saturne, se révoltèrent contre lui, se saisirent de sa personne, et l’enfermèrent dans une étroite prison.
Jupiter, très-jeune alors, mais rempli de courage, sortit de l’île de Crète, défit les Titans, délivra son père, le rétablit sur son trône, et revint victorieux dans sa retraite.
Saturne régna encore pendant plusieurs années ; mais l’âge et le souvenir de sa propre conduite envers son père Uranus l’ayant rendu soupçonneux, il consulta l’oracle, qui lui répondit qu’il avait tout à craindre du plus jeune de ses enfans. Dès-lors il chercha tous les moyens de se défaire de Jupiter ; il lui dressa des embûches, que celui-ci sut éviter ; mais, se voyant tous les jours exposé à de nouveaux dangers, il songea sérieusement à se défendre. Saturne vint bientôt après dans son île de Crète, dont il était souverain, pour attaquer son fils ; mais ceux qui la gouvernaient pour lui s’étant rangés du côté de Jupiter, il fut obligé de se retirer avec précipitation dans la partie de la Grèce qui, par la suite, porta le nom de Péloponèse. Jupiter l’y suivit, le vainquit, et le força d’aller chercher un asile en Italie, où Janus le reçut favorablement.
Les Titans, alors répandus dans la Grèce, jaloux de la puissance du nouveau conquérant, et sollicités par Saturne, assemblèrent des troupes, et lui présentèrent le combat ; mais, ayant été défaits, ils allèrent avec Saturne se cacher au fond de l’Espagne.
Jupiter commença par délivrer ses frères et ses sœurs ; ensuite il alla chercher les Titans dans le lieu de leur retraite ; il les battit une seconde fois aux environs du Tartesse, et ce fut par cette bataille qu’il termina cette guerre qui avait duré dix années. Saturne, ne se voyant plus en sûreté dans un pays dont son fils était le maître, passa dans la Sicile ; où il mourut de chagrin, comme lui-même avait fait mourir son père Uranus.
C’est à cette dernière victoire et à la mort de Saturne que commença le règne de Jupiter. Son véritable nom était Jou, c’est-à-dire jeune, pour marquer qu’il était le dernier des enfans de Saturne, et en même temps qu’il s’était extrêmement distingué pendant sa jeunesse. Par la suite, on y ajouta la qualité de pater, père, d’où l’on fit Joupater et Jupiter. Devenu le maître d’un vaste empire, il épousa sa sœur, nommée Junon par les Romains, et que les Grecs appelaient Héra ou la maîtresse. On donnait aussi le nom de Jovis à Jupiter ; et l’on y joignit le mot père, pour désigner qu’il était le maître des dieux.
L’impossibilité de régir à lui seul d’aussi vastes états lui fit établir différens gouverneurs. nous apprend qu’Atlas gouvernait les frontières d’Afrique ; il s’y rendit si célèbre, qu’il donna son nom à la chaîne de montagnes qui s’étend jusqu’à la mer ; elle se nomme encore de même aujourd’hui ; et la partie de mer qui baigne cette chaîne de montagnes se nomma, pour la même cause, l’Océan Atlantique. Nous trouvons aussi dans les anciens que Pluton fut gouverneur des parties occidentales de l’empire des Titans, des Gaules et de l’Espagne ; ce que nous rappellerons dans l’histoire de ce dieu. Après la mort de Pluton, le gouvernement fut donné à Mercure, qui s’y rendit très-célèbre, et devint la principale divinité des Celtes. On ignore l’histoire des autres gouverneurs ; on sait seulement que Jupiter s’était réservé tout l’Orient, la Grèce, ses îles, et la partie de l’Asie d’où venaient ses ancêtres.
On s’aperçoit sans doute que, dans ces traditions et ces fragmens de l’histoire, il n’est point question du partage du monde entre les trois frères. Il paraît au contraire que Jupiter demeura seul maître de l’empire, et ne donna que des gouvernemens à ses frères ; mais on observera que les Grecs n’ayant point d’histoire certaine pour les guider, leurs poëtes ont eu la possibilité de se livrer à leur imagination ; et, retrouvant sans cesse à la tête des dieux Jupiter, Neptune et Pluton, ils ont cru pouvoir désigner la portion d’empire échue à chaque dieu. Pour mieux l’établir, ils ont consulté leurs plus anciennes traditions ; et, ce furent vraisemblablement les anciens souvenirs conservés du partage du monde entre les trois enfans de Noé, qui les guidèrent lorsqu’ils voulurent désigner l’empire de chaque dieu.
Nous devons ajouter que le partage du monde entre Jupiter, Neptune et Pluton, n’était point généralement admis parmi les anciens. L’Angleterre possède un monument précieux qui prouve cette différence d’opinion des anciens, et jette une grande lumière sur ce point de discussion.
A Londres, dans une des plus belles et des plus riches collections du monde, celle de M. Townley, on voit une statue antique de Jupiter, qui représente ce dieu avec la foudre, symbole du dieu du ciel ; il la tient dans sa main droite ; dans sa gauche il tient un trident, symbole du dieu de la mer, et l’on voit à ses côtés un Cerbère, symbole du dieu des enfers. Ce morceau, très-précieux et très-bien conservé, s’accorde parfaitement avec les détails historiques rapportés ci-dessus.
Les anciens qui ont écrit l’histoire de l’île de Crète louent beaucoup le courage, la prudence, la justice et les vertus civiles et militaires de Jupiter. Leurs ouvrages n’existent plus en originaux ; mais les Grecs nous en ont conservé les fragmens. Ils disent qu’il fut excellent législateur, que ses lois étaient justes, et qu’il veillait attentivement à les faire exécuter. Il extermina les brigands qui s’étaient cantonnés dans la Thessalie ; et, voulant y avoir une place de défense, il la fit construire sur le mont Olympe : ce qui donna lieu aux poëtes de dire qu’il habitait le ciel.
Les lieux qui nous ont vus naître, et ceux où l’on a pris soin de notre enfance, nous sont toujours les plus chers. D’où vient donc le charme qu’ils ont pour nous ? Ne serait-ce point parce qu’ils nous rappellent tous les secours qui nous ont été prodigués dans l’âge où nous en avions tant de besoin ? Et ne semble-t-il pas que la providence a voulu, par ce penchant délicieux, nous avertir d’être toujours fidèles au plus juste, au premier des devoirs, à celui de la reconnaissance ? Les soins de l’empire du monde n’empêchaient point Jupiter d’aller souvent dans l’île de Crète ; c’est là qu’il se livrait au repos ; heureux s’il n’avait point terni sa gloire et ses belles actions par son goût immodéré pour le plaisir ! C’est à ce goût qu’il faut rapporter cette foule d’intrigues coupables et souvent ridicules dont l’histoire a été transmise sous l’enveloppe de ses différentes métamorphoses. Elles indisposèrent tellement contre lui Junon, son épouse, qu’elle entra dans une conjuration que Jupiter dissipa dès qu’il en fut informé. Ce fut là le dernier de ses exploits : accablé de vieillesse, ce fut dans son île favorite de Crète qu’il alla terminer ses jours. On y voyait son tombeau près de la ville de Gnosse, l’une des principales de cette île, avec cette inscription : Ci gît Zan, que l’on nommait Jupiter. Il vécut cent vingt ans ; on comptait soixante-deux ans de règne depuis la défaite des Titans et la mort de Saturne. Les Curètes, ses parens, prirent soin de ses funérailles.
L’empire de Jupiter eut le sort des grands états, dont la splendeur survit rarement aux souverains qui les ont créés. Après sa mort, il fut divisé en un grand nombre de petits royaumes, gouvernés par une suite de princes dont la plupart nous sont inconnus. Ce qui reste de leur histoire ne mérite pas d’être rapporté. L’île de Crète fut la portion de cet empire qui subsista le plus long-temps. Crès, fils de Jupiter, y régna après la mort de son père.
Les anciens nous apprennent aussi que Deucalion, fils de Prométhée, et de la race des Titans, s’établit dans la Thessalie, où ses enfans régnèrent long-temps. Telle est l’histoire des princes Titans et de Jupiter, le plus grand dieu des Grecs et des Romains : histoire fondée sur d’anciennes traditions, autorisée par
, par
, par
, par
, par
. On peut ajouter que l’Écriture Sainte donne une grande idée des Titans, puisque Judith, remerciant le Seigneur de la mort d’Holopherne, dit :
Ce n’est point un de ces hommes puissans qui lui a ôté la vie ; ce ne sont point les fils des Titans, les Géans ; c’est une femme.
Au reste, on ne prétend point renfermer dans ces fragmens d’histoire toutes les traditions répandues dans la Grèce au sujet de Jupiter et de sa famille ; mais on a préféré celle qui avait le plus de vogue.
Explication de quelques-unes des fables contenues dans l’histoire et la fable de Jupiter. §
Nous nous bornerons à donner l’explication des traits principaux ; ils serviront à répandre plus de clarté sur l’histoire de Jupiter.
Pour entendre la fable où il est dit que Jupiter précipita dans les enfers son père Saturne, il faut observer que, parmi les Grecs, les pays situés à l’orient étaient regardés comme les lieux les plus élevés du monde. Ceux au contraire situés à l’occident passaient pour les plus bas. Il n’eut fallu pas davantage pour entraîner l’imagination fertile des Grecs ; les pays orientaux furent désignés par le nom de ciel, et les pays occidentaux ou inférieurs par celui d’enfer.
C’est d’après cette idée, comme nous le verrons dans l’histoire de Pluton, qu’on plaça les enfers dans l’Espagne, ou dans l’Italie, ou dans l’Épire, ou dans les pays situés à l’occident de la Grèce. Les Titans ayant été forcés de se réfugier dans l’Italie et dans l’Espagne, les poëtes dirent qu’ils, avaient été plongés dans les enfers. De même ils donnèrent le nom de Tartare au Tartese, fleuve de l’Espagne ; et, les Titans ayant été battus près de ce fleuve et noyés en partie dans ses eaux, on publia qu’ils avaient été plongés dans le Tartare. Quelques-uns d’eux ayant été rappelés d’Italie ou d’Espagne, on dit qu’ils avaient été délivrés des enfers. Ils recommencèrent une nouvelle conspiration en s’alliant au parti de Saturne. Jupiter les battit, les poussa au fond de l’Espagne, et, pour garder les passages, il y plaça des troupes fidèles et aguerries, ce qui donna lieu à la fiction des hécatonchires ou géans à cent bras.
Il faut expliquer de même la fable du dieu Neptune qui emprisonnait les Titans par la mer. Ce frère de Jupiter commandait ses flottes ; il se rendit maître des ports de l’Espagne, et ferma tous les passages par lesquels les Titans auraient pu s’échapper.
Nous avons dit que Jupiter détruisit les brigands qui dévastaient la Thessalie ; on les peignit comme des géans redoutables. L’Écriture Sainte fait observer que le mot nephilim, qui a été traduit par celui de géant, signifie aussi des hommes livrés à toutes sortes de débauches, des brigands, des scélérats. Cependant il est généralement reconnu qu’il y a eu des hommes d’une grandeur extraordinaire, et le passage de Judith que nous avons rapporté plus haut prouve que les Titans étaient de ce nombre.
Jupiter avait fait construire sur le mont Olympe une citadelle inaccessible : les poëtes la représentèrent comme le ciel même, et les travaux que les ennemis de Jupiter firent pour attaquer cette forteresse furent dépeints par la fable du mont Ossa entassé sur le mont Pélion.
Dans le combat des Titans, on peint Polybotès accablé par Neptune sous une partie de l’île de Cos. Cette fable signifie que l’amiral le poursuivit jusque dans cette île où il le fit périr. On voit par tous les fragmens qui restent de cette histoire, que Jupiter fut attaqué par mer et par terre.
Parmi les fables conservées sur la manière dont Jupiter fut élevé dans l’île de Crète, il est dit que des colombes prirent le soin de le nourrir. Cette fable doit son origine au mot phénicien ou arabe himan ou heman, qui signifie également prêtre et colombe. Cette équivoque suffit pour faire confondre ensemble les prêtres curètes et les colombes.
Les Curètes ont acquis une si grande célébrité, qu’il est indispensable d’en parler. L’antiquité porta sa vénération pour eux jusqu’au point de leur élever des autels et des temples. Ou leur attribua l’invention de forger le fer et les métaux. L’Écriture Sainte la donna à Tulbalcaïn ; il est possible cependant qu’ils en soient les premiers inventeurs dans la Grèce, et, sur les marbres de Paros, nommés aujourd’hui d’Arundel, on apprend l’événement qui donna lieu aux Curètes de faire cette utile découverte. Leurs inscriptions portent que le feu prit dans la forêt du mont Ida, soit par le tonnerre, soit par quelque autre accident, et que la violence du feu mit en fusion une quantité considérable de fer et d’autres métaux. Les Curètes sentirent tout l’avantage qu’ils pouvaient tirer de cette expérience, et trouvèrent moyen de la renouveler et de se l’approprier. On voit sur les marbres d’Arundel que cet événement arriva sous le règne de Minos premier. Les Curètes employèrent les métaux à se faire des armes particulières. Dans leurs danses ils mêlaient le bruit des tambours et des sonnettes à celui de leurs armes, et frappaient en cadence sur leurs boucliers, ce qui donna aux Grecs la première idée de la mesure dans la musique.
Il paraît certain que c’est à l’un de ces Curètes ou Dactyles Idéens, nommé Hercule idéen, qu’il faut attribuer la première institution des jeux olympiques. Un fragment d’histoire rapporte que cet Hercule, suivi de trois de ses compagnons, quitta le mont Ida, situé dans l’île de Crète, et qu’il vint jusque dans l’Élide. Ce fut là, qu’en mémoire de la guerre entre Saturne et Jupiter il établit une course, et régla que celui qui remporterait le prix aurait une couronne d’olivier pour récompense. Après avoir fondé de cette manière ces jeux devenus si célèbres, le même Hercule fit élever dans l’Élide un autel à Jupiter Olympien.
Nous ajouterons aux explications que nous avons données plus haut, que Typhée ou Typhon, représenté si formidable dans le combat des géans contre Jupiter n’est autre chose que le Typhon des Égyptiens. Les Grecs s’étaient emparés de cette fable égyptienne, qui n’était elle-même qu’une allégorie, pour représenter un tyran cruel qui avait fait long-temps le malheur de l’Égypte. On lui trouve encore un autre sens beaucoup plus vraisemblable : les Égyptiens le peignaient sous la forme d’un monstre horrible, qu’ils disaient avoir été produit par les exhalaisons pestilentielles du Nil. Ce fleuve, en se débordant sur la portion de l’Égypte qui forme aujourd’hui le Delta, ne sembla d’abord qu’un immense marais, et pendant long-temps ses vapeurs le rendirent inhabitable ; mais, lorsque le temps et les travaux de la culture eurent changé ce vaste accroissement de terre en plaines les plus fertiles du globe, les Égyptiens consacrèrent le souvenir de son état primitif dans la fable de leur Typhon, et les Grecs l’ajoutèrent à toutes celles qu’ils ont placées dans l’histoire de leur Jupiter.
Manière dont on représentait Jupiter. §
On représentait le plus ordinairement Jupiter sous la figure d’un homme majestueux avec de la barbe. Un trône lui servait de siége ; de sa main droite il tenait la foudre, et dans sa main gauche on remarquait une victoire et un sceptre. A ses pieds était un grand aigle, avec les ailes déployées, et enlevant Ganymède. La partie supérieure du corps de Jupiter était nue, et la partie inférieure couverte. (Fig. 6.)
Le trône, par sa stabilité, marquait la sûreté de son empire. La partie supérieure du corps n’était point couverte, pour signifier qu’il était visible aux intelligences et aux parties célestes de l’univers ; de même que les longs vêtemens qui couvraient la partie inférieure annonçaient qu’il était invisible pour la terre et les mortels.
Le sceptre et la victoire figuraient que rien ne pouvait résister à sa puissance ; et, par l’aigle aux ailes déployées, on voulait faire entendre qu’il était le maître du ciel comme l’aigle l’est des plaines de l’air.
Par la suite nous donnerons la description du temple de Jupiter Olympien, l’une des sept merveilles du monde. C’était dans ce temple que l’on voyait le trône et la statue du dieu, chef-d’œuvre du célèbre .
Chaque peuple avait sa manière différente de représenter Jupiter. Dans l’île de Crète, il n’avait point d’oreilles, pour apprendre, disaient les Crétois, que le dieu de l’univers ne doit écouter personne en particulier, mais se montrer également propice à tous ceux qui l’implorent. Les Lacédémoniens lui donnaient quatre oreilles, pour qu’il pût entendre les prières de quelque côté qu’elles vinssent,
La figure de la justice se trouvait toujours placée à côté de Jupiter, et l’on y joignait les Heures et les Grâces, pour prouver que, dans tous les instans, il daignait entendre avec bonté les demandes des mortels, qu’il était toujours juste, et qu’il se plaisait à leur accorder des bienfaits.
Le Jupiter Sérapis, si respecté chez les Égyptiens, portait un boisseau sur la tête au lieu d’une couronne.
Le Jupiter Ammon, si célèbre par l’oracle qu’il avait dans la Libye, portait des cornes de bélier. Le mot ammon vient du grec, et veut dire sable. La fable dit que cette représentation et ce culte viennent de ce que Bacchus, s’étant égaré dans les sables de la Libye, et mourant de son, s’adressa à Jupiter, qui vint à lui sous la forme d’un bélier pour lui montrer une source. Bacchus, par reconnaissance, lui fit élever un temple auprès de cette source, où il le fit représenter avec des cornes de bélier, et lui donna le nom de Jupiter Ammon. dépeint Jupiter avec des sourcils noirs, le front couvert de nuages, ébranlant tout l’Olympe d’un seul mouvement de son front ; la foudre est dans sa main ; l’aigle est à ses pieds ; le Respect et l’Équité siègent à ses côtés ; devant lui sont les deux coupes du bien et du mal, qu’il répand à son gré sur les hommes.
Il ajoute que la foudre de Jupiter était composée de trois rayons de grêle, de trois de pluie, de trois de feu, de trois de vent. Il dit qu’il s’y mêlait de la frayeur, des éclairs, du bruit et de la colère.
Des métamorphoses de Jupiter. §
Il serait impossible de rendre un compte exact de toutes les métamorphoses de Jupiter ; nous nous bornerons à citer une des principales, et nous y joindrons quelques-unes de celles qu’il fit subir aux mortels, soit pour les récompenser, soit pour les punir.
Il prit la forme d’un aigle pour enlever Ganymède fils de Tros, roi des Troyens, qu’il chargea du soin de verser le nectar aux dieux à la place d’Hébé, déesse de la jeunesse. Cette métamorphose de Jupiter ne fut point la seule cause qui fit représenter un aigle à ses pieds. La fable, confondue avec l’histoire, rapporte que Périphas, roi d’Athènes, se fit tellement aimer de son peuple, que ses sujets voulurent l’adorer comme Jupiter lui-même, c’est-à-dire n’avoir pas d’autre souverain. Jupiter offensé voulut foudroyer ce mortel ; mais il se contenta de le changer en aigle, et de l’employer lorsqu’il voulait traverser les airs. On aperçoit dans cette fiction que Jupiter le dépouilla de son royaume, et lui donna quelque emploi dans sa cour.
L’on trouve aussi dans l’histoire, que Jupiter avant de partir de Naxe pour aller combattre les Titans, voulut offrir un sacrifice sur le rivage ; pendant qu’il rendait hommage aux dieux, on vit un aigle voler vers lui, et s’arrêter sur sa tête.
Lorsque Jupiter voulait parcourir la terre, il conservait rarement ses attributs divins. Dans une de ses courses, il alla loger chez Lycaon, prince arcadien très-cruel, qui faisait mourir les étrangers qui arrivaient dans ses états. Il lui fit cependant connaître son rang suprême ; mais Lycaon, voulant éprouver si c’était vraiment Jupiter, lui fit servir les membres d’un de ses hôtes qu’il avait mis à mort. Ce crime horrible fut puni dans l’instant. La foudre réduisit le palais en cendres ; et Lycaon fut changé en loup, pour qu’il conservât, sous cette forme, l’empreinte de sa férocité.
En cherchant l’explication de cette fable, nous trouvons que Lycaon, prince très-inférieur à Jupiter, abusait souvent de son pouvoir pour commettre des crimes. Jupiter, avant de le punir, voulut connaître la vérité par lui-même ; il alla dans la cour de Lycaon, et, l’ayant reconnu coupable, il en fit une prompte justice.
Quelques auteurs donnent une autre explication de cette fable ; ils disent que Lycaon, fanatique et cruel, crut rendre plus d’honneur à Jupiter en lui sacrifiant un enfant ; mais que ce prince, ou ce dieu, pénétré d’horreur, le punit sur-le-champ. Nous avons vu qu’au moment de la naissance de Jupiter il fut nourri avec le lait de la chèvre Amalthée : la fable dit que le dieu, pour la récompenser, la plaça parmi les astres avec ses deux chevreaux, et en forma le signe des chevreaux, elle ajoute que, voulant reconnaître les soins que les nymphes avaient pris de son enfance, il leur donna une des cornes de la chèvre Amalthée, en y joignant la vertu de produire tout ce qu’elles pourraient désirer ; ce qui la fit nommer corne d’abondance.
Il est aisé d’apercevoir que cette faculté de produire tous les biens n’était autre chose que la promesse faite par Jupiter de ne jamais refuser les demandes qu’elles voudraient lui faire ; il faut expliquer à peu près de la même manière la corne d’abondance qu’Hercule reçut du fleuve Achéloüs. La fable raconte que ce fleuve, devenu rival d’Hercule auprès de la nymphe Déjanire, essaya de le combattre, et fut vaincu. Achéloüs se métamorphosa en taureau, et sous cette nouvelle forme, il vint attaquer son rival, qui, après l’avoir terrassé une seconde fois, lui enleva une de ses cornes. Achéloüs ne put obtenir qu’elle lui fût rendue qu’en cédant à son vainqueur la corne d’abondance.
Voici l’histoire de cet échange. Le fleuve Achéloüs, considérablement grossi par les pluies ou les fontes de neige, déborda sur les terres en culture, et les ravagea. Hercule fit élever des digues, pour garantir les récoltes de nouveaux dégâts ; elles se trouvèrent trop faibles, et furent rompues. Hercule trouva moyen de les réparer, et laissa subsister quelques canaux bien ménagés, pour donner aux eaux du fleuve la possibilité de porter la fertilité dans les terres en les arrosant ; les poëtes célébrèrent ce bienfait en imaginant la fable de l’échange de la corne d’abondance contre celle du fleuve Achéloüs.
Nous n’étendrons pas davantage l’histoire des métamorphoses de Jupiter, parce qu’on les retrouvera dans les fables des dieux, des demi-dieux et des héros.
Du culte rendu à Jupiter. §
On ne peut pas douter que le plus solennel de tous les cultes rendus aux dieux du paganisme était celui que l’on rendait à Jupiter. Il était aussi le plus varié, puisque chaque peuple changeait à son gré ses cérémonies religieuses. Il paraît certain qu’on ne lui offrait point des victimes humaines, comme on en a plusieurs fois offert à Saturne son père ; la fable de Lycaon en est une preuve incontestable. On trouve cependant quelques exemples, mais très-rares, de ces sacrifices barbares ; et lorsque Cécrops vint s’établir à Athènes, il abolit pour jamais cette horrible superstition.
Les victimes les plus ordinaires que l’on offrait à Jupiter étaient une chèvre, ou une brebis, ou un taureau blanc dont on dorait les cornes. Souvent on ne lui offrait que de la farine, du sel, de l’encens. Parmi les arbres, le chêne et l’olivier lui étaient consacrés. Son culte était presque universel : mais personne ne l’honorait plus particulièrement que les dames romaines. Il avait plusieurs temples dans Rome ; l’un des plus remarquables était placé près du Capitole, et dédié à Jupiter Vengeur. Le dieu était représenté avec des flèches à la main pour montrer qu’il était toujours prêt à punir les crimes. Il avait trois oracles extrêmement célèbres, celui de Dodone, celui de Trophonius, et celui d’Ammon dans la Libye.
Des noms que l’on donnait à Jupiter. §
La plupart des noms donnés à Jupiter tiraient leur origine des lieux où il était honoré, ou des événemens qui lui avaient fait élever des temples ou des autels. Il serait impossible de les faire tous connaître ; nous ne parlerons que des principaux.
Le plus ordinairement on donnait à ce dieu le titre optimus, maximus : le très-bon, le très-grand.
lui donne le nom de
Jupiter roi
.
l’appelle
le tout-puissant
. Aux ides de juin, les Romains célébraient sa fête sous le titre de Jupiter invincible ; on l’appelait Stator, parce qu’il avait arrêté l’armée des Romains dans sa fuite ; Pistor, pour conserver la mémoire de la manière dont il sauva le Capitole pendant que les Gaulois l’assiégeaient. Jupiter avertit la garnison d’employer à faire du pain tout le blé qui lui restait, et de jeter ce pain dans le camp des ennemis, afin de leur prouver que les provisions étaient très-abondantes ; ce stratagème réussit, et fit lever le siége. On le nommait Diespiter, comme était le père de la lumière du jour ; Pluvius, pour avoir accordé de la pluie dans une grande sécheresse ; Hospitalis, parce qu’il était le père de l’hospitalité ; père des dieux, modérateur, recteur, pour marquer sa souveraineté sur les autres dieux ; maître des tempêtes et des vents, et souvent Serenus, parce qu’il représentait l’éther ; Capitolinus, à cause de son temple sur le Capitole ; Olympien, Atabirius, Dictæus et Idæus, parce que les montagnes de ce nom lui étaient consacrées ; Dodonæus, Trophonius et Ammon, à cause de ses oracles. On lui donnait aussi le titre de tonnant et de foudroyant, parce que les Cyclopes lui avaient donné la foudre. Quelquefois les Grecs lui donnaient le nom d’Egyptus, de Nilus, et alors on le confondait avec Osiris. On le nommait aussi Expiator, parce qu’il expiait les crimes des hommes. Tels sont les principaux surnoms de Jupiter.
Histoire de Japet, de Prométhée, d’Épyméthée et de Pandore. §
Ces princes étant très-célèbres, et de la famille des Titans, nous allons placer leur histoire à la suite de celle de Jupiter.
Japet, de qui les Grecs se vantaient de tirer leur origine (comme nous le verrons plus en détail lorsqu’il sera question des demi-dieux et des héros), était fils de Titan. Il fut père de Prométhée (nom qui dérive du grec, et signifie prévoir l’avenir) et d’Épyméthée, qui signifie souvenir du passé.
Prométhée, voyant que Jupiter avait créé l’homme, essaya de l’égaler en formant des statues avec de l’argile. Il parvint à les rendre si parfaites, qu’elles paraissaient presque animées. Minerve, déesse de la sagesse, lui dit que le feu du ciel aurait seul le pouvoir de les animer : l’ambitieux Prométhée conçut l’espoir de le voler ; il alluma un flambeau aux rayons du soleil, et, dès qu’il eut communiqué cette flamme céleste à ses statues, ces ouvrages devinrent semblables à ceux de Jupiter.
Le maître des dieux, pour punir ce larcin, ordonna à Mercure d’attacher Prométhée sur le mont Caucase. Là, un vautour lui rongeait le foie, qui renaissait sans cesse ; ce qui rendait son supplice éternel. (Fig. 7.)
Les autres dieux, jaloux de ce que Jupiter s’attribuait à lui seul le droit de créer des hommes, se réunirent pour former une femme parfaite. Minerve lui donna la sagesse, Vénus la beauté, Apollon la connaissance de la musique, Mercure l’éloquence. Cet assemblage de perfection la fit nommer Pandore, nom qui vient de deux mots grecs, et veut dire tout don. Jupiter voulut la voir ; et, sous le prétexte de lui faire aussi son présent, il lui donna une boîte, avec ordre de la porter à Prométhée. Ce prince, trop sage et trop prudent pour ne pas sentir tout le danger d’un pareil message, refusa de recevoir Pandore et d’ouvrir la boite. L’imprévoyant Épyméthée, séduit par la beauté de Pandore, la choisit pour femme, et devint père d’une fille nommée Pyrrha, qui, par la suite, épousa Deucalion. La curiosité d’Épyméthée ne put se modérer à la vue de la boîte donnée par Jupiter ; elle fut indiscrètement ouverte. Elle contenait tous les maux, qui, dans l’instant, s’échappèrent et se répandirent sur la terre. Épyméthée regrettant trop tard sa fatale curiosité, voulut refermer la boîte ; mais il ne restait plus dans le fond que la seule espérance, dernier bien des malheureux mortels. Ce déluge de maux produisit le siècle de fer.
Cette fable, la plus charmante de celle que nous ont transmises les Grecs, rappelle trop bien le souvenir de la chute d’Adam, conservé par la tradition, pour ne pas l’expliquer en disant qu’elle est une copie altérée de l’histoire de la création de l’homme, et de l’instant où il perdit le bonheur avec son innocence.
Cette explication suffit lorsqu’on veut seulement l’appliquer à l’imprévoyante curiosité d’Épyméthée, et aux maux échappés de la boîte de Pandore ; mais on n’y voit point assez pourquoi les poëtes ont attribué à Prométhée une seconde création de l’homme.
Nous allons rapporter ce que les monumens anciens et les traditions nous ont laissé sur cette fable. C’est principalement à chercher la vérité que nous devons employer les efforts de notre esprit ; et rien ne serait plus dangereux que d’accoutumer la jeunesse à se contenter de superficies agréables et spirituelles.
Recherches historiques sur la fable de Prométhée. §
L’observation et l’étude de l’antiquité portent à croire que Prométhée fut le premier inventeur des statues. Un beau monument respecté par les temps, et dont la gravure se trouve dans le premier volume de l’Antiquité expliquée par les figures, représente Prométhée formant un homme. On voit qu’il travaille avec un ciseau et un maillet, preuve certaine qu’il s’agit de l’art des statues. Pour rendre le sens des fables des poëtes, on a placé Minerve auprès de Prométhée, dirigeant son travail par ses conseils ; et, près d’eux, on voit un char portant Psyché, symbole de l’âme, que l’on reconnaît à ses ailes de papillon. Tout annonce qu’on a voulu désigner par ce monument que les statues de Prométhée étaient si parfaites, qu’elles paraissaient animées, et qu’il n’avait pu les faire sans le secours de Minerve, déesse de la sagesse et des arts. Cette première imitation de l’homme étonna tellement, dans l’origine, que la fable peignit Prométhée comme un second créateur. Elle publia de même, par la suite, que Dédale faisait marcher ses statues, parce qu’il fut le premier qui sépara leurs jambes en les sculptant.
Prométhée fut du nombre des Titans qui se rendirent redoutables à Jupiter. Forcé de fuir devant ce roi victorieux, il se retira dans la Scythie, et se cacha dans les forêts du mont Caucase, qui ne semblaient habitées que par des aigles et des vautours. Le chagrin que lui fit éprouver un exil aussi cruel pour un ambitieux fut figuré par un vautour qui lui déchirait le foie. L’histoire nous apprend que les habitans très-peu nombreux de la Scythie et du Caucase vivaient sans lois, et de la manière la plus grossière : Prométhée, prince savant et très-poli, leur apprit à vivre d’une manière plus douce et plus convenable ; ce qui donna lieu de dire qu’il avait formé l’homme avec l’aide de la déesse de la sagesse. On le peignit de même volant le feu du ciel, parce qu’il fut le premier qui établit des forges dans la Scythie.
Lorsque l’empire de Jupiter fut assez solidement établi pour ne pouvoir plus être ébranlé par les efforts des Titans, Hercule obtint la liberté de Prométhée ; ce qui fit dire qu’il l’avait détaché du Caucase, et qu’il avait tué le vautour. Cependant, comme Jupiter avait fait le serment que l’exil durerait trente années, il crut le remplir et l’adoucir à la fois, en permettant à Prométhée de porter à son doigt un fragment de rocher du Caucase. On croit même que c’est de là qu’est venue la coutume de porter des anneaux et des bagues. Prométhée profita de sa liberté pour venir passer le reste de ses jours dans la Grèce. Après sa mort, on lui accorda les honneurs que l’on rendait aux demi-dieux et aux héros.
Quelques historiens ou commentateurs de l’antiquité donnent une autre interprétation au feu céleste volé par Prométhée ; ils assurent que ce prince fut l’inventeur du fusil d’acier avec lequel on tire du feu des cailloux ; d’autres disent que Prométhée, prévoyant qu’il ne trouverait pas de feu sur le Caucase, prit la précaution d’en emporter avec lui dans une plante longue et moelleuse que les Latins nommaient ferulla. Sa tige a cinq à six pieds d’élévation : elle est remplie d’une moelle que le feu consume très-lentement, et sans jamais s’éteindre tant qu’il reste de cette moelle. Cette plante, très-connue des matelots, leur a souvent servi pour transporter du feu d’une île dans une autre.
Ces deux explications doivent faire observer tout le prix que les hommes attachaient aux premières découvertes qui leur étaient utiles, puisqu’ils accordaient les honneurs divins à leurs premiers inventeurs. L’argent suffit pour payer le manœuvre, mais le génie a droit à de plus grandes récompenses ; et n’oublions jamais que nous devons de la reconnaissance et des égards aux hommes laborieux qui consacrent une partie de leur vie à l’accroissement des sciences, et à se rendre vraiment utiles aux hommes.
L’histoire n’a rien conservé sur Épyméthée, la fable seule s’est emparée de ce personnage, et se borne à dire qu’il fut métamorphosé en singe. On peut juger de là qu’il voulut imiter son frère ; mais que, beaucoup moins prudent et moins habile, il le copia maladroitement : ce qui le fit comparer au singe, animal imitateur de tout ce qu’il voit faire.
Histoire et fable de Junon. §
Junon était fille de Saturne et de Rhéa ; elle était sœur de Jupiter, de Neptune, de Pluton, de Vénus et de Cérès. Les Grecs la nommaient Héra, la maîtresse, ou Mégalè, la grande. Chez les Romains, on l’appelait Juno, de Juvans, secourable (nom commun entre elle et Jupiter) ; on la nommait aussi la reine.
Plusieurs pays se disputaient l’honneur de l’avoir vue naître : Samos surtout, et Argos où elle était honorée d’un culte particulier. dit qu’elle fut élevée par Océan et par Téthys sa femme. D’autres disent qu’elle le fut par les filles du fleuve Astérion ; d’autres enfin, par les Heures.
Dans le temps des princes Titans, on suivait encore quelques usages des premiers patriarches ; et Jupiter, à l’exemple de son père et de son aïeul, épousa sa sœur Junon. Les noces furent célébrées dans le pays des Gnossiens, près du fleuve Thérène. Du temps de , on y voyait encore le temple de Junon, entretenu par les prêtres du pays, et tous les ans on y rappelait la cérémonie de ce mariage.
Jupiter, pour rendre ses noces plus solennelles, chargea Mercure d’y inviter tous les dieux, tous les hommes et tous les animaux. La nymphe Chéloné dédaigna de s’y trouver. Mercure la précipita dans un fleuve, et la changea en tortue, pour qu’elle gardât un éternel silence. Le mot grec chelonè signifie une tortue, et cet animal était regardé par les anciens comme le symbole du silence.
Junon eut trois enfans : Hébé, déesse de la jeunesse, qui servait le nectar aux dieux avant l’enlèvement de Ganymède. La fable dit qu’une chute qu’elle fit dans le ciel fit oublier aux dieux leur gravité ; ce qui décida Jupiter à prendre un échanson. Mars, son second fils, fut conçu par la vertu d’une fleur. Junon, jalouse de ce que Jupiter avait enfanté de son cerveau Minerve, déesse de la sagesse, voulut produire quelque chose d’aussi surprenant. Elle consulta la déesse Flore, qui lui dit que dans les champs d’Olène il existait une fleur qui produirait l’effet qu’elle désirait dès qu’elle l’aurait touchée. Junon en fit l’essai, et mit au monde Mars, dieu de la guerre. Vulcain fut le troisième fils de Junon. Jupiter le précipita du ciel à cause de sa difformité. Nous donnerons par la suite son histoire, ainsi que celle de Minerve et de Mars. Nous allons nous arrêter à faire connaître ce que l’on a voulu figurer par les naissances extraordinaires de Minerve et de Mars.
La fable dit que Jupiter sentit une très-grande douleur dans son cerveau, et que Minerve, sa plus noble production, en sortit toute formée et armée, sans avoir passé par l’état de l’enfance. Elle ajoute qu’il se fit donner un coup de hache par Vulcain. Cette fable est allégorique, et signifie que l’on ne parvient point sans effort à la sagesse : ce qui a été figuré par le coup de hache et par la douleur que ressentit Jupiter. On a voulu faire connaître en même temps que Jupiter étant le plus sage et le plus grand des dieux, la déesse de la sagesse était sortie de son cerveau dans toute sa perfection.
La naissance du dieu de la guerre a une tout autre origine, quoiqu’elle soit de même une allégorie. Junon, déesse altière et jalouse, déclara souvent la guerre à Jupiter ; elle prit même parti contre lui dans la guerre des Titans. Elle était implacable dans sa colère ; le pouvoir de se venger était celui qu’elle chérissait le plus : voilà ce qui fit dire que le dieu de la guerre était son fils. Son origine, tirée d’une fleur, est une seconde allégorie, pour peindre la promptitude avec laquelle Junon s’irritait. Le moindre mécontentement excitait sa vengeance ; le refus d’une fleur était à ses yeux une offense assez grave pour attirer sa haine et ses poursuites. Son orgueil et sa jalousie se firent cruellement sentir après que le berger Pâris lui eut préféré Vénus, lorsqu’il fut chargé de donner à la plus belle la pomme jetée par la Discorde. Pâris était fils de Priam, roi des Troyens. Ce titre devint la cause des persécutions de Junon contre Énée et les malheureux Troyens qu’il conduisait avec lui. Toutes les femmes aimées par Jupiter, ainsi que leurs enfans, devinrent les objets de son implacable colère.
Tant de haines et de vengeances lassèrent Jupiter, et le portèrent à punir Junon d’avoir pris parti contre lui dans la guerre des Titans. Il la fit suspendre au milieu de l’air par deux pierres d’aimant : et, après lui avoir fait lier les mains derrière le dos, il fit attacher deux enclumes sous ses pieds. Vulcain fut chargé de cette commission qu’il exécuta volontiers pour se venger de ce qu’elle l’avait mis au monde tout contrefait. Les dieux ne purent la tirer de ses entraves. Il fallut recourir à Vulcain, qui, pour récompense, exigea qu’on le mariât avec Vénus, la plus belle des déesses.
Cette punition ne corrigea point Junon ; s’étant aperçue que Jupiter aimait la nymphe Io, fille d’Inachus et d’Ismène, elle en fit l’objet de ses vengeances. Jupiter, pour soustraire cette nymphe à la connaissance de Junon, la métamorphosa en vache. La ruse ne put tromper la déesse ; elle demanda impérieusement que cette vache lui fût confiée, et Jupiter n’osa la refuser. Junon la mit sous la garde d’Argus, qui avait cent yeux. Cet espion de la déesse ne pouvait être surpris, parce que cinquante de ses yeux restaient ouverts pendant que l’autre moitié se livrait au sommeil (image parfaite de la jalousie). Cependant Mercure, à la demande de Jupiter, trouva moyen d’endormir entièrement Argus par les sons de sa flûte, et le tua pendant son sommeil.
Junon, pour récompenser Argus, le métamorphosa en paon, et voulut que ses yeux restassent empreints sur son plumage. Cet oiseau lui fut spécialement consacré ; on la représentait souvent sur un char traîné par deux paons.
La mort d’Argus ne débarrassa point la malheureuse Io des persécutions de Junon. La déesse fit sortir de la terre un taon qui poursuivait sans cesse la fille d’Inachus. Désespérée de ses tourmens perpétuels, elle s’élança dans la mer, passa la Méditerranée à la nage, et vint aborder dans l’Égypte, où elle reprit sa première forme. Elle eut un fils nommé Épaphus.
Le culte que les Égyptiens rendaient à la déesse Iris, sous la forme d’une vache, a sûrement donné lieu à cette fable ; et la manière dont Io traversa la Méditerranée ne put être autre chose qu’un voyage par mer.
Mercure était le messager de Jupiter ; Junon choisit Iris pour remplir le même emploi auprès d’elle, et, pour la récompenser, elle la plaça dans le ciel sous la forme de l’arc-en-ciel.
Les enfans de Cadmus, frère d’Europe, enlevée par Jupiter, furent les déplorables victimes de la jalousie de Junon. Ino, la première des quatre filles de ce prince, après avoir épousé Athamas, fut tellement maltraitée par Junon, qu’elle se précipita dans la mer avec son fils Polycerte, que depuis on honora comme dieu des ports, sous le nom de Palémon. Agavé, femme d’Echion, vit déchirer son fils Panthée par les Bacchantes. Autonoé, femme d’Aristée, eut la douleur de voir Actéon, son fils, changé en cerf, et dévoré par ses propres chiens ; ce jeune prince, guidé par Junon, ou par un hasard funeste, avait surpris Diane pendant qu’elle était au bain. Enfin Sémélé, fille de Cadmus, ayant cédé au conseil que lui fit donner Junon d’exiger de Jupiter qu’il se fît voir à elle dans toute sa gloire, fut consumée par les rayons qui l’environnaient. Tels furent les cruels moyens par lesquels Junon se vengea de la beauté d’Europe, et du pouvoir qu’elle avait eu de plaire à Jupiter.
Égine, fille d’Asope, reine du pays d’Égine, devint funeste à son pays. Junon fit périr tous les habitans de cette contrée par une horrible peste, parce qu’Égine avait inspiré de la tendresse à Jupiter. Éacus, fils d’Égine pria Jupiter, son père, de repeupler le pays ; ce dieu fit sortir d’un vieux chêne de la forêt de Dodone une immense quantité de fourmis, qui sur-le-champ furent métamorphosées en hommes. Les Grecs, qui suivirent Achille à la guerre de Troie, prétendaient descendre de ces fourmis. On les nommait Myrmidons, mot qui vient du mot myrmex, fourmi.
La manière la plus ordinaire de représenter Junon était sous la figure d’une femme assise sur un trône, tenant un sceptre dans une de ses mains, dans l’autre un fuseau, et portant sur sa tête une couronne radiale. (Fig. 8.) On la représente aussi quelquefois avec un arc-en-ciel autour de la tête. Junon, dans son temple d’Argos, avait une statue d’or et d’ivoire d’une grandeur extraordinaire, au-dessus de laquelle on voyait les Grâces et les Heures. Cette déesse présidait principalement aux empires et aux richesses ; elle les offrit vainement à Pâris, pour qu’il la préférât à Vénus, et lui donnât la pomme. Elle présidait aussi aux parures des femmes.
Lorsqu’elle présidait aux accouchemens on la nommait Lucine ; et lorsqu’on la représentait remplissant cette fonction, on la voyait assise, tenant d’une main un enfant emmaillotté, et une fleur dans l’autre, ou bien avec un fouet et un sceptre. Pendant les fêtes appelées Lupercales, les femmes désiraient être frappées avec ce fouet.
A Rome, elle avait un temple auguste sous le nom de Matuta, un autre à Samos sous celui de Samia : quelquefois on la nommait la Terre, comme on donnait à Jupiter le nom de pluie ou d’air, parce que l’un et l’autre causent la fertilité de la terre.
De toutes les divinités du paganisme, il n’y en avait point dont le culte fût plus solennel et plus répandu. Les prodiges qu’elle avait opérés, et ses vengeances lorsqu’on l’avait oubliée ou lorsqu’on avait osé se comparer à elle, avaient inspiré tant de crainte et de respect, qu’on n’oubliait rien pour l’honorer et la fléchir ; de sorte que son culte était presque plus général que celui de Jupiter. On le trouvait dans l’Europe, l’Asie, l’Afrique, et surtout dans la Syrie et dans l’Égypte ; mais il faut remarquer que la Junon d’Égypte était la même qu’Iris et Astarté.
Les oisons, l’épervier et le paon étaient particulièrement consacrés à Junon. Chez les Égyptiens, c’était le vautour. Parmi les plantes, on lui offrait la dictame et les pavots. Dans les sacrifices, un agneau femelle était la victime la plus ordinaire qu’on lui sacrifiait.
Le respect pour cette déesse allait si loin, que chacun ayant son génie, celui des femmes se nommait Junon.
Cléobis et Biton, deux frères célèbres par leur piété, s’attachèrent au char de leur mère, un jour où elle devait aller au temple de Junon. Ils la traînèrent pendant un trajet de quarante stades. Cette mère reconnaissante pria Junon de les récompenser dignement de leur piété. Après avoir offert leur sacrifice, ils allèrent prendre leur repas, et s’endormirent paisiblement. La mort vint les surprendre pendant leur sommeil. Depuis ce temps, les habitans d’Argos regardèrent la mort comme le repos le plus parfait et le plus grand des biens. Ils élevèrent à Cléobis et à Biton deux statues, qui les représentaient traînant le char de leur mère.
Histoire d’Hymen ou Hyménéus et autres dieux du mariage. §
A la suite de l’histoire de Junon Lucine, nous croyons devoir placer celle d’Hymen. Ce fut pour consacrer son souvenir et lui rendre un culte, que les Grecs donnèrent le nom d’hyménée aux fêtes du mariage. On rapporte qu’il y avait à Athènes un jeune homme d’une extrême beauté, mais fort pauvre, et d’une naissance obscure. Son nom était Hyménéus. Il aimait une Athénienne d’une naissance supérieure à la sienne. Un jour qu’elle devait aller avec les femmes d’Athènes, célébrer, en l’honneur de Cérès, sur les bords de la mer, une fête dont les hommes étaient exclus, Hyménéus se travestit en femme, et se mêla parmi le cortége. Pendant la fête, des corsaires surprirent les femmes et les enlevèrent. La vue des vins apportés pour cette fête excita leur avidité : ils en burent jusqu’à l’ivresse ; et la chaleur du vin leur troubla tellement le cerveau qu’ils s’endormirent.
Hyménéus, rempli de courage, se fit alors reconnaître ; il exhorta les femmes à le seconder : elles s’emparèrent des armes de leurs ravisseurs endormis, et les égorgèrent. Après cette exécution, Hyménéus courut à Athènes, déclara ce qu’il avait fait pour la délivrance des dames athéniennes, et demanda pour récompense d’être uni à celle qu’il aimait (grâce qui lui fut accordée). Les Athéniens, en mémoire de cet heureux mariage et de cet événement, invoquèrent depuis Hyménéus, et célébrèrent des fêtes en son honneur. Pour donner de l’éclat à sa naissance inconnue, on publia qu’il était fils du dieu du Jour et de la muse Calliope.
On représentait toujours ce dieu sous la figure d’un beau jeune homme couronné de fleurs et de marjolaine, tenant de sa main droite un flambeau, et de sa gauche un voile couleur de feu, ou d’un jaune clair.
Quoique les Romains eussent adopté cette divinité des Grecs, ils voulurent avoir aussi leur dieu du mariage. Un événement à peu près semblable à celui que nous venons de raconter étant arrivé lors de l’enlèvement des Sabines, Thalassius, le héros de cette aventure, reçut les mêmes honneurs qu’Hyménéus. Les Romains honoraient encore deux autres dieux du mariage, Jugatinus et Domiducus.
Histoire de Cérès. §
L’histoire et la fable de Cérès tiennent à celles des dieux des enfers ; mais nous croyons devoir les rapporter en partie, pour faciliter davantage la connaissance de la famille des Titans. La même raison nous fera donner, à sa suite, quelques détails sur Atlas et ses filles.
Cérès (fig. 9) était fille de Saturne et de Cybèle : on la regarde comme la première inventrice de l’art de cultiver la terre. Pluton, son frère, lui ayant enlevé sa fille Proserpine pour la transporter dans les enfers (c’est-à-dire dans l’Espagne), Cérès se plaignit de cet enlèvement à Jupiter. Ce dieu décida qu’elle irait aux enfers redemander sa fille, et que Pluton serait forcé de la rendre, pourvu qu’elle restât sans boire et sans manger pendant le séjour qu’elle y ferait. Malheureusement, elle avait déjà sucé quelques grains de grenade : Ascalaphe la dénonça ; ce qui irrita tellement Cérès, qu’elle lui jeta de l’eau du Phlégéton sur le visage, et aussitôt Ascalaphe fut métamorphosé en hibou, oiseau qui annonce les malheurs. Minerve le prit depuis sous sa protection, parce qu’il veille et distingue les objets pendant la nuit (allégorie qui convient parfaitement à la sagesse, toujours en garde contre la surprise).
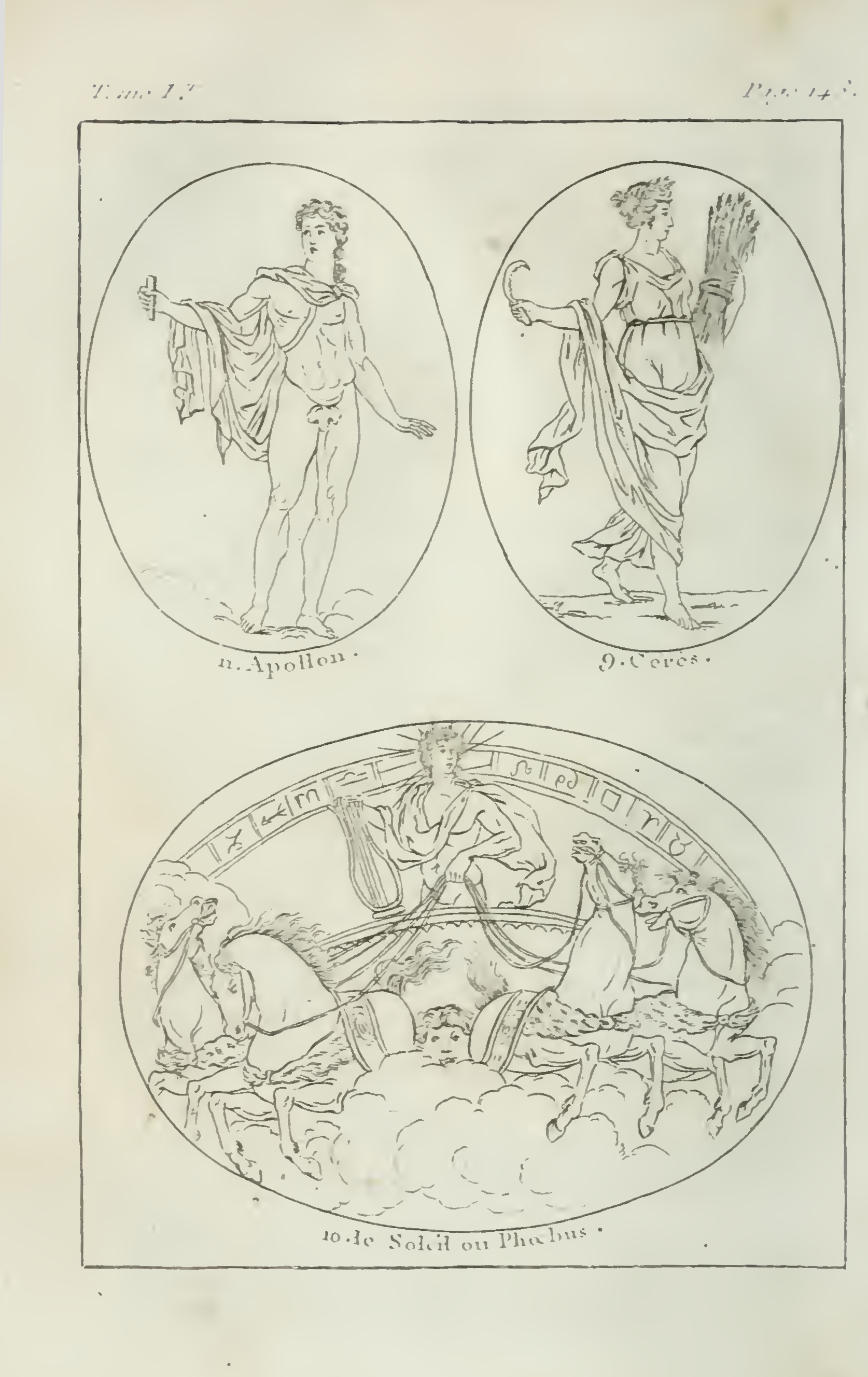
En cherchant le sens de-cette fable, on trouve que les conseils d’Ascalaphe déterminèrent Proserpine à recevoir Pluton pour époux ; ce que Cérès vit avec douleur. Ascalaphe devint l’objet de sa vengeance ; mais il paraît que sa prudence et sa sagesse engagèrent Minerve à le prendre sous sa protection.
Jupiter, voulant apaiser et consoler Cérès, permit à Proserpine de passer seulement une moitié de l’année dans les enfers, et l’autre moitié dans le ciel. Ce partage de l’année peut s’expliquer de deux manières différentes : souvent Proserpine était prise pour la lune, et l’on voulait exprimer par cette fable le temps où elle paraît à la vue de la terre, et le temps où elle disparaît. On l’explique encore plus naturellement en disant que le roi Jupiter lui permit de passer une partie de l’année dans le royaume de Pluton, et l’autre partie dans le séjour ordinairement habité par Cérès sa mère.
Nous ne multiplierons point trop les explications des fables ; mais nous croyons utile de citer quelques exemples, dans le dessein d’accoutumer nos lecteurs à faire usage de la sagacité de leur esprit ; et nous avons l’espoir que nous serons très-souvent surpassés par eux dans ce genre de travail et de recherches.
La fontaine Aréthuse, qui coulait sous la terre, fut témoin de l’enlèvement de Proserpine par Pluton ; elle en avertit Cérès, qui courait le monde avec deux flambeaux à la main pour retrouver sa fille.
Aréthuse, fille de Nérée et de la nymphe Doris, avait été métamorphosée en fontaine par Diane, dont elle était nymphe. Cette déesse eut recours à cette métamorphose pour soustraire Aréthuse aux poursuites du fleuve Alphée. Nous avons précédemment donné l’explication de cette fable.
Nous n’étendrons pas plus loin l’histoire de Cérès ; on la retrouvera lorsque nous parlerons des dieux des enfers.
rapporte qu’après la mort d’Hypérion, les enfans d’Uranus partagèrent entre eux le royaume. Les deux plus célèbres de ces enfans furent Saturne et Atlas. Les lieux maritimes furent le partage d’Atlas. Ses sujets furent nommés Atlantes, et son nom fut aussi donné à la plus haute montagne du pays. Il excellait dans l’astronomie. Ce fut lui qui le premier représenta le globe de la terre par une sphère ; ce qui fit imaginer la fable dans laquelle on dit qu’il soutenait le monde sur ses épaules. Il eut plusieurs enfans. Hespérus fut le plus remarquable par sa piété et sa bonté. Un jour qu’il était monté jusqu’au plus haut du mont Atlas, il fut emporté par un coup de vent, et son corps ne put être retrouvé. Le peuple, touché de son sort, et se souvenant de ses vertus, crut qu’il avait été enlevé par les dieux, et lui accorda les honneurs divins. Pour conserver son nom, on le donna à la plus brillante des planètes.
Atlas eut sept filles très-célèbres, qui furent appelées Atlantides, mais dont les véritables noms étaient Maïa, Électre, Taygète, Astérope, Mérope, Alcyone, et Céléno. Elles furent aimées par les héros les plus illustres ; elles en eurent des enfans qui, par la suite, égalèrent leurs pères, et furent les chefs de grands peuples. Maïa, l’aînée des sept, eut de Jupiter, Mercure, l’inventeur des arts. Les Grecs faisaient descendre presque tous leurs héros des Atlantides. Après leur mort, on les honora comme les déesses, et on les plaça dans le ciel sous le nom de Pleïades. Elles se nommèrent aussi Hespérides, du nom de leur mère Hespéris.
La grande réputation de leur beauté porta Buziris, roi d’Espagne, à les faire enlever par des pirates qu’il envoya dans le pays quelles habitaient. Ces pirates les surprirent dans un jardin, se saisirent d’elles, et s’apprêtaient à les embarquer, lorsque les cris de ces jeunes princesses furent entendus par Hercule, qui se trouvait alors sur le rivage. Il courut à leur secours, vainquit facilement ces lâches ravisseurs, et rendit les Atlantides à leur père Atlas, qui, par reconnaissance, lui donna les pommes d’or du jardin des Hespérides, que le héros venait conquérir par ordre d’Eurysthée, roi de Mycènes.
Ces pommes d’or étaient probablement des oranges très-peu communes alors, et qu’Atlas faisait garder soigneusement par des dogues ; ce qui donna lieu à la fable qu’elles étaient d’or et gardées par un dragon.
Atlas ne borna pas sa reconnaissance à ce faible présent ; il instruisit Hercule dans l’astronomie, et ce héros s’acquit la plus grande gloire en apportant le premier dans la Grèce la science de la sphère. Ce fut à ce sujet qu’on publia qu’Atlas, pour se reposer quelque temps, l’avait prié de se charger du fardeau du monde.
Le mont Atlas est si élevé, qu’il semble toucher au ciel : son sommet se perd dans les nues ; et les poëtes, confondant cette montagne avec le prince dont elle portait le nom, peignirent Atlas comme le soutien du monde.
Ce fut aussi pour désigner cette montagne, que les poëtes, dans l’histoire de Persée, dirent que ce prince avait métamorphosé Atlas en rocher, en lui présentant la tête de Méduse.
Les Hyades passaient aussi pour être les filles d’Atlas. On en nomme six : Eudore, Ambrosie, Prodite, Coronis, Phyleto et Polyxo ; d’autres y ajoutent Thyone. Le mot grec hyade signifie pluvieux. Il paraît que ces prétendues filles d’Atlas étaient des personnages poétiques, qui représentaient des étoiles découvertes par Atlas, comme on donne aujourd’hui le nom d’Herschell à la planète nouvellement découverte par ce célèbre astronome.
On comptait ordinairement trois Atlas : le premier était roi d’Italie, le second régna dans l’Arcadie, et le troisième était celui dont nous venons de parler. Voilà pourquoi ce dernier se trouve dans l’histoire d’Hercule et de Persée, héros très-postérieurs aux premiers princes Titans. Il paraît aussi qu’Atlas eut un frère nommé Hespérus, et qu’il faut le distinguer de celui qui fut emporté par un coup de vent. Ce second Hespérus vint s’établir dans l’Occident ; et c’est d’après lui que les Grecs appelèrent Hespéries toutes les régions occidentales de la Grèce.
Histoire du Soleil. §
Les Grecs et les Romains confondaient presque toujours le Soleil avec Apollon. assure qu’il est le même que le Soleil. dit que le Soleil et la lune sont deux, divinités, dont l’une s’appelle Apollon, et l’autre Diane. dit la même chose. Malgré ces autorités, les marbres d’Arundel et tous les anciens monumens prouvent qu’il faut distinguer l’un de l’autre.
On peint toujours Apollon sous la figure d’un jeune homme qui tient un arc ou une lyre à la main, tandis que le soleil est représenté avec la tête environnée de rayons, tenant un globe d’une main (fig. 10) ; ce que l’on n’observe jamais dans les représentations d’Apollon. Le culte du Soleil est le premier de tous les cultes idolâtres ; nous l’avons déjà désigné sous le nom de Sabisme. Les Égyptiens, les Phéniciens, les Arabes, les Perses, adoraient le Soleil long-temps avant que l’Apollon des Grecs fût connu.
Tous les peuples de l’Orient l’adoraient ; les Chaldéens et les Phéniciens, sous le nom de Bélus ; les Égyptiens, sous celui d’Osiris et d’Horus son fils ; les Ammonites, sous celui de Moloch ; les Perses, sous celui de Mithras ; les seuls Grecs et les Romains confondirent ensemble ces deux divinités.
Le soleil était particulièrement adoré dans l’île de Rhodes. Ses habitans lui élevèrent une statue colossale de cent pieds de hauteur, faite avec de l’airain. Elle était une des sept merveilles du monde, et fut renversée par un tremblement de terre. L’histoire dit que les Sarrasins ayant pris cette île, chargèrent neuf cents chameaux des seuls débris de cette statue.
L’antiquité nous a conservé les noms des quatre chevaux qui traînaient le char du Soleil. les nomme Eoüs, Pyroïs, Aéthon et Phlégon, noms grecs qui signifient le rouge, le lumineux, le resplendissant, et qui aime la terre. Le premier désigne le lever du soleil, dont les rayons sont rouges à cet instant ; le second marque le moment où les rayons sont plus clairs ; le troisième figure le midi, temps où cet astre est dans tout son éclat ; et le quatrième représente le coucher du soleil ; on le voit alors se rapprocher de la terre.
Le Soleil préside aux douze signes du zodiaque, et chacun de ces signes répond à un mois de l’année ; de sorte que le soleil les parcourt tous pendant le courant de l’année ; ce qui les a fait appeler les douze maisons du soleil.
Mars, signe du Bélier. Il représente celui sur lequel Phryxus et Hellé s’enfuirent pour échapper aux persécutions de leur marâtre.
Avril, signe du Taureau. Il représente celui dont Jupiter prit la forme pour enlever Europe.
Mai, signe des Gémeaux. Ils représentent Castor et Pollux, fils de Jupiter et de Léda.
Juin, signe de l’Écrevisse. On croit qu’elle représente celle qui vint piquer Hercule tuant l’hydre de Lerne.
Juillet, signe du Lion. Il représente celui de la forêt de Némée, tué par Hercule, et dont la peau lui servait de manteau.
Août, signe de la Vierge ou Astrée. Pendant le siècle d’or, elle habitait la terre ; mais lorsqu’il fut fini, ne pouvant supporter la vue des crimes que les hommes commettaient, elle remonta dans le ciel avec les autres dieux ; elle fut la dernière à quitter la terre, et se retira dans la partie du ciel qui fait le signe de la Vierge.
Septembre, signe de la Balance. Elle représente la Justice, dont la balance doit toujours être parfaitement égale. Elle signifie aussi que dans ce mois les jours sont égaux aux nuits.
Octobre, signe du Scorpion. Il représente Orion, que Diane métamorphosa en cet animal.
Novembre, signe du Sagittaire. Il représente le centaure Chiron, qui tirait de l’arc. Il avait été le maître d’Hercule, et ce héros reconnaissant l’aimait beaucoup, mais, dans le combat des Lapithes contre les Centaures, Hercule le blessa involontairement avec une de ses flèches qui avait été trempée dans le sang de l’hydre. Cette blessure causa au centaure Chiron des douleurs si cruelles, qu’il désira de mourir, quoique immortel. Les dieux, touchés de ses plaintes, lui accordèrent sa demande. Il mourut, fut enlevé dans le ciel et placé parmi les signes du zodiaque.
Décembre, signe de la Chèvre. Elle représente la chèvre Amalthée, ou la princesse Mélisse, qui avait eu soin de l’enfance de Jupiter,
Janvier, signe du Verseau. Il représente Ganymède versant le nectar à Jupiter et aux dieux. Il désigne aussi les pluies abondantes qui tombent pendant ce mois.
Février, signe des poissons. Il représente les dauphins qui conduisirent Amphitrite à Neptune.
On ne se bornait point à l’astronomie ; le désir de pénétrer dans l’avenir fît imaginer l’astrologie, science mensongère, dont l’ignorance était la dupe, et dont l’avarice de ceux qui l’exerçaient savait tirer de grands profits. Les astrologues, pour se donner plus d’importance, prétendaient que chacun des signes du zodiaque répondait à une partie du corps humain.
Parmi les personnages placés au nombre des signes du zodiaque, il faut remarquer Orion, dont nous allons donner la fable,
Jupiter, Neptune et Mercure, faisant ensemble le tour de la terre, allèrent loger chez un certain Œnopéus ou Hyrieus : non-seulement cet homme les reçut très-bien ; mais, pour les régaler, il tua le seul bœuf qui lui restait. Les dieux, admirant le bon cœur et la générosité de cet honnête homme, lui dirent qu’il obtiendrait tout ce qu’il voudrait leur demander. Il voulut avoir un fils sans être obligé de prendre une femme. Sa demande lui fut accordée ; les trois dieux firent naître Orion dans la peau de ce même bœuf qui avait été tué pour servir à leur repas. Ils le formèrent avec de la terre détrempée dans de l’eau. Orion devint un grand chasseur. Un serpent l’ayant blessé, Diane, déesse de la chasse, le changea en la constellation qui porte son nom.
On croit qu’Orion était disciple d’Atlas, et qu’il apporta dans la Grèce la connaissance des mouvemens des cieux ; ce qui porta les Grecs à le placer au nombre des signes du zodiaque.
On attribuait plusieurs enfans au Soleil : Eéthès et Pasiphaé passaient pour être ses filles, ainsi que Rhodia, qui tira son nom de l’île de Rhodes. Les poëtes disent que le jour de sa naissance il tomba une pluie d’or, et que les rosiers de Rhodes furent couverts de fleurs nouvelles.
Parmi les enfans du Soleil, Aurore et Phaéton sont les deux plus célèbres.
Aurore ouvre tous les matins les portes du ciel ; elle précède son père, et annonce son retour. Un jour elle enleva Tithon, fils de Laomédon, et pria les dieux de le rendre immortel. Ils cédèrent à sa demande ; mais elle ne put obtenir qu’il ne vieillirait point. Tithon, sûr de l’immortalité, ne songea qu’au bonheur qu’il trouvait auprès d’Aurore ; il oublia que le temps a des ailes, et qu’il entraîne dans sa course la beauté, la jeunesse. Ses ravages ne pouvaient atteindre Aurore, douée de tous les attributs des dieux, tandis que chaque jour, chaque instant précipitait Tithon vers la vieillesse. Les dégoûts qui l’accompagnent lui rendirent la vie insupportable ; il implora de nouveau le crédit d’Aurore auprès des dieux ; l’immortalité n’était plus pour lui qu’un douloureux fardeau. Aurore en eut pitié, et le fit changer en cigale.
Cette jolie fable des Grecs est une allégorie dont le but est de nous avertir que nous formons beaucoup de vœux indiscrets, et que, s’ils étaient tous exaucés, nous ne ferions souvent qu’éterniser nos malheurs et nos regrets.
De l’union de Tithon avec Aurore naquit Memnon, qui secourut Priam dans la guerre de Troie. Il fut tué par Achille, et sa mère fit sortir de son bûcher des oiseaux que, depuis, on a nommés Memnonides.
Aurore fit un second enlèvement qui eut des suites cruelles. Céphale venait d’épouser Procris : leur tendresse était mutuelle, et rien ne manquait à leur bonheur. Le plaisir de la chasse entraînait souvent Céphale au milieu des bois avant que le jour parût. Aurore le surprit, et l’enleva dans son char. La vue de la déesse ne l’empêcha pas de se livrer à tout le désespoir que lui causait sa séparation d’avec Procris. Aurore le renvoya sur la terre, et lui fit don d’un javelot qui ne manquait jamais le but vers lequel on le lançait. L’amour de la chasse conduisit de nouveau Céphale au milieu des forêts ; son épouse s’alarma de ses fréquentes absences, et craignit d’avoir de nouvelles rivales parmi les nymphes, ou même parmi les déesses. Elle alla se cacher au milieu d’un épais feuillage, pour observer les démarches de son époux. Un mouvement involontaire, qui causa quelque bruit, trompa Céphale ; le javelot fatal fut lancé, et perça le cœur de la malheureuse et tendre Procris.
Histoire de Phaéton. §
La chute du téméraire Phaéton, fils du Soleil, a trop de célébrité pour la taire. Epaphus, fils de Jupiter et de la nymphe Io, lui ayant un jour disputé l’honneur d’être fils du Soleil, Phaéton, irrité de cette injure, consulta sa mère Climène, qui lui conseilla d’aller au palais de son père demander des preuves de sa naissance. Le Soleil ayant juré par le Styx qu’il ne refuserait aucune de ses demandes, l’imprudent Phaéton exigea que, pendant un jour seulement, il lui confiât la conduite du char qui porte la lumière. Le dieu du jour, ne pouvant plus refuser, fut forcé de céder, et donna vainement des conseils au téméraire ; les chevaux sentirent bientôt la faiblesse de la main qui les conduisait : ils s’écartèrent du juste milieu qu’ils devaient tenir dans leur course ; ils embrasèrent le ciel et la terre. Jupiter foudroya Phaéton, et le précipita dans l’Éridan. Les Héliades, ses inconsolables sœurs, furent changées en peupliers, et leurs larmes en gouttes d’ambre. Cygnus, son frère, mourut de douleur, et fut métamorphosé en cygne.
La fable de Phaéton paraît être une allégorie, pour peindre un jeune ambitieux qui fait une entreprise au-dessus de ses forces. On trouve cependant un véritable Phaéton, grand astronome, qui régna sur le pays des Molosses, et se noya dans le Pô.
Histoire et fable d’Apollon. §
Jupiter ayant abandonné Junon pour Latone, en eut deux enfans, Apollon et Diane. Avant leur naissance, Junon suscita contre sa rivale un effroyable serpent, que l’on nomma Python. Ce monstre, disent les poëtes, avait été formé avec le limon laissé sur la terre par les eaux du déluge.
Cette fable ressemble beaucoup à celle du serpent produit par les exhalaisons pestilentielles du Nil ; et tout porte à croire que les Grecs ont imaginé leur Apollon d’après Horus, fils d’Osiris, que les Égyptiens confondaient avec le Soleil.
Nous allons donner la fable d’Apollon, telle que les poëtes nous l’ont transmise.
Junon, poursuivant partout sa rivale, obtint de la Terre qu’elle ne lui donnerait aucun asile ; Latone, dont le nom signifie caché se réfugia dans l’Archipel, sur une île flottante que la mer couvrait souvent de ses eaux. Elle se nommait Délos. Neptune, par pitié pour Latone, fit surnager cette île, et la rendit stable. Ce fut là qu’elle mit au monde Apollon et Diane. La crainte de Junon l’empêcha de s’y fixer ; elle fuyait sans cesse d’un lieu dans un autre. Un jour qu’elle parcourait la Lycie, elle arriva près d’un marais où des paysans travaillaient. Épuisée de fatigue et de soif, elle leur demanda de l’eau pour se désaltérer. Vous me conserverez la vie, leur dit-elle ; mais les Lyciens, inspirés par Junon, lui refusèrent ce léger secours, et l’insultèrent. Latone, indignée, les métamorphosa en grenouilles, pour les punir de leur brutale inhumanité.
Nous ne donnerons point l’histoire suivie de Latone et d’Apollon ; elle se trouve dans toutes les poésies anciennes et modernes. Nous nous bornerons à faire connaître les traits principaux et les fables les plus intéressantes.
Apollon portait beaucoup de noms différens. Il se nommait Délius, à cause de l’île de Délos, où il avait pris naissance ; Phœbus, pour faire allusion à la lumière du soleil (Phoïbos signifie clair, pur) ; Pythius, à cause de sa victoire sur le serpent Python, victoire qu’il faut attribuer au soleil, qui, en éclairant la terre et desséchant le limon, fait périr les reptiles venimeux. On le nommait Actiacus, à cause du promontoire d’Actium, si célèbre par la victoire qui rendit Auguste maître de Rome et du monde ; Palatinas, parce qu’Auguste lui fit bâtir sur le mont Palatin un temple auquel il joignit une bibliothèque.
Apollon fut banni du ciel pour avoir mis à mort, à coup de flèches, les Cyclopes qui forgeaient les foudres de Jupiter. La fable rapporte à ce sujet qu’Esculape, fils d’Apollon, avait si bien réussi dans la médecine, sous la conduite de son père et celle du centaure Chiron, qu’il était parvenu à ressusciter Hippolyte, fils de Thésée, dont nous rapporterons l’histoire à l’article des héros. Jupiter, irrité qu’un mortel usurpât ses droits, foudroya le médecin trop habile. Apollon, ne pouvant se venger sur Jupiter lui-même, tua les Cyclopes à coups de flèches.
Rien n’était plus redoutable que ces flèches d’Apollon ; il s’en servit avec plus de justice contre le serpent que Junon avait suscité contre Latone et contre lui. La défaite de ce monstre donna lieu à l’établissement des jeux Pythiens, si connus dans la Grèce. On les célébrait tous les quatre ans. Pendant ces jeux, on s’exerçait à chanter, à danser et à jouer des instrumens ; le vainqueur obtenait une couronne de laurier.
Il est nécessaire de faire connaître l’idée que les Grecs, et généralement les anciens, avaient des flèches d’Apollon. Elles représentaient les rayons du soleil. On leur reconnaissait un si grand pouvoir, qu’on leur attribuait toutes les morts subites. en avait cette opinion, avec cette différence que la mort des femmes lui paraissait une vengeance de Diane, ou de la Lune, et celle des hommes une vengeance d’Apollon, ou du Soleil. L’histoire des enfans de Niobé, tués par Apollon et Diane, prouve combien l’on croyait à l’influence du soleil et de la lune.
La fière Niobé, piquée de ce que l’on rendait à Latone un culte religieux, tandis qu’on la délaissait, quoique par sa naissance et le grand nombre de ses enfans elle crut mériter le même honneur, courut à Thèbes, et fit tous ses efforts pour interrompre les sacrifices que l’on offrait à Latone. Cette injure attira sur elle la colère d’Apollon et de Diane ; ils percèrent avec leurs flèches les enfans de Niobé, pendant qu’ils faisaient leurs exercices dans les plaines voisines de Thèbes,
Nous allons expliquer cette fable, en la rapprochant de l’histoire. Niobé, fille de Tantale et sœur de Pélops, suivit son frère lorsqu’il passa dans la partie de la Grèce qui prit de lui le nom de Péloponèse. Elle épousa Amphion, prince célèbre par son éloquence. Il venait de faire construire les murailles de Thèbes, en persuadant à ses sujets qu’ils devaient sacrifier quelques portions de leurs biens pour mettre leur ville eu état de défense. Le même prince, amateur de la musique, avait ajouté trois cordes aux quatre que la lyre avait auparavant. Ces deux circonstances réunies firent publier qu’il avait bâti les murailles de Thèbes au son de sa lyre.
Le mariage d’Amphion et de Niobé fut très-heureux par sa fécondité : ils eurent quatorze enfans ; mais une peste cruelle ayant ravagé le pays, ils périrent tous ; et, comme on attribua cette peste à une chaleur extrême que la nuit même ne pouvait tempérer, on imagina la fable de leur mort, telle que nous l’avons rapportée plus haut. C’est par une suite de cette même opinion, qu’
a dit que la peste survint dans le camp des Grecs aussitôt qu’Apollon eut lancé ses flèches
. Toute les fois qu’on voulait peindre Apollon irrité, on le représentait armé de ses flèches ; et, pour exprimer qu’il était apaisé, on mettait une lyre dans sa main. Pendant les maladies contagieuses, on plaçait des branches de laurier devant sa maison, dans l’espoir que le dieu épargnerait ceux qui rendaient cet honneur à la nymphe Daphné qu’il avait aimée, et qui avait été métamorphosée eu laurier.
dit que les enfans de Niobé restèrent sans sépulture pendant neuf jours
; mais que les dieux, après ce terme, les ensevelirent eux-mêmes. L’histoire dit que ces princes étant morts de la peste, ou fut long-temps sans oser les approcher. Les Thébains, effrayés pour eux-mêmes, parurent insensibles aux malheurs de la reine, ce qui fit dire qu’ils avaient été changés en pierres. Cependant quelques hommes plus dévoués leur donnèrent la sépulture, et, pour flatter le désespoir de Niobé, on publia que les dieux les avaient enterrés. Amphion mourut presque aussitôt de chagrin ou de la peste. Niobé, que rien ne pouvait plus consoler, retourna dans la Lydie, au pied du mont Sypile, où le chagrin termina bientôt ses jours. On publia qu’elle avait été changée en rocher, parce que l’excès de ses peines, la rendant en quelque sorte immobile, ne lui laissait plus même la force de faire entendre ses plaintes.
Jupiter vengea la mort des Cyclopes en exilant Apollon du ciel (c’est-à-dire du royaume dont il lui avait confié le gouvernement) ; la cour d’Admète lui servit d’asile : ce prince le reçut favorablement, et lui donna la souveraineté de la partie de ses états qui était située sur les bords du fleuve Amphrise. Dans ces temps reculés, les noms de pasteur et de roi étaient souvent synonymes. La fable peignit Apollon homme le pasteur des troupeaux d’Admète, et le fit regarder comme le dieu des bergers. Elle ajoute que Mercure l’ayant aperçu dans cette nouvelle condition, lui enleva adroitement une vache, Apollon, pour punir le larcin, eut recours a ses traits ; mais il les trouva dérobés. Ce fut pendant cet exil que Daphné, fille du fleuve Pénée, fut métamorphosée en laurier, dans l’instant où sa course trop faible ne pouvait plus la faire échapper aux poursuites d’Apollon. Le dieu voulut que cet arbre lui fût consacré, et que son feuillage servît à couronner ceux qui excelleraient dans la poésie et dans les jeux pythiens.
,
assure que le laurier a la propriété de n’être jamais frappé par la foudre
. Un fragment d’histoire rapporte que Daphné, fille d’un roi de Thessalie nommé Pénée, poursuivie par un jeune prince sur les bords d’un fleuve qui portait le même nom, tomba dans ses eaux et s’y noya. La grande quantité de lauriers qui croissaient le long de ce fleuve, fit dire que la jeune princesse avait été métamorphosée en laurier.
Ce fut peu de temps après qu’Apollon tua, sans le vouloir, le jeune Hyacinthe qu’il aimait beaucoup. Zéphire, qui aimait cet enfant, fut jaloux de le voir jouer au palet avec Apollon. Il souffla sur le palet du dieu avec tant de violence, qu’il alla briser la tête du malheureux Hyacinthe. Apollon le métamorphosa en la fleur qui porte son nom. Ses regrets inutiles de ce meurtre involontaire n’apaisèrent point les parens d’Hyacinthe ; ils poursuivirent le meurtrier de leur fils. Il alla se réfugier à Troie auprès de Laomédon, qui lui demanda son secours pour bâtir les murailles de cette ville. Ce fut là qu’il rencontra Neptune, qui, disgracié comme lui par Jupiter, parcourait la terre. L’ingrat Laomédon, après les avoir employés l’un et l’autre, leur refusa leur salaire ; pour se venger, Neptune détruisit les travaux en les inondant, et une peste horrible fut la suite de la colère d’Apollon. L’oracle, consulté sur les moyens d’apaiser le ciel, répondit que tous les ans il fallait exposer une jeune fille troyenne sur les rochers, pour servir de pâture aux monstres de la mer. Le sort tomba sur Hésione, fille de Laomédon. La puissance de son père et sa beauté ne purent la sauver : il fallut obéir à l’oracle ; mais Hercule vint à son secours, et tua le monstre. L’avare Laomédon osa refuser les deux beaux chevaux qu’il avait promis à Hercule. Le héros indigné le mit à mort, embrasa la ville, et emmena prisonnier Priam, fils de Laomédon. Ces fables se trouvant jointes à l’histoire d’Hercule, nous donnerons leur explication, lorsqu’il sera question de ce demi-dieu.
Quelque temps après ces aventures, Apollon fut rappelé dans le ciel et rétabli dans ses droits. Jupiter lui confia le soin de conduire le char du soleil et de répandre la lumière sur la terre.
distinguait quatre Apollon : les trois derniers étaient des princes grecs ; le plus ancien de tous était Horus, fils d’Osiris et d’Isis. Cette reine d’Égypte lui donna Latone pour nourrice : et, pour le dérober aux persécutions de Typhon, elle le cacha dans l’île de Chemnis, située dans un lac auprès de Butes. Latone était née dans cette dernière ville. Nous avons déjà fait observer qu’Osiris était le symbole du soleil chez les Égyptiens : Horus, son fils, le fut de même après lui. Les Grecs confondaient presque toujours Osiris avec leur Jupiter ; il n’est donc nullement surprenant qu’ayant donné le nom d’Apollon à plusieurs de leurs princes, ils les aient confondus avec l’Apollon égyptien. Parmi les dieux du paganisme, il n’en est aucun dont les poëtes aient publié plus de merveilles. Ils le peignirent comme l’inventeur de la poésie, de la musique et de l’éloquence. Aucun dieu ne possédait mieux l’art de pénétrer dans l’avenir. Ses oracles étaient sans nombre. Il unissait à tous ces avantages la beauté, la grâce, et le pouvoir de charmer par son esprit et les sons harmonieux de sa lyre. Le dieu du jour, par le seul éclat de son nom, efface tous les éloges que l’imagination la plus brillante voudrait lui donner.
Parmi les princes grecs qui ont porté le nom d’Apollon, l’un d’eux aima Clytie, nymphe de l’Océan ; il l’abandonna pour Leucothoé, fille d’Orchame, roi de Babylone. Le désespoir de Clytie l’entraîna jusqu’à se laisser mourir de soif et de faim. Les poëtes s’emparèrent de cette aventure, et voyant que l’héliotrope ou tournesol a toujours sa fleur penchée vers le soleil, ils publièrent que Clytie avait été métamorphosée en héliotrope, et que sa nouvelle forme n’ayant pu détruire sa sensibilité, elle se tourne encore vers le soleil pour lui reprocher son inconstance.
Les poëtes voulurent de même donner une origine au cyprès, arbre lugubre et sans feuilles : ils publièrent que l’enfant Cyparisse, aimé par Apollon, tua, sans le vouloir, un cerf qu’il aimait beaucoup ; le regret de sa perte le fit mourir de chagrin. Apollon changea cet enfant en cyprès, et voulut que cet arbre fût consacré aux funérailles.
Il n’y eut point de dieu plus honoré qu’Apollon. Ses temples étaient sans nombre dans la Grèce et dans l’Italie. Dans tous, on consultait ses oracles. La ville de Délos attirait les habitans de toutes les parties du monde par la magnificence des fêtes qu’elle célébrait en son honneur. Toutes les cérémonies de son culte avaient rapport au soleil, dont il était le symbole. L’épervier et le loup lui étaient consacrés, parce qu’ils ont la vue perçante ; le corbeau, la corneille et le cygne, parce qu’on leur croyait le don de prévoir l’avenir, et parce qu’ils servaient d’augures.
La fable imaginée sur le corbeau mérite d’être rapportée. Son plumage fut d’abord blanc ; mais Apollon le noircit pour le punir d’un indiscret avis qu’il lui donna sur une infidélité de Coronis. Les transports de la jalousie sont terribles et souvent aveugles. Apollon fit périr cette nymphe, et s’en repentit trop tard. Il la métamorphosa en corneille, et voulut que son plumage lugubre et celui du corbeau fussent à la fois la preuve de ses regrets et de sa vengeance.
Le temps a conservé beaucoup de monumens qui représentent ce Dieu. Les rayons qui brillent autour de sa tête, sa jeunesse, sa beauté, sa lyre et ses flèches, le font toujours reconnaître (Fig. 11.) On le voit ordinairement sans barbe. Il avait presque autant de noms qu’il y avait de pays où on lui rendait un culte. Nous avons cité les principaux, mais nous allons nous arrêter à celui de Musagète, parce qu’il nous conduit à l’histoire des Muses, dont il était le maître et l’instructeur.
Histoire et fable des Muses. §
et saint nous apprennent qu’à Sycione, on employa, dans le même temps, trois habiles sculpteurs à faire les statues des Muses. Elles n’étaient que trois alors, et l’on voulait consacrer seulement les trois statues qui paraîtraient les plus parfaites. L’habileté des ouvriers rendit la préférence si difficile à décider, que, pour conserver ces neuf chefs-d’œuvre, on les plaça dans le temple d’Apollon. Depuis ce temps, les poëtes ont célébré neuf Muses ; et nous croyons très-inutile d’examiner quel a été, dans l’origine, leur véritable nombre. L’obscurité sur ce point est d’autant plus grande, qu’on donnait souvent le nom de Musagète, ou conducteur des muses, à Hercule. Il paraît, il est vrai, que, dans ces cas, on confondait ce héros avec le Soleil. M. résout ce problème d’une manière si ingénieuse, que nous croyons devoir la citer.
Il assure que ce célèbre Hercule et ses douze travaux n’étaient que les emblèmes du soleil et des douze signes du zodiaque. Il explique de même le nombre des cinquante femmes que l’on donnait à ce demi-dieu, en disant qu’elles étaient l’emblème des cinquante semaines de l’année. Les Muses, dit-il, étaient les douze mois de l’année ; et, quoique l’on n’en compte ordinairement que neuf, il faut y joindre les trois mois de l’année pendant lesquels on se repose des travaux de l’agriculture.
Quelque savante que soit cette explication, elle est nouvelle, et n’est point généralement adoptée ; nous devons donc nous borner à suivre et les poëtes. Ils ne comptaient que neuf Muses, filles de Jupiter et de Mnémosyne, déesse de la mémoire. Elles étaient vierges, et la fable dit qu’un jeune homme, nommé Adonis, ayant tenté de leur plaire, elles le firent mourir.
On a voulu peindre, par cette fable, l’inutilité des efforts que l’on fait pour s’élever jusqu’à la poésie, lorsqu’on ne possède pas les dons nécessaires aux poëtes. Cette prétendue mort d’Adonis est une allégorie pour peindre un homme très-vain de son esprit, qui croyait être poëte, et dont les ouvrages n’ont pu lui survivre.
On croit généralement que le nom des Muses vient du grec muein, expliquer les mystères.
On les nommait quelquefois Piérides. Les neuf filles de Piérus, roi de Macédoine, osèrent les défier au chant. Pour punir leur orgueil, les Muses victorieuses les changèrent en pies, et conservèrent le nom de Piérides, en mémoire de leur triomphe.
Ces sortes de défis contre les dieux étaient toujours dangereux, et très-rarement impunis. Le satyre Marsyas osa prétendre que les sons de sa flûte plairaient davantage que les accords d’Apollon sur sa lyre. Des juges furent choisis. Le dieu, vainqueur du satyre, l’écorcha vif, pour le punir de sa folle témérité.
Voici l’origine de cette fable : Avant l’invention de la lyre, la flûte était l’instrument préféré. Apollon, avec sa lyre, trouva le moyen d’unir à la beauté du chant le charme des accords ; il la fit préférer à la flûte, et les poëtes peignirent les regrets et la jalousie de Marsyas, en disant qu’Apollon l’avait écorché.
Les auteurs anciens ne sont pas entièrement d’accord sur les noms des Muses et sur leurs symboles : nous allons rapporter la manière la plus ordinaire de les nommer et de les peindre.

1. Clio, la première des Muses, prend son nom de la gloire et de la renommée ; elle préside à l’histoire. On la croit inventrice de la guitare : on en place ordinairement une dans sa main droite : et dans sa main gauche on remarque un plectre au lieu d’archet. On la représente aussi très-souvent écrivant l’histoire. (Fig. 12.)
2. Thalie préside à la comédie. Son nom veut dire la florissante, et lui est donné à cause de sa voix. On la représente appuyée sur une colonne, tenant un masque à la main. (Fig. 13.)
3. Melpomène préside à la tragédie. On la voit ordinairement reposant sa main sur la massue d’Hercule, parce que l’objet de la tragédie est de représenter les belles actions des héros, et le plus illustre de tous est Hercule. (Fig. 14)
4. Euterpe préside aux instrumens de musique ; son nom veut dire agréable : elle paraît toujours environnée de flûtes, de lyres, de guitares, et des attributs de la musique. (Fig. 15.)
5. Terpsichore ou la divertissante, a le soin de présider à la danse. Son visage est toujours riant, et un seul de ses pieds touche légèrement la terre. (Fig. 16.)
6. Érato. Son nom vient du mot grec eros, amour. Elle inspire les poésies légères, les chansons amoureuses : et sa physionomie variante ne peut être peinte, parce qu’elle change toutes les fois qu’un sujet nouveau l’inspire. (Fig. 17.)
7. Polymnie tire son nom de la multiplicité de ses chansons. On la peint avec une lyre, comme étant l’inventrice de l’harmonie : ses regards qui s’élèvent vers le ciel, annoncent qu’elle préside à l’ode. (Fig. 18.)
8. Uranie, ou la céleste, est l’inventrice de l’astronomie et des sciences. Elle tient un globe dans sa main ; quelquefois ce globe paraît posé sur un trépied ; on remarque alors l’équerre ou le compas dans sa main. (Fig. 19)
9. Calliope doit son nom à la majesté de sa voix ; elle préside aux poëmes héroïques. On voit près d’elle la trompette de la renommée, des couronnes de laurier, des faisceaux d’armes et des trophées. (Fig. 20.)
Un jour que les Muses allaient au Parnasse pour entendre les leçons de leur maître Apollon, une forte pluie les força de se réfugier dans le palais de Pyrénée, roi de Phocide. Ce prince voulut les insulter ; elles prirent des ailes et s’envolèrent. Voulant les poursuivre, il s’élança du haut d’une tour ; mais il ne put se soutenir dans les airs ; il tomba et se brisa la tête.
L’histoire rapporte que ce roi Pyrénée chassa de son royaume tous les hommes instruits, tous les sages, et qu’il fit fermer les écoles publiques. Cette fantaisie brutale le fit généralement mépriser, et lorsqu’il mourut, personne ne voulut honorer sa mémoire. Ce prince médiocre, après avoir vainement essayé de faire admirer ses ouvrages, crut se venger en persécutant les sciences ; et les poëtes imaginèrent la fable que nous avons citée, dans l’intention de flétrir à jamais son souvenir.
Souvent on représente les Muses environnant Apollon sur le mont Parnasse ou sur le mont Hélicon ; on y ajoute Pégase déployant ses ailes pour s’élever au ciel, et faisant, d’un coup de pied, jaillir la fontaine Hippocrène, si célèbre parmi les poëtes. Nous reviendrons sur cet article en rapportant l’histoire de Persée.
Parmi les enfans d’Apollon, il faut distinguer Linus, inventeur des vers lyriques. Il excellait dans le talent de montrer à jouer de la lyre ; ses écoliers les plus célèbres furent Orphée, Thamiras et Hercule. Ce dernier, plutôt propre, à combattre les monstres qu’à cultiver les arts agréables, fut tellement irrité d’une réprimande de son maître Linus, qu’il lui brisa la tête avec sa lyre.
Les oracles d’Apollon servirent à rendre très-fameuses plusieurs villes et plusieurs contrées. Il avait surtout à Delphes un temple très-magnifique. La prêtresse, qu’il animait de son enthousiasme, était assise sur une espèce de table à trois pieds, que l’on nommait cortina ou trépied. On la couvrait avec la peau du serpent Python.
On ne peut douter qu’il n’entrât beaucoup de fraude dans les réponses des oracles. Cependant un assez grand nombre se vérifiaient. Les pères de l’église se réunissent pour croire que Dieu a permis quelquefois à l’éternel ennemi du genre humain de prévoir l’avenir. Les nombreuses histoires des oracles vérifiés viennent à l’appui de cette opinion.
Si leurs réponses, en effet, avaient toujours été démenties par les événemens, l’adresse extrême des prêtres d’Apollon n’aurait pu suffire pour maintenir la confiance pendant un si grand nombre de siècles. Il faut cependant observer que les réponses des oracles étaient tellement équivoques et obscures, qu’on pouvait les interpréter de mille manières différentes ; de sorte que la vérité pouvait quelquefois se rencontrer avec l’interprétation que l’on avait adoptée.
Nous repaierons des oracles dans le chapitre où il sera question des Sibylles.
Histoire de Diane ou la lune §
Diane était sœur d’Apollon, dieu du jour, et elle se nommait Phœbé : l’un et l’autre avaient les mêmes attributs. Nous avons déjà prouvé que, chez les Égyptiens, Osiris était le symbole du soleil, et Isis le symbole de la lune. Pour ne point répéter ces détails, nous allons donner l’histoire ou plutôt la fable de Diane adoptée par la Grèce.
Les Grecs honoraient Diane sous trois qualités différentes : la première, comme divinité céleste ; alors elle était la Lune ou Phœbé : la seconde, comme divinité terrestre ; sous ce rapport, on la nommait Dicté ou Dictynne, du nom d’une nymphe qu’elle aimait beaucoup, et qui, la première, inventa les filets : la troisième enfin, comme divinité des enfers ; elle y commandait sous le nom d’Hécate ou de Proserpine.
Ce fut pour désigner ces trois qualités différentes qu’on lui donna le nom de déesse à trois formes.
Les bergers de Thessalie se vantaient de faire descendre la lune sur la terre par la force de leurs enchantemens. Lorsqu’elle venait à s’éclipser, ils assuraient qu’elle venait sur la terre, et s’y rendait à leurs ordres.
Diane naquit avec son frère Apollon, et sur-le-champ, dit la fable, elle servit de sage-femme à sa mère Latone. Les douleurs qu’elle lui vit souffrir, l’engagèrent à demander à Jupiter le don de la virginité, et de présider aux accouchemens ; l’un et l’autre lui furent accordés. Les filles qui se mariaient croyaient devoir apaiser la déesse, et lui consacraient leur ceinture ; ce qui la fit surnommer Tisiphone, ou Détache-ceinture. On la nommait aussi Trivia, parce qu’elle présidait aux grands chemins. Il y avait en Égypte une autre Diane, nommée Bubastès : elle était fille d’Osiris et d’Isis ; on lui donnait, comme à sa mère, le nom de Diane. Elle partageait avec Junon le nom de Lucine. Les femmes près d’accoucher les invoquaient également l’une et l’autre sous ce nom. La plupart des autres noms donnés à la déesse venaient des lieux où elle était particulièrement honorée. Elle eut deux temples d’une extrême célébrité ; celui d’Éphèse, l’une des sept merveilles du monde, et dont nous donnerons la description à l’article des temples, fut brûlé le 6 de juin, jour de la naissance d’Alexandre-le-Grand. Érostrate, coupable de cet incendie, voulut rendre son nom immortel en commettant un crime que l’on ne pût oublier.
Le second temple était situé dans la Chersonèse taurique (aujourd’hui la Crimée). Sa plus grande célébrité venait de ce que l’on y offrait des victimes humaines à Diane. Tous les étrangers que la tempête jetait sur ces côtes, ou que le hasard y faisait aborder, servaient de victimes dans ces barbares sacrifices. Oreste et Pylade, si connus par leur tendre amitié, tuèrent le pontife Thoas, emportèrent la statue de la déesse, et vinrent la déposer en Italie, où elle fut appelée Phazelis, parce qu’ils la cachèrent dans un fagot de bois.
Sur la terre, Diane présidait à la chasse : Soixante nymphes, filles de l’Océan, et vingt autres filles, avaient soin de son équipage. On la représente ordinairement chaussée d’un cothurne, portant un arc et un carquois. Son front est orné d’un croissant, et son char est tiré par des biches. (Fig. 21.)
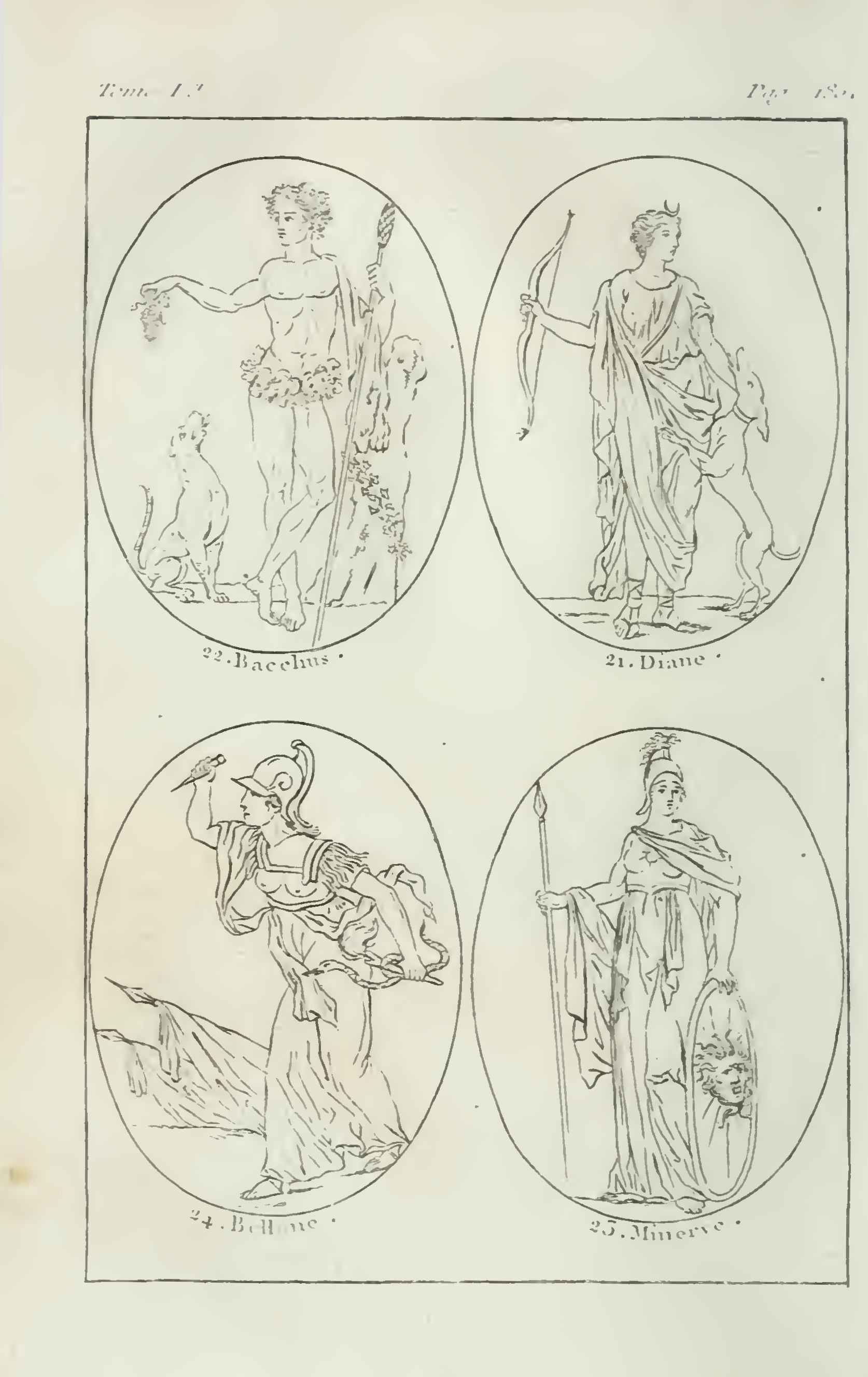
Diane était regardée comme la déesse de la chasteté. Les nymphes de sa suite devaient l’imiter, et les fautes, même involontaires, étaient sévèrement punies. Le malheureux Actéon, conduit par Junon, ennemie de sa famille, pénétra, sans le vouloir, jusqu’à la grotte solitaire où Diane et les nymphes de sa suite prenaient le bain : dans l’instant même, la déesse le métamorphosa en cerf, et il fut dévoré par ses propres chiens.
Calisto, nymphe d’Arcadie et favorite de la déesse, ne put éviter sa vengeance. Jupiter, pour la séduire, avait pris la forme de Diane elle-même. Cette excuse ne la garantit point ; la déesse la chassa de sa cour, et l’abandonna à la jalousie de Junon, qui la métamorphosa en ourse. Réduite à se cacher au fond des bois, elle ne put toujours échapper aux poursuites des chasseurs. Arcas, son propre fils, ayant atteint l’âge pendant lequel on trouve tant de charmes à la chasse, rencontra sa mère sans la reconnaître. Calisto, retrouvant en lui tous les traits de Jupiter, qu’elle ne pouvait oublier, ne songea plus à fuir ; ses yeux se fixèrent sur le jeune prince, qui s’apprêtait à la percer d’un dard. Jupiter, pour empêcher ce crime horrible, le métamorphosa en ours, et les plaça l’un et l’autre dans le ciel. Telle est la fable que les poëtes ont imaginée sur la constellation composée de sept étoiles, que l’on nomme aujourd’hui la grande Ourse où le Chariot. L’étoile nommée Bootès ou le Bouvier, qui suit la grande Ourse, représente le fils de Calisto.
Près du pôle arctique, on aperçoit aussi la petite Ourse, connue par les astronomes sous le nom de Cynosure : elle sert de guide aux nautoniers. Les étoiles qui la composent représentent les nymphes qui prirent soin de l’enfance de Jupiter.
Diane, aussi fière que Junon, ne souffrait pas que l’on osât se comparer à elle. Dédalion, fils de l’astre du matin nommé Lucifer, fut changé en épervier, parce que Chioné sa fille ayant eu la témérité de préférer sa beauté à celle de Diane, la déesse la perça d’une flèche. Dédalion, ne pouvant se consoler de la mort de sa fille, se précipita du haut d’une tour. Apollon en eut pitié, et le changea en épervier.
Une fable dit que Diane avait aimé Endymion, roi d’Élide, et que, toutes les nuits, elle descendait de son char, pour aller le voir dans les montagnes de la Carie. Cette fiction, offensante pour Diane, n’est fondée que sur le goût d’Endymion pour l’astronomie, et sur son attention à observer tous les mouvemens de la lune. Ce prince aimait à se retirer à Latma, dans une grotte des montagnes de Carie ; il y passait souvent les nuits, ce qui fit imaginer la fable des visites de Diane. Son application constante à l’étude, et son insensibilité pour les plaisirs firent dire aussi qu’il avait obtenu de Jupiter le don de dormir éternellement. On voit encore sur le mont Latmus une espèce de caverne que l’on appelle toujours la grotte d’Endymion.
Le char du soleil était d’or, et celui de la lune était d’argent. On peignait la marche tranquille de ce dernier, en disant qu’il s’avançait sans bruit au milieu des ombres de la Nuit, divinité particulière que l’on disait fille du Chaos. Elle passait pour la plus ancienne des déesses, afin d’exprimer que les ténèbres avaient existé avant la lumière. Ou représentait la Nuit montée sur un char d’ébène, accompagnée par les étoiles, environnée d’un grand voile noir ; elle tenait un flambeau renversé, comme si elle voulait l’éteindre. Les poëtes donnaient à la Nuit un grand nombre d’enfans, mais tous étaient métaphoriques : la Douleur, la Crainte, l’Amour, l’Envie, la Vieillesse, etc., etc.
Nous parlerons dans un autre article de toutes ces divinités particulières, leur histoire interromprait trop celle des grandes divinités.
On donnait à Diane le nom d’Hécate, originaire d’un mot grec qui signifie frapper de loin ; on voulait exprimer par ce surnom la rapidité avec laquelle ses rayons arrivent du ciel sur la terre. On donnait à ces rayons le nom de flèches, comme on le donnait à ceux du soleil. L’influence des uns et des autres était également redoutée.
Quelques auteurs font dériver ce nom de Diane du mot grec ékaton, qui servait à désigner le nombre cent, parce que, dans les sacrifices offerts à cette déesse pour l’apaiser, on immolait cent victimes, ou parce que c’était par ses ordres que les âmes des corps privés des honneurs de la sépulture restaient errantes autour des enfers pendant cent années.
Les noms de phœbus et de phœbé, que portaient Apollon et Diane, à cause de la lumière qu’ils répandent sur la terre, avaient une seconde origine, qu’il est utile de connaître ; ils venaient de la mère de Latone, qui portait aussi le nom de Phœbé. Sa naissance inconnue la fit regarder comme fille de la Terre. Cette première Phœbé devait sa plus grande célébrité à l’oracle situé au pied du Parnasse, que lui céda la Terre sa mère. Apollon et Diane partagèrent d’abord cette espèce d’héritage, mais bientôt on n’y consulta plus que le dieu du jour.
Cet oracle étant celui de Delphes, il est indispensable d’en connaître l’origine.
rapporte que des chèvres, qui paissaient dans les vallées du mont Parnasse, firent découvrir cet oracle
. Dans l’une de ces vallées, on apercevait une ouverture très-étroite ; quelques chèvres, ayant voulu brouter les herbes qui croissaient à l’entour, éprouvèrent une sorte d’ivresse qui leur fit faire des bonds extraordinaires.
Le berger qui les gardait, surpris de cet effet, s’approcha pour considérer cette ouverture ; l’air qui s’en exhalait lui causa une sorte de délire qu’il regarda lui-même comme un enthousiasme sacré. Le bruit de cette merveille attira les habitans du voisinage.
L’essai mille fois répété produisit mille fois la même ivresse. Surpris d’un prodige que les connaissances physiques de ce temps ne pouvaient expliquer, les habitans du pays supposèrent qu’une divinité favorable, ou la Terre elle-même, rendait ses oracles par cette ouverture, et donnait à ceux qui s’en approchaient le pouvoir de lire dans l’avenir. Dès-lors ce lieu fut regardé comme sacré ; on y établit une espèce de sanctuaire où l’on ne pouvait pénétrer sans payer de riches tributs à la divinité que l’on voulait consulter. Par la suite des temps un temple magnifique environna ce sanctuaire, et l’affluence de ceux qui s’y rendaient multiplia tellement les habitations, qu’elles servirent à former la ville de Delphes. Cette ouverture était placée vers le milieu du Parnasse, montagne de la Phocide, en descendant du côté du midi.
Le temple et la ville de Delphes acquirent de si grandes richesses, qu’on les comparait à celles des rois de Perse. Nous ne terminerons point cet ouvrage sans traiter plus en détail l’intéressant article des oracles.
Histoire de Bacchus. §
L’orgueil et l’ambition des Grecs les portaient à croire que tous les dieux et tous les héros avaient pris naissance dans leur pays. Jamais peuple ne fut plus avide de célébrité. Les conquêtes de Bacchus avaient trop illustré son nom, pour ne pas faire naître le désir de lui supposer une origine grecque. Cependant , et , fidèles à leurs devoirs d’historiens, nous apprennent que Bacchus, né en Égypte, fut élevé dans Nisa, ville de l’Arabie Heureuse, où son père Ammon l’avait envoyé. Leurs détails historiques s’étendent même assez pour faire reconnaître dans le Bacchus adopté par les Grecs, le fameux Osiris, conquérant des Indes. Les fables des poëtes, et les récits des anciens auteurs ne peuvent convenir qu’à ce roi d’Égypte. Ils disent que ce dieu vint au secours de Jupiter dans la guerre contre les Géans ; ensuite ils le disent fils de Sémélé et petit-fils de Cadmus. Or, ce dernier prince n’exista que plusieurs siècles après cette guerre. Les fables ajoutent que Bacchus, couvert d’une peau de tigre, secourut puissamment Jupiter, mais que les Géans le mirent en pièces. Cette dernière circonstance ne peut convenir qu’à la Mort d’Osiris, tué par le cruel Typhon son frère.
explique cette contradiction, en disant que le culte de cette divinité fut rapporté de l’Égypte dans la Grèce par Orphée. Cadmus l’ayant favorablement accueilli, le poëte voulut témoigner sa reconnaissance, en attribuant à un prince de la famille de Cadmus l’histoire et la fable du Bacchus égyptien. En effet, le culte que l’on rendait à ce dieu et celui que l’on rendait à Osiris se ressemblaient parfaitement. Ce rapprochement sert à prouver de plus en plus que la Grèce devait le culte de ses dieux et même la plupart de leurs noms aux colonies orientales.
comptait trois Bacchus. en comptait cinq, et les modernes ont encore plus varié sur leur nombre et sur leur origine.
Un grand nombre de savans croient que les poëtes ont peint dans leur Bacchus. Ils trouvent de si grandes ressemblances entre l’un et l’autre, qu’il nous paraît utile de les rapporter, sans prétendre toutefois les donner comme des certitudes.
et Bacchus sont nés en Égypte. Le premier fut exposé sur le Nil, les poëtes ont dit la même chose du second. Le nom de , et celui de Mysos donné à Bacchus par Orphée désignent également qu’ils ont été sauvés des eaux.
Bacchus fut élevé dans l’Arabie sur une montagne appelée Nisa ; c’est dans le même pays que a passé quarante années.
Bacchus, pendant une persécution cruelle qui s’éleva contre lui, se retira sur les bords de la mer Rouge ; , pour enlever le peuple hébreu aux persécutions des Égyptiens, traversa la mer Rouge.
L’armée de Bacchus, composée d’un grand nombre d’hommes et de femmes, passa par l’Arabie pour aller à la conquête des Indes. L’armée du législateur des Hébreux, composée d’hommes, de femmes et d’enfans, fut obligée d’errer long-temps dans le désert pour se rendre dans la Palestine, qui tenait, ainsi que les Indes, au continent de l’Asie.
La fable représente Bacchus avec des cornes : elles font allusion aux deux rayons de lumière qui brillaient sur le front de .
Bacchus fut élevé sur le mont Nisa ; reçut les tables de la loi sur le mont Sinaï. La transposition d’une seule lettre rend les deux noms absolument semblables. Bacchus armé de son thyrse défait les Géans, combat les Géans descendans d’Énoc ; une verge est l’instrument de ses miracles.
Jupiter envoie Iris à Bacchus, pour lui ordonner d’aller dans les Indes détruire une nation impie. Dieu ordonna à d’aller dans la Palestine exterminer une nation idolâtre.
Le dieu Pan donne un chien à Bacchus, pour le suivre dans ses voyages. Caleb, dont le nom hébreu signifie un chien, est le fidèle compagnon de .
Bacchus, en frappant la terre avec son thyrse, en fait sortir des flots de vin. , en frappant le rocher avec la verge miraculeuse, en fait jaillir une fontaine.
Ce parallèle est trop parfait pour ne pas conduire à croire que la fable de Bacchus n’est qu’une tradition défigurée de l’histoire de . Cependant quelques savans cherchent à prouver que Bacchus est le même que Nemrod, fils de Chus, ce qui lui fit donner d’abord le nom de Barchus, fils de Chus, et, par corruption, on changea ce nom en celui de Bacchus.
Quelques autres savans croient que Bacchus est le même que Noé, à qui l’Écriture Sainte attribue l’invention de cultiver la vigne. Quoi qu’il en soit, on peut conclure de ces divers rapprochemens que le législateur des Hébreux ayant été très-célèbre dans l’Égypte, on a emprunté plusieurs de ses traits principaux pour embellir l’histoire de Bacchus, ou plutôt d’Osiris, qui paraît avoir été le véritable Bacchus.
L’histoire fait reconnaître aussi que le culte de cette divinité fut porté dans la Grèce par Cadmus. Sémélé, fille de ce prince, eut un fils surnommé Bacchus, qui fit quelques actions et quelques conquêtes semblables à celles de l’ancien. On les confondit ensemble par la suite ; et, pour honorer Cadmus, on rendit à son petit-fils les mêmes honneurs qu’au Bacchus d’Égypte.
Fable de Bacchus. §
Il ne suffit pas de connaître les rapprochemens historiques entre Bacchus et ; nous allons donner la fable de sa naissance, telle qu’on la trouve dans les poëtes grecs.
Il était fils de Jupiter et de Sémélé, fille de Cadmus. Cette princesse habitait la ville de Thèbes. Junon, jalouse de Sémélé, prit la figure de Béroé, nourrice de sa rivale, et, sous cette forme, lui conseilla d’exiger de Jupiter qu’il se fît voir à elle la foudre à la main, et dans tout l’appareil qui l’environnait lorsqu’il se montrait à Junon. La crédule Sémélé prévient Jupiter qu’elle avait une demande à lui faire, et lui fit jurer par le Styx qu’elle ne serait pas refusée ; Jupiter prononça le serment, et, malgré les suites fatales qu’il devait avoir, il fut forcé de l’accomplir. La malheureuse Sémélé ne put soutenir l’éclat du plus grand des dieux : les rayons de lumière embrasèrent le palais ; elle périt dans les flammes. Cependant Jupiter, voulant sauver l’enfant dont elle était enceinte, l’enferma dans sa cuisse, et voulut qu’il y restât jusqu’au moment de sa naissance. Cette fable ridicule fit donner par la suite à Bacchus le surnom de Bimater, qui a deux mères.
En recherchant l’origine de cette fable extraordinaire sur la naissance de Bacchus, on trouve que Sémélé périt peu après l’embrasement de son palais, mais que l’on parvint à sauver l’enfant dont elle était enceinte. Aussitôt après sa naissance, Jupiter le fit transporter, par Mercure son messager, dans Nisa, ville située près d’une montagne appelée Méros, mot qui signifie cuisse. Cette fable n’a pas d’autre origine.
Les filles d’Atlas, à la prière de Mercure, prirent soin de l’enfance de Bacchus ; Silène se chargea de l’instruire : il ne voulut plus s’en séparer, et le suivit dans toutes ses conquêtes. Nous reviendrons à l’histoire de Silène lorsqu’il en sera temps. Nous nous bornerons dans ce moment à dire que la fable le peint ordinairement comme le dieu des buveurs, ainsi qu’elle peint Bacchus comme le dieu du vin, parce qu’on lui attribuait l’invention de cultiver la vigne.
Bacchus, par reconnaissance pour les filles d’Atlas, les changea en ces étoiles que l’on nomme les Hyades, nom qui vient de Hyie, surnom du dieu du vin.
Dans les représentations de Bacchus, on le voyait toujours avec la figure d’un jeune homme frais et vermeil. On voulait par-là désigner la vivacité que donne le vin, vivacité qu’il fait éprouver même aux vieillards.
Sa main est armée d’un thyrse, espèce de baguette environnée de feuilles de vigne et de lierre. On croyait que le lierre, par sa fraîcheur avait le pouvoir de dissiper les fumées du vin, et l’empêchait de porter à la tête. C’est de là que presque tous les tableaux de Bacchus le représentent couronné de lierre et de pampre de vigne.
On le voit ordinairement monté sur un char traîné par des panthères et des tigres. On voulait figurer, par cet attelage, que l’excès du vin inspire la fureur, fait perdre la raison, et rend souvent cruel.
Dans les sacrifices offerts à Bacchus, on immolait ordinairement une pie ou un bouc : la première, pour avertir que le vin fait parler indiscrètement ; et le second, parce qu’il ronge les bourgeons de la vigne.
Les fêtes du dieu du vin se célébraient avec de grandes clameurs par des prêtresses que l’on nommait Bacchantes, ou Bassarides, ou Thyiades, et souvent Ménades ; elles couraient les montagnes vêtues de peaux de tigres. Lorsqu’elles invoquaient le dieu, leurs cheveux étaient épars, et dans leurs mains on voyait des thyrses et des flambeaux. Ces fêtes se nommaient Bacchanales, Dionysia, du surnom de Bacchus ; ou Triétérica, parce qu’on les célébrait de trois ans en trois ans. On leur donnait aussi le nom orgies, qui veut dire fureur. Dans une autre fête, nommée Aschosia, on s’amusait à sauter à cloche-pied sur des vessies remplies d’air, et ceux qui tombaient excitaient des rires.
Rien n’était plus dangereux que la vengeance de Bacchus et de ses adorateurs, lorsqu’on osait troubler ses fêtes ou s’opposer à son culte. Penthée, fils d’Echion et d’Agavé, voulut empêcher les Thébains, dont il était roi, de célébrer les fêtes de Bacchus ; le dieu inspira à sa mère Agavé une fureur si aveugle, qu’elle se fit suivre par les bacchantes, et déchira de ses mains son malheureux fils.
Cet exemple funeste ne produisit aucun effet sur les Minéides ; un jour que l’on célébrait la fête de Bacchus, elles affectèrent de travailler à des ouvrages de tapisserie : le dieu les changea en chauve-souris, et leur ouvrage en feuilles de lierre.
Lycurgue, qu’il ne faut pas confondre avec le législateur de Lacédémone, voulut détruire les vignes de la Thrace. Il s’arma d’une faux et se mit à les couper. Un coup maladroitement donné retomba sur ses jambes ; et le peuple, témoin de sa blessure, la regarda comme une punition de l’insulte qu’il avait voulu faire au dieu du vin.
Bacchus, ayant réuni une immense armée d’hommes et de femmes, partit pour la conquête des Indes. Ses troupes, au lieu de lances et de boucliers, portaient des tambours et des thyrses. Tout céda à la frayeur que causa cette troupe bruyante ; mais, comme Bacchus n’avait d’autre projet que d’enseigner l’art de cultiver la vigne aux différens peuples qu’il soumettait, il fut reçu partout comme une divinité bienfaisante. Bacchus porta ses conquêtes, ou plutôt ses voyages et ses fêtes, dans les pays situés au-delà de la Méditerranée, comme l’Arcadie et la Syrie, mais il ne pénétra jamais dans les provinces immenses qui s’étendent jusqu’au Gange, et qui portent aujourd’hui le nom de Grandes-Indes. Ce fut à son retour, qu’il épousa Ariadne, fille de Minos, roi de Crète. Il lui fit présent d’une couronne d’or enrichie de pierreries, chef-d’œuvre de Vulcain. Après la mort d’Ariadne, cette couronne fut mise au rang des constellations, ou plutôt on donna son nom à une réunion de huit étoiles, dont trois sont extrêmement brillantes.
Alexandre-le-Grand, dans ses conquêtes de l’Inde, se proposa Bacchus pour modèle : et pendant dix jours ses soldats célébrèrent les fêtes de ce dieu avec tous les emportemens de l’ivresse.
Parmi les monumens les plus célèbres qui restent de Bacchus, les plus beaux sont ceux qui représentent son mariage avec Ariadne, que l’infidèle Thésée avait abandonnée dans l’île de Naxos. Il existe surtout une pierre inestimable sur laquelle cette cérémonie est gravée ; on la nomme le cachet de ; elle appartenait au roi de France.
Souvent on plaçait un caducée auprès de Bacchus, pour montrer qu’il préférait la paix à la guerre.
Parmi les différens noms donnés à Bacchus, il faut remarquer celui de Nyctelius ; il venait de ce que les orgies se célébraient pendant la nuit, à la clarté des torches et des flambeaux.
Le nom de Dionysius venait de dios, dieu, et Nysa, ville où il avait été élevé. On le nommait aussi Evan et Hyie, mots qui signifient courage , mon fils, et que Jupiter répétait souvent pendant que Bacchus combattait contre les géans. On croit aussi que le nom de Bacchus peut venir de bacchein, hurler, à cause des cris des bacchantes.
Histoire de Minerve. §
Chez les Grecs et chez les Romains, Minerve était regardée comme la plus noble production de Jupiter ; mais long-temps avant eux, les Égyptiens lui rendaient un culte. Parmi cinq déesses de ce nom, que
reconnaissait,
il dit que la plus ancienne était issue du Nil, et fort honorée dans l’Égypte
. La seconde était fille de Saturne ; elle avait inventé la guerre. La troisième était fille de Jupiter : la quatrième était Athénienne et fille de Vulcain ; enfin la dernière des cinq était fille du géant Pallas ; et c’est à cette dernière que l’on donnait également le nom de Minerve ou de Pallas. Les fables de ces différentes déesses ayant presque toujours été confondues ensemble, nous allons donner celle que la mythologie a principalement conservée.
Jupiter, après la guerre des Titans, se voyant, par le consentement des autres dieux, maître absolu du ciel et de la terre, épousa Métis, qui passait pour la personne la plus sage de l’univers. (Ce nom est allégorique, et nous avons déjà dit que Métis signifie la providence.) Ayant appris du ciel qu’elle allait mettre au monde une fille d’une sagesse consommée, et un fils à qui les destinées réservaient l’empire du monde, il la dévora. Quelque temps après, se sentant une grande douleur de tête, il eut recours à Vulcain, qui d’un coup de hache lui fendit le cerveau, d’où Minerve sortit armée et assez grande déjà pour être en état de secourir puissamment Jupiter dans la guerre des géans.
Cette fiction de la naissance de Minerve a toujours paru mystérieuse, et l’inscription placée sur son temple à Saïs, en Égypte, ajoute encore à cette obscurité ; elle était conçue en ces termes : Je suis ce qui est, ce qui a été, ce qui sera ; personne n’a pu soulever le voile qui me couvre ; et si l’on veut savoir mes ouvrages, c’est moi qui ai fait le soleil.
Les savans les plus célèbres croient que cette inscription mystérieuse, placée sur le temple de la déesse de la sagesse, a été tirée des livres de
, où la sagesse éternelle, parlant d’elle-même, dit :
Je suis sortie de la tête du Très-Haut avant tout ce qui a été créé.
Ce rapprochement est d’autant plus vraisemblable, que l’on ignorait à Saïs le temps où le culte de Minerve avait commencé : tout porte à croire qu’il remontait jusqu’aux derniers patriarches. Il existait en effet depuis très-long-temps, lorsque Cécrops, originaire de Saïs, quitta cette ville, et conduisit une colonie dans la Grèce, où l’on adopta bientôt ses coutumes et son culte. Ce prince avait une fille qu’il avait fait nommer Athénée, pour la consacrer à Minerve. La célébrité de Cécrops fit, par la suite des temps, confondre sa fille avec la déesse dont elle portait le nom.
Minerve, Athénée et Pallas, n’étaient parmi les Grecs qu’une même divinité. Considérée comme Minerve, elle présidait à la sagesse ; comme Athénée, elle était la protectrice d’Athènes ; comme Pallas, elle présidait à la guerre. Cette dernière fonction la faisait souvent confondre avec Bellone, divinité différente dont nous parlerons en finissant l’article de Minerve,
Les habitans de l’île de Rhodes se distinguèrent beaucoup par le culte qu’ils rendirent d’abord à Minerve ; mais ils le négligèrent après avoir adopté le Soleil comme leur première et plus grande divinité.
Les Athéniens, dans l’espoir de s’assurer la bienveillance particulière de cette déesse, la déclarèrent la protectrice de leur ville, et lui firent bâtir un temple magnifique, dans lequel on l’honorait sous le nom de Parthénos, vierge. , le plus illustre et le plus habile sculpteur de son siècle, l’orna d’une statue d’or et d’ivoire ; son génie sut la rendre digne de la déesse qu’elle représentait. Les Athéniens, pour donner encore plus de solennité au culte de Minerve, célébraient en son honneur les fêtes magnifiques nommées Athénées. Elles avaient été instituées par Érichthonius, troisième roi d’Athènes. Ces fêtes se nommèrent Panathénées, par la suite des temps, lorsque Thésée eut rassemblé les douze bourgades de l’Attique pour en former la seule ville d’Athènes.
Ces fêtes furent divisées en grandes et en petites. Les grandes se célébraient de cinq en cinq ans, et les petites chaque année.
C’était à ces fêtes que les poëtes nommés Rapsodes allaient chanter les vers d’ .
La fable dit que l’honneur de donner un nom à la ville d’Athènes, qui d’abord portait le nom de Cécrops, son fondateur, fit naître un grand différent entre Neptune et Minerve. Les douze grands dieux furent choisis pour être les arbitres de ce différent. Ils décidèrent que la divinité qui produirait la chose la plus utile à la ville lui donnerait son nom. Aussitôt Neptune, d’un coup de trident, fit sortir de la terre un superbe cheval, symbole de la valeur belliqueuse. Minerve fit sortir un olivier fleuri, symbole de la paix. Les douze grands dieux jugèrent en faveur de Minerve ; elle donna son nom d’Athénée à la ville.
L’histoire a conservé l’explication de cette fable. Elle dit que Cécrops, originaire de Saïs, ayant conduit une colonie égyptienne chez les peuples de l’Attique, leur fît abandonner leurs coutumes barbares, leur apprit à cultiver la terre, et surtout l’olivier, pour lequel le terrain se trouve très-convenable. Il fit recevoir le culte de Minerve, à qui cet arbre était particulièrement consacré. La ville prit alors le nom de sa divinité tutélaire. Athènes devint fameuse par l’excellence de ses huiles, son commerce, très-augmenté par ce moyen, fit attacher beaucoup de prix à la culture de cet arbre, et la nécessité d’assurer la navigation des peuples étrangers fit réformer le goût naturel que les Athéniens avaient pour la piraterie. Pour peindre l’origine de cette réforme et la consacrer, ou imagina la fable de Neptune surpassé par Minerve.
Quelques historiens disent que cette fable fut imaginée pour peindre un différent survenu entre les matelots, qui reconnaissaient Neptune pour leur chef, et, le peuple réuni au sénat, qui étaient présidés par Minerve. L’aréopage fut chargé de juger ce différent ; il prononça que l’on devait préférer l’agriculture et la vie champêtre au métier de pirate ; il fit des lois sages et sévères pour assurer la liberté du commerce, et l’on consacra ce jugement en disant que Neptune avait été surpassé par Minerve, et que les douze grands dieux eux-mêmes l’avaient décidé.
Arachné, fille très-célèbre par son adresse dans les ouvrages de tapisserie, osa dire que Minerve elle-même ne pouvait l’égaler. Elle étala ses ouvrages, et défia la déesse de leur comparer les siens. Minerve, indignée, déchira les toiles d’Arachné, et la frappa de sa navette. L’orgueilleuse Arachné ne pouvant se consoler de cet affront, voulut se pendre, Minerve la suspendit en l’air, et la métamorphosa en araignée.
Cette fable est une allégorie par laquelle on a voulu faire entendre qu’un fol orgueil est toujours puni. Peut-être cependant doit-elle son origine au mot arach, qui signifie à la fois filer et toile d’araignée. En général, on trouve beaucoup de fables allégoriques réunies à l’histoire de Minerve. On peut ranger dans ce nombre celle de Tirésias.
Cette fable rapporte qu’un jour il surprit Minerve pendant qu’elle se baignait. Dans l’instant même il fut privé de la vue ; mais sa mère obtint qu’il aurait le don de prévoir l’avenir. On a voulu dire, par cette fable, que le vrai sage n’attache plus aucun prix aux événemens ordinaires de la vie, et que, uniquement attentif aux leçons de la sagesse, elles lui apprennent à profiter de l’expérience présente pour prévoir l’avenir.
Le surnom de Pallas n’était pas le seul que l’on donnait à Minerve. On l’appelait Parthenia, parce qu’elle était vierge ; Cæsia, à cause de ses yeux bleus ; Tritonia, à cause du lac Triton, dont une fable supposait qu’elle tirait son origine. Le mot trito signifie aussi cerveau ; et, comme elle était sortie du cerveau de Jupiter, ce fut peut-être ce nom qui la fit surnommer Tritonia. Quelquefois on la nommait Hippia, cavalière.
Les fêtes de Minerve, appelées Quinquatria, se célébraient à Rome au mois d’avril. Pendant leur durée, les disciples portaient des présens à ceux qui les instruisaient. On les obligeait de les donner eux-mêmes, pour les habituer en même temps à la reconnaissance et au bonheur qu’un cœur généreux éprouve toujours lorsqu’il s’acquitte d’un devoir, ou lorsqu’il accorde un bienfait, Ces présens se nommaient minervalia, ou dons offerts à la sagesse, afin d’ajouter à leur prix, et pour rappeler aux maîtres que la sagesse devait continuellement les guider dans leurs travaux et dans les leçons qu’ils donnaient à la jeunesse. Dans ces temps, on ne faisait aucune libéralité sans invoquer les Grâces, parce qu’elles présidaient aux bienfaits : il ne suffisait pas de donner. Il existait chez les Grecs et chez les Romains des peintures ou des gravures dans lesquelles on voyait les véritables Grâces repousser de leur temple les Grâces paresseuses ou contrefaites. Nous ne croyons pas avoir besoin d’expliquer le sens de ces allégories.
On attribuait beaucoup d’inventions à Minerve : celles des beaux-arts, l’usage de l’huile, le talent de filer et celui d’orner la tapisserie. Ces prétendues inventions n’étaient qu’allégoriques. Les sciences et les arts sont les véritables richesses de l’esprit ; il était digne de la sagesse d’y présider. L’huile indique que, pour s’instruire, il faut souvent consacrer des veilles au travail. L’art de filer indique la patience et la suite qu’il faut mettre à ses ouvrages. Les ornemens de la tapisserie annoncent qu’il faut chercher à les embellir. Minerve sort de la tête de Jupiter, pour montrer que la sagesse n’a pas été inventée par les hommes, mais que son origine est céleste.
Elle vient au monde toute armée, parce que le sage, fort de sa conscience et de sa vertu, sait combattre le vice et résister au malheur.
Elle est vierge, parce que la sagesse ne peut s’allier avec la corruption et les plaisirs.
On ne voit aucun ornement la parer, et son regard est sévère, parce qu’elle n’a pas besoin de parure étrangère ; elle brille autant sous l’éclat de la pourpre que sous les habits les plus simples ; ses traits, toujours nobles, se font également aimer et respecter sous les rides de la vieillesse et sous les dehors frais et charmans de la jeunesse.
On représente souvent Minerve tenant une quenouille et s’apprêtant à filer, pour avertir que l’on doit fuir l’oisiveté et préférer avant tout les travaux utiles. Bellone préside aux combats sanglans ; c’est à la guerre contre le vice que Minerve préside. On voit sur sa tête un casque surmonté d’un hibou. Une de ses mains tient une pique, et l’autre l’égide, espèce de bouclier couvert de la peau d’un serpent que Minerve avait tué, et au milieu duquel était gravée la tête de Méduse, l’une des Gorgones. Cette tête environnée de serpens, et cette armure, inspiraient la terreur. La déesse s’en servait pour effrayer les coupables. Le hibou qui surmontait son casque annonçait que la sagesse se plaît souvent à méditer pendant le silence et le calme des nuits. (Fig. 23.)
Bellone. §
Les Grecs donnaient à Bellone le nom d’Enyo, et cependant la confondaient souvent avec Pallas. Elle était fille de Phorcys et de Céto ; elle était sœur de Mars, et les anciens l’appelaient le plus ordinairement Duelliona.
Les poëtes la peignaient comme une divinité guerrière, qui préparait le char et les chevaux de Mars lorsqu’il partait pour les combats. On la représentait aussi les cheveux épars, tenant une torche à la main. (Fig. 24.) Bellone avait un temple à Rome auprès de la porte Carmentale. C’était dans ce temple que le sénat donnait audience aux ambassadeurs, auxquels il n’était pas permis d’entrer dans la ville, ainsi qu’aux généraux qui revenaient de la guerre. A la porte de ce temple, on voyait une petite colonne que l’on nommait guerrière, contre laquelle on jetait une pierre lorsque l’on faisait une déclaration de guerre.
Bellone avait son rang parmi les dieux communs ; elle était égale au dieu Mars. Ses prêtres étaient installés dans leur sacerdoce en se faisant des incisions à la cuisse. Ils offraient en sacrifice à leur déesse le sang qui coulait de ces blessures, mais cette cruauté n’était que simulée.
Le culte de Bellone, très-célèbre à Rome, l’était beaucoup davantage dans deux villes principales particulièrement consacrées à cette déesse, et qui l’une et l’autre se nommaient Comane.
Sur les anciens monumens on voit Bellone armée d’une pique et d’un bouclier, mais il est très-difficile de la distinguer de Pallas.
Histoire de Mars. §
Le dieu Mars, que les Grecs nommaient Arès, était fils de Jupiter et de Junon. La fable que nous avons rapportée précédemment sur sa naissance, dans l’histoire de Junon, a été imaginée par les seuls poëtes latins. Elle était entièrement inconnue aux Grecs et aux anciens. La nouveauté de cette fable sert à prouver qu’elle n’était qu’une allégorie des Latins, pour peindre la jalousie qu’éprouva Junon en voyant la manière dont Jupiter avait enfanté la sagesse.
Junon confia l’éducation de Mars à Priape, l’un des Titans ou Dactyles idéens. Cet habile instituteur, remarquant les heureuses dispositions de son élève, lui donna l’habitude des exercices du corps et du maniement des armes. Il sut le préparer à devenir un grand capitaine, et lui apprit qu’en se couvrant de gloire il pourrait monter au rang des dieux les plus illustres, et s’élever au-dessus de la foule de petits dieux parmi lesquels sa naissance le plaçait. C’était par reconnaissance et pour rendre hommage aux soins habiles de Priape, qu’on lui donnait la dîme des dépouilles consacrées au dieu Mars.
Il y eut beaucoup de princes de ce nom, et par la suite presque tous les peuples voulurent avoir leur Mars. Nous allons citer les principaux.
dit que le premier de tous, auquel on attribue l’invention des armes et l’art de ranger les troupes en bataille, fut Belus
; l’Écriture Sainte le nomme Nemrod, et le peint comme
un fort chasseur devant le Seigneur
. Il exerça d’abord son adresse contre les bêtes féroces : ensuite il s’en servit contre les hommes ; il parvint à les subjuguer. La gloire et la force étonnent toujours. Les peuples, après avoir d’abord craint et admiré Nemrod, reconnurent combien il était capable de les protéger et de les défendre. L’exécution de ses ordres assurait les triomphes et produisait la sûreté de tous ; on sentit l’utilité d’un chef suprême ; la couronne orna son front, et les descendans de ces mêmes peuples en firent un dieu.
Le savant
nous apprend que le nom Belus fut donné à ce roi de Babylone, parce qu’il fut le premier qui fit la guerre aux animaux féroces
.
Le second Mars était un ancien roi d’Égypte. Le troisième était roi de Thrace, et se nommait Odin. Il se distingua tellement par sa force, sa valeur et ses conquêtes, qu’il mérita parmi ce peuple, le plus belliqueux du monde, le nom de dieu de la guerre ; le même Odin s’appelait souvent Mars Hyperboréen.
Le quatrième Mars était celui de la Grèce, que l’on surnommait Arès ; et le cinquième était le Mars des Latins, qui passait pour être le père de Romulus et de Rémus.
Les Gaulois avaient aussi leur Mars, qu’ils nommaient Hesus, et qu’ils croyaient honorer en lui sacrifiant des victimes humaines. Les Scythes, avec leur simplicité ordinaire, adoraient le dieu de la guerre sous la forme d’une épée ; et les Perses, en faisant l’apothéose du fameux Nemrod, lui donnèrent le nom d’Orion, et le regardèrent comme le dieu des combats. Les Grecs, toujours jaloux d’orner l’histoire de leurs dieux, attribuèrent à leur Mars les aventures de tous ceux que nous venons de citer.
Le célèbre tribunal de l’Aréopage fut institué pour juger le différent survenu entre Neptune et Mars, où Ares. Ce dernier ne voulut point consentir au mariage d’Alcippe, sa fille, avec Allyrotius, fils de Neptune. Ce jeune insensé, n’écoutant que sa passion, eut l’audace de l’enlever. Il ne put échapper au dieu de la guerre, et sa folle témérité lui coûta la vie. Neptune, désespéré de la mort de son fils, appela Mars en jugement. Les plus braves Athéniens s’étant rassemblés pour juger cette affaire, déclarèrent Mars innocent, et le purgèrent à la manière accoutumée.
Le lieu du jugement, situé sur une hauteur, fut nommé Aréopage, des deux mots Arès et pagos, roche de Mars. L’établissement de ce tribunal si respecté pour sa justice, doit être placé, selon les marbres d’Arundel, quinze cent soixante ans avant l’ère chrétienne, sous le règne de Cranaüs.
Le récit de cet événement fut embelli par l’imagination des poëtes ; ils délaissèrent la noble simplicité de l’histoire pour les brillans atours de la poésie. On publia que Mars avait été absous par les douze grands dieux, parce que les juges, au nombre de douze, avaient été choisis dans les familles les plus illustres d’Athènes.
Les noms donnés au dieu Mars avaient différentes significations. Celui d’Arès signifie dommage, et représentait les malheurs de la guerre. Peut-être vient-il aussi du mot hébreu Arists, fort et terrible. Les Latins l’appelaient Gradivus pendant la paix, et Quirinus pendant la guerre.
Romulus, regardé par les Romains comme fils de Mars, obtint le nom de Quirinus, lorsque l’on fit son apothéose. Mars portait le nom de Silvestre et de père, lorsqu’on l’invoquait pour qu’il préservât les campagnes des ravages de la guerre. Les Grecs le nommaient Corythaïx, remuant son casque, pour le peindre sanguinaire et terrible.
Dans les tableaux, on voit son char conduit par Bellone ; ses chevaux, fils de Borée et d’Erinnys, se nommaient la Terreur et la Crainte. Sur sa cuirasse, on remarque plusieurs monstres ; les poëtes ajoutent que la fureur et la colère surmontent son casque, et que la renommée précède toujours ses pas.
Mars avait plusieurs temples dans Rome ; Auguste lui en fit élever un magnifique après la bataille de Philippes, sous le nom de Mars vengeur.
Les prêtres de ce dieu se nommaient Saliens ; ils gardaient les anciles ou boucliers sacrés, dont voici l’origine. La rencontre d’un bouclier d’une forme inconnue jusqu’alors fit croire qu’il était tombé du ciel ; l’oracle consulté, dit que l’empire du monde était destiné à la ville qui conserverait le bouclier. Numa Pompilius, pour mieux assurer sa garde, le fit imiter de manière à ne pouvoir distinguer le véritable. La forme des anciles était ovale, avec une petite échancrure. Leur longueur était d’environ deux pieds et demi. Le nombre des anciles, ainsi que celui des prêtres saliens était de douze. Tullius Hostilius en doubla le nombre.
Pendant la fête des anciles, qui commençait aux calendes de mars, et durait treize jours, on les portait en procession en dansant et en chantant des vers qui avaient rapport à la solennité. Pendant la durée de ces fêtes, on ne pouvait entreprendre aucune expédition militaire, aucun voyage, aucune affaire importante.
Les anciens monumens représentent ordinairement le dieu Mars sous la figure d’un homme très-fort, armé d’un casque, d’une pique et d’un bouclier. (Fig. 25.) Quelquefois il est nu, quelquefois il est couvert d’un habit militaire et d’un manteau. Mars vainqueur porte un trophée ; Mars Gradivus est dans l’attitude d’un homme qui marche à grands pas.
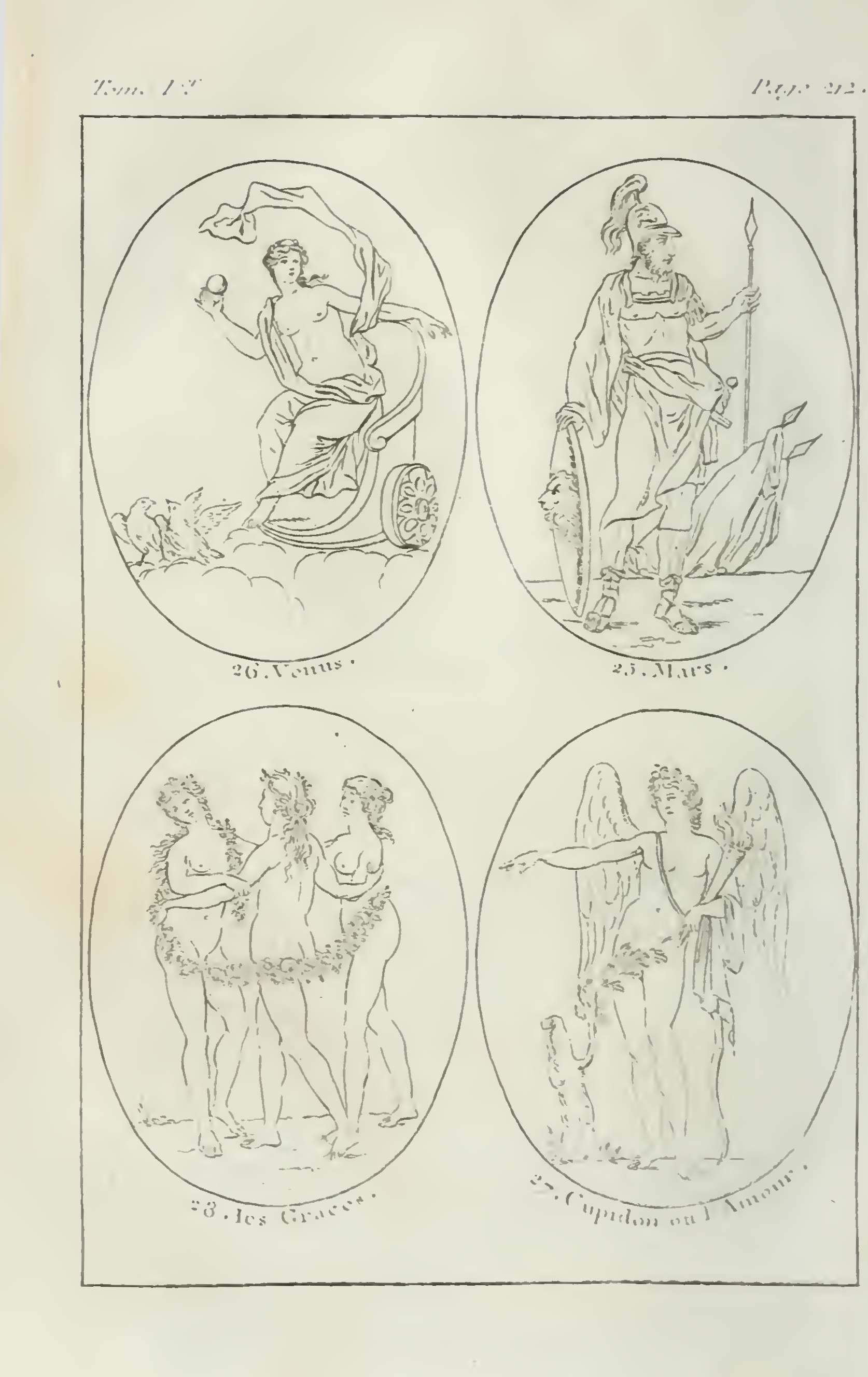
La Victoire. §
dit que la Victoire était fille du Styx et de Pallante, ou de l’Achéron. Elle assista Minerve dans le combat contre les Géans. Elle avait plusieurs temples dans la Grèce et dans Rome. Ce fut dans son temple que les Romains placèrent la statue de Cybèle, lorsqu’ils la firent venir de Pessinunte.
Les Arcadiens, au moment de leur arrivée en Italie, élevèrent un temple à la Victoire, et le dictateur Sylla établit des jeux en l’honneur de cette déesse.
Sur les marbres et les médailles, on la voit, volant dans les airs, et tenant dans sa main une couronne ou une palme. Les Égyptiens la représentaient sous la forme de l’aigle, oiseau toujours victorieux. Quelquefois on la voit portée par un globe, pour désigner qu’elle domine la terre. Dans les victoires navales, on la voit sur une proue de vaisseau.
Histoire et fable de Vénus. §
Emprunter à la vérité son pouvoir et son langage pour les prêter à l’imagination : étonner, émouvoir et toujours plaire, tels sont les effets que la poésie veut produire, lorsqu’elle s’abandonne à ce qu’elle appelle son génie. Elle peut orner, agrandir même un événement ordinaire ; mais ce pouvoir cesse lorsqu’elle a besoin de peindre les excès des passions, car les bornes de la vérité sont les siennes ; elle n’est plus que ridicule et sans effet, dès qu’elle prétend les dépasser.
Les poëtes reconnurent bientôt l’insuffisance de leurs couleurs, lorsqu’ils voulurent peindre la beauté. Son dangereux pouvoir se faisait sentir, et souvent leurs plus séduisantes images s’effaçaient auprès des modèles qu’ils essayaient d’égaler. Pour échapper à cet écueil et sauver leur amour-propre, ils la divinisèrent, et ne se trompèrent point en prévoyant que les faibles mortels deviendraient bientôt leurs complices et s’empresseraient de lui dresser des autels.
Vénus sort de l’écume de la mer ; une conque marine, voguant légèrement sur la superficie des eaux, est poussée par le souffle des Zéphyrs jusqu’au pied du mont Cythérée. Les pieds délicats de la déesse touchent la terre, et les fleurs naissent sous ses pas. Les Heures, chargées de son éducation, la reçoivent, et la conduisent dans le ciel. Elle a pour cortége les Ris, les Grâces et les Jeux. Le ceste, ceinture mystérieuse qui produit toutes les passions et les fait naître à la vue de celle qui la porte, ajoute encore à sa puissance, à ses charmes. Telle était la Vénus des poëtes lorsqu’elle parut devant les dieux.
Laissons à la poésie le soin d’embellir ses tableaux, et bornons-nous à connaître ce que la mythologie nous apprend sur l’origine de Vénus.
dit qu’elle naquit de l’écume de la mer, et du sang que perdit Cœlus lorsqu’il fut blessé par Saturne son fils
. Ce mélange bizarre produisit la plus belle des déesses ; elle parut aux environs de Cythérée, d’où elle passa en Chypre.
Presque tous les poëtes ont suivi la tradition d’ ; cependant , aussi ancien et beaucoup plus célèbre, la dit fille de Jupiter et de Dioné. compte quatre Vénus : la première, fille du Ciel et de la Lumière ; la seconde, née de l’écume de la mer, et mère de Cupidon ; la troisième, fille de Jupiter et de Dioné, femme de Vulcain et mère d’Anteros ; enfin la quatrième était Astarté, épouse d’Adonis, et née en Phénicie.
en distinguait trois : une céleste, qui présidait aux chastes amours, une terrestre, qui présidait aux mariages, et une troisième appelée Aversative, qui éloignait les passions criminelles. Telle est la variété d’opinions qui régnait parmi les anciens poëtes au sujet de Vénus.
Parmi les modernes, l’illustre chevalier paraît ne reconnaître qu’une Vénus. Il la nomme Calycopis : elle était fille d’Otreus, roi de Phrygie. Elle épousa Thoas, qui fut surnommé Cinyras, et fut mère d’Énée. Thoas lui fit élever des temples à Paphos, dans Amathonte, dans l’île de Chypre et à Biblos ; il institua des fêtes en l’honneur de Vénus, que l’on nomma orgies ; et, pour veiller à son culte, il forma un collège de prêtres. , et , sont les auteurs sur lesquels l’illustre se fonde pour donner cette origine à Vénus.
Les fables et les récits des poëtes sur cette déesse, ne peuvent rien éclaircir, parce que l’on y trouve un mélange continuel de physique, de morale et d’histoire. Souvent ils la considèrent comme déesse, quelquefois comme planète, et presque toujours son nom ne sert qu’à peindre les passions.
Il paraît certain que différens personnages ont porté le nom de Vénus ; mais sa véritable origine se trouve dans la Phénicie. Ce peuple oriental adorait Vénus, Uranie ou Céleste, c’est-à-dire la planète de ce nom ; et, par la suite des temps, on mêla à son culte celui d’Astarté, femme d’Adonis.
Lorsque les Phéniciens conduisirent leurs colonies dans les îles de la Méditerranée, ils s’arrêtèrent d’abord dans l’île de Chypre, qui se trouvait être la plus rapprochée des côtes de la Syrie. De là ils allèrent à Cythère, île voisine du continent de la Grèce. Leur commerce et leur religion furent adoptés par les habitans du pays, et l’amour du merveilleux leur fit publier que c’était parmi eux que Vénus avait paru pour la première fois. On la nomma Aphrodite, écume, pour exprimer quelle était arrivée par la mer. Le temple de Cythère était le plus ancien de ceux que Vénus avait dans la Grèce.
L’histoire d’Astarté fut bientôt confondue par les Grecs avec celle de Vénus. L’incertitude des faits historiques, l’impossibilité de les ranger avec ordre, ne laissèrent plus aux poëtes, que leur imagination pour guide ; ils ne consultèrent que leurs passions ou celles des rois et des grands personnages qu’ils voulaient flatter. De là les peintures les plus séduisantes, et souvent les aventures les plus scandaleuses, furent les matériaux dont ils se servirent pour former l’histoire de leur Vénus. La peinture et la sculpture, sœurs de la poésie, se crurent le droit d’imiter ses écarts. On représenta Vénus comme la déesse des plaisirs ; On lui donna pour fils Cupidon ou l’Amour, et tous les chefs-d’œuvre que les arts et les poëtes produisirent lui furent consacrés.
Cependant, quelque mauvaise idée que l’on eût de cette divinité, on la regardait comme l’une des plus puissantes, parce qu’elle présidait aux passions. Partout elle avait des temples. Ceux de Paphos, de Gnide, d’Amathonte, de Cythère et d’Idalie, furent les plus remarquables par leur beauté ; mais les plus profanés par la licence et le désordre.
Le culte de Vénus variait à l’infini. Dans quelques lieux, on le bornait à brûler de l’encens sur ses autels ; dans quelques autres, on immolait une chèvre blanche.
Les femmes avaient coutume de lui consacrer leur chevelure. La reine Bérénice, voulant obtenir pour son mari un succès favorable, dans la guerre contre Séleucus, voua la sienne à cette déesse, et la fit suspendre dans son temple. Elle disparut. On consulta sur cet événement ; et les astrologues, pour flatter la reine, dirent que sa chevelure avait été changée en étoiles, et placée dans le ciel. Cette fable fit appeler chevelure de Bérénice une étoile nouvellement découverte.
Le mélange de l’histoire d’Astarté avec celle de Vénus, donna lieu à la fable d’Adonis. Il était fils de Cinyras, roi de Chypre, et de Myrrha. Cette nymphe fut métamorphosée en l’arbre qui porte son nom, avant la naissance d’Adonis son fils. Lorsque l’instant où il devait voir le jour fut arrivé, l’arbre s’entr’ouvrit, les Naïades reçurent Adonis, et prirent soin de son enfance. Élevé dans les bois, la chasse devint son plus grand plaisir ; Vénus l’y accompagnait, et, lorsqu’elle était forcée de s’éloigner, elle tremblait qu’il ne fût blessé par les bêtes sauvages. Mars, jaloux des soins que Vénus accordait à ce beau jeune homme, suscita contre lui un énorme sanglier. Cet animal furieux s’élança contre Adonis, qui le frappa de son javelot ; mais la blessure ne l’ayant pas renversé mort, il lui resta assez de force pour le déchirer avec ses défenses. Vénus accourut à son secours, mais vainement ; il était mort. Inconsolable de sa perte, elle le métamorphosa en anémone, et obtint de Proserpine qu’il passerait six mois dans les enfers et six mois sur la terre. On éleva des temples au favori de Vénus. Dans celui de Chypre, le plus magnifique de tous, on voyait le célèbre collier d’Ériphile, femme d’Amphiaraüs, à qui Polynice, fils d’Œdipe, l’avait donné pour l’engager à trahir son époux.
L’histoire explique la fable d’Adonis. Elle apprend que ce jeune prince régnait sur une partie de la Phénicie, et réunissait à la plus grande beauté les plus parfaites qualités de l’âme. Il épousa la fille du roi de Byblos, et succéda au trône de son beau-père. Un jour qu’il chassait dans les forêts du mont Liban, un sanglier le blessa très-dangereusement. La reine, croyant la blessure mortelle, fit paraître une douleur si vive, que ses sujets le crurent mort ; le deuil fut général dans la Phénicie. Le prince guérit ; et, dans les transports d’allégresse publique, on peignit le danger qu’il avait couru, en disant qu’il était revenu des enfers. Cette fable s’accrédita d’autant mieux, que, par la suite des temps, Adonis représenta le soleil, et la reine Astarté la lune. On voulut figurer le partage des jours et des nuits, en disant qu’Adonis passait six mois sur la terre, et six mois dans les enfers.
Nous n’essayerons pas de rapporter toutes les fables des poëtes sur Vénus ; elles sont sans nombre, et nous avons déjà dit qu’elles sont un mélange d’histoire, de morale et de physique. Tout poëte avait le droit de les créer à son gré, le génie savait éterniser les siennes, tandis que l’oubli devenait le partage de la médiocrité.
Parmi les plus célèbres, celle du mariage de Vénus avec Vulcain, le plus difforme des dieux, signifie que l’empire de la beauté s’étend même sur ceux qui n’ont pas le don de plaire en partage. Vulcain débarrasse Junon des entraves que lui-même avait forgées par l’ordre de Jupiter ; il met un prix à ce service ; il devient l’époux de Vénus. (Images de ces unions inégales, dans lesquelles on croit compenser les dons de la nature par ceux de la fortune.)
Dans la fable de Mars, on voit le redoutable dieu des combats, couronné par la victoire, ne plus attacher le même prix à ses trophées sanglans, et les abandonner pour venir déposer ses lauriers aux pieds de la beauté.
Le génie de la peinture croit lui devoir un tribut ; il conduit la main d’ ; et ce peintre immortalise son nom, en animant une toile sur laquelle Vénus paraît avec tous ses charmes. Les regards attristés et jaloux de Junon sont l’hommage le plus vrai qu’elle puisse rendre à la beauté de sa rivale. Près d’elle on voit Pallas étonnée ; sa bouche presque en mouvement fait reconnaître qu’elle vient de parler ; et le spectateur, séduit par le talent du peintre, croit l’entendre confirmer le jugement de Pâris, lorsqu’il donna à Vénus la pomme jetée par la Discorde, avec cette devise : A la plus belle.
Il serait impossible de faire connaître toutes les manières de représenter cette déesse. Les ouvrages de peinture et de sculpture variaient autant que les fables.
Lorsqu’elle tient un globe dans sa main, elle représente la Vénus céleste, ou la planète de ce nom. La statue du célèbre la représente montée sur un char tiré par une chèvre marine, les Néréides et les dauphins portant des amours nagent autour d’elle. Très-souvent on la peint portée sur une conque marine, parcourant les ondes de la mer ; sa tête est surmontée d’un voile enflé par le souille des Zéphyrs, l’Amour nage à côté delle ; des Tritons l’environnent ; une rame est à ses pieds pour rappeler son origine ; on y place de même une corne d’abondance, pour désigner les richesses que produit le commerce de la mer.
Lorsque Vénus parcourt la terre ou les cieux, son char est tiré par des colombes ou des cygnes ; l’Amour l’accompagne, et les Grâces lui servent de cortége. (Fig. 26.)
La plus parfaite et la plus belle de ses statues est celle appelée de Médicis ; on l’attribue au célèbre . Une des plus singulières la représente couronnée d’épis, tenant un thyrse environné de grappes et de feuilles de raisin ; on remarque trois flèches dans l’une de ses mains. On a voulu désigner par-là qu’elle lance plus sûrement ses traits lorsque le dieu du vin et les plaisirs de la table sont réunis avec elle. Deux amours l’accompagnent.
Un dessin de représente Vénus placée sur un char traîné par deux lions ; un voile voltige au-dessus de sa tête, et sa main gauche est armée d’une flèche ; un Cupidon volant au-dessus d’elle couronne sa tête ; des lauriers et des myrtes l’environnent de toutes parts ; un homme marche en avant avec une lyre qu’il a l’air de toucher ; deux hommes éclairent les lions avec des flambeaux ; la marche est fermée par un Satyre qui joue de la flûte. Le dessin représente Vénus victorieuse.
L’histoire du saut de Leucate tient trop à celle de Vénus, pour ne pas la rapporter. Il y avait en Leucadie, près de Nisopolis, un lieu fort élevé, du haut duquel on s’élançait dans la mer pour trouver un remède à l’amour. Des filets artistement tendus empêchaient de se blesser en tombant, et l’on payait de riches tributs aux inventeurs de cette fourberie. Phocas fut le premier qui s’élança du haut du rocher. Les expériences réitérées firent apparemment abandonner cet usage ridicule ; les filets ne furent plus entretenus ; mais le promontoire de Leucate resta fameux, et la malheureuse , à laquelle la Grèce donnait le nom de dixième Muse, vint encore ajouter à sa célébrité. Désespérée de l’insensibilité de Phaon, elle courut au promontoire, se précipita dans la mer, et périt dans ses flots.
Le fleuve Selemne, auprès de Parrare, passait aussi pour avoir la propriété d’éteindre les feux de l’amour, lorsqu’on se baignait dans ses eaux.
La rose était particulièrement consacrée à Vénus, comme étant la plus belle des fleurs. La fable ajoutait que sa couleur était blanche d’abord, mais qu’elle avait été légèrement teinte en rouge par le sang d’Adonis, qu’une épine avait fait couler. On lui dédiait le myrte, parce qu’il vient ordinairement sur le bord des eaux, où la déesse avait paru pour la première fois,
La fable se plaît à raconter l’occasion qui lui fit consacrer les colombes.
L’Amour et Vénus se trouvant ensemble dans un lieu couvert de fleurs, Cupidon se vanta d’en cueillir plus que sa mère. Vénus accepta le défi ; mais l’Amour, en se servant de ses ailes pour voler de fleurs en fleurs, allait remporter la victoire, lorsque la nymphe Péristère aida Vénus. L’Amour, piqué de sa défaite, changea la nymphe en colombe. Cette fable vient de l’équivoque du mot grec peristera qui signifie une colombe.
Les surnoms donnés à Vénus variaient autant que ses fables et les lieux où elle était honorée. On l’appelait Uranie, ou Céleste, lorsqu’on la confondait avec la planète de son nom ; Aphrodite, parce qu’elle était sortie de l’écume de la mer. Les Romains la nommaient Murtea, à cause du myrte ; les Syriens, Astarté ; les Perses, Anaïtis. On lui donnait aussi les noms de Mère, de Victorieuse et d’Amie, parce qu’elle présidait à l’union des cœurs, etc.
Fable de l’Amour ou Cupidon. §
L’Amour n’est point un personnage réel ; il n’a d’autre origine que l’imagination des poëtes. en admettait trois, parce qu’il reconnaissait trois Vénus. n’en reconnaît qu’un seul, produit en même temps que le chaos et la terre : il a voulu peindre, par ce personnage allégorique, l’instant où la terre fut peuplée par les hommes et par les animaux. Il les disait fils de la Nuit et de l’Éther. Les poëtes le disent fils du dieu des richesses et de la déesse de la pauvreté, pour signifier que la fortune et la misère peuvent également éprouver le pouvoir de l’amour.
Sans nous arrêter à toutes les généalogies imaginées par les poëtes, nous nous bornerons à dire que par l’Amour on a voulu désigner le principe physique qui servit à lier ensemble les parties divisées de la matière, lorsque le chaos fut débrouillé.
Cette idée générale ne pouvait suffire aux poëtes pour embellir leurs tableaux, ils distinguèrent d’abord deux Amours ; l’un fils de Vénus Uranie, qui présidait aux unions légitimes ; et l’autre, qu’ils nommaient Antéros, était fils de Vénus et de Mars ; il présidait aux passions. (Fig. 27.) Bientôt ils les multiplièrent à l’infini, mais leurs diverses fables appartiennent beaucoup plus à la poésie qu’à la mythologie. Leur culte, leurs temples et leurs autels se confondaient avec ceux de Vénus.
Notes sur la manière de représenter Cupidon. §
Nous n’essayerons pas d’indiquer les différentes manières de représenter Cupidon. Les Muses, les Grâces et les arts de tous les siècles en ont fait l’objet de leurs tableaux les plus rians et les plus aimables. On n’exigera sûrement pas de nous de les rapporter toutes. Qu’il soit permis de citer un seul des chefs-d’œuvre qui ont paru sur ce sujet.
Ce chef-d’œuvre nous rappelle que lorsque voulut peindre Vénus recevant la pomme destinée à la plus belle, pour mieux forcer tous les regards à céder au jugement de Pâris, il rassembla toutes les beautés de la Grèce ; mais l’ingénieux artiste n’imita point le berger du mont Ida. Fidèle aux règles, de son art, ses yeux ne se laissèrent point éblouir. Une seule beauté n’eut pas le droit de les fixer. Ce fut en empruntant à chacune d’elles son trait le plus parfait, que le peintre forma sa Vénus.
A peine eut-il achevé le chef-d’œuvre, que la multitude de beautés qui l’environnait, surprise et confuse à la vue de la déesse, se prosterna devant elle, et toutes ne semblèrent plus être que les nymphes de sa suite2.
Psyché. §
La fable de Psyché n’a aucun rapport avec l’histoire ; c’est une simple allégorie pour figurer l’âme. Son mariage avec l’amour lui fit obtenir les attributs et le rang des immortels. On a voulu marquer par cette union l’empire que les passions ont sur notre âme.
L’aimable et célèbre a paré cette fable de tous les charmes de son esprit, et lui a conservé la tournure naïve et la moralité qui caractérisent ses ouvrages. On n’abrège pas plus que l’on ne sépare les statues des Grâces ; il faut le lire.
Les anciens représentaient Psyché avec des ailes de papillon. Il faut remarquer que, dans la langue grecque, le mot Psyché signifie également âme et papillon.
Les Grâces. §
Parmi les divinités imaginées par les anciens, les plus agréables sans doute étaient les Grâces, puisque c’était d’elles que les autres empruntaient tous leurs charmes. Elles donnaient aux lieux, aux personnes, aux ouvrages, à tout, ce dernier agrément qui embellit la perfection même. Elles seules dispensaient le don général de plaire. Chaque science, chaque art avait sa divinité protectrice ; mais toutes les sciences et tous les arts reconnaissaient l’empire des Grâces. Leur pouvoir, supérieur à celui de la beauté, donnait plus de charmes à la riante jeunesse, et se faisait encore aimer et sentir sous les traits de la vieillesse.
Les anciens ne s’accordaient nullement sur leur origine. Les uns les disaient filles de Jupiter et de Junon, d’autres les disaient filles de Jupiter et d’Eurynome ; mais l’opinion la plus commune est qu’elles étaient filles de Vénus et de Bacchus.
Le nombre des Grâces est incertain. Les Athéniens et les Lacédémoniens n’en comptaient que deux. et les autres poëtes en comptent trois, qu’ils nomment Églé, Thalie et Euphrosine. donne le nom de Pasithée à l’une des Grâces : la Grèce et plusieurs autres pays reconnaissaient souvent quatre déesses de ce nom. Il est vrai qu’alors elles représentaient les Heures, et plus souvent encore les quatre Saisons. Pour les faire reconnaître, on les représentait couronnées d’épis, de fleurs, de raisin et d’olivier, ou de quelque autre feuillage vert. Il existe des statues antiques d’Apollon, tenant à sa main quatre petites Grâces. Quelques auteurs ajoutaient à leur nombre la Persuasion, pour apprendre que plaire est le plus sûr moyen de persuader.
Dans les premiers temps, des pierres non taillées servaient à représenter les Grâces ; on voulait figurer par-là que les objets même les plus simples s’embellissaient par elles.
Par la suite, on les représenta sous la figure de jeunes vierges nues, ou légèrement enveloppées d’une gaze, pour annoncer que la beauté doit être naturelle ; que rien ne peut y suppléer, et qu’elle doit sobrement employer les ornemens étrangers (Fig. 28).
On voyait à Élis trois statues des Grâces : la première tenait une rose, la seconde un myrte, et la troisième un dé à jouer : le myrte et la rose, parce qu’ils sont consacrés à Vénus ; le dé à jouer, parce que la jeunesse aime les jeux.
On rencontrait souvent des statues de Satyres dont les figures étaient hideuses. Ces statues étaient creuses, et dans leur intérieur on trouvait les images des Grâces. (Leçon aussi douce qu’elle est spirituelle, pour nous apprendre que les avantages de la beauté ne suffisent pas.) Souvent les bonnes qualités de l’âme et les grâces de l’esprit ne se laissent point apercevoir au premier coup d’œil. Malheur à qui ne sait pas les chercher ni les reconnaître ! La figure d’ excitait souvent le rire, mais les sages de tous les siècles rendront hommage à la beauté de son génie.
Il est facile de croire que les Grâces eurent des autels sans nombre. On dit que ce fut Étéocle, roi d’Orchomène, qui régla leur culte, et fit élever leur premier temple. Par la suite des temps, cette croyance le fit regarder comme leur père. Cependant les Lacédémoniens lui disputaient l’honneur de leur avoir rendu le premier hommage, et l’attribuaient à Lacédémon, leur quatrième roi.
Les villes de Périnthe, de Bysance, de Delphes, et beaucoup d’autres de la Grèce et de la Thrace, leur avaient élevé des temples. Tous ceux que l’on consacrait à l’Amour étaient embellis par leurs images. Elles occupaient une place dans les temples de Mercure, pour désigner que le dieu de l’éloquence ne peut se passer de leur secours. Il en était de même dans ceux des Muses ; lorsqu’on les invoquait, on n’eût osé oublier les Grâces. et tous les poëtes célèbres imploraient leurs inspirations autant que celles des Muses ; elles étaient inséparables. Dans toutes les saisons de l’année, on célébrait des fêtes en leur honneur, mais le printemps leur était principalement consacré comme à Vénus. On trouvait que les fleurs rappelaient leur image. Toute la Grèce était remplie de monumens qui les représentaient. Smyrne possédait leur tableau peint par . Le sage lui-même avait fait leur statue en marbre, et en avait fait une en or.
On croit généralement qu’elles dispensaient la bonne grâce, l’égalité d’humeur, la gaieté, l’éloquence, la sagesse ; mais la première et la plus belle de leurs prérogatives était de présider aux bienfaits et à la reconnaissance. Les Athéniens, ayant été secourus par les habitans de la Chersonèse dans un danger pressant, élevèrent un autel avec cette inscription : A celle des Grâces qui préside à la reconnaissance. Ils sentaient bien, ces spirituels Athéniens, que l’ingratitude seule peut regarder la reconnaissance comme un fardeau ; mais en même temps ils les peignaient vives et promptes, pour avertir qu’un bienfait ne doit jamais se faire attendre ; ils se plaisaient à répéter
qu’une grâce qui vient trop lentement cesse d’être une grâce
. Tous les attributs et les surnoms de ces déesses étaient allégoriques. Elles se nommaient Charites, Joie, pour désigner que celui qui donne et celui qui reçoit doivent l’un et l’autre éprouver du bonheur. Elles étaient toujours jeunes, pour avertir que la mémoire d’un bienfait ne doit jamais vieillir. Elles étaient vierges, parce que l’intention de celui qui dispense un bienfait doit toujours être pure. Elles étaient douées de prudence, ce qui faisait dire à
:
Les Grâces sont vierges et non pas courtisanes.
Dans leurs danses, elles se tenaient par la main, pour apprendre aux hommes qu’ils devaient s’unir par des bienfaits ; enfin dans ces danses elles formaient toujours un cercle, pour avertir que la véritable reconnaissance cherche toujours à faire retourner les bienfaits vers la source qui les a produits.
Histoire et fable de Vulcain. §
Il paraît qu’il faut distinguer trois Vulcain. Le premier de tous est Tubalcaïn dont parle , et qu’il place dans la dixième génération du côté de Caïn. Tel fut sans doute le premier inventeur de l’art de forger les métaux. Le second Vulcain était un des premiers rois des Égyptiens., ou plutôt leur première divinité. Le silence qu’ils gardent sur son origine porte à croire que, pour la trouver, il faut remonter jusqu’à Tubalcaïn.
Le troisième Vulcain, dont les Grecs ont composé l’histoire de celle des deux premiers, et de ce qu’ils y ont ajouté, était un prince Titan, fils de Jupiter, qu’une disgrâce força de se retirer dans l’île de Lemnos, où il établit des forges. Nous allons parcourir sa fable, telle que les Grecs nous l’ont transmise.
Il était fils de Jupiter et de Junon. Il vint au monde avant terme et contrefait : Jupiter le récompensa de lui avoir fourni des foudres pendant la guerre des Géans, et d’avoir forgé des entraves pour punir Junon, en consentant à son mariage avec Vénus, la plus belle des déesses.
On lui donnait le surnom de Mulciber, comme ayant l’art d’adoucir le fer, ou Tardipes, parce qu’il était boiteux. Après sa retraite ou son exil dans l’île de Lemnos, on l’appela Lemnius. La fable lui attribue les ouvrages les plus fameux dont elle parle. Elle cite entre autres le palais du Soleil, les armes d’Achille, celles d’Énée, le collier d’Hermione, la couronne d’Ariadne, et le chien d’airain qu’il anima. Jupiter fit présent de ce chien à Europe. Procris le reçut d’elle, et le plus grand prix qu’il eut à ses yeux, fut le pouvoir de le donner à Céphale. Jupiter finit par le métamorphoser en pierre.
On reconnaît, en lisant cette fable, que le chien de Vulcain fut imité par quelque statuaire, qui, pour le faire, employa la pierre au lieu de l’airain,
Jupiter, trouvant Vulcain trop laid et trop contrefait pour lui permettre d’habiter le ciel, le précipita d’un coup de pied dans l’île de Lemnos, située près de celles nommées Liparos, qui s’appelèrent d’abord Vulcanies, et ensuite Éolies. Ces îles, remplies de volcans, vomissaient des torrens de lave enflammée ; on les regardait comme les forges de Vulcain, et l’on avait la même idée du mont Etna en Sicile.
L’histoire représente le Vulcain grec, l’un des princes Titans, comme très-habile dans l’art de forger le fer et les métaux. Le feu, qu’il avait si habilement employé, lui fut consacré, et portait souvent son nom. L’utilité de l’art de forger les métaux se fit si bien reconnaître, que les hommes crurent devoir des autels à son inventeur.
La fable dit que Vulcain se fit aider dans ses travaux par les Cyclopes ; après avoir nommé Polyphème leur père, elle désigne ses fils Brontès, Stéropes et Pyracmon, comme les plus célèbres.
Polyphème était fils de Neptune et d’une fille du géant Titye, qui s’appelait Europe, comme la sœur de Cadmus enlevée par Jupiter. Galatée, nymphe marine, fille de Nérée et de Doris, eut le malheur de lui plaire ; il espéra la toucher en lui élevant un temple ; mais, ayant reconnu sa préférence pour Acis, il écrasa son rival en lui lançant un rocher. La triste Galatée, ne pouvant le rendre au jour, le métamorphosa en fleuve ; il coule dans la Sicile, et a conservé le nom d’Acis.
Il paraît que les Cyclopes étaient les premiers habitans de la Sicile. L’ignorance de leur origine les a fait regarder comme les fils du Ciel et de la Terre. Leur premier établissement se fit probablement au pied du Mont Etna, et les flammes qu’il vomit le firent regarder comme la forge de Vulcain. On compara de même le bruit horrible de ce volcan à celui des coups redoublés des Cyclopes sur leurs enclumes. La fable les peignait avec un seul œil au milieu du front. On peut croire qu’ils portaient un masque pour se garantir du feu, et qu’une seule ouverture placée à la hauteur des yeux leur laissait voir leurs ouvrages.
Vulcain eut plusieurs enfans ; mais le plus célèbre fut Érichthonius, ou Érechthée, quatrième roi d’Athènes. On le disait sans mère, ou fils de la Terre. Ses jambes étaient torses et contrefaites ; pour les cacher, il inventa l’usage des chars et des attelages à quatre chevaux de front. Après sa mort, la fable le plaça dans le ciel, et dit qu’il était chargé de conduire la constellation nommée le Chariot. La difformité de ses jambes fit dire aussi qu’il avait des jambes de serpent.
Les fêtes célébrées en l’honneur de Vulcain se nommaient lampadophories, ou porte-flambeaux. Les jouteurs couraient jusqu’au bout de la carrière avec une torche allumée dans leur main. Lorsqu’elle s’éteignait, on était chassé de l’arène, et le prix appartenait à celui qui le premier touchait le but et conservait sa torche allumée.
Dans les anciens monumens, Vulcain paraît toujours avec la barbe et la chevelure négligées ; son habit descend jusqu’au-dessus des genoux ; il porte un bonnet rond et pointu ; sa main droite tient un marteau, et sa gauche des tenailles. (Fig. 29.)
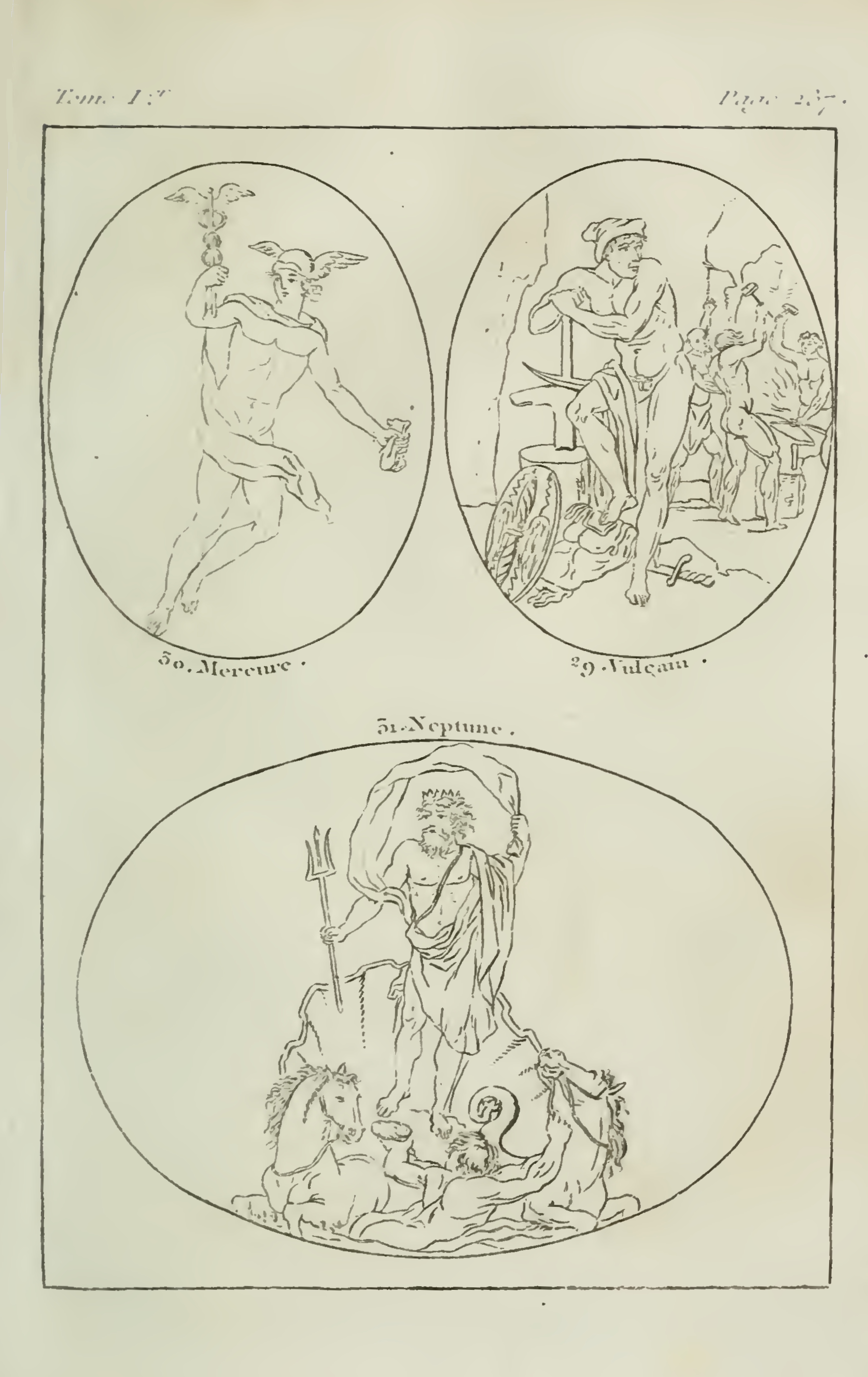
Les Romains, dans leurs traités les plus solennels, prenaient le feu vengeur pour témoin ; et les assemblées où l’on traitait les affaires les plus graves de l’état se tenaient dans le temple de Vulcain.
Parmi les peuples anciens les Égyptiens sont ceux qui ont le plus honoré ce dieu. Il avait à Memphis un temple magnifique, devant lequel on avait placé une statue colossale de soixante-quinze pieds de hauteur. Celle du temple petite et mesquine, excita les rires de Cambyse, lorsqu’il conquit Memphis ; il la fit jeter au feu par mépris.
Le lion était consacré à Vulcain, parce que ses rugissemens imitent le bruit d’un volcan ; et des chiens veillaient à la garde du temple de cette divinité.
Histoire et fable de Mercure. §
Les anciens reconnaissaient un si grand nombre de Mercure, et leur attribuaient des fonctions si différentes les unes des autres, que, pour éviter la confusion, il faut recourir à l’histoire. Elle nous apprend qu’il faut réduire leur nombre à deux, dont le plus ancien était le Thaut ou Thot des Égyptiens, contemporains d’Osiris. Le second était, selon , fils de Jupiter et de Maïa, fille d’Atlas.
L’antiquité n’a point de personnage plus célèbre que le Mercure égyptien. Il était l’âme du conseil d’Osiris. Ce prince, en partant pour la conquête des Indes, voulut qu’il restât auprès d’Isis, qu’il avait nommée régente de ses états ; il le regardait comme l’homme le plus capable de la servir dans l’administration de son royaume.
Mercure fit fleurir les arts et le commerce dans toute l’Égypte. Occupé des sciences les plus sublimes, il employa ses vastes connaissances dans la géométrie, à montrer aux Égyptiens la manière de mesurer leurs propriétés, dont les limites étaient souvent emportées par les débordemens du Nil. Il inventa les caractères hiéroglyphiques, qui, par la suite, servirent à conserver la mémoire du culte religieux et des mystères.
, d’accord avec sur la confiance dont le grand Osiris honorait Mercure, rapporte qu’au lieu des dialectes incertains et grossiers dont on se servait alors, il réforma la langue égyptienne, et lui donna des règles exactes. Il trouva des noms pour des choses d’usage qui n’en avaient pas ; il inventa les premiers caractères, et régla jusqu’à l’harmonie des phrases et des mots. Après avoir fixé les pratiques des sacrifices et le culte des dieux, il forma quelques hommes dans la connaissance des principes astronomiques.
Suite de l’histoire de Mercure. §
Mercure imagina la lyre, à laquelle il donna trois cordes ou trois sons, le grave, l’aigu et le moyen. Il fut l’inventeur de l’élocution et de l’interprétation, ce qui, par la suite, le fit surnommer Hermès. L’Égypte lui attribuait la découverte de l’olivier. Il établit aussi l’usage de la lutte et de la danse, pour faire acquérir à la fois de la force et de la grâce. On porte à quarante-deux le nombre des livres qu’il a laissés, et rien ne peut se comparer au respect que les Égyptiens avaient pour eux.
Quelques auteurs attribuent une partie de ces livres à ou trois fois grand ; mais leurs preuves sont incertaines. Ces livres célèbres n’existent plus depuis long-temps ; on sait seulement que les trente-six premiers contenaient toute la philosophie égyptienne, et les six derniers traitaient de médecine, de médicamens et d’anatomie : tel est le portrait qui nous est resté du plus ancien des Mercure.
Le second Mercure, fils de Jupiter et de Maïa, devint extrêmement célèbre parmi les princes Titans. Après la mort de son père, il eut pour son partage l’Italie, les Gaules et l’Espagne ; mais il n’en fut le maître absolu qu’après la mort de son oncle Pluton.
Ce prince, très-habile, très-fin, artificieux même, voyagea dans l’Égypte pour s’instruire dans les sciences et les coutumes de ce pays. Il y apprit surtout la magie, qui alors y était fort en vogue. Ses parens, les Titans, le consultaient comme un augure ; ce qui donna lieu aux poëtes de le peindre comme l’interprète des dieux. Dans ses voyages en Égypte, il était parvenu à se faire initier dans tous les mystères.
L’emploi que Mercure fit souvent de son adresse et de son éloquence, le fit regarder comme le messager des dieux. Ses succès dans plusieurs traités de paix lui firent aussi donner le nom de dieu de la paix.
Il contribua beaucoup à polir les mœurs et à cultiver l’esprit des peuples qu’il gouvernait. Il les unit ensemble par le commerce et par de bonnes lois. Les grands défauts qu’il joignait à de grandes qualités lui suscitèrent une guerre dans laquelle il fut vaincu par les autres enfans de Jupiter. Il se retira dans l’Égypte, où il mourut. Ce Mercure des Grecs était généralement regardé comme l’inventeur des beaux-arts : les Gaulois l’honoraient sous le nom de Theutatès, et lui offraient des victimes humaines. Tel était le second Mercure dont l’histoire a conservé le souvenir.
Fable des Grecs sur Mercure. §
Mercure, fils de Jupiter et de Maïa, fille d’Atlas, était le plus occupé des dieux de l’Olympe. Confident et messager des autres divinités, il avait soin de toutes leurs entreprises. Il gouvernait la guerre et la paix, présidait aux assemblées, écoutait, inspirait les harangues, y répondait ; enfin, il était le surintendant général des dieux.
Pour exprimer sa promptitude à remplir tant de fonctions, on le représentait avec des ailes à la tête et aux pieds. (Fig. 30.) Ces dernières se nommaient talaria ou talonnières. Pour marquer son talent à négocier la paix, on plaçait dans sa main le caducée, baguette autour de laquelle, on voyait deux serpens entrelacés ; il était le symbole de la paix. On dit qu’un jour il rencontra deux couleuvres qui se battaient ; il les sépara avec sa baguette, ou plutôt il les réunit, et depuis ce temps il portait cette image de la réunion lorsqu’il allait négocier la paix. Ce fut pour honorer Mercure que les négociateurs de la paix portèrent depuis le caducée, et se nommèrent Caduceatores.
Lorsque l’on représentait Mercure avec une simple baguette, ou voulait le désigner conduisant dans les enfers les âmes des morts. On croyait que lui seul avait le pouvoir de séparer, avec cette baguette, les âmes d’avec les corps. Il présidait aussi à la métempsycose, et faisait passer dans d’autres corps les âmes qui avaient accompli le temps qu’elles devaient demeurer dans le royaume de Pluton.
Dans ses portraits, on voyait des chaînes d’or sortir de sa bouche, et s’attacher aux oreilles de ceux qui l’écoutaient : image parfaite du pouvoir avec lequel son éloquence entraînait les esprits.
Ces statues, placées dans les carrefours indiquaient le chemin aux passans. Quelquefois les Romains adossaient ces statues à celles d’autres dieux. Celles adossées à Minerve, se nommaient Hermathènes ; celles adossées à l’Amour, se nommaient Hermérotes, etc.
On l’appelait Mercure, de mercatura, négoce, parce qu’il y présidait ; mais, comme on le soupçonnait de protéger aussi la fourberie, on le regardait comme le dieu des voleurs. Son aventure avec Battus prouve qu’il volait quelquefois lui-même. Un jour il vit Apollon gardant les troupeaux d’Admète : il lui vola quelques bœufs, et fut aperçu par Battus. Mercure, pour le séduire et lui faire garder le secret, lui donna une belle vache ; mais, n’osant encore se fier à sa discrétion, il se retira, et bientôt après il reparut sous une autre forme. Il questionna Battus sur le larcin, et lui promit un bœuf et une vache s’il lui découvrait le voleur. Celui-ci, tenté par l’appât du gain, décela le secret ; aussitôt Mercure se fit reconnaître, elle changea en pierre de touche. L’origine de cette fable vient de ce que Battus fut le premier à reconnaître la propriété de cette pierre, qui sert à découvrir la nature des métaux.
On donnait à Mercure le nom de dieu à trois têtes, à cause de sa puissance dans le ciel, sur la terre et dans les enfers, ou, selon quelques poëtes, parce qu’il eut trois filles d’Hécate. On l’appelait Cyllenius, du nom de la montagne de Cyllène, sur laquelle il était né ; Nomius, à cause des lois dont il était l’auteur ; Camillus, qui sert les dieux, nom qui depuis fut donné à ceux qui servaient dans les sacrifices des dieux ; Vialis, parce qu’il présidait aux grands chemins. Ses statues, dans ces cas, n’avaient ni pieds ni mains : c’est ce que nous appelons des bustes.
Mercure fut l’inventeur des poids et mesures, qui, servant à vendre en détail, multiplient les profits du commerce. Il inventa la lyre, à laquelle les Latins donnèrent le nom de testudo, tortue, parce que la lyre fut faite avec l’écaille de cet animal. Quelques poëtes disent qu’il en fit présent à Apollon, et l’échangea contre le caducée.
Dans les sacrifices offerts à Mercure, on brûlait en son honneur les langues des victimes, parce qu’il était le dieu de l’éloquence, On plaçait sa statue devant la porte dei maisons dans l’espoir qu’il en écarterait les voleurs, dont il était le dieu.
Divinités de la mer et des eaux. §
Les besoins de la vie, toujours renaissans, ces besoins dont la privation cause la mort, portèrent les hommes à croire qu’il existait des dieux chargés d’y présider. De là chaque élément eut sa divinité. L’impossibilité de concevoir ces êtres invisibles leur fit joindre des êtres animés qui leur servaient de symbole. C’est ainsi que les Égyptiens donnèrent les noms d’Osiris et d’Isis au soleil et à la lune. Neptune, célèbre parce qu’il commandait les flottes de Jupiter, devint le dieu des mers. Chaque fleuve, chaque fontaine, chaque amas d’eau eut sa divinité particulière.
Ce culte variait comme les coutumes et les opinions des différens peuples, mais le culte de l’eau était général. Les Égyptiens avaient la mer en horreur, parce qu’elle leur représentait le redoutable Typhon. Ils réservaient toute leur vénération pour l’eau du Nil. Ils nommaient ce fleuve Océan, Ypeus ou Nilus, souvent même Siris, par abréviation d’Osiris. Chez eux ce fleuve, ou plutôt le dieu de l’eau, était représenté par un vase percé de toutes parts, qu’ils nommaient hydria. Les Perses ayant prétendu soutenir la prééminence du feu, leur grande divinité, les prêtres égyptiens acceptèrent le défi ; l’hydria fut placée sur un brasier ardent, mais les trous du vase, adroitement fermés avec de la cire, laissèrent échapper l’eau qu’il contenait, et le Nil fut vainqueur. Depuis ce temps, rien n’égalait le respect des Égyptiens pour l’hydria, qu’ils nommaient aussi dieu Canope, selon eux, le Nil, ou l’eau en général, était le principe fécond de toutes choses, et donnait seul le mouvement et la vie à tout ce qui respire.
Les Indiens rendaient au Gange les honneurs divins. Cette superstition dure encore, et les princes qui règnent sur les bords de ce fleuve font payer à leurs sujets le droit de s’y baigner et d’y puiser de l’eau.
Presque tous les peuples de la terre faisaient des libations à l’Océan, aux mers, aux fontaines et aux fleuves. La Grèce n’avait ni rivières ni fontaines où l’on ne plaçât des statues et des inscriptions religieuses. On attribuait à l’eau les effets les plus surprenans, et les poëtes étendirent infiniment ce genre de culte et d’idolâtrie en y joignant leurs fonctions. De là sont venues ces divinités dont le nombre surpasse celles du ciel et des autres parties de l’univers.
Océan avait eu de Téthys soixante-douze nymphes, nommées Océanides ; Nérée, cinquante Néréides, dont rapporte les noms. fait monter le nombre des nymphes des eaux jusqu’à trois mille ; et, si l’on ajoute les Naïades, les Napées, les Lymniades, etc., etc., on trouvera que les divinités des eaux étaient innombrables. Nous nous bornerons à donner les fables les plus essentielles parmi celles qui tiennent à cette partie de la mythologie.
Histoire d’Océan et de Téthys. §
Océan était fils du Ciel et de la Terre. Il était à juste titre regardé comme le premier dieu des eaux, puisqu’il en contient le plus grand amas, et qu’il les communique aux autres mers et à la terre par cette admirable circulation des fleuves, des rivières, des fontaines et des nuages, qui portent partout la fécondité.
Il paraît certain que ce nom a été porté par un prince de la famille des Titans.
dit que Junon fut élevée chez Océan et Téthys
.
dit que l’Océan était ami intime de Prométhée, frère d’Atlas
; cependant il paraît que les anciens ont plus généralement regardé l’Océan comme une divinité physique.
Ce dieu des eaux eut pour femme Téthys, dont naquirent Nérée et Doris, qui eurent un grand nombre d’enfans connus sous le nom de nymphes. Celles qui présidaient aux forêts, aux arbres et aux prairies se nommaient Dryades, Hamadryades, ou Napées. Celles qui veillaient aux fleuves, aux rivières, aux fontaines, se nommaient Naïades. Celles qui habitaient les montagnes se nommaient Oréades, et celles qui commandaient sur la mer s’appelaient Néréides, du nom de leur père. La plus illustre de ces dernières, que l’on nommait aussi Thétis, doit être distinguée de la femme d’Océan. Jupiter l’aima ; mais ayant lu dans le livre des destins qu’elle aurait un fils plus grand que son père, il la donna pour épouse à Pélée, qui fut père d’Achille.
Deux monumens antiques seulement nous ont transmis la manière dont on représentait Océan. Le premier est une statue déterrée à Rome vers le milieu du seizième siècle : il fait voir ce dieu assis sur les ondes de la mer, sous la figure d’un vieillard tenant une pique ; et près de lui on remarque un monstre marin d’une forme inconnue.
Le second est une pierre de , représentant pareillement un vieillard assis sur la mer, et dans le lointain on aperçoit quelques vaisseaux.
L’histoire d’Océan n’est point étendue parce que les anciens ne le regardaient point comme un personnage réel. On représentait Nérée environné de ses filles, de dauphins et de chevaux marins.
Histoire de Neptune et d’Amphitrite. §
Neptune, fils de Saturne, était frère de Jupiter. L’empire des eaux lui échut en partage. Son sceptre était un trident, son char une vaste coquille, ses coursiers des veaux marins, ou des chevaux dont la moitié du corps avait la forme de poisson. Les Tritons en grand nombre lui servaient de cortége, et sonnaient de la trompe avec des conques marines.
L’histoire nous apprend que Neptune, l’un des plus célèbres princes Titans, eut en partage la mer, les îles, et tous les lieux qui s’en rapprochent.
dit que Neptune fut le premier qui commanda une armée navale. Saturne, son père, l’employa pour s’opposer par mer aux entreprises des Titans. Jupiter son frère, s’étant emparé de l’empire de Saturne, lui continua le commandement des flottes, et le trouva toujours fidèle à seconder ses desseins. Les princes Titans ayant fui devant Jupiter jusque dans les pays occident taux, Neptune les empêcha d’en sortir, et la fable peignit sa victoire en disant qu’il les avait enfermés dans les enfers.
Les poëtes multiplièrent le nombre des Neptune, en donnant ce nom à tous les princes inconnus qui arrivaient par mer, et s’acquéraient quelque célébrité ; c’est à cet abus qu’il faut rapporter la multitude de fables, de métamorphoses et d’aventures attribuées à Neptune.
Amphitrite, femme de Neptune, est un personnage entièrement poétique, n’ayant aucun rapport avec l’histoire, et portant ce nom parce que la mer environne les terres. Quelques anciens cependant la croient fille d’un prince Titan, et disent que Neptune eut besoin d’employer un négociateur très-adroit pour réussir à ce mariage. Cette aventure a donné lieu à la fable du dauphin, envoyé par Neptune pour déterminer Amphitrite à devenir son épouse. Ce dieu, par reconnaissance, plaça le dauphin parmi les astres, auprès du Capricorne, et doua les poissons de cette espèce d’une vitesse à la nage supérieure à celle de tous les autres. Les poëtes leur supposent un penchant qui les porte à aimer les hommes, et à les secourir dans les naufrages.
Si nous en croyons , Neptune était Libyen, et très-anciennement honoré dans ce pays ; mais il paraît que ce dieu des Libyens ne présidait point à la mer. Il avait instruit ses peuples à dompter les chevaux ; ce qui le fît surnommer Hippius.
La confusion de ces deux personnages produisit la fable de Neptune frappant avec son trident la terre, dont il fait sortir un superbe cheval.
L’origine de la fable de Neptune aidant Apollon à bâtir les murailles de Troie est fondée sur ce que les murs de cette ville et ses digues contre la mer étaient si solides, qu’on attribuait cet ouvrage aux dieux. L’avare Laomédon, loin de les honorer, s’empara de l’argent amassé dans le temple de Neptune, et négligea le culte d’Apollon. Une violente irruption de la mer détruisit les digues, et laissa les terres couvertes de cadavres et de limon après s’être retirée : la chaleur du soleil causa la peste ; et le peuple, toujours superstitieux, répéta que ces deux fléaux étaient les suites de la vengeance de Neptune et d’Apollon.
Les Grecs donnaient à Neptune le surnom de Posédon, ou Brise-vaisseaux. Son trident avait trois pointes, pour distinguer les eaux de la mer, celles des fleuves et celles des fontaines.
Les nombreux vaisseaux de Neptune étaient distingués par différens animaux, ou différentes figures placées sur les proues ; c’est à cela seul qu’il faut rapporter ses métamorphoses.
On représente ordinairement le dieu de la mer voguant sur les eaux, dans une conque à laquelle sont attelés deux chevaux marins. D’une main il tient son trident, et de l’autre il s’appuie sur un dauphin. (Fig. 31.)
Nous ne ferons point mention de tous les surnoms donnés à Neptune, et de tous ses temples : leur nombre égalait celui des nautoniers qui échappaient aux naufrages.
Ses victimes ordinaires étaient le cheval et le taureau. Le mois de février lui était consacré, parce que dans ce mois on faisait les purifications, et c’était avec de l’eau qu’elles se faisaient.
Pendant les fêtes de Neptune, les chevaux et les mulets, couronnés de fleurs, demeuraient sans travail. Personne n’osait troubler leur repos. Les hommes voulaient, par ce moyen, lui témoigner leur reconnaissance de ce qu’il leur avait appris à dompter ces animaux, et à les rendre utiles,
Des Tritons et des Sirènes. §
Le premier des Tritons était fils de Neptune et d’Amphitrite, ou, selon quelques poëtes, de Céléno. La partie supérieure de son corps ressemblait à celle d’un homme, et la partie inférieure à celle d’un dauphin.
Triton était trompette de Neptune : il en sonna dans la guerre des dieux contre les Géans. Ce bruit extraordinaire, dit la fable, les épouvanta tellement, qu’ils prirent la fuite et cédèrent la victoire aux dieux. Cette fable ne serait-elle pas une tradition altérée de la chute des murs de Jéricho ? Au reste, les fables des Tritons ont été imaginées d’après la croyance presque générale des anciens et des modernes, qu’il existe des hommes marins. La pente naturelle des Grecs vers le merveilleux, jointe à la diversité prodigieuse des animaux marins, a suffi pour accréditer ces fables et les rendre innombrables.
On doit avoir la même opinion des Sirènes. Les poëtes les représentent comme de jeunes et belles filles, habitant les rochers des côtes de la Sicile. Le charme de leur chant attirait les nautoniers, et leurs vaisseaux venaient se briser contre les écueils. Leucosie, Ligie et Parthénope, étaient les trois plus célèbres. La dernière mourut dans une ville à laquelle on donna son nom. Le tyran Phalaris l’ayant rebâtie par la suite des temps, lui donna le nom de Neapolis, Naples, ou Ville neuve.
Les Sirènes étaient filles du fleuve Achéloüs et de la nymphe Calliope. , dans ses Métamorphoses, dit qu’elles étaient les compagnes de Proserpine, lorsque Pluton enleva cette fille de Cérès. Elles prièrent les dieux de leur accorder des ailes pour la chercher autour de la grande mer ; elles les obtinrent. La jalouse Junon leur inspira le perfide dessein de défier au chant les neuf Muses. Elles furent vaincues ; les élèves d’Apollon les punirent en leur arrachant leurs ailes, dont elles se firent des couronnes. Plusieurs monumens anciens représentent les Muses avec cet ornement à leur tête.
Les Sirènes avaient la voix très-belle, et pinçaient parfaitement du luth. Orphée, pendant le voyage des Argonautes, empêcha ses compagnons d’être séduits par elles, en chantant lui-même les batailles et les victoires des dieux. La perfection de ses chants, qu’il accompagnait avec son luth, fit connaître aux Sirènes toute sa supériorité. De dépit elles jetèrent leurs instrumens dans la mer, et perdirent la voix.
Ulysse leur fît éprouver un nouvel affront. Prévenu contre leur séduction par la magicienne Circé, il se fit attacher au grand mât de son vaisseau, après avoir eu soin de faire boucher les oreilles de ses compagnons avec de la cire.
L’histoire explique ces deux fables en disant que des courtisanes et des comédiennes habitaient les côtes de la Sicile, et cherchaient à fixer les voyageurs auprès d’elles en leur présentant sans cesse l’image des plaisirs.
On les représentait sous la figure de très-belles filles jusqu’à la ceinture, et le reste de leur corps ressemblait à celui des Tritons. Le mot Sirène vient de Séira, chaîne, et désigne la difficulté de résister, à leurs charmes et d’éviter leurs liens.
Le saint homme
dit dans un de ses livres :
Je pleure mes malheurs sur le ton des Sirènes.
Il paraît qu’il voulait désigner certains oiseaux des Indes dont parle
; la douceur de leur chant endormait les voyageurs ; ils n’habitaient que les lieux les plus sauvages.
Protée. §
Protée, fils de Neptune, ou d’Océan et de Téthys, était chargé du soin de conduire les troupeaux de Neptune, composés de phoques, de veaux marins, etc. Les Latins le nommaient aussi Vertumnus. Il avait le don de prendre à son gré toutes les formes. Épris de Pomone, déesse des jardins, il choisit pour la persuader la forme d’une vieille à laquelle cette déesse accordait toute sa confiance. Ce stratagème lui réussit ; il devint l’époux de Pomone.
La fable d’Aristée, fils d’Apollon et de la nymphe Cyrène, prouve tout le pouvoir de Protée pour se métamorphoser. Eurydice allait épouser Orphée, déjà l’autel nuptial était préparé dans une prairie émaillée de fleurs ; le fougueux Aristée se présente, et veut s’opposer à cette union ; il s’élance pour saisir Eurydice ; elle fuit dans la prairie, et croit n’avoir à redouter que ce jeune insensé, lorsqu’un serpent venimeux, caché sous les fleurs, se trouve froissé par le pied d’Eurydice, et se venge en lui faisant une blessure mortelle. Les nymphes, désolées de ce malheur, punirent Aristée en tuant ses abeilles. Pour réparer cette perte, sa mère Cyrène l’envoie consulter Protée, lui recommande de le surprendre pendant son sommeil, de le garrotter fortement, et l’assure qu’après avoir vainement essayé ses métamorphoses, il reprendra sa première forme, et lui dira le secret dont il a besoin. Protée, surpris par Aristée, se réveille chargé de liens ; vainement il change de forme ; il est forcé de céder pour recouvrer sa liberté. Il apprend à ce jeune homme qu’il doit immoler quatre génisses aux mânes d’Eurydice. Il en sortit effectivement de nombreux essaims d’abeilles.
nous assure qu’en exposant au soleil la peau d’un taureau ou d’une génisse, elle attire des insectes qui bientôt se changent en abeilles
.
On trouve dans l’histoire un Protée, roi d’Égypte, vivant vers le temps de la guerre de Troie. On croyait que ce prince, impénétrable, très-sage et très-prévoyant, avait le pouvoir de lire dans l’avenir. La difficulté de connaître ce qu’il voulait cacher, et le désir de l’embarrasser dans ses réponses, ont pu faire dire aux poëtes que pour découvrir ses secrets il fallait le lier.
Quelques auteurs disent que Protée fut un des magiciens que Pharaon appela lorsque fit ses miracles à la sortie d’Égypte. D’autres enfin regardent la fable de Protée comme une allégorie servant à faire connaître que la vérité demeure cachée pour ceux qui ne s’attachent pas fortement et constamment à l’étudier.
Glaucus, Portunus, Phorcys, Saron, Égéon. §
Glaucus était pêcheur. Un jour il s’aperçut que les poissons acquéraient une force extraordinaire en touchant une herbe sur laquelle il les avait posés. Il voulut l’éprouver, et, dès qu’il l’eut touchée, il s’élança dans la mer, où les dieux marins le reçurent dans leur compagnie.
Glaucus était un habile pêcheur, qui avait le talent de plonger et de rester long-temps sous l’eau. Pour se rendre plus recommandable, il se vantait d’être reçu par les dieux de la mer ; il finit par se noyer, et donna lieu à la fable que nous venons de citer.
Les anciens reconnaissaient trois Glaucus ; l’un, fils de Minos ; le second, fils d’Hippolochus ; et le troisième, surnommé le Politique.
Portunus, ainsi nommé par les Latins, était fils d’Athamas et d’Ino, fille de Cadmus. Junon, ennemie de Cadmus, parce qu’il était frère d’Europe, inspira tant de fureur au roi de Thèbes Athamas, époux d’Ino, qu’il la menaça de la déchirer avec son fils Mélicerte. L’un et l’autre s’enfuirent précipitamment, et tombèrent dans la mer, où ils périrent. La fable en fit des dieux marins. Le nom d’Ino fut changé en celui de Leucothoé, et Mélicerte fut appelé Palémon.
On le peignait avec une clef à la main droite, pour désigner que les ports étaient sous sa protection et sous sa garde.
Les dames romaines honoraient beaucoup Leucothoé ; mais elles n’osaient offrir des vœux à cette déesse qu’en faveur de leurs neveux, parce qu’elles redoutaient pour leurs propres enfans les malheurs qui avaient accablé Leucothoé et son fils. Les femmes esclaves n’avaient pas le droit d’entrer dans son temple.
Phorcys ou Phorcus, dieu marin, était fils de Pontus et de la Terre ; d’autres disent de Neptune. Il était père des Gorgones, dont nous parlerons dans l’histoire de Persée. Thoose, sa fille, fut mère de Polyphème, le plus célèbre des Cyclopes. On le regardait aussi comme le père du serpent qui gardait les pommes d’or du jardin des Hespérides, et comme celui de Scylla. Cette nymphe, aimée par Neptune, excita la jalousie d’Amphitrite ; la déesse empoisonna la fontaine où elle se baignait. Scylla, ressentant l’effet du poison, devint furieuse, et se précipita dans la mer, où elle fut changée en monstre marin très-redoutable pour les vaisseaux.
Telle est la fable que l’on imagina sur le gouffre situé entre Reggio et Messine ; le bruit des courans d’eau ressemble à des aboiemens de chiens. La crainte qu’inspirait ce gouffre et celui de Charibde, situé à son opposite, fit honorer l’un et l’autre comme des dieux marins. Le gouffre de Charibde prit son nom d’une femme très-cruelle, qui pillait les voyageurs ; Hercule en purgea la terre.
Saron était regardé comme le dieu particulier des mortels. Il était roi de Corinthe. Ce prince, très-passionné pour la chasse, s’élança dans la mer, en poursuivant un cerf. Épuisé de chaleur et de fatigue, il y périt. Son corps fut rejeté par la mer auprès du bois sacré de Diane, dans le marais Phœbéen. On enterra son corps dans le parvis du temple ; et, depuis ce temps, ce marais se nomme Saronique, au lieu de Phœbéen.
Égéon est peint par
comme un redoutable géant.
le dit fils du ciel et de la Terre
. Il habitait la mer, il en sortit pour secourir les Titans contre Jupiter. Neptune le vainquit, et le força de rentrer sous les eaux.
Nous ne devons pas omettre les fables des Alcyons, oiseaux marins qui ont la propriété de faire leurs nids sur les flots, même pendant l’hiver. Pendant les quatorze jours, du 13 décembre au 28 du même mois, la mer reste calme et semble respecter ces oiseaux. Les mariniers donnent à ce temps le nom de jours alcyons. Cette singularité produisit une fable.
Alcyone, femme de Ceix, roi de Trachine, vit en songe son époux qui revenait de consulter l’oracle de Delphes. Au lever de l’aurore, elle courut sur le rivage ; elle aperçut un corps flottant, et reconnut Ceix ; n’écoutant plus que son désespoir, elle se précipita dans la mer. Les dieux, touchés de compassion, les changèrent l’un et l’autre en alcyons.
Nymphes, Dryades, Hamadryades, Napées, Oréades et Néréides. §
Ces divinités tiraient leur origine de l’eau, et doivent être rangées parmi les divinités de la mer. Celles qui habitaient la terre portaient généralement le nom de nymphes. Celles qui gardaient les fleuves et les fontaines se nommaient Naïades. Celles qui habitaient les marais, les étangs, se nommaient Limniades ; celles des bocages, Napées ; celles des bois, Dryades ; et celles qui étaient particulièrement attachées à quelques arbres, avec lesquels elles naissaient et mouraient, se nommaient Hamadryades. Les nymphes des montagnes s’appelaient Oréades, et celles de la mer portaient toutes le nom de Néréides. On leur offrait en sacrifice du lait, de l’huile, du miel et quelquefois des chèvres. On croit que le mot nymphe vient de lympha, eau, ou du mot phénicien néphas, âme.
Avant le système du Tartare et des Champs-Élysées, on croyait que les âmes erraient autour des tombeaux, ou dans les jardins et les bois qu’elles avaient aimés pendant qu’elles étaient réunies à des corps. On avait pour ces lieux un respect religieux ; et c’est de là qu’était venue la coutume de sacrifier aux mânes sous des arbres verts. On chargea les Nymphes du soin d’y présider, et l’on juge d’après cela que leur nombre dut s’accroître à l’infini. Nous croyons très-inutile de les nommer toutes.
D’Éole et des vents. §
Éole, dieu des vents et des tempêtes, doit être placé parmi les dieux de la mer. Il passait pour fils de Jupiter, et devait ce titre à son seul mérite.
Ce prince, fils d’Hippotas, vivait au temps de la guerre de Troie, et régnait sur les îles Éolies, qui, avant lui se nommaient Vulcanies. Elles sont au nombre de sept. Les connaissances des anciens sur la navigation étaient si bornées, et les dangers de la mer étaient si grands, que l’on regardait comme au-dessus du pouvoir des hommes de les prévoir et de s’en garantir.
Éole, plus prévoyant, plus observateur et plus instruit que ses contemporains, parut supérieur à la nature humaine, parce que souvent il annonçait les tempêtes. Il observait attentivement de quel côté les vents poussaient la fumée qui s’élevait au-dessus des volcans, et par ce moyen il était parvenu à distinguer ceux qui avaient plus de violence et de durée. Ce fut de cette manière qu’il prévint Ulysse du changement qui allait survenir dans le temps : il voulut l’engager à différer son départ. La manière assurée dont il donnait ce conseil fit croire aux compagnons de ce prince qu’Éole commandait aux tempêtes, et qu’à la prière d’Ulysse il pourrait les retenir. Ils décidèrent leur départ ; bientôt ils se repentirent de leur folle précipitation : la tempête survint, et, presque tous périrent. Les poëtes ne manquèrent pas de célébrer à leur manière cette prédiction d’Éole. Ils feignirent qu’à la prière d’Ulysse ce dieu avait renfermé les Vents dans des peaux, et lui en avait confié la garde ; mais que ses imprudens compagnons les ayant ouvertes, les Vents déchaînés avaient bouleversé la mer et fait périr le vaisseau qui les portait. La crainte inspirée par ces terribles divinités ne laissait entreprendre aucun voyage sans leur offrir des sacrifices. Les descendans d’Éole, après avoir donné plusieurs rois à la Grèce, envoyèrent des colonies dans l’Asie Mineure, dont ils peuplèrent les côtes ; ensuite ils passèrent en Italie.
La fable dit que les Vents étaient fils d’Aurore et d’Astrée, l’un des Géans qui firent la guerre aux dieux. Ses enfans furent aussi turbulens que lui. Les quatre principaux donnèrent leurs noms aux vents. Le premier est Borée, ou vent du septentrion ; Auster, ou vent du midi, est le second ; Eurus, vent de l’orient, est le troisième ; et Zéphyre, vent de l’occident, est le quatrième.
Borée, désirant épouser Orythie, fille d’Érechthée, roi d’Athènes, fut refusé par ce prince : il se servit de son souffle pour l’enlever et la transporter dans la Thrace ; il en eut deux fils, Calaïs et Zéthès, dont nous parlerons au voyage des Argonautes.
La fable rapporte que Borée, métamorphosé en cheval, donna naissance à douze poulains d’une telle vitesse, qu’ils couraient sur l’eau sans enfoncer, et sur les épis sans les faire plier. Cette allégorie sert à peindre la vitesse des vents.
Divinités de la terre §
Les souvenirs altérés et trop faibles de la tradition sainte ne suffisaient plus pour ramener à la connaissance du vrai Dieu. La force, le nombre et l’adresse, assuraient à l’homme l’empire de la terre ; il en jouissait sans reconnaissance, et ne songeait qu’à satisfaire ses besoins et ses passions.
Cependant, quelque grand que fût son orgueil, il reconnut qu’il ne pouvait commander aux élémens, et qu’ayant à lutter sans cesse contre les dangers qui menaçaient sa vie, il avait besoin de secours et de protection.
La douleur, la crainte et la nécessité, le forcèrent à croire qu’il existait une puissance supérieure à la sienne ; il se soumit à l’implorer, mais il se crut le droit d’attacher un prix à ses hommages : il lui demanda de veiller à ses besoins. L’idée d’un seul Dieu, suprême, universel, et dispensateur de tous les biens, l’aurait trop effrayé ; il partagea ses fonctions son pouvoir, multiplia les dieux, et, prêtant à ces divinités de son imagination les passions qui l’agitaient lui-même, il espéra qu’en offrant des sacrifices plus nombreux il obtiendrait davantage.
Ce fut ainsi que l’homme étendit sans cesse le nombre des dieux du ciel, de la terre, de la mer et des enfers. La terre elle-même devint une divinité. Les bois, les campagnes, les moissons, les jardins, les prairies, eurent des dieux protecteurs ; les maisons eurent leurs dieux lares, leurs dieux pénates, et chacun d’eux eut ses honneurs, ses fonctions et son culte.
On les considéra d’abord comme des êtres invisibles et supérieurs à la nature humaine ; mais quelques hommes s’étant distingués par la culture des champs, des jardins, ou par quelques inventions utiles, on donna leurs noms à ces divinités inconnues, et bientôt on les confondit ensemble.
Dans ce nombre immense, on en comptait douze du premier ordre, que l’on appelait Consentes. Ils différaient des douze grands dieux dont nous avons parlé précédemment.
Jupiter et la Terre étaient les deux premiers.
Le Soleil et la Lune, qui influent si considérablement sur les récoltes et la végétation, étaient les seconds.
Cérès, déesse des blés, et Bacchus, dieu du vin, étaient les troisièmes.
Robigus et Flore étaient les quatrièmes. Le premier empêchait les fruits de se gâter, et veillait à les faire mûrir ; Flore veillait à la naissance des fleurs.
Minerve et Vénus étaient les cinquièmes. La première avait fait naître l’olivier, et la seconde présidait aux jardins.
Enfin l’Eau et Bonus Eventus étaient les sixièmes. La première, parce que, sans elle, la Terre est aride, et ne produit rien ; le second, dont le nom signifie bon succès, veillait à procurer de bonnes récoltes.
Tels étaient les principaux dieux de la terre. Leurs fonctions et leurs noms prouvent qu’ils ne devaient leur origine et le culte qu’on leur rendait qu’au besoin que les hommes avaient de leur secours.
Démogorgon. §
Cette divinité allégorique était le génie de la terre. On avait tant de crainte et de vénération pour son nom, que personne n’osait le prononcer hautement. Les philosophes regardaient cette divinité comme l’esprit de chaleur qui produit les plantes et leur donne la vie. Le peuple l’honorait comme un véritable dieu. On le représentait sous la forme d’un vieillard crasseux, couvert de mousse, pâle et défiguré, habitant toujours les entrailles de la terre. Il avait pour compagnons l’Éternité et le Chaos. (Fig. 32.)
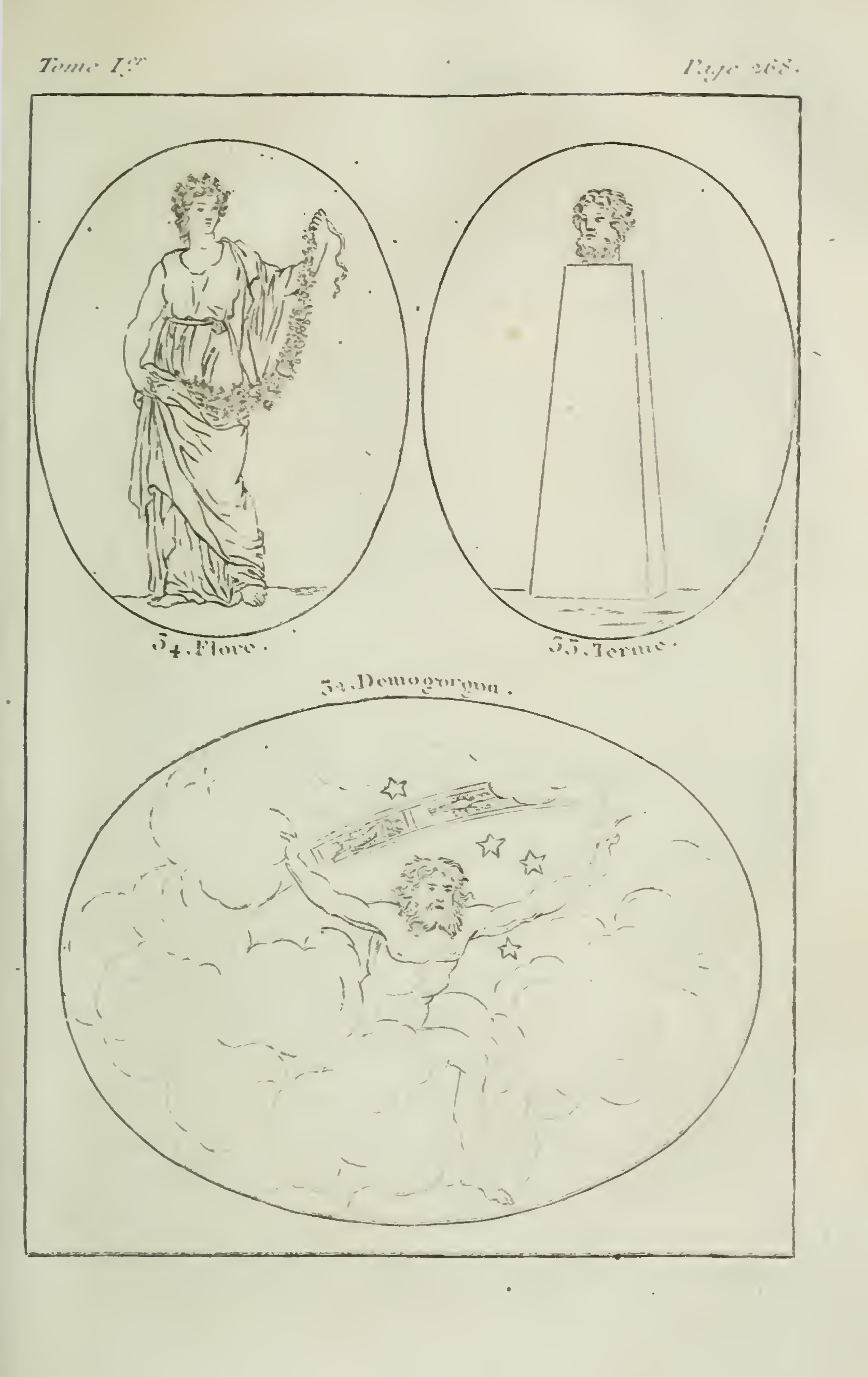
Nous croyons devoir donner une partie de la description que les poëtes nous ont transmise de cette obscure et singulière divinité.
« Fatigué de l’ennui de son triste séjour, il fit une boule sur laquelle il s’assit, et, s’étant élevé en l’air, il environna la terre et forma le ciel. Ayant passé sur les monts Acrocérauniens, qui jetaient des flammes, il en tira de la boue enflammée, qu’il envoya dans le ciel pour éclairer le monde, et former avec cette matière de feu le Soleil, qu’il donna pour époux à la terre.
« Ils produisirent le Tartare et la nuit. Démogorgon, troublé dans le fond de son antre par les douleurs qu’éprouvait le Chaos, fit sortir la Discorde du fond de la terre, pour qu’elle habitât sa superficie ; elle fut le premier de ses enfans. Il en tira de même les trois Parques, le serpent Python, la Nuit., le Tartare, etc., etc. »
Nous n’étendrons pas davantage les détails sur cette monstrueuse génération. Cette enveloppe grossière laisse entrevoir le mystère de la création du monde et les traits défigurés de l’ancienne tradition.
Les Arcadiens furent les premiers à croire la terre animée par un génie ; c’est d’eux qu’il reçut le nom Démogorgon.
Parmi les différens noms portés par la terre, le plus ancien de tous est Titée ou Titaïa, qui signifie boue ou terre, comme Uranus signifie le ciel. Le chaos seul était plus ancien que le ciel et la terre. On le nommait arbitrairement Ops, Tellus, et souvent on lui donnait les noms des déesses Vesta, Cérès, Proserpine, Rhéa, Diane, ou Cybèle. Parmi les différentes fêtes de la Terre, celle appelée la fête de la bonne déesse était si célèbre, que nous croyons devoir en donner une idée.
Le premier jour de mai, les vestales se transportaient dans la maison du souverain pontife, pour faire un sacrifice à la bonne déesse, divinité mystérieuse dont les femmes seules connaissaient le nom.
Ce sacrifice, offert pour le salut et la prospérité du peuple romain, se faisait avec des préparatifs très-dispendieux et la plus étonnante circonspection. On ornait à grands frais la maison où la fête se célébrait ; et, comme elle avait toujours lieu pendant la nuit, une infinité de lumières éclairaient les appartenions. Le principal soin consistait à éloigner les hommes. Le maître de la maison, ses enfans et ses esclaves, étaient exclus. Toutes les fenêtres étaient soigneusement fermées, et l’on allait jusqu’à couvrir d’un rideau les peintures d’hommes et celles des animaux mâles.
Le même voile qui nous a dérobé la connaissance des mystères de Cérès Éleusine, a couvert ceux de la bonne déesse. On n’en peut parler avec certitude, et tous les historiens de Rome avouent leur ignorance sur ce point. Les conjectures que l’on a faites à ce sujet ne méritent aucune croyance.
Le peuple était persuadé que la déesse aurait sur-le-champ frappé d’aveuglement celui qui aurait osé porter ses regards sur ces mystères. On les célébrait aussi quelquefois dans les maisons des consuls et des premiers magistrats de la république.
On représentait ordinairement la Terre sous la forme d’un globe.
Du dieu Terme. §
Le respect pour le droit sacré de propriété peut seul assurer le repos et l’existence des sociétés. Sans lui la faiblesse serait dépouillée par la force, et les terres resteraient incultes ; car l’homme ne travaille que pour recueillir avec certitude. Telle est l’origine des lois qui forcèrent les particuliers à marquer leurs propriétés par des bornes.
Cérès, protectrice du labourage, est regardée par les anciens comme la première législatrice qui ordonna l’usage des bornes. attribue cette invention à Numa Pompilius ; mais il paraît certain qu’elle est due au célèbre Thaut, ou Mercure Égyptien, qui rectifia de cette manière les désordres que causaient les débordemens du Nil.
Numa, trouvant insuffisantes les lois établies pour assurer les propriétés, sut persuader au peuple romain qu’il existait un dieu protecteur des limites et vengeur des usurpations. Il lui fît bâtir un temple sur le mont Tarpeïen, institua des fêtes en son honneur, et régla son culte. Il fit représenter ce nouveau dieu sous la forme d’un rocher inébranlable. La fête de Terme prenait de lui le nom Terminalis. On lui offrait du lait, des fruits et quelques gâteaux. Les sacrifices publics avaient lieu dans un temple, et les sacrifices particuliers s’offraient sur les propriétés.
Les deux possesseurs de terres qui se touchaient se rendaient, chacun de leur côté, près de la borne qui séparaient leurs champs ; ils l’ornaient avec une guirlande de fleurs, et la frottaient avec de l’huile, dans le dessein de la conserver plus long-temps. Pour terminer cette fête pleine de simplicité, on immolait des agneaux et de jeunes truies, qui servaient ensuite au repas des deux familles réunies, et la Concorde était toujours invoquée par les assistans.
Un événement accrédita beaucoup le dieu Terme. Tarquin le Superbe voulut faire bâtir sur le Mont Capitole le Temple que Tarquin l’Ancien avait voué à Jupiter. Il fallut, pour le construire, déplacer beaucoup de statues et de chapelles ; on les éloigna de ce lieu sans éprouver de résistance ; mais le dieu Terme, plus solidement établi par Numa, brava tous les efforts ; il fallut le laisser au milieu du temple que l’on faisait construire. Les pontifes publièrent que tous les dieux, par respect pour Jupiter, avaient cédé leurs places ; mais que Jupiter lui-même, par respect pour le droit de propriété, lui avait assuré une place au milieu de son temple ; Telle est l’origine du dieu Terme ; cependant, avant Numa, Jupiter était honoré sous le nom de Jupiter Terminalis, et les Grecs honoraient un protecteur des limites, sous le nom de Jupiter Horius.
Les sermens les plus solennels et les plus sacrés étaient ceux que l’on formait sur cette pierre.
Par la suite des temps, on représenta souvent le dieu Terme par une borne pyramidale surmontée d’une tête. (Fig. 33.)
Flore, Pomone, Vertumne et Priape, dieux des jardins. §
Flore était la déesse des fleurs et l’épouse de Zéphire. Il paraît qu’il en existait une très-ancienne, dont on ignore l’origine. Les Romains honorèrent une seconde Flore, et lui attribuèrent le culte rendu à la première, qui n’était probablement qu’un personnage allégorique. (Fig. 34.)
Acta Laurentia, célèbre courtisane, légua l’héritage de ses biens immenses au sénat romain. Ils furent acceptés ; mais, pour cacher leur source, on assimila Laurentia à l’ancienne Flore, et on l’honora comme la déesse des bosquets et des fleurs. Ses fêtes firent instituer les jeux floraux.
Pomone, déesse des vergers, devint l’épouse de Vertumnus, ou Protée, comme nous l’avons dit précédemment. L’adresse de cette déesse à cultiver les arbres fruitiers et les jardins lui acquit parmi les Romains une très-grande réputation, à laquelle sa beauté ajoutait encore. Elle fut placée dans le Panthéon de Rome ; mais on ne trouve aucune trace de son histoire parmi les Grecs.
Vertumnus, son époux, dont le nom vient de vertere, changer, tourner, était le symbole de l’année et des variations des saisons. On le représentait souvent sous les formes de laboureur, de moissonneur, de vigneron, et sous celle d’une vieille, pour signifier le printemps, l’été, l’automne et l’hiver. Quelques auteurs le confondent avec Janus ; d’autres le disent un ancien roi d’Étrurie, célèbre par son amour de la culture des jardins.
On représente Pomone sous la figuré d’une belle et jeune femme, assise sur un panier de fruits, ayant des pommes sur ses genoux, et des branches chargées de fruits autour d’elle. (Fig. 35.)

On peint Vertumnus sous la figure d’un jeune homme, tenant des fruits dans une main, et dans l’autre urne corne d’abondance. Son habillement ne le couvre qu’à demi. (Fig. 36.)
Priape était aussi regardé comme dieu des jardins : on le disait fils de Vénus et de Bacchus. Il naquit à Lampsaque. Sa figure hideuse servait ordinairement d’épouvantail pour écarter les voleurs et les oiseaux. Les Orientaux adoraient ce même dieu sous le nom de Béelphégor.
De Palès et de quelques autres divinités champêtres. §
Palès était la divinité des bergers et la conservatrice des troupeaux. Sa fête, nommée Palilia ou Parilia, se célébrait au mois d’avril. On n’y tuait point d’animaux ; elle était entièrement champêtre. Les bergers purifiaient leurs troupeaux avec de la fumée de soufre, d’olivier, de buis, de laurier et de romarin. Ils allumaient un grand feu de paille, autour duquel ils dansaient ; ensuite ils offraient à la déesse du lait, du fromage, du vin cuit et des gâteaux de millet : c’était pendant cette même fête que l’on célébrait la fondation de Rome.
Anna perenna était une autre divinité champêtre du même rang que Palès. La joie la plus naturelle et les plaisirs les plus simples animaient toujours les fêtes de ces deux déesses.
Bubonna, déesse des bouviers, présidait à la conservation des bœufs.
Mellona prenait soin des abeilles ; on invoquait aussi pour les protéger le berger Aristée.
Seïa veillait aux blés pendant qu’ils étaient encore renfermés sous la terre. Ségesta les protégeait pendant la moisson, et Tutélina en prenait soin lorsqu’ils étaient dans les greniers.
Robigus, rouille, était invoqué pour qu’il préservât les blés de la maladie de la rouille.
Bonus Eventus, bon succès, était honoré d’un culte particulier : sa statue, faite par , était placée dans le Capitole ; il était au nombre des grands dieux de la terre et des campagnes.
Populonia, dont le nom signifie dégât, ravage, empêchait la grêle et la foudre de détruire les biens de la terre.
Pilumnus présidait à la mouture des grains, et Picumnus aux engrais. Saturne portait aussi le nom de Sterculius, parce qu’il avait, le premier, enseigné l’usage de fumer les terres.
Hippona était la déesse des écuries et des jumens ; Collina était celle des collines. Jugatinus présidait aux coteaux. Tous ces dieux avaient été imaginés par les Latins ; ils tenaient leurs noms des emplois qu’ils avaient, et jamais on ne les trouve parmi les dieux des Grecs.
Des Satyres, des Faunes, des Égypans et du dieu Pan. §
Les Satyres, les Faunes et les Égypans étaient des divinités champêtres, ou plutôt des demi-dieux, que les anciens croyaient habitans des forêts et des montagnes. On les nommait indifféremment Pans, Égypans, ou Satyres. On les représentait comme des hommes d’une petite taille, et ressemblant beaucoup à des chèvres. On donnait le nom Silènes à ceux qui étaient avancés en âge. On les disait fils de Mercure et de la nymphe Yptimé, ou fils de Bacchus et de la nymphe Nicéa, fille de Sangar.
Il paraît que ces bizarres divinités doivent leur culte à la frayeur et à la surprise qu’inspira la vue des premiers singes. On ne leur trouve aucune autre origine raisonnable.
Le dieu Pan tenait le premier rang parmi les dieux antiques. Les poëtes le disaient fils de Jupiter et de la nymphe Calisto, ou fils de Mercure et de Pénélope. On le représentait sous la forme d’un Satyre, tenant à sa main une flûte que l’on nommait Syrinx. (Fig. 37.)
Les Arcadiens honoraient très-particulièrement ce dieu. Les Romains célébraient, au mois de février, des fêtes en son honneur, que l’on nommait Lupercales, du lieu de même nom qu’Évandre lui consacra, et où l’on croyait que Rémus et Romulus avaient été allaités par une louve. Ses prêtres se nommaient Luperci.
Sa véritable origine était très-ancienne. Les Égyptiens, après avoir adoré le soleil sous le nom d’Osiris, la lune sous celui d’Isis, et les différentes parties de l’univers sous divers noms, adorèrent l’ensemble du monde sous le nom de Pan, qui signifie tout. Ils lui donnèrent une figure humaine jusqu’à la ceinture, pour représenter tous les hommes, et le reste de son corps représentait tous les animaux.
L’origine de la terreur panique est incertaine. Quelques auteurs l’attribuent à la frayeur soudaine que le dieu Pan excita parmi les Gaulois, lorsque, sous leur chef Brennus, ils s’apprêtaient à piller le temple de Delphes. D’autres la font venir de ce que le dieu Pan habite les forêts ; et, lorsqu’on s’égare sous leur ombre solitaire, on s’inquiète souvent au premier bruit que l’on entend.
Les poëtes racontent que le dieu Pan aima les trois nymphes Écho, Syrinx et Pithys. Écho le rebuta pour s’attacher au beau Narcisse, qui, s’étant vu dans une fontaine, devint épris de sa propre figure, et périt de langueur en se regardant. Écho, désespérée de sa mort, se laissa consumer de tristesse ; mais étant immortelle, elle ne conserva que sa voix, qui lui sert à répéter tout ce qu’elle entend. Cette fable est du nombre des allégoriques.
Syrinx, nymphe d’Arcadie, était de la suite de Diane. Le Dieu Pan s’étant mis un jour à sa poursuite, elle se réfugia près du fleuve Ladon, son père, qui la métamorphosa en roseau. Pan ayant observé que le vent, en agitant ces roseaux, leur faisait rendre des sons mélodieux, en coupa quelques-uns, et en composa sa flûte, qui fut appelée Syrinx.
La nymphe Pithys fut plus sensible à la tendresse de Pan ; mais Borée, jaloux de cette préférence, se servit de son souffle pour la précipiter du haut d’un rocher, Les dieux, pendant sa chute, la changèrent en pin, arbre consacré au dieu Pan.
De Silène et de Midas. §
Silène, nourricier de Bacchus, était le plus célèbre des Satyres. Nous allons donner l’histoire et la fable de ce personnage, extrêmement fameux dans l’antiquité. La fable s’unira quelquefois à la vérité, mais nos lecteurs sauront très-facilement distinguer l’une de l’autre.
assure que Silène naquit à Malée, ou du moins qu’il y fut élevé
. On le représentait ordinairement monté sur un âne (Fig. 38), presque toujours ivre, ayant bien de la peine à se soutenir, et suivant Bacchus dont il était le compagnon inséparable. Telle est l’idée que les poëtes donnent ordinairement de Silène ; mais les plus graves auteurs en parlent d’une manière beaucoup plus avantageuse, Silène, disent-ils, était un philosophe plein de sagesse et de lumières ; son ivresse, presque continuelle, était mystérieuse, et ne servait qu’à désigner l’attention profonde avec laquelle il méditait.
L’aventure qui le fit rester quelque temps auprès de Midas donna lieu à beaucoup de fables.
Bacchus, après avoir abandonné la Thrace, où les Bacchantes avaient déchiré le malheureux Penthée, était venu dans la Lydie, auprès du mont Tmolus, où croissaient d’excellens vins. Silène se promenait dans le pays, monté sur un âne, et venait souvent méditer ou se reposer auprès d’une fontaine. Midas, roi du pays, connaissant ses grands talens, désirait depuis long-temps converser avec lui ; il le fit enlever pendant qu’il se livrait au sommeil ; mais, étant lui-même initié aux mystères de Bacchus, il reçut Silène avec le plus grand respect, et le garda près de lui pendant dix jours et dix nuits, pour lui demander ses instructions et célébrer les orgies. Après ce terme, il voulut l’accompagner et le ramener lui-même à Bacchus. (Ici recommence la fable.) Le dieu charmé de revoir son nourricier, dont l’absence l’avait fort inquiété, promit à Midas de lui accorder sa première demande. Ce prince, avide de richesses, lui demanda le pouvoir de convertir en or tout ce qu’il toucherait. Sa demande fut accordée, mais bientôt elle lui devint funeste. Sous sa main, les arbres et les pierres devinrent or ; mais il en fut de même lorsqu’il toucha les mets de sa table. Pressé par la faim, il recourut à Bacchus. Le dieu lui dit de se laver les mains dans le Pactole, et depuis ce temps ce fleuve roule de l’or parmi ses sables. Telle fut la manière dont les poëtes travestirent l’histoire. Nous allons la débarrasser de son voile, et lui rendre sa simplicité.
Midas était roi du pays où coule le Pactole. Devenu possesseur du royaume, après la mort de Gordius son père, il fit présent au temple de Delphes d’une chaîne d’or d’un prix inestimable. Les jardins de ce prince avaient de la célébrité ; Silène voulut les voir, et passa quelques jours auprès de Midas. Ce prince, économe jusqu’à l’avarice, régnait sur un pays fort riche. La vente de ses grains, de ses bestiaux, de ses vins, lui rapportait un produit immense : ce qui donna lieu à la fable qu’il changeait en or tout ce qu’il touchait. Ayant appris par Bacchus et par Silène que le Pactole roulait de l’or parmi ses sables, sa cupidité changea d’objet : il abandonna les soins de la campagne, et fit retirer par ses sujets l’or qu’entraînait ce fleuve : ce qui fit dire qu’en se lavant les mains dans le Pactole, il lui avait communiqué la propriété de produire de l’or. Midas, malgré son amour pour les richesses, ne négligeait rien de ce qui tenait à la religion, aux bonnes lois et au bonheur de son royaume. Pour s’acquérir plus de confiance et d’autorité, il assura que Silène, nourricier de Bacchus, l’instruisait des mystères célébrés dans les orgies ; il profitait effectivement de ses lumières, et le prenait pour guide en formant ses établissemens politiques et religieux.
Pour mieux veiller à la police de son royaume, Midas avait des espions ou des surveillans fidèles : on dit d’abord qu’il entendait de loin, et les mécontens le peignirent avec des oreilles d’âne. Il commanda le silence, et quelques punitions arrêtèrent ces propos insultans : on fit une seconde fable allégorique dans laquelle on publia que son barbier, n’osant dire hautement qu’il avait vu des oreilles d’âne à Midas, avait été confié son secret dans un marais, et que bientôt après les roseaux agités par les vents faisaient entendre : Midas a des oreilles d’âne. On s’aperçoit que ces deux fables sont allégoriques.
Le goût de Silène pour le vin, et l’établissement des orgies dans la Lydie, fait par lui, le firent représenter sous la forme d’un homme ivre. Les plus graves auteurs disent que l’âne qu’on lui donnait pour monture, servait à représenter les pas lents, mais assurés, de la philosophie.
Quelques auteurs confondent ensemble Silène et Marsyas ; ce dernier était le célèbre joueur de flûte qu’Apollon écorcha après l’avoir vaincu. Cette erreur vient de ce qu’on les peignait l’un et l’autre en Satyres, et de ce qu’ils vivaient dans le même temps. Après la mort de Silène, on l’honora comme demi-dieu ; son culte était indépendant de celui qu’on rendait à Bacchus.
De Faunus et de Sylvanus. §
Faunus, fils de Picus, vivait du temps de Pandion, roi d’Athènes, et du temps d’Évandre et d’Hercule. Ce prince, rempli de bravoure et de sagesse, se distingua tellement, qu’il passa pour le fils de Minerve. Les soins qu’il donna à la culture des terres le firent placer parmi les divinités champêtres, et on le représenta sous la forme de Satyre. On croyait qu’il rendait des oracles ; mais cette fable tient à l’étymologie de son nom. (Phonein en grec, et fari en latin, signifie parler.) Les Romains admirent aussi parmi les divinités des champs Fauna, sa femme, et Silvanus, son fils. Le nom de ce dernier dérive du mot sylva, forêt. Il présidait aux bois, et sa représentation était celle des Satyres que l’on croyait ses frères.
Picus, père de Faunus, était un prince accompli. Devenu l’époux de la belle Canente, dont fait un portrait enchanteur, un accident le fit périr à la chasse : on ne retrouva pas corps, et l’on publia que la magicienne Circé, désespérée de le trouver insensible, l’avait changé en pivert. Canente ne pouvant se consoler de la perte de son époux, ne voulut plus parler, et se cacha dans la plus profonde solitude ; on publia que les dieux, pour la récompenser de sa tendresse, l’avaient enlevée dans le ciel,
Des dieux Lares et des dieux Pénates. §
Ces dieux étaient protecteurs des empires, des villes, des chemins, des maisons et des particuliers. On les distinguait en lares publics, lares des maisons, des champs, des ennemis, de la mer, des chemins, etc., etc. Ils étaient sans nombre, et chacun choisissait le sien à sa dévotion. On plaçait parmi ces dieux les âmes de ceux qui avaient bien servi l’état, et les familles y joignaient les âmes de leurs parens et de leurs amis.
Leur culte se bornait à renfermer de petites figures dans le lieu le plus secret de la maison, auquel on donnait alors le nom de Lararium. On leur consacrait des lampes, symbole de la vigilance, et on leur immolait le chien, animal si recommandable par son attachement et sa fidélité.
Lorsqu’un enfant quittait l’ornement appelé bulla, on le déposait aux pieds des dieux domestiques ; et lorsqu’une famille romaine faisait une adoption, ce qui était fort commun, les magistrats nommaient ceux qui devaient veiller au culte des dieux lares, que l’enfant adoptif semblait abandonner.
Dans les fêtes publiques de ces dieux, nommées Compitales, on suspendait dans les rues de petites figures de cire, et l’on priait les dieux lares et pénates de ne faire sentir leur colère qu’à ces petites figures.
Les Romains disaient tous ces dieux fils de Jupiter et de Lorunda. La ressemblance du nom et l’ignorance de leur origine avaient seules donné lieu à cette généalogie. Il paraît que leur culte était venu de Phrygie, et avait été apporté par Énée. Jacob emporta les dieux lares et pénates de la maison de son beau-père Laban : l’Écriture Sainte leur donne le nom de Téraphim.
Les génies avaient aussi leur rang parmi ces dieux. Les hommes en avaient deux ; un bon, qui produisait tous les biens, et l’autre mauvais, cause de tous les maux. Les femmes avaient aussi leurs génies, qui s’appelaient Junones.
On ne croyait pas la puissance de ces génies égale ; on disait que le génie d’Antoine redoutait celui d’Auguste. On les représentait sous la forme de jeunes hommes, tenant d’une main un vase à boire, et de l’autre une corne d’abondance. Ils paraissaient aussi quelquefois sous la forme d’un serpent. Le front leur était principalement consacré.
Chacun honorait son génie, surtout aux jours de naissance. On parsemait la terre avec des fleurs, et on lui offrait du vin dans des coupes. Chaque lieu avait son génie particulier. On était persuadé que l’univers entier était rempli d’esprits, qui en réglaient les mouvemens. , qui a le plus étendu ce système, parle des Gnomes, des Sylphes, des Salamandres. Les premiers habitaient la terre, les seconds l’air, et les troisièmes le feu ; mais il faut laisser aux contes de fées le plaisir de les dépeindre.
Divinités des enfers. §
L’idée d’un Dieu qui punit le crime et récompense la vertu est aussi ancienne que le monde. Le premier homme la reçut de Dieu même, et la transmit à sa postérité. A mesure qu’on s’éloigna des origines, les idées se brouillèrent, les traditions furent altérées, et l’idolâtrie prit naissance : mais la différence qui existe entre le crime et la vertu se fit si fortement sentir à quelques hommes, plus sages que les autres, qu’ils cherchèrent à conserver soigneusement ce frein nécessaire, qui peut seul arrêter la corruption générale.
Plus on examine les traditions anciennes, et plus l’on reconnaît que la croyance à l’immortalité de l’âme était universelle. La plus coupable erreur a pu seule élever des doutes sur cette importante vérité ; mais ils sont tellement démentis par le cri général de toutes les consciences et de tous les peuples, qu’il est inutile de les combattre.
Les philosophes de tous les siècles ont consacré cette vérité, et les poëtes se sont efforcés de l’étendre par leurs descriptions.
Un fragment de nous apprend que le système des poëtes sur les enfers fut entièrement pris dans les coutumes que les Égyptiens observaient lorsqu’ils enterraient leurs morts.
Le Mercure grec, dit-il, conducteur des âmes, était le prêtre chargé de recevoir le corps d’un Apis mort. Il le conduisait à un second prêtre, qui portait un masque à trois têtes, semblables à celles du Cerbère des poëtes. Le second prêtre lui faisait traverser l’Océan, lui servait de nocher, et le transportait aux portes de la ville du Soleil, d’où il arrivait dans les heureuses plaines habitées par les âmes.
L’Océan continue , est le Nil même, auquel les Égyptiens donnaient ce nom. La ville du Soleil est Héliopolis ; les plaines heureuses sont les belles campagnes situées aux environs du lac Achéruse, auprès de Memphis. C’est là que se terminent les funérailles, et que sont enterrés les corps des Égyptiens.
Dans les cérémonies funèbres, on commençait par désigner le jour auquel le corps serait inhumé. Les juges étaient les premiers avertis, ensuite les parens et amis du mort. Son nom se répétait de toutes parts, et l’on avertissait qu’il allait passer le lac. Aussitôt quarante juges s’assemblaient, et venaient s’asseoir en forme de cercle sur les bords de ce lac. Des ouvriers amenaient une barque, et le pilote, appelé Caron par les Égyptiens, s’apprêtait à la gouverner.
Avant de placer le cercueil dans la barque, la loi permettait à tout le monde d’élever des plaintes contre le mort. Les rois n’étaient point exempts de cette coutume ; et, si les plaintes étaient prouvées, les juges prononçaient la sentence qui privait le mort des honneurs de la sépulture ; mais celui qui ne prouvait pas son accusation subissait demandes peines.
Lorsqu’aucun accusateur ne se présentait, les parens quittaient le deuil, et commençaient à faire l’éloge du défunt, en parlant de son éducation, et en parcourant tous les âges de sa vie. Ils relevaient sa justice, sa piété, son courage, et priaient les dieux infernaux de le recevoir dans le séjour du bonheur. L’assistance applaudissait, unissait ses éloges, et félicitait le mort d’avoir mérité de passer l’éternité dans la paix et dans la gloire.
Telles étaient les cérémonies qu’ avait vu pratiquer en Égypte, et sur lesquelles il fonda sa fable des enfers, en y joignant les circonstances qui s’accordaient aux coutumes des Grecs.
Le même ajoute que souvent on gardait dans les maisons les ancêtres embaumés, pour y perpétuer le souvenir de leurs belles actions.
Le respect des Égyptiens pour les morts était porté si loin, que souvent ils conservaient les corps de ceux à qui l’on avait refusé les honneurs de la sépulture pour cause de crimes ou pour dettes. Lorsque leurs descendans devenaient riches ou puissans, ils acquittaient les dettes de leurs ancêtres, réhabilitaient leur mémoire, et les faisaient enterrer honorablement.
Quelquefois on mettait en dépôt les corps embaumés ; pour cautionner un emprunt, on donnait son propre corps pour gage, et ceux qui manquaient à cet engagement étaient dévoués à l’infamie pendant leur vie, et privés des honneurs de la sépulture.
Malgré les ténèbres épaisses de ces temps, on croyait généralement qu’après la mort le corps matériel était réduit en poudre ou en cendres ; mais que l’âme, cette partie spirituelle de l’homme, retournait dans le ciel. Les païens distinguaient l’âme de l’esprit. Ils regardaient la première comme l’enveloppe de l’esprit, et croyaient qu’elle descendait aux enfers.
Les poëtes n’étaient point d’accord sur le temps que les âmes devaient passer dans les Champs-Élysées. Quelques-uns le fixaient à mille ans, mais tous regardaient les supplices du Tartare comme éternels.
Nous croyons devoir faire connaître l’idée que les anciens s’étaient formée du Tartare, et cette description abrégée sera tirée de .
Description des enfers §
Devant la porte des enfers la Douleur et le Chagrin vengeur ont établi leur demeure. C’est là qu’habitent les pâles Maladies, la triste Vieillesse, la Frayeur, la Faim qui suggère tant de crimes, le Travail, la Mort et le Sommeil, frère de la Mort. On y trouve la Guerre et la Discorde, ayant pour chevelure des couleuvres tressées avec des bandelettes ensanglantées. Près de ce monstre sont posés les lits de fer des Furies : cent autres monstres assiégent l’entrée de ce fatal séjour. Tel est l’Averne, première porte des enfers.
Près de cet antre, un chemin conduit à l’Achéron ; c’est là qu’accourent de toutes parts les âmes qui doivent passer ce fleuve. Caron reçoit dans sa barque celles qui ont reçu les honneurs de la sépulture, mais il est inflexible pour les autres. Elles errent pendant un siècle sur ce triste rivage.
Après avoir passé le fleuve, une nouvelle porte sert d’entrée au palais de Pluton ; elle est gardée par Cerbère, monstre à trois têtes, dont l’une veille toujours.
Parvenu dans cette affreuse demeure, on, trouve d’abord les âmes de ceux qui sont morts presqu’en naissant, ensuite les âmes de ceux qu’une injuste condamnation a privés du jour, et celles de ceux qui se sont eux-mêmes arraché la vie. Plus loin on voit errer, dans une forêt de myrtes, les amans que le désespoir a fait mourir. En sortant de ce bois, on trouve la demeure des héros morts les armes à la main. Près de là s’aperçoit le tribunal où Minos, Éaque et Rhadamanthe exercent la justice. Éaque et Rhadamanthe prononcent le jugement, et Minos l’approuve ou le change.
Un bruit horrible commande l’attention et fait apercevoir le Tartare, prison éternelle, autour de laquelle le Phlégéton roule des torrens de flammes ; et les marais infects et bourbeux du Cocyte l’environnent de toutes parts. Trois enceintes de murailles et des portes d’airain rendent encore ces lieux plus inaccessibles. Tysiphone, la plus terrible des furies, retient les coupables qui voudraient s’échapper. Rhadamanthe les force d’avouer leurs crimes les plus secrets, et les Furies les punissent. Des serpens horribles servent de fouet à ces déesses impitoyables : elles en frappent les victimes, et ne leur laissent jamais un instant de repos.
Telle est en partie la description que fait des enfers. Il y joint celle des Champs-Élysées, où règne un printemps éternel.
Il est facile de reconnaître que ces fables des Grecs et des Romains ne sont que la peinture embellie des cérémonies que pratiquaient les Égyptiens.
Pluton, Cérès, Proserpine et autres dieux des enfers. §
Pluton, troisième fils de Saturne et d’Ops, régnait dans les enfers avec Proserpine. Ses noms les plus ordinaires étaient Dis, Adès, Orcus et Februus. Dis exprime les richesses ; il y présidait, parce qu’elles sont renfermées dans les entrailles de la terre. Adès signifie triste et sombre. Orcus vient du latin urgere, pousser, parce que ce dieu poussait vers la mort. Februus vient de februare, faire des lustrations, parce qu’on en faisait toujours dans les cérémonies funèbres.
Le sceptre de Pluton était une fourche à deux pointes ; il tenait dans ses mains les clefs de son empire, pour annoncer qu’on n’en sortait point (Fig. 39), et dans les sacrifices, les brebis noires lui étaient immolées.

Pluton était le plus jeune des frères de Jupiter ; dans le partage du monde, il eut les pays occidentaux, qui s’étendent jusqu’à l’Océan, et fixa son séjour au fond de l’Espagne. Il y fit exploiter des mines d’or et d’argent. Ce travail ne pouvant s’exercer que sous la terre, on publia qu’il avait pénétré jusqu’aux enfers et s’en était emparé.
Quoique Plutus fût aussi le dieu des richesses, il ne faut pas le confondre avec Pluton, divinité qui lui était très-supérieure. Plutus était fils de Cérès et de Jasion. On le représentait aveugle comme la Fortune, pour montrer que les richesses sont dispensées aux bons et aux mauvais.
La laideur de Pluton et l’obscurité de son royaume l’ayant fait rebuter par toutes les déesses, il s’en plaignit à son frère Jupiter, et obtint de lui la permission de se choisir une épouse. Inquiet des secousses de l’Etna il craignit que le jour ne pénétrât dans son empire par quelque ouverture. Il alla visiter la Sicile ; et ce fut alors qu’il rencontra Proserpine, fille de Cérès. Cette princesse, suivie de ses compagnes, se plaisait à cueillir des fleurs ; Pluton l’aperçut, et l’enleva. Cyane, cherchant à s’y opposer, fut changée en fontaine ; et le dieu des enfers, entrouvrant la terre d’un coup de son sceptre, disparut à tous les yeux, emportant avec lui la fille de Cérès.
Nous avons déjà vu, dans l’histoire de cette déesse, quels furent ses regrets et les courses qu’elle entreprit pour retrouver sa fille.
On ne peut douter que la Cérès des Grecs était l’Isis des Égyptiens ; ses mystères étaient les mêmes, et furent apportés par les colonies orientales.
Pendant le règne d’Érechthée, une grande famine se fit sentir dans la Grèce. Les Athéniens, dont le sol était peu fertile, souffrirent encore plus que leurs voisins. Érechthée prit le parti d’envoyer en Égypte. Ses émissaires rapportèrent de ce pays une grande quantité de blés, avec la manière de les cultiver. Ils rapportèrent en même temps le culte de la divinité qui présidait à l’agriculture. Le mal que l’on venait de souffrir, et la crainte de le voir se renouveler, firent adopter les mystères de la déesse. Dans le même temps, Triptolème reçut le culte dans Éleusis, où il régnait ; il voulut même être prêtre de Cérès ou Isis ; et, pour témoigner sa reconnaissance de l’abondance que l’agriculture avait fait renaître, il eut soin, en secourant ses voisins, de leur apprendre les travaux de Cérès, et de faire adopter son culte.
Telle est l’origine de la fable de Cérès et de Triptolème. On publia que Cérès était venue de Sicile à Athènes. On ajouta que sa fille Proserpine avait été enlevée, parce que l’on avait manqué pendant quelque temps d’alimens et de fruits. Pluton la conduit dans les enfers, pour désigner le temps où les semences restent enfermées dans la terre. Jupiter arrange ce différent et réconcilie Cérès avec Pluton, pour désigner les nouvelles moissons qui couvrirent la terre.
Quelques savans prétendent que Cérès était reine de Sicile, qu’elle alla dans l’Attique pour instruire Triptolème des travaux de la terre, et que ce fut sa fille qui fut enlevée par Pluton, roi d’Espagne.
On croit aussi que l’enlèvement de Proserpine est une allégorie pour représenter la saison pendant laquelle les semences restent sous la terre, et celle où elles reparaissent.
De la métempsycose. §
Lorsque les âmes étaient sorties des corps qu’elles animaient, Mercure les conduisait dans le Tartare ou dans les Champs-Élysées. Après avoir passé dans la barque de Caron, les âmes des coupables étaient plongées dans les enfers, et les âmes de ceux qui avaient bien vécu habitaient l’Élysée. On croyait presque généralement qu’après un séjour de mille ans dans ces lieux enchanteurs, elles retournaient sur la terre animer d’autres hommes, ou même des animaux. Avant de sortir des enfers, elles buvaient des eaux du Léthé, qui avaient la propriété de faire oublier le passé.
Cette idée doit son origine aux Égyptiens. C’est d’après eux qu’ , et les poëtes l’ont propagée dans leurs écrits.
Des juges des enfers, des Furies et des Parques. §
Trois juges examinaient, à leur tribunal les âmes que Mercure conduisait dans les enfers.
Minos, roi de Crète et fils d’Astérius, était le premier. Il voulut se faire passer pour fils de Jupiter et d’Europe. Pour obtenir qu’on le crût, il promit de sacrifier à Neptune le premier objet qui lui serait apporté par la mer. Dans l’instant même il vit aborder sur le rivage un taureau d’une extrême blancheur. Il le trouva si beau qu’il ne voulut point l’immoler, et le garda pour en faire le chef de son troupeau. Le dieu de la mer, irrité, se vengea de Minos en remplissant sa famille de troubles. Pasiphaé, sa femme, lui suscita les plus grands malheurs. Il eut d’elle trois fils et deux filles célèbres, Ariadne et Phèdre, dont nous verrons l’histoire à l’article des demi-dieux.
Rhadamanthe passait aussi pour fils de Jupiter et d’Europe. Forcé de fuir la Crète, parce qu’il avait tué son frère, il se retira à Calée, ville de Béotie, où il épousa Alcmène, veuve d’Amphitryon.
Éacus ou Éaque, fils de Jupiter et d’Égine, fille d’Asope, régnait dans l’île d’Ænone ; sa seconde femme, fille du centaure-Chiron, le rendit père de Télamon et de Pélée. Sa première femme était Psamathé, fille de Nérée, dont il eut Phocus.
Rhadamanthe fut établi le juge des Asiatiques ; Éaque fut celui des Européens. Minos, au-dessus d’eux, jugeait souverainement, et décidait les cas incertains. Le lieu dans lequel était placé le tribunal, se nommait le Champ de la Vérité. Le mensonge et la calomnie n’en pouvaient approcher. La supériorité de Minos était marquée par un sceptre qu’il tenait à sa main, et l’on voyait près de lui l’urne qui renfermait le jugement des humains. Les Furies présidaient aux châtimens des coupables. Elles étaient trois : Tysiphone, Mégère et Alecto. On les disait filles de l’Achéron et de la nuit. Leurs noms signifiaient : rage, carnage, envie. On les représentait avec des flambeaux ardens à la main, des serpens pour cheveux, et un fouet de serpens. (Fig. 40.) Les Grecs les nommaient Erynnides, ce qui signifie troubles d’esprit. On leur donna le nom d’Euménides, Douces, lorsque Minerve les eut apaisées, et lorsqu’elles cessèrent de tourmenter Oreste, qui avait tué sa mère.
Les trois Parques habitaient le royaume des enfers ; elles étaient filles de la Nécessité. C’étaient elles qui filaient les jours et les destinées des hommes. La plus jeune, nommée Clotho, tenait la quenouille ; Lachésis tournait le fuseau ; et Atropos, avec le ciseau fatal, tranchait le cours de la vie. Les poëtes disaient que, pour filer les jours heureux, elles employaient l’or et la soie, et que les jours malheureux étaient filés avec de la laine noire.
On représentait les Parques sous la figure de trois femmes accablées de vieillesse. Clotho, vêtue d’une robe de différentes couleurs, portait une couronne de sept étoiles, et avait à la main une quenouille, qui tenait au ciel et touchait à la terre. La robe de Lachésis était parsemée d’étoiles ; elle avait près d’elle une infinité de fuseaux. Atropos, vêtue de noir, tenait des ciseaux ; et l’on voyait autour d’elle un nombre infini de fuseaux, plus ou moins remplis, selon l’étendue ou la brièveté de la vie. (Fig. 41.)
Némésis, dieux mânes, la nuit, le sommeil et la mort. §
Némésis veillait à la punition des crimes. Elle parcourait le monde avec une extrême vigilance, pour découvrir les coupables. Elle les poursuivait jusque dans les enfers, pour les châtier avec la plus grande rigueur. On la représentait avec des ailes, un gouvernail et une roue de char, pour annoncer qu’elle poursuivait le crime en tous lieux et sans relâche. (Fig. 42.) Fille de la justice, elle récompensait les bonnes actions, et punissait impitoyablement l’impiété.
Les dieux Mânes n’étaient pas bien clairement connus par les anciens. Souvent ils les confondaient avec les âmes des morts, et quelquefois avec les dieux lares. Ces divinités présidaient aux sépultures et aux ombres, (pie I on croyait errantes autour des lieux funèbres.
La Nuit était fille du Chaos ; on la représentait couverte d’un grand voile noir parsemé d’étoiles, parcourant sur un char d’ébène la vaste étendue des cieux, ou sans char, avec un voile qui voltigeait au gré des vents, pendant qu’elle s’approchait de la terre pour éteindre la torche qu’elle tient à la main. (Fig. 43.)
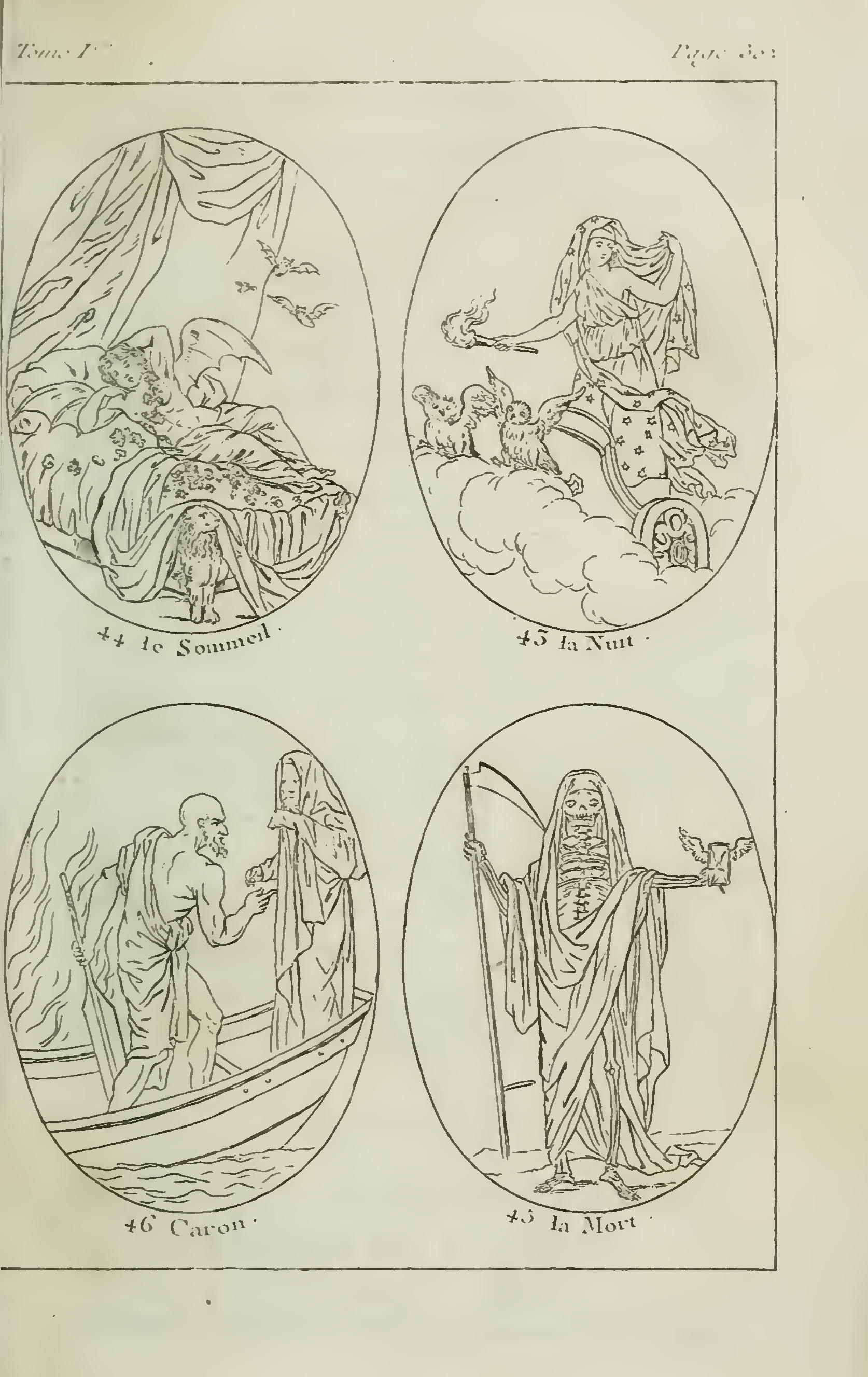
Le Sommeil, fils de la Nuit et frère de la Mort, se représente sous la figure d’un enfant dormant profondément. Une de ses mains tient des pavots, qui servent aussi à reposer sa tête, et près de lui est un vase rempli d’une liqueur assoupissante. (Fig. 44.)
La Mort, fille de la Nuit et sœur du Sommeil, est représentée sous la forme effrayante d’un squelette. Sa robe noire est parsemée d’étoiles ; elle a des ailes immenses, et son bras décharné est armé d’une faux. (Fig. 45.)
De Caron, de Cerbère et des fleuves de l’enfer. §
Caron, selon les poëtes, était fils d’Érèbe et de la Nuit. Son nom signifie colère. Son humeur était triste et sévère. Les dignités, les richesses, n’obtenaient de lui aucun égard. Chargé du soin de passer les ombres dans les enfers, il refusait celles qui étaient privées des honneurs de la sépulture. (Fig. 46.) Elles erraient sur le rivage pendant cent ans, avant d’être admises dans la barque fatale. On était si persuadé qu’il exigeait un droit de passage, que l’on plaçait toujours une pièce de monnaie sous la langue du mort. Cette pièce s’appelait naulage ; celle des rois était ordinairement d’or.
Il fallait aussi avoir une attestation de bonne vie et de bonnes mœurs, signée par un grand prêtre. Les anciens nous ont conservé la forme de ces attestations.
« Moi, soussigné, Amitius Sextus, pontife, j’atteste que M. a été de bonne vie et de bonnes mœurs. Que ses mânes soient en paix. »
Cette coutume était une imitation complète de celle des Égyptiens.
Cerbère, gardien des enfers, avait trois têtes ; des couleuvres au lieu de poil environnaient son cou. Il était fils de Typhon et d’Échidna. Orphée l’endormit au son de sa lyre, lorsqu’il alla demander à Pluton de lui rendre Eurydice. Lorsqu’Hercule descendit dans les enfers, pour en délivrer Alceste, il enchaîna Cerbère et s’en fit suivre. On dit qu’en passant dans la Thessalie, la vue du jour lui fit vomir son venin sur l’herbe, ce qui la rendit mortelle pour les animaux qui la goûtaient. Cette fable fait allusion à la grande quantité d’herbes vénéneuses que produit ce pays. La fable de Cerbère fut encore imaginée d’après l’usage qu’avaient les Égyptiens de faire garder leurs morts par des dogues.
L’enfer avait cinq fleuves principaux. Le premier s’appelait l’Achéron. Il fut repoussé dans les enfers, parce qu’il avait apaisé la soif des Titans pendant leur combat contre Jupiter. Son nom veut dire angoisse ou hurlement. Ce fleuve est dans la Thesprotie, prend sa source dans le marais de l’Achéruse et son embouchure est dans le golfe Adriatique, près d’Ambracie.
Le second est le Cocyte, dont le nom signifie pleurs, gémissement ; on le disait formé par les larmes des coupables. Ce fleuve coulait aussi dans l’Épire, ou plutôt dans la Thesprotie, et se jette dans le marais Achéruse ; ce n’était qu’un marais bourbeux et non pas un fleuve.
Le Styx est le troisième. C’est une fontaine d’Arcadie, qui coule d’un rocher, et forme un ruisseau qui se cache sous la terre ; son eau était mortelle ; voilà pourquoi les poëtes en ont fait un des fleuves de l’enfer. La fable a fait du Styx une fille de l’Océan, dont la Victoire était fille. Elle secourut Jupiter dans la guerre des Titans. On dit qu’elle fut mère de l’Hydre. Son nom inspirait tant de terreur, que le serment le plus inviolable était de jurer par le Styx. Les dieux eux-mêmes ne pouvaient l’enfreindre. Si quelques dieux y manquaient, Jupiter ordonnait à Iris de leur présenter une coupe pleine de l’eau empoisonnée de cette fontaine ; il les éloignait de sa table pendant un an, et les privait même de la divinité pour neuf années. Lorsque les dieux juraient par le Styx, ils devaient avoir une main sur la terre et l’autre sur la mer. Le nom de Styx signifie eau du silence. On se servait de l’eau de cette fontaine pour faire subir des épreuves aux coupables. Telle est la principale origine des fables sur ce fleuve d’enfer : ses eaux coulaient dans l’Épire, que l’on regardait comme une partie du royaume de Pluton. En général, toutes les eaux dont les qualités étaient mauvaises, étaient regardées comme des fleuves d’enfer. Il en était ainsi du lac Averne, placé en Italie près de Pouzolles, et du Léthé, ou Fleuve d’Oubli, situé dans l’Afrique. Les fables attribuaient à ce dernier le pouvoir de faire oublier les événemens passés. Ce fleuve était le quatrième. Le Phlégéton, ou le cinquième fleuve, roulait des torrens de feu. Les eaux de ce marais exhalaient des vapeurs sulfureuses, et son limon était brûlant. Cette propriété le fit placer au nombre des fleuves de l’enfer.
Des Champs-Élysées. §
Nous ne ferons point la description des Champs-Élysées : elle variait autant que l’imagination des poëtes. Chacun d’eux peignait ce qu’il croyait le plus capable de plaire, et laissait encore à ses lecteurs le pouvoir d’ajouter à ses tableaux. Nous nous bornerons à dire que les anciens plaçaient ordinairement ce séjour délicieux dans les îles appelées aujourd’hui Canaries. Il est probable que la tradition du paradis terrestre a fait naître l’idée des Champs-Élysées,
Du culte des enfers. §
Jamais on n’élevait d’autels à ces redoutables divinités. On les réservait pour les dieux de la terre et de la mer, que l’on nommait dieux supérieurs. Ceux des enfers se nommaient dieux inférieurs.
On faisait des fosses dans lesquelles on laissait couler le sang des victimes, que l’on choisissait toujours d’une couleur noire. Les pontifes, pendant les prières, baissaient la main vers la terre, au lieu de l’élever vers le ciel. En général, on craignait et l’on haïssait les divinités infernales. On les regardait comme implacables. Jamais on ne leur demandait un bienfait ; on ne cherchait qu’à les apaiser. Jamais on ne composait d’hymnes en leur honneur ; on ne leur élevait point des temples, et l’on n’avait aucun espoir dans les vœux qu’on leur adressait. Leur empire dans les enfers était aussi absolu que celui de Jupiter dans le ciel.
Principaux coupables punis dans les enfers. §
Les Titans furent précipités dans les enfers, pour avoir fait la guerre au dieu Jupiter. La fable les peint accablés sous le mont Etna. Typhon, le plus grand d’entre eux, est étendu sous la Sicile ; son bras droit répond au Pélore, situé vers l’Italie ; son bras gauche répond au Pachine, situé vers l’orient ; ses pieds sont à l’occident, du côté de la Libye.
attribue les tremblemens de terre de la Sicile aux mouvemens qu’il fait pour se dégager, et les éruptions de l’Etna sont les efforts qu’il fait encore pour attaquer le ciel
.
Sisyphe est forcé de rouler une pierre énorme jusqu’au haut d’une montagne, d’où elle retombe dès qu’elle a touché le sommet. (Fig. 47.) On l’accusait d’avoir essayé de tromper Pluton, et de se rendre immortel, en retournant sur la terre. On trouve dans l’histoire que pendant sa jeunesse il avait échappé à une maladie très-dangereuse, et avait ensuite vécu très-long-temps.

Salmonée, prince d’Élide, voulut s’égaler à Jupiter ; il crut imiter sa foudre, en faisant rouler sur un pont d’airain un char éclairé de flambeaux. Jupiter le précipita d’un coup de foudre.
Phlégias, ayant brûlé un temple d’Apollon, voit sans cesse un énorme rocher suspendu sur sa tête et prêt à l’écraser. Ses plaintes éternelles servent à effrayer les ombres coupables.
Le géant Tytie, dont le corps couvrait neuf arpens, ayant osé insulter Latone, Apollon le fit périr avec ses flèches, et le précipita dans les enfers. Un vautour lui déchire continuellement le foie.
Il faut observer que les neuf arpens qui couvraient le corps du géant Tytie signifient que le lieu destiné à sa sépulture contenait neuf arpens.
Ixion, ayant porté l’insolence jusqu’au point de se déclarer rival de Jupiter, fut précipité dans le Tartare, et attaché sur une roue environnée de serpens. (Fig. 48.)
Tantale, roi de Phrygie, était fils de Jupiter et de la nymphe Pluto. On rapporte diversement son crime. On dit qu’il avait découvert au fleuve Asope le lieu où Jupiter avait caché sa fille Égine, après l’avoir enlevée. D’autres disent qu’il laissa voler un chien que Jupiter lui avait confié, et avec lequel il faisait garder son temple de Crète ; d’autres enfin racontent qu’ayant été admis à la table des dieux, il avait révélé leurs secrets, et volé du nectar pour en faire boire à ses amis ; mais on s’accorde plus généralement à rapporter son crime de la manière suivante :
Les dieux honorèrent Tantale de leur visite ; il voulut éprouver s’ils connaissaient les choses cachées. Ce prince barbare égorgea Pélops son fils, et fit entremêler ses membres avec les mets que l’on servait aux dieux. Ils témoignèrent leur colère à l’aspect de cet horrible repas ; mais Cérès uniquement occupée de la douleur que lui causait l’enlèvement de sa fille Proserpine, mangea une épaule sans y prendre garde. Les dieux ressuscitèrent le jeune Pélops, et Jupiter remplaça par une épaule d’ivoire celle que Cérès avait mangée.
Pour punir Tantale de son double attentat contre les dieux et contre la tendresse qu’il devait à son fils, il fut précipité dans le fond des enfers, où il éprouve sans cesse la soif la plus brûlante et la faim la plus dévorante. Pour redoubler son supplice, il est plongé dans l’eau jusqu’au menton ; mais dès qu’il approche sa bouche pour chercher à se désaltérer, l’eau se retire. Les mets les plus séduisans l’environnent de toutes parts ; mais ils s’éloignent dès qu’il veut les saisir pour les dévorer. (Fig. 49.) Les savans ne sont point d’accord sur l’explication de cette, fable ; quelques-uns d’eux la regardent comme une allégorie pour peindre l’avarice. Tantale, périssant de soif et de faim au milieu de la plus grande abondance, représente l’avare qui n’ose entamer son trésor, et se laisse consumer par la misère dans la crainte de le diminuer ; mais rien n’explique la barbarie de Tantale, et l’histoire ne dit rien de satisfaisant pour expliquer le meurtre de Pélops.
Parmi les principaux coupables, il faut remarquer les Danaïdes, condamnées à remplir d’eau une cuve sans fond. (Fig. 50.) La fable imaginée pour peindre ce genre de punition, n’a d’autre fondement que la coutume observée par les Égyptiens à Memphis. Près du lac Achéruse, au-delà duquel on enterrait les morts, des prêtres versaient de l’eau dans une cuve sans fond, pour exprimer l’impossibilité de revenir à la vie.
Les poëtes ont feint que les Danaïdes subissaient ce genre de supplice, pour les punir du crime que nous allons rapporter.
Danaüs et Égyptus, fils de Bélus, descendaient de Jupiter et de la nymphe Io. Égyptus s’empara du royaume qui depuis ce temps porte son nom. Danaüs son frère fut forcé de s’éloigner ; il rassembla ceux qui suivaient son parti, et vint du côté d’Argos. Il attaqua Gélanor, roi de ce pays, et le détrôna. Il eut diverses femmes, dont il eut cinquante filles. Son frère Égyptus eut de même cinquante fils. Ces princes, ayant appris la puissance et la nouvelle fortune de Danaüs, demandèrent ses filles en mariage, et les obtinrent ; mais ce conquérant du royaume d’Argos, inquiet et cruel, ayant su par l’oracle qu’un de ses gendres lui donnerait la mort, chercha à se venger des mauvais traitemens de son frère Égyptus ; il ordonna à ses filles de poignarder leurs époux pendant la première nuit de leurs noces. La seule Hypermnestre n’obéit point à cet ordre barbare. Elle en avertit Lyncée, qui s’enfuit à Lyrce, près d’Argos, et elle se rendit à Larisse. En arrivant dans ces deux villes, ils allumèrent des flambeaux sur les tours les plus élevées, pour s’avertir qu’ils étaient hors de péril. Lyncée rassembla des troupes, fit la guerre à Danaüs, et s’empara de son trône.
Les poëtes, pour rappeler ce fait historique et l’embellir à leur manière, peignirent la punition des Danaïdes telle que nous l’avons dit précédemment.
On trouve aussi dans le Tartare, Œdipe, Étéocle, Polynice, Thésée et plusieurs autres ; mais nous en parlerons à l’article des demi-dieux et des héros.
Des divinités particulières. §
Il serait impossible de nommer et de désigner toutes les divinités particulières des anciens ; ils érigeaient en dieux les vertus, les passions, les biens et les maux : nous nous bornerons à parler des plus connus.
Les Grecs honoraient la Félicité sous le nom d’Endémonia, ou de Macaria. Un oracle ayant dit aux Athéniens qu’ils remporteraient la victoire si un des enfans d’Hercule se donnait volontairement la mort, Macarie, une de ses filles se tua elle-même. Les Athéniens furent victorieux, et honorèrent sous le nom de Macaria Félicité celle qui s’était dévouée pour eux.
Les Romains n’honorèrent la Félicité que long-temps après la fondation de Rome. Lucullus lui fit élever un temple après la guerre contre Mithridate et Tigrane. On la représentait comme une reine assise sur un trône, tenant une corne d’abondance, avec cette légende : La Félicité publique. (Fig. 51.)
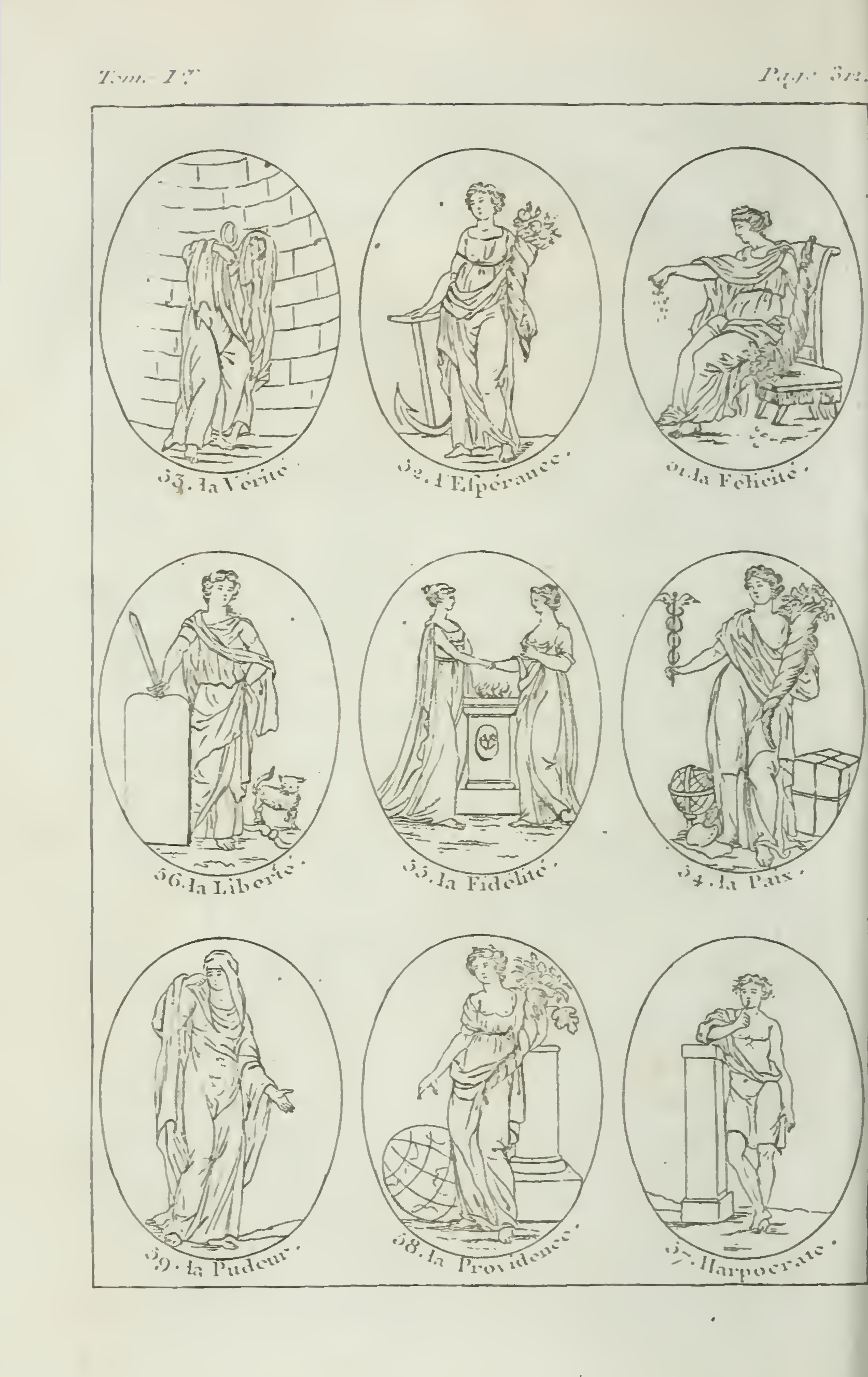
L’Espérance, cette dernière ressource des hommes contre les maux qui les accablent, fut bientôt divinisée par eux. Les Grecs honoraient l’Espérance sous le nom d’Elpis, et les Romains sous celui de publica, Espérance publique.
dit que l’immortalité animait l’Espérance, et que la vertu seule avait droit de compter sur elle
. Rome lui avait élevé plusieurs temples. On la représente avec une corne d’abondance, des fruits, des fleurs, une ruche à miel (Fig. 52), et les nautoniers la représentaient avec une ancre.
L’Éternité n’avait ni temples, ni autels. On se bornait à la représenter sous la figure d’une femme, avec une légende qui portait son nom, Éternité. Elle tenait à la main une tête de soleil rayonnant, ou une tête de lune, parce qu’on les croyait éternels. On la représentait aussi sous la forme du Phénix, oiseau fabuleux qui renaît de ses cendres ; ou sous celle d’un globe, parce qu’il n’a aucunes bornes ; ou sous celle d’un serpent qui forme le cercle en mordant sa queue ; quelquefois aussi sous la forme d’un éléphant, à cause de la longue vie de cet animal : ce qui démontre la faible idée que les anciens avaient de l’Éternité. Toutes les généalogies de leurs dieux prouvent qu’ils ne pouvaient concevoir la divinité sans commencement et sans fin.
Le Temps était représenté par Saturne : on le peignait avec des ailes, pour marquer la rapidité de sa course, et avec une faux, pour exprimer ses ravages. (Voy. Saturne, Fig. 3, Pl. i.)
On divisait le Temps en plusieurs parties, le siècle, la génération ou l’espace de trente ans, le lustre ou cinq ans, l’année et les saisons. On n’en admettait d’abord que trois, l’été, l’automne et l’hiver : on y ajouta le printemps. L’on personnifia le crépuscule du matin, l’aurore, le midi, le soir, le crépuscule du soir, et la nuit. Chacune de ces parties était représentée par un homme ou une femme suivant son nom masculin ou féminin.
La Pensée fut divinisée ; on l’implorait pour n’avoir que de bonnes pensées.
Tous les genres de piété furent honorés. M. Acilius Glabrio fit élever un temple à la Piété filiale sur les fondemens de la maison qu’avait habitée la femme romaine qui avait nourri son père dans la prison.
Les Athéniens avaient élevé des autels à la Miséricorde. Les Romains les imitèrent, et donnèrent à ces temples le nom d’Asiles.
La Vertu, qui peut seule assurer le bonheur, fut adorée par les anciens, et l’on trouve encore dans le quatrième livre de la Cité de Dieu, par saint , quelques traces du culte qu’on lui rendait. Scipion, le destructeur de Numance, fut le premier qui consacra un temple à cette divinité. Marcellus voulut réunir dans un même temple la Vertu et l’Honneur ; il consulta les pontifes : ils déclarèrent qu’un seul temple ne pouvait contenir deux divinités aussi grandes. Marcellus en fit construire deux qui se touchaient, de sorte que l’on passait du temple de la Vertu à celui de l’Honneur, pour apprendre aux hommes qu’ils ne pouvaient parvenir au véritable honneur que par la pratique de la vertu. On ne sacrifiait jamais à l’Honneur, sans avoir la tête découverte, et sans donner les marques du plus grand respect.
La Vérité passait pour être mère de la Vertu et fille du Temps ; on la représentait comme une jeune vierge, couverte d’un habit dont la blancheur égalait celle de la neige. (Fig. 53.)
disait que la vérité se cachait au fond d’un puits, tant elle est difficile à découvrir.
La Concorde, la Paix et la Fidélité, étaient, trois déesses différentes. Le pouvoir de la Concorde s’étendait sur les maisons, les familles et les villes. Celui de la Paix s’étendait sur tout l’empire.
dit que ce fut dans le temple de la Paix que furent déposées les riches dépouilles du temple de Jérusalem.
On rassemblait dans le même temple tous ceux qui professaient les arts, lorsqu’ils avaient à soutenir leurs droits et leurs prérogatives, afin que la présence de la déesse de la Paix pût bannir toute haine et toute aigreur de leurs disputes. On représentait cette déesse sous la forme d’une femme couronnée de laurier, d’olivier, de roses, tenant d’une main des épis, symbole de l’abondance qu’elle procure, et de l’autre le caducée. (Fig. 54.) On lui donnait pour compagnes Vénus et les Grâces.
La Fidélité présidait à la bonne foi dans les traités et dans le commerce ; le serment que l’on faisait par elle, ou par Jupiter Fidius, était regardé comme le plus inviolable de tous. On croit généralement que Numa Pompilius fit élever son premier temple. La figure de deux femmes qui se donnent la main représente ordinairement cette déesse. (Fig. 55.)
Un peuple autant idolâtre de sa liberté que l’était le peuple romain, ne pouvait manquer d’en faire une divinité : elle avait plusieurs temples. On la représentait appuyée sur une table des lois, ayant une épée à la main pour les défendre, avec cette légende : Elles assurent la liberté de tous. (Fig. 56.) On représentait la Licence foudroyée par le ciel, dans l’instant où elle s’efforce de briser une table des lois et la balance de la justice.
Le Silence avait ses autels ; les peuples de l’Orient l’adoraient sous le nom d’Harpocrate, et les Romains en avaient fait une déesse, qu’ils nommaient Ageronia. (Fig. 57.) Ces derniers avaient aussi le dieu de la parole, qu’ils nommaient Aïus Locutius.
La Pudeur avait des temples. On la représentait sous la figure d’une femme voilée, ou d’une femme qui montre son front avec son doigt pour annoncer qu’il est sans trouble et sans tache. (Fig. 58.)
La Providence était représentée par une femme appuyée sur une colonne, tenant de la main gauche une corne d’abondance, et montrant un globe avec sa main droite, pour apprendre qu’elle étend ses soins sur tout l’univers, et qu’elle dispense tous les biens. (Fig. 59.)
On représente la Justice sous la figure d’une jeune fille, tenant une balance égale des deux côtés, ayant une épée nue à la main et un bandeau sur les yeux ; elle est assise sur un bloc de pierre, prête à prescrire des peines contre le crime et des récompenses pour la vertu. (Fig. 60.)
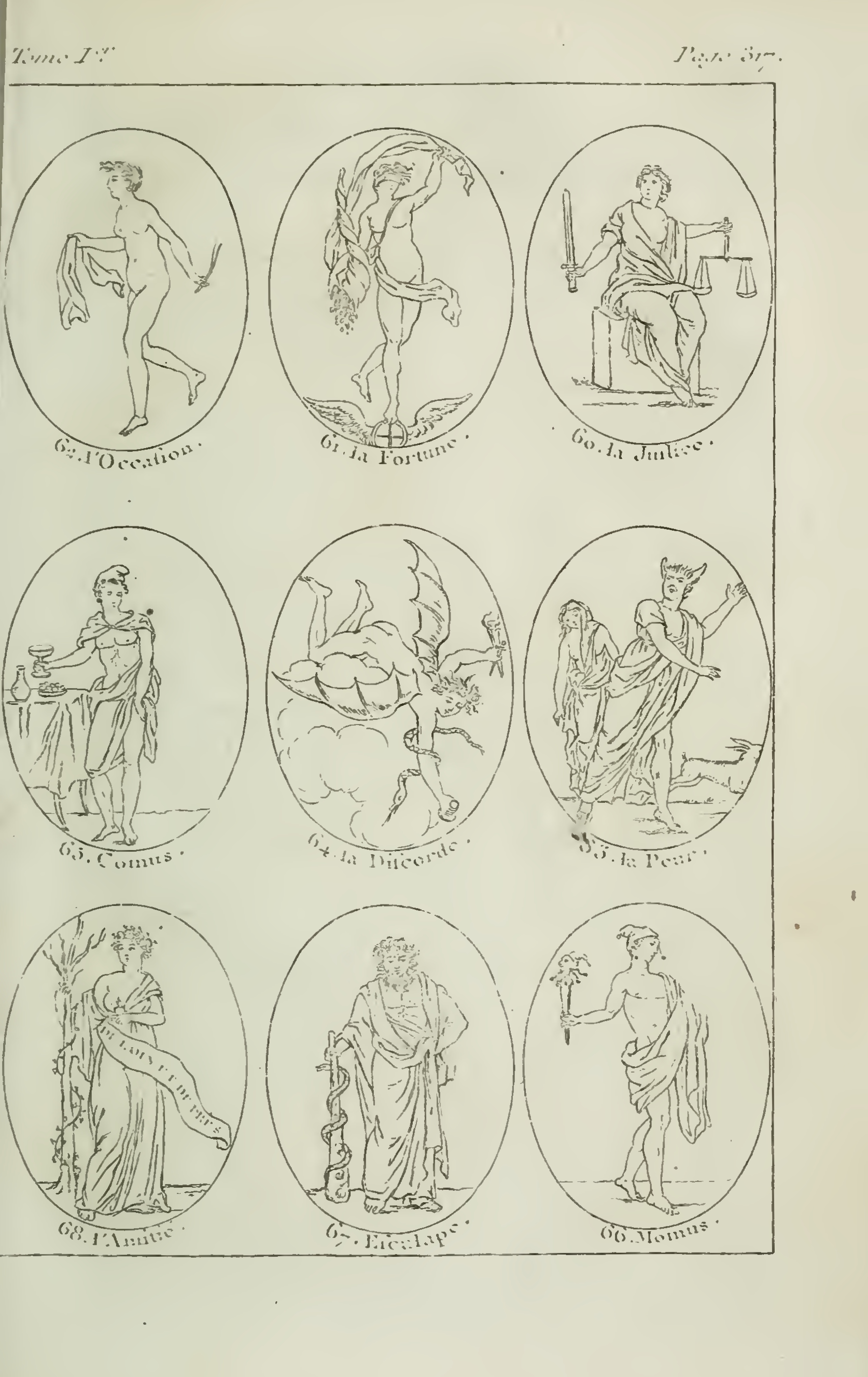
La Fortune présidait au bien et au mal. On la représentait sous la figure d’une femme aveugle et presque chauve, avec des ailes aux deux pieds. L’un d’eux est posé sur une roue qui tourne avec vitesse, et l’autre est en l’air. (Fig. 61.)
L’Occasion se représentait de même, mais elle avait une touffe de cheveux sur la tête, afin de laisser un moyen de la saisir. (Fig. 62.)
Suite des divinités particulières. §
LaPâleur et la Peur. Les hommes frappés à la vue des événemens dont ils ne connaissaient pas la cause, et qui leur inspiraient de la frayeur, firent une divinité du trouble même qui les agitait ; et, pour s’en délivrer, ils lui adressaient des vœux, des prières. Il est impossible de désigner le moment où ce culte commença. Dans les combats, on donnait au dieu de la guerre la Peur et la Fuite pour cortége. Les deux fils de Médée ayant été massacrés par les Corinthiens, une peste cruelle fit périr une partie de leurs enfans. L’Oracle leur ordonna de sacrifier aux mânes irrités de ces innocentes victimes, et d’ériger en même temps une statue à la Peur.
On la représentait avec des cheveux hérissés, le visage élevé, la bouche ouverte et le regard troublé. (Fig. 63.) La Pâleur était représentée par une figure maigre et allongée, les cheveux abattus et le regard fixe.
Les Lacédémoniens avaient placé le temple de la Peur auprès du tribunal des Éphores, afin d’inspirer aux méchans la crainte d’un châtiment sévère. On joignait toujours la Peur aux autres dieux lorsqu’on prononçait des sermens.
Il serait aussi long qu’inutile de nommer toutes les divinités particulières. En général, les Romains, et les Grecs avant eux, adoraient les vertus, les passions, les vices et jusqu’aux événemens imprévus. Chacun pouvait créer à son gré quelque dieu nouveau. Lorsque des voyageurs, en traversant une rivière, une forêt, éprouvaient quelque danger ou quelque surprise, ils dressaient un autel, l’ornaient de quelques attributs, de quelques inscriptions, et ces monumens du caprice étaient respectés, souvent même adorés par ceux que le hasard conduisait auprès d’eux. Il sera toujours facile de suppléer à la nombreuse liste que nous supprimons pour ne point fatiguer nos lecteurs. Les poëtes et les anciens, en nommant ces divinités dans leurs ouvrages, s’attachent surtout à peindre leur influence et leurs effets ; il sera donc toujours très-facile de les reconnaître ; elles auront du moins alors les charmes et les ornemens de la poésie.
Cependant, parmi les divinités malfaisantes, il ne faut pas oublier Atée ou la Discorde. (Fig. 64.) Chassée de l’Olympe par Jupiter, parce qu’elle cherchait à brouiller les dieux, elle vint sur la terre exercer toutes ses fureurs. On attribuait à cette cruelle déesse les guerres, les querelles entre les particuliers, les dissensions dans les ménages ; ce fut elle qui jeta, au milieu du festin préparé pour les noces de Pélée, la fatale pomme, avec cette inscription : A la plus belle. Nous avons déjà dit que les Prières, ses sœurs, courent après elle, pour réparer les maux qu’elle cause ; mais elles sont boiteuses, et leur cruelle sœur les devance toujours.
De Comus et de Momus. §
Comus présidait aux festins, à la bonne chère : il n’est connu que de nom. Tout peintre a le droit de prendre son imagination pour guide lorsqu’il veut le représenter. (Fig. 65.) Son nom vient de commessari, manger : on croit aussi qu’il vient d’une espèce de chanson très-familière aux anciens, que l’on nommait comos, et que l’on chantait dans les repas.
Momus, fils du Sommeil et de la Nuit, était le dieu de la raillerie et des bons mots. (Fig. 66.) Satirique jusqu’à l’excès, les dieux et Jupiter même étaient les objets de ses plus sanglantes railleries. Son nom vient du mot grec momos, reproche. Il blâmait les dieux de n’avoir pas mis une ouverture au cœur de l’homme, pour laisser la possibilité de distinguer la vérité du mensonge.
Des dieux de la médecine. §
Le nom d’Esculape, que les Grecs appelaient Asclépios, paraît étranger, et semble tiré des langues de l’Orient. Il est certain qu’Esculape était connu dans la Phénicie, avant de l’être dans la Grèce. , le plus ancien des auteurs phéniciens, nomme un Esculape, fils de Sydic ou le Juste, et d’une princesse de la famille des Titans. Le célèbre , dont l’opinion est une véritable autorité pour les savans, nomme un Esculape, roi de Memphis : il était frère du premier Mercure, et vivait deux cents ans avant le déluge, plus de mille ans avant l’Esculape grec. parle aussi d’un Esculape égyptien, célèbre médecin, qui contribua beaucoup à répandre en Égypte l’usage des lettres que Mercure avait inventées. C’est donc dans la Phénicie et dans l’Égypte qu’il faut chercher le véritable Esculape. Honoré comme un dieu dans ces deux pays, son culte passa dans la Grèce, et fut apporté par des colonies. On l’établit d’abord dans Épidaure, ville du Péloponèse, et bientôt les Grecs prétendirent qu’il était originaire de leur pays ; mais, comme leur mythologie était fort incertaine, ils racontaient différemment son histoire. Les poëtes lui donnaient pour père Apollon, et pour mère Coronis, fille de Phlégyas. Esculape, au moment de sa naissance, fut exposé sur une montagne, et allaité par une chèvre. Le berger du troupeau crut voir cet enfant environné de lumière. Retiré de ce lieu, il fut élevé par Trygone, femme du berger qui l’avait découverte ; et dès qu’il commença à parler, on renvoya à l’école du célèbre centaure Chiron. Son esprit, très-vif et très-subtil, lui fit faire de grands progrès dans la connaissance des simples, et dans la composition des remèdes. Suivant l’usage de ces temps, il joignit la chirurgie à la médecine, et devint si habile, qu’il passa pour l’inventeur et ensuite le dieu de la médecine.
Esculape, contemporain d’Hercule et de Jason, les accompagna dans le voyage des Argonautes, et leur fut extrêmement utile. Peu de temps après sa mort, on lui rendit les honneurs divins. On le plaça dans le ciel ; il forme le signe appelé le Serpentaire. Ses descendans régnèrent dans une partie de la Messénie. C’est de là que Machaon et Podalyre, ses deux fils, allèrent à la guerre de Troie.
Les poëtes publièrent dans leurs fables que la science d’Esculape allait jusqu’à ressusciter des morts ; que Pluton se plaignit à Jupiter de ce qu’il rendait son royaume désert, et que ce dieu, pour apaiser le dieu des enfers, foudroya le médecin. Nous avons déjà dit qu’Apollon tua les Cyclopes à coups de flèches, pour venger la mort de son fils.
A Épidaure, on honorait Esculape sous la forme d’un serpent. On le représentait aussi sous la figure d’un homme. Sa statue, ouvrage de , était d’or et d’ivoire, comme celle de Jupiter Olympien à Athènes, mais plus petite de moitié. Il est représenté sur un trône, tenant d’une main un bâton, et appuyant l’autre sur la tête d’un serpent. (Fig. 67.) On voyait autour du temple grand nombre de colonnes, sur lesquelles étaient écrits les noms de ceux qui se disaient guéris par lui. Le coq et le serpent étaient spécialement consacrés à ce dieu.
La fable publie qu’Esculape était sorti d’un œuf de corneille, sous la forme d’un serpent. Un aventurier ayant trouvé moyen d’introduire un de ces reptiles dans un œuf de corneille, et l’ayant mis dans les fondations d’un temple que l’on élevait en l’honneur d’Esculape, publia qu’il avait trouvé cet œuf, et que c’était Esculape lui-même qui s’était ainsi déguisé. Cette fable fut crue par le peuple, et la foule venait adorer cette divinité de la santé. Les prêtres, habiles médecins, et possesseurs des secrets d’Esculape, faisaient prendre des remèdes aux malades, et laissaient à leur dieu tout l’honneur de la guérison.
Le serpent devint le symbole d’Esculape ; il l’est en même temps de la prudence, qualité si nécessaire aux médecins. rapporte que les Romains, attaqués de la peste, apprirent dans les livres sacrés qu’il fallait aller chercher Esculape à Épidaure. On députa des ambassadeurs. Les prêtres leur donnèrent une couleuvre privée, qu’ils assurèrent être Esculape lui-même. Elle fut embarquée solennellement, et, le vaisseau étant parvenu jusqu’à l’île du Tibre, elle en sortit, et se cacha dans les roseaux. On crut que le dieu avait choisi ce lieu pour demeure ; on lui bâtit un temple superbe sur ce lieu même, et l’on fit revêtir d’un beau marbre blanc tous les bords de l’île, en lui donnant la forme, ou plutôt le dessin d’un grand vaisseau. Ce fut ainsi que, l’an de Rome 462, le culte d’Esculape fut établi parmi les Romains.
Nous ne terminerons pas l’article des divinités particulières, sans dire que les Grecs et les Romains accordaient à l’amitié les honneurs divins. Les Grecs la nommaient Philia, et les Romains la peignaient (Fig. 68) sous la forme d’une jeune femme, la tête découverte, et vêtue d’un habit très-simple, avec ces mots écrits au bas du vêtement : La mort et la vie. Sur son front on lisait : L’hiver et l’été. Une de ses mains tenait une légende, sur laquelle était écrit : De loin et de près. Ces paroles et ces symboles signifiaient que l’Amitié ne vieillit point ; qu’elle est égale dans toutes les saisons, pendant l’absence comme pendant la présence, à la vie et à la mort ; qu’elle s’expose à tout pour servir un ami, et qu’elle n’a rien de caché pour lui. Cette dernière pensée était exprimée par l’une de ses mains, appuyée sur son cœur. Cette peinture, toute éloquente qu’elle est, n’égale point les expressions de , lorsqu’il dit, en pleurant la mort de son ami :
« Depuis que je l’ai perdu, tout devient pour moi douleur et regret. Nous étions à moitié de tout, nous unissions nos larmes : nos plaisirs étaient doublés ; maintenant j’unis à mes maux les pleurs de sa perte ; et, si quelque plaisir vient me surprendre, je me le reproche, il me semble que je lui dérobe sa part. »
FIN DU TOME PREMIER.