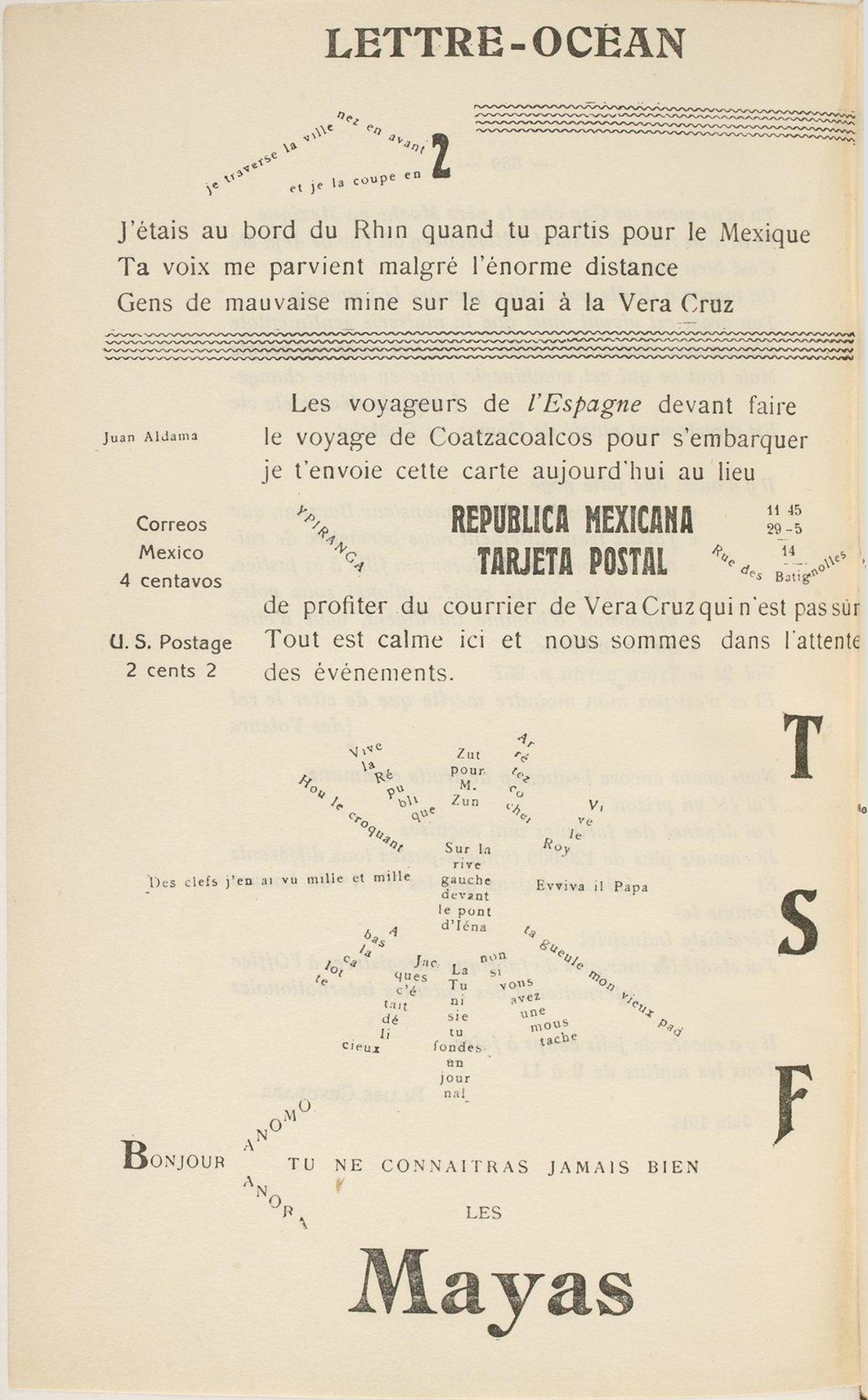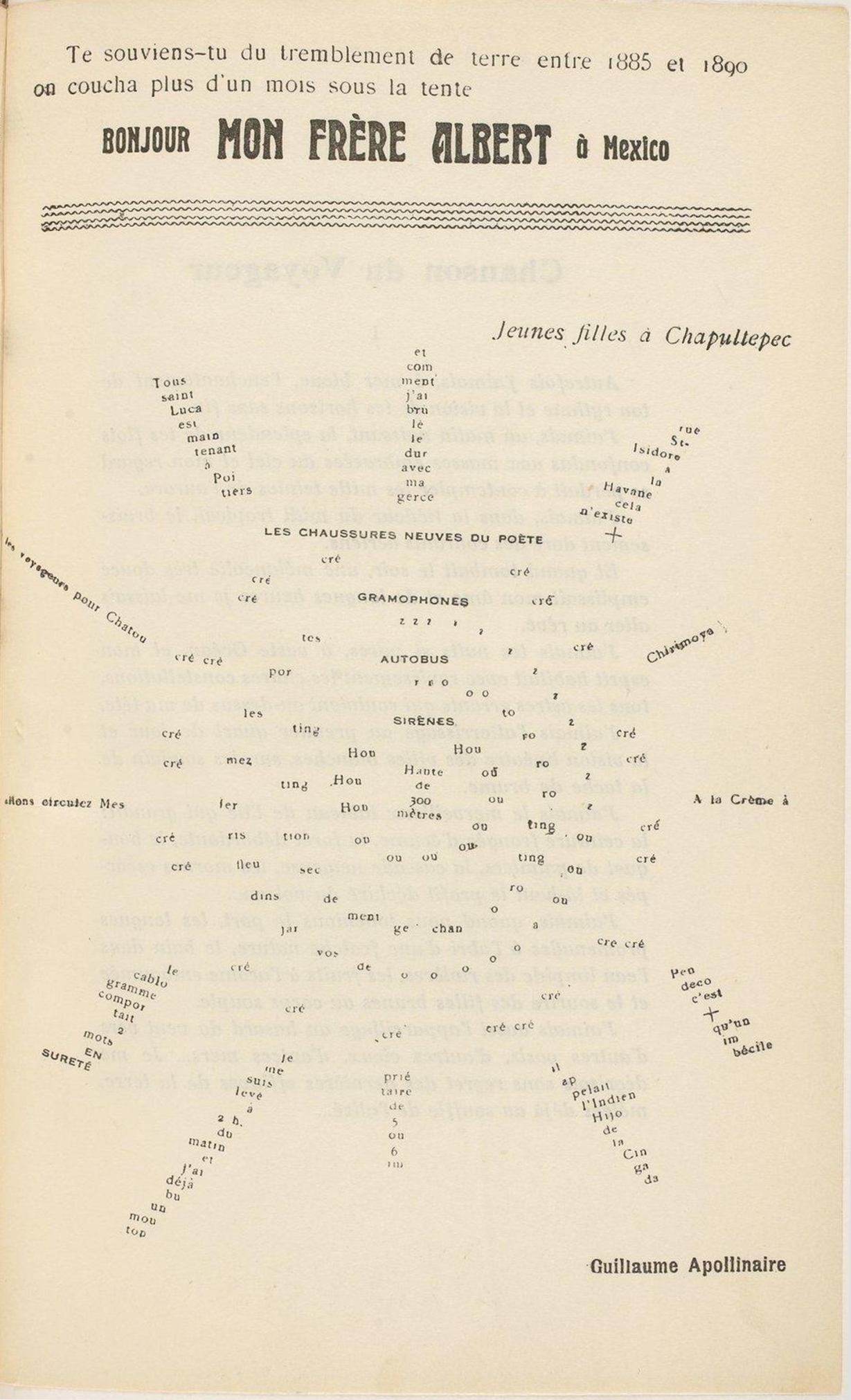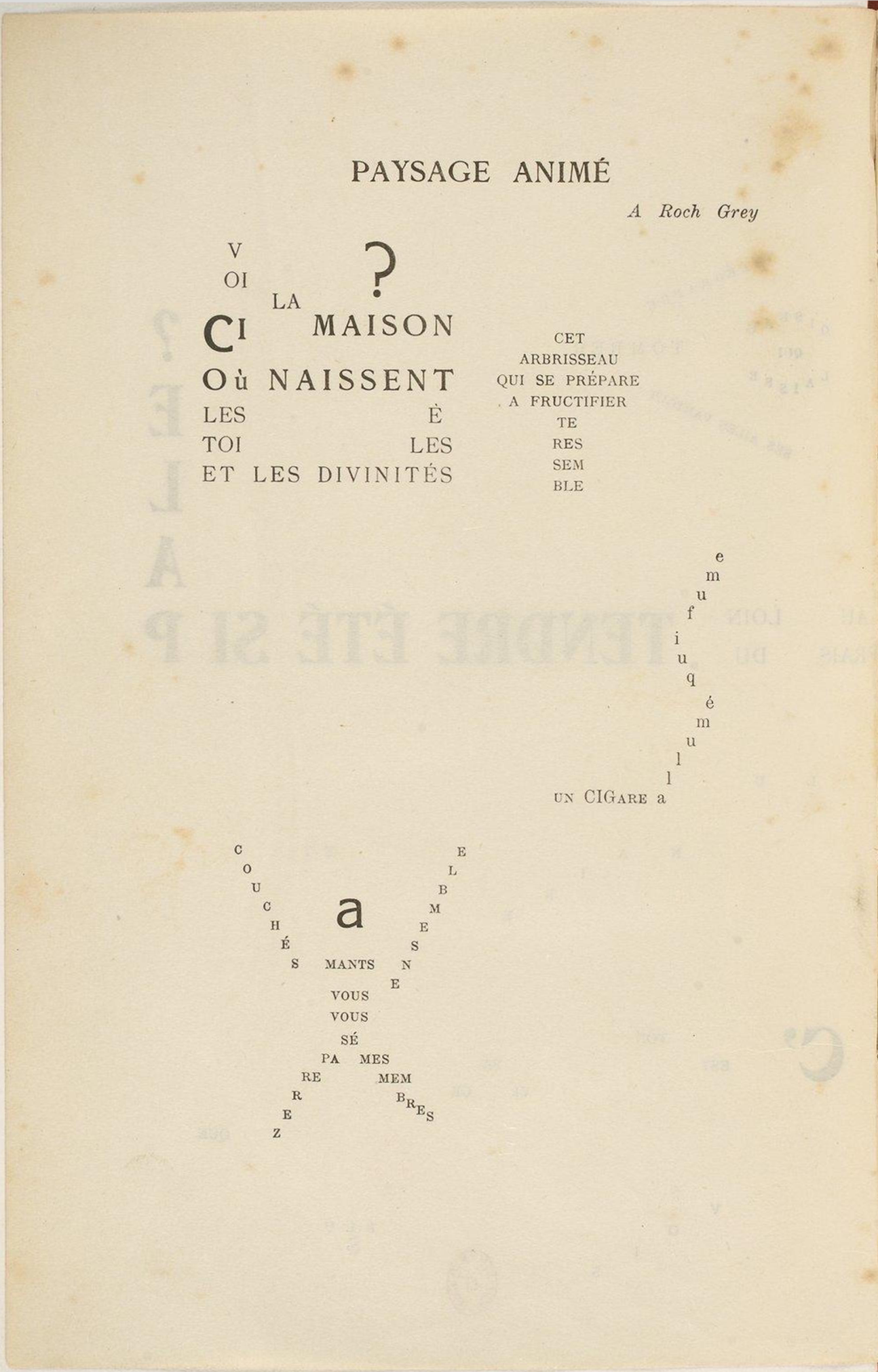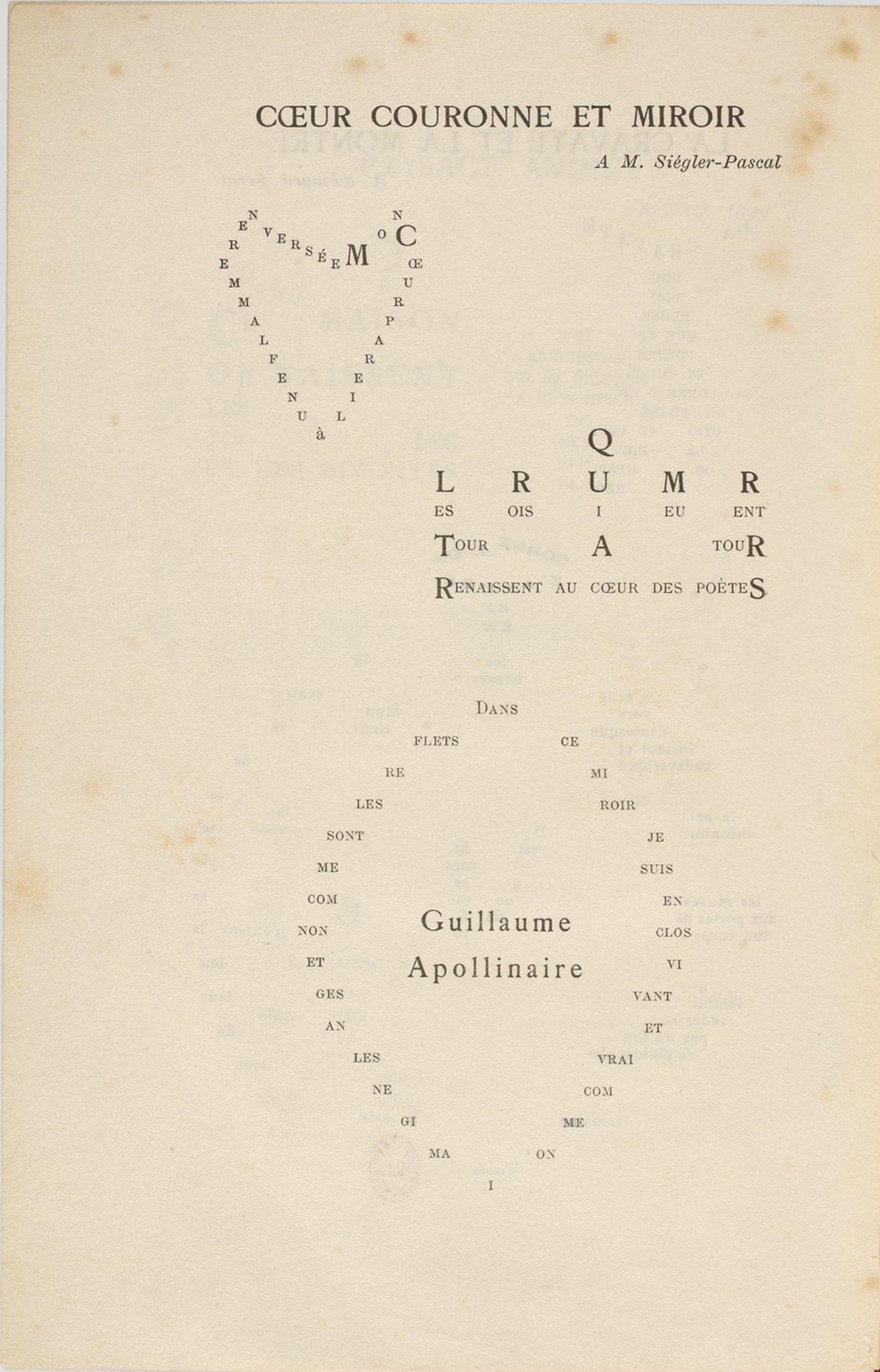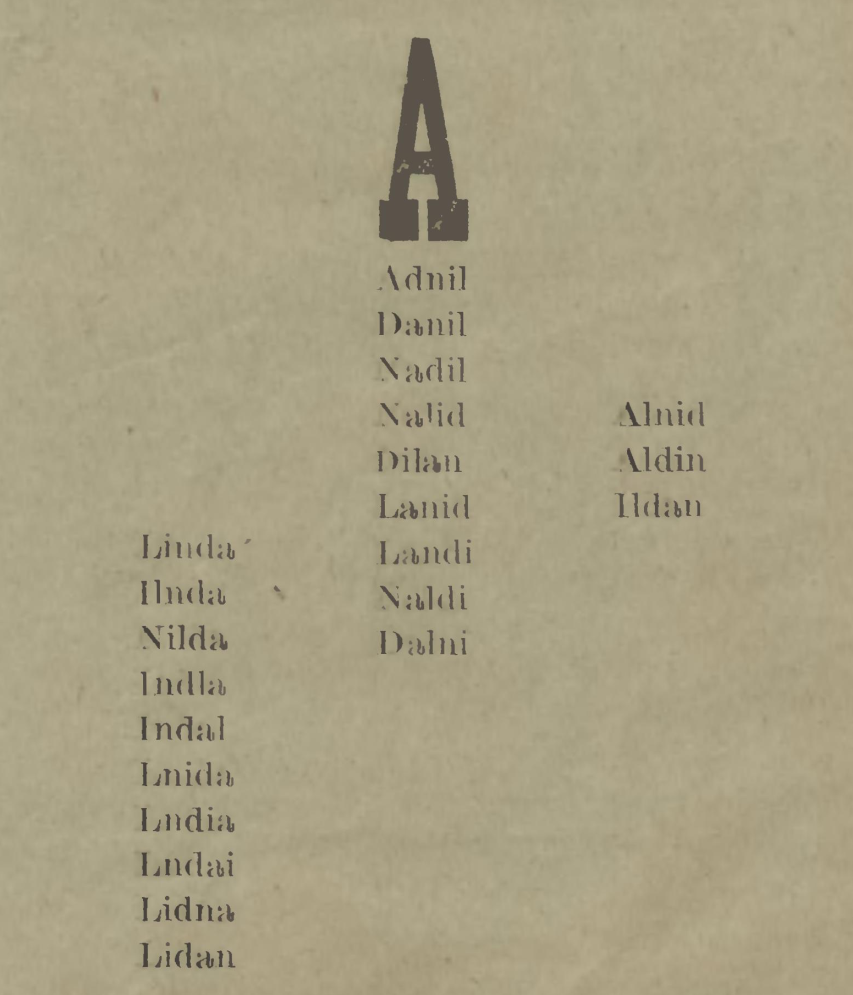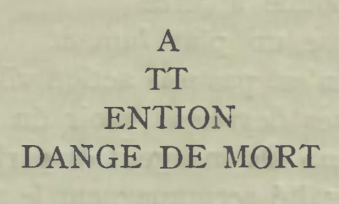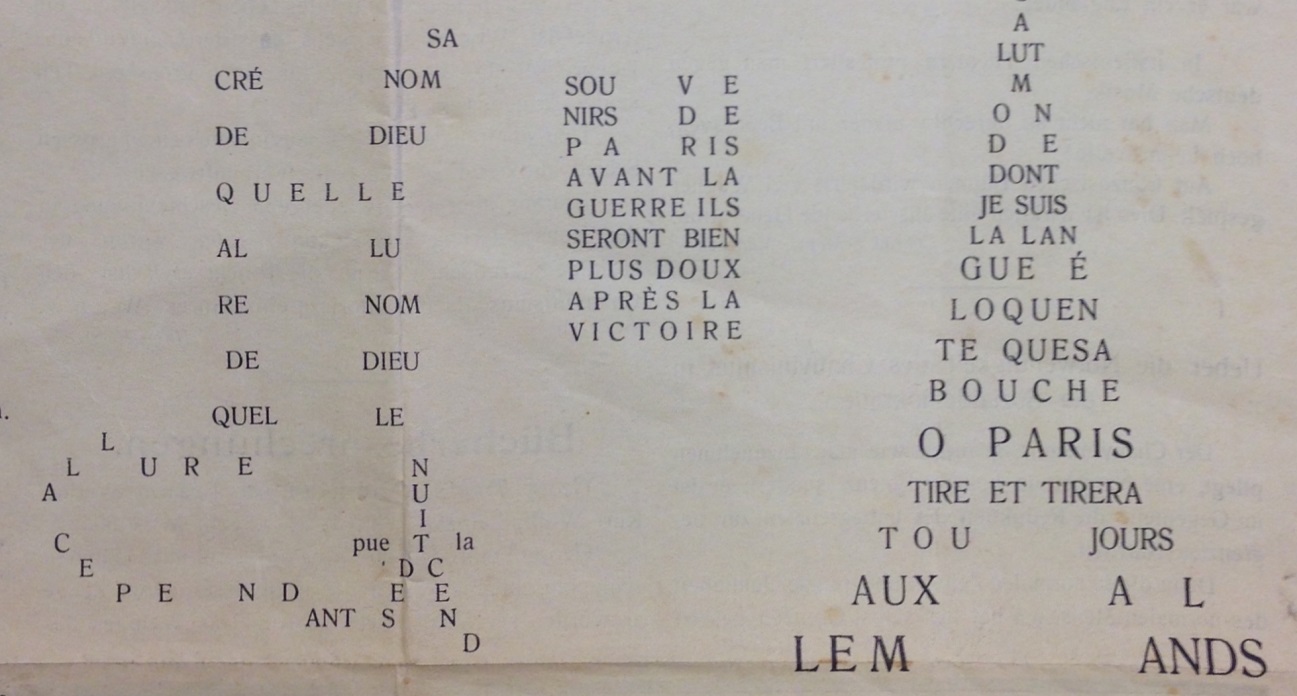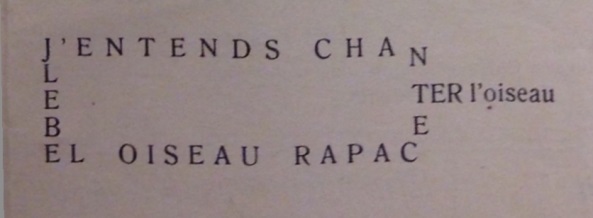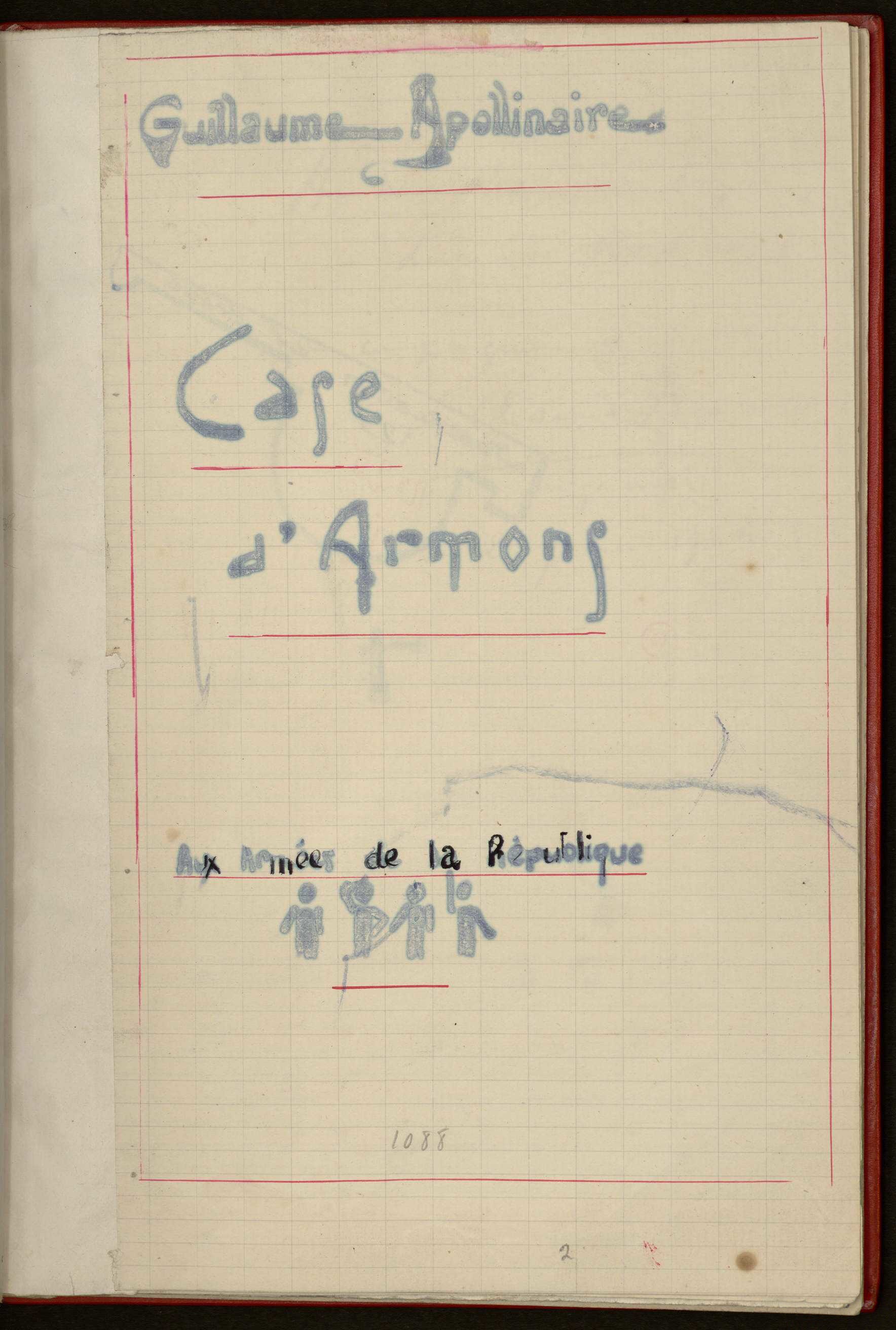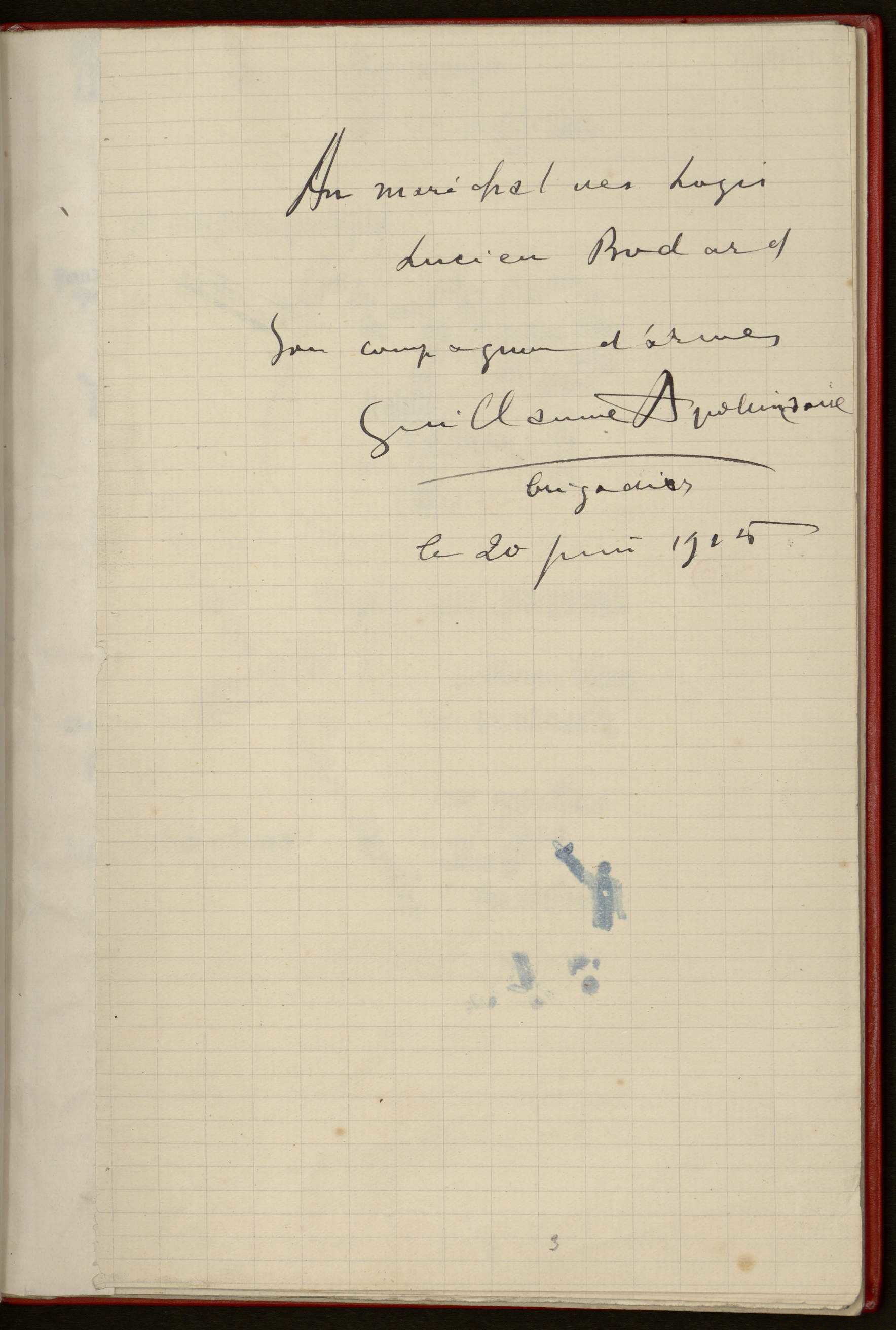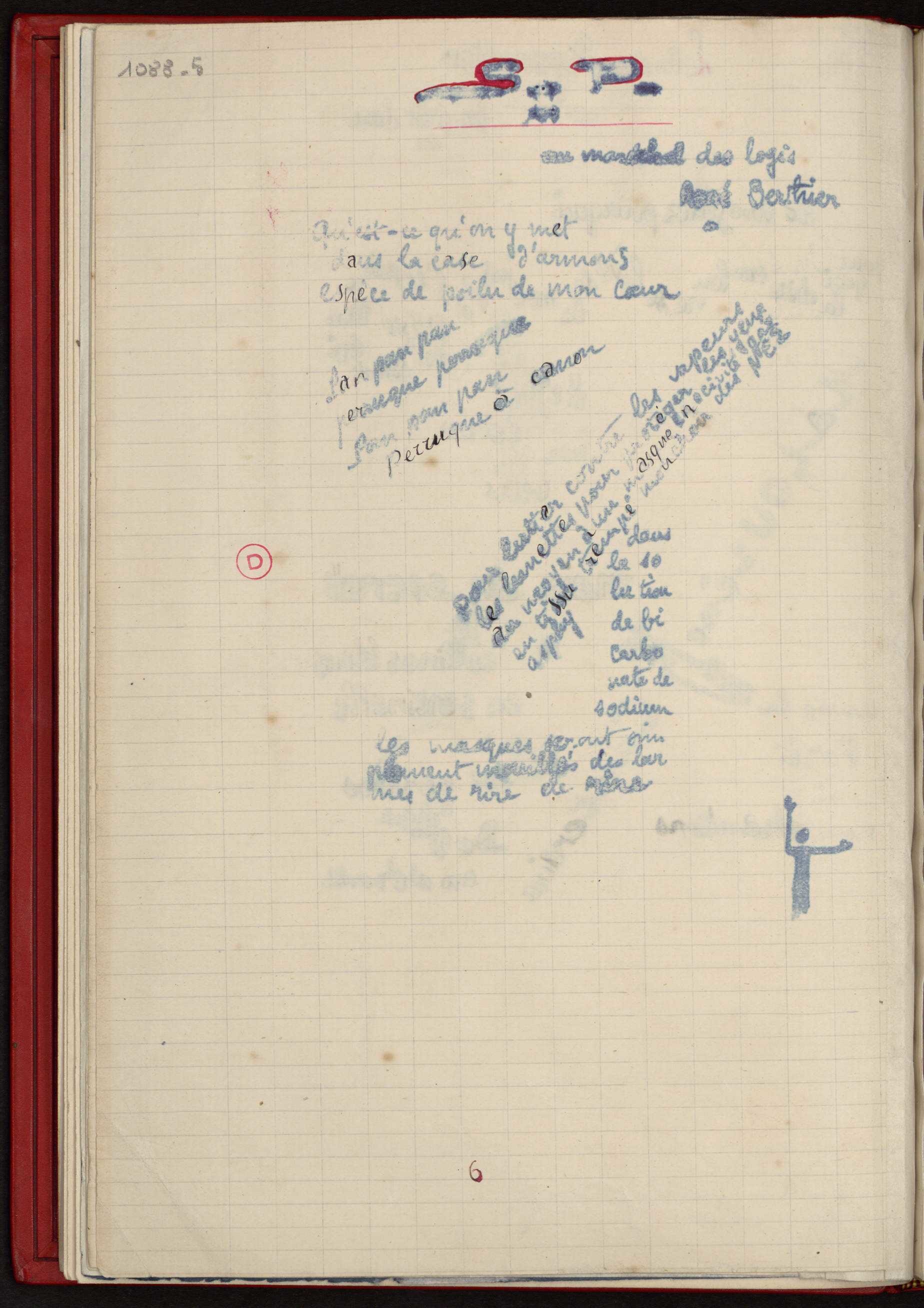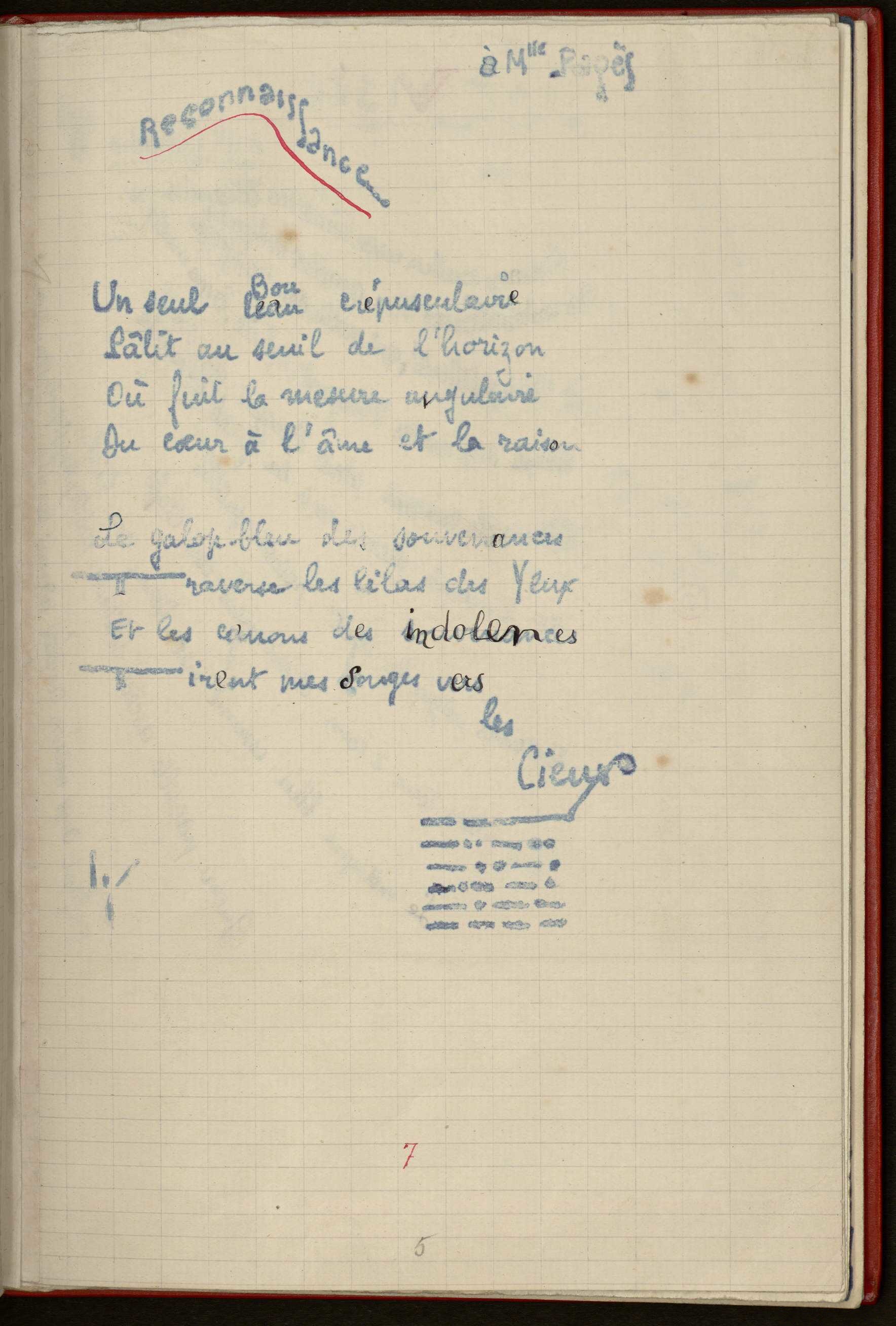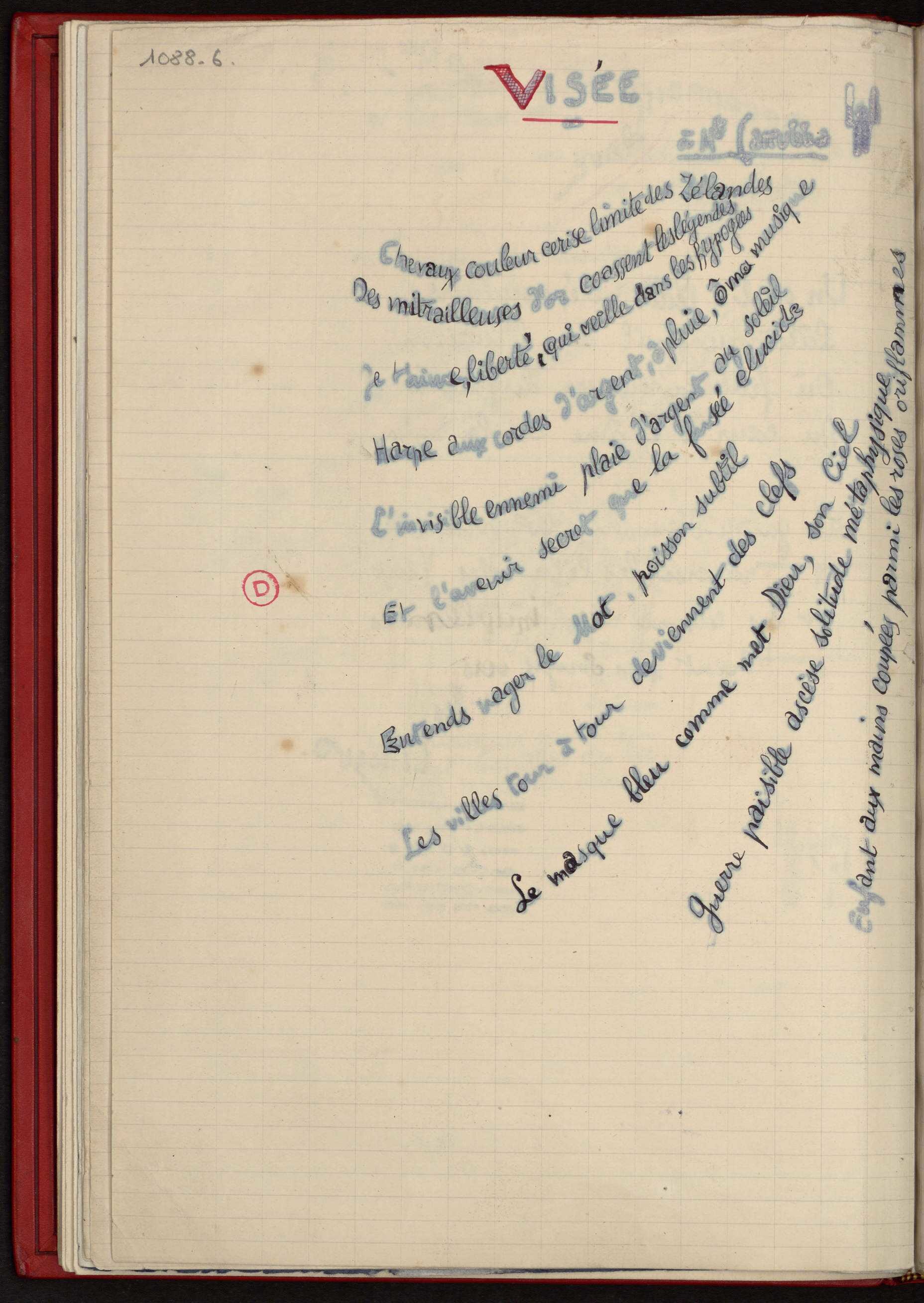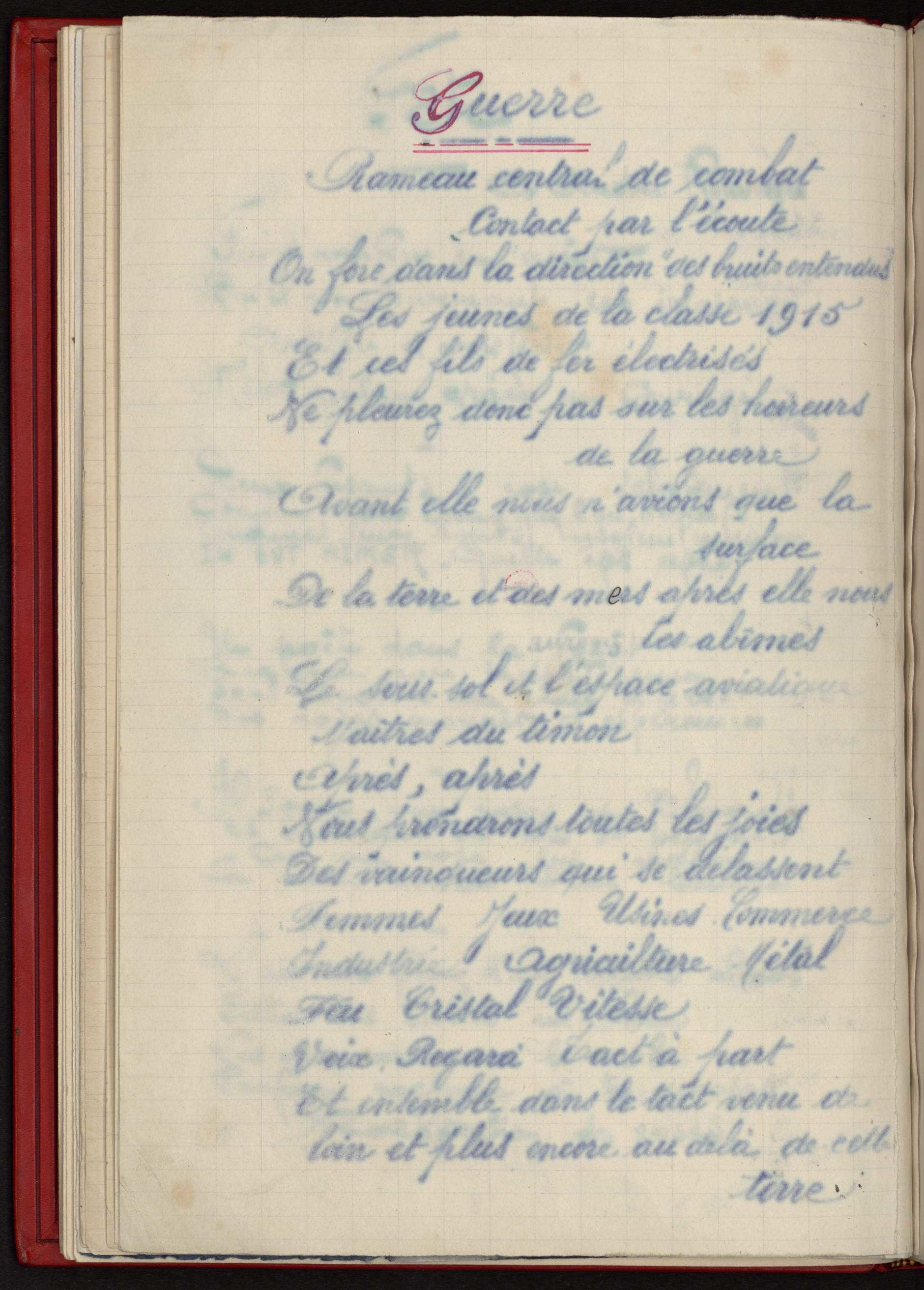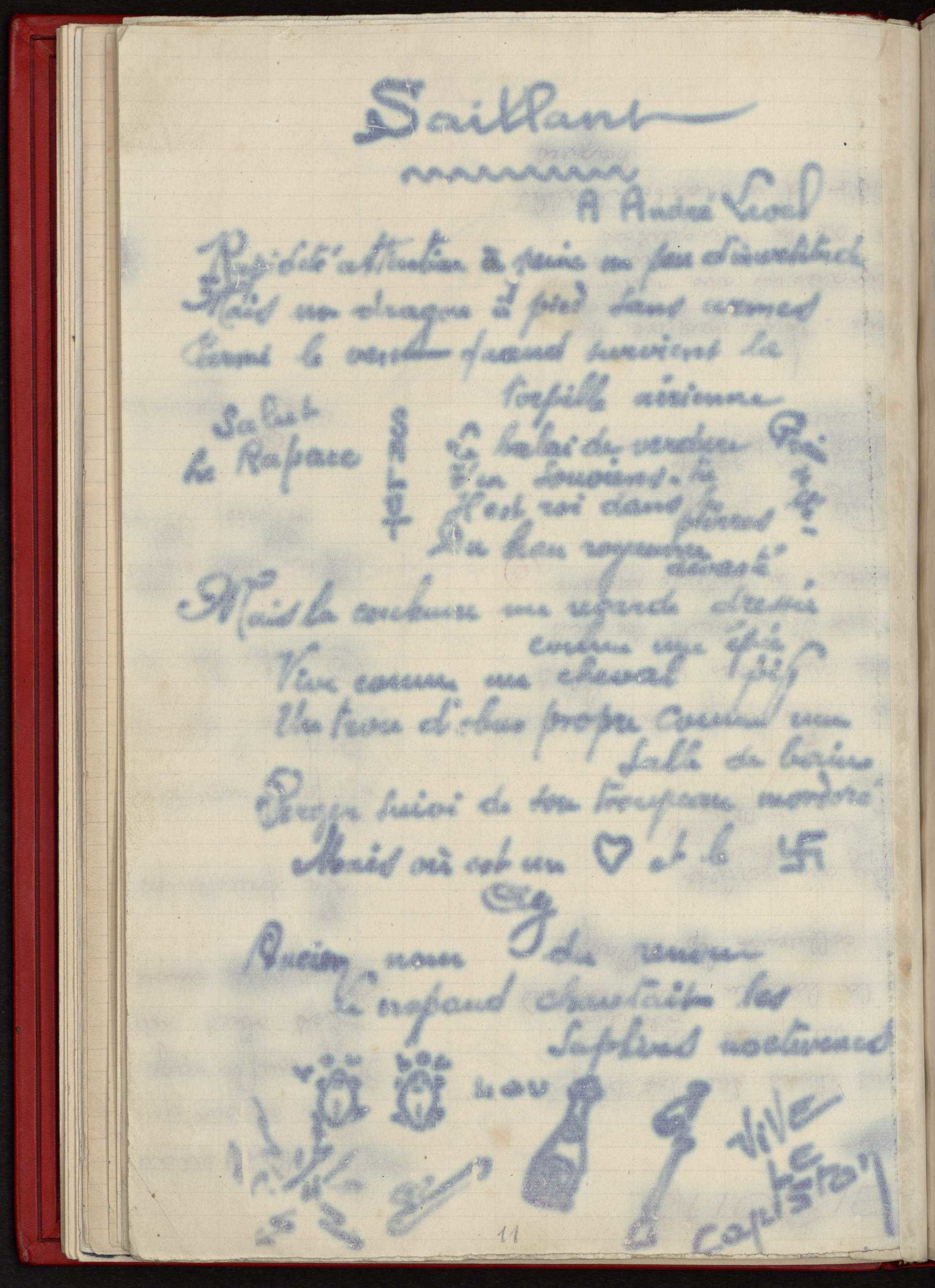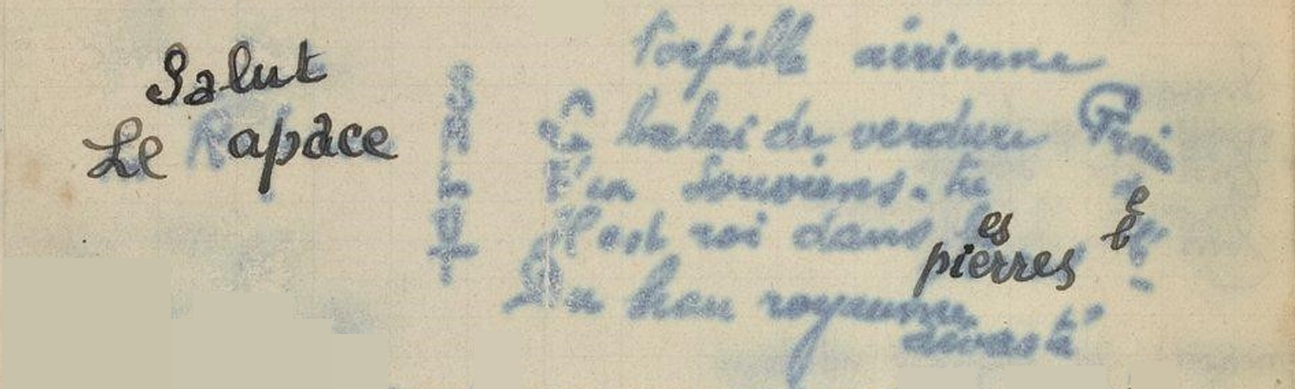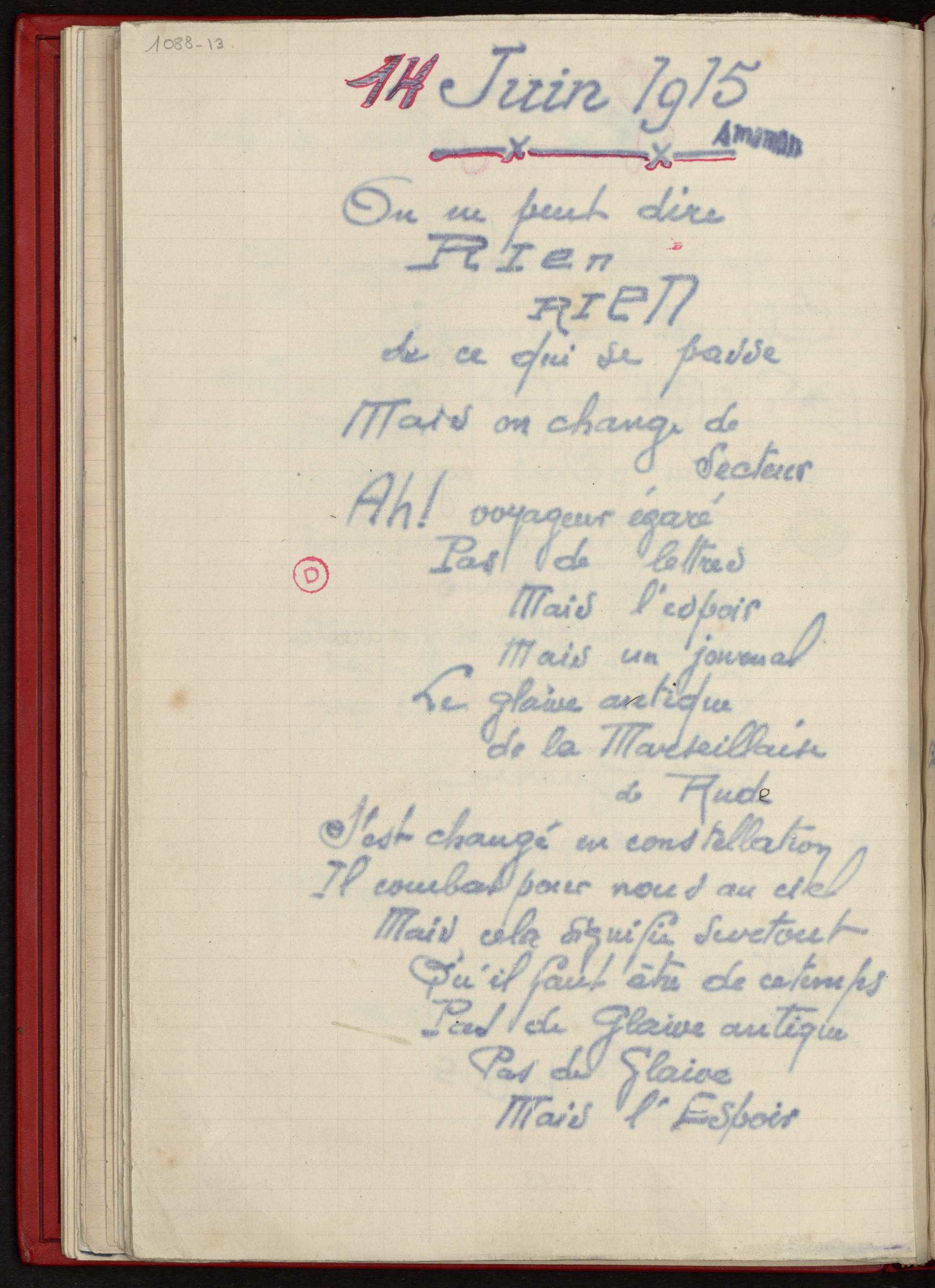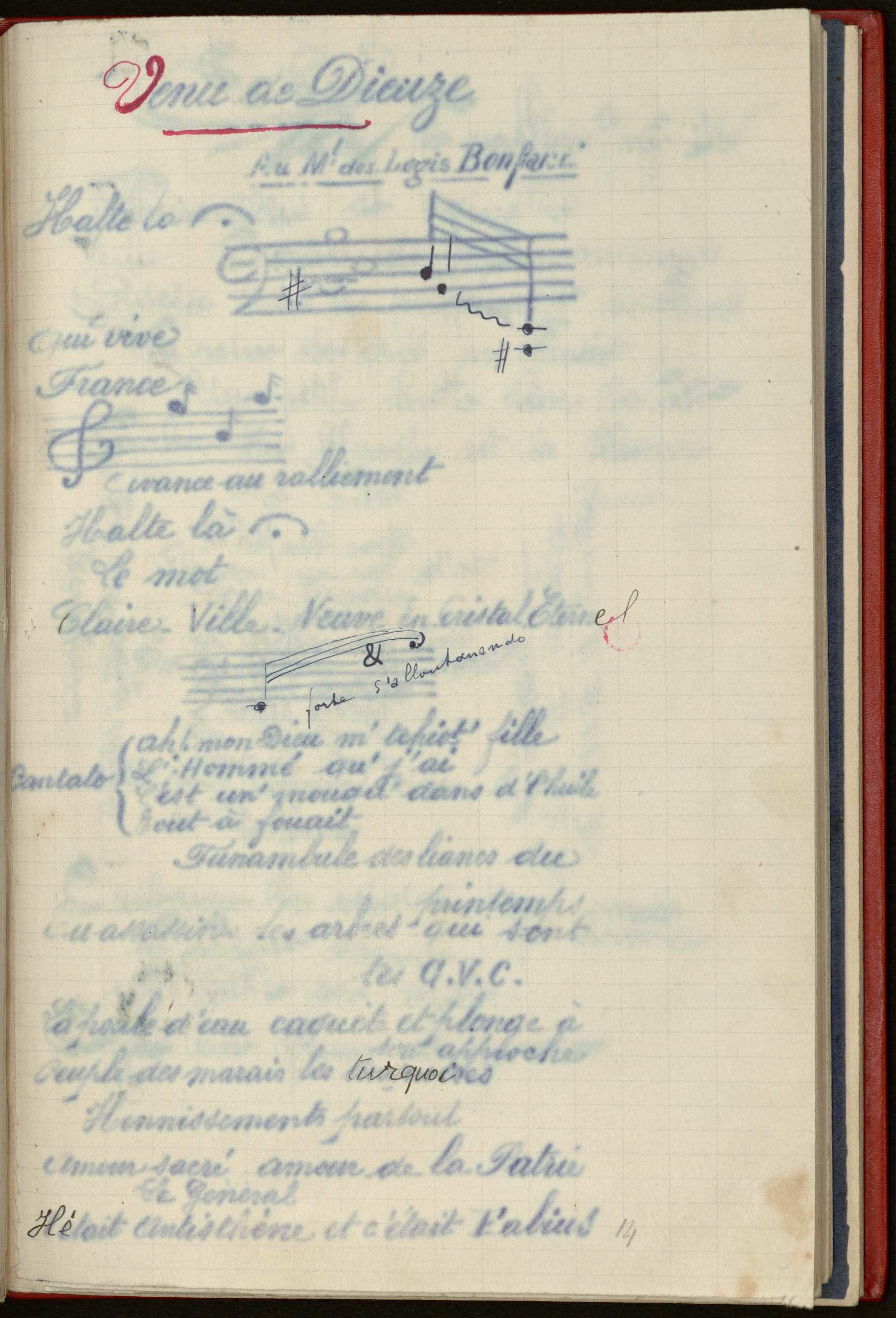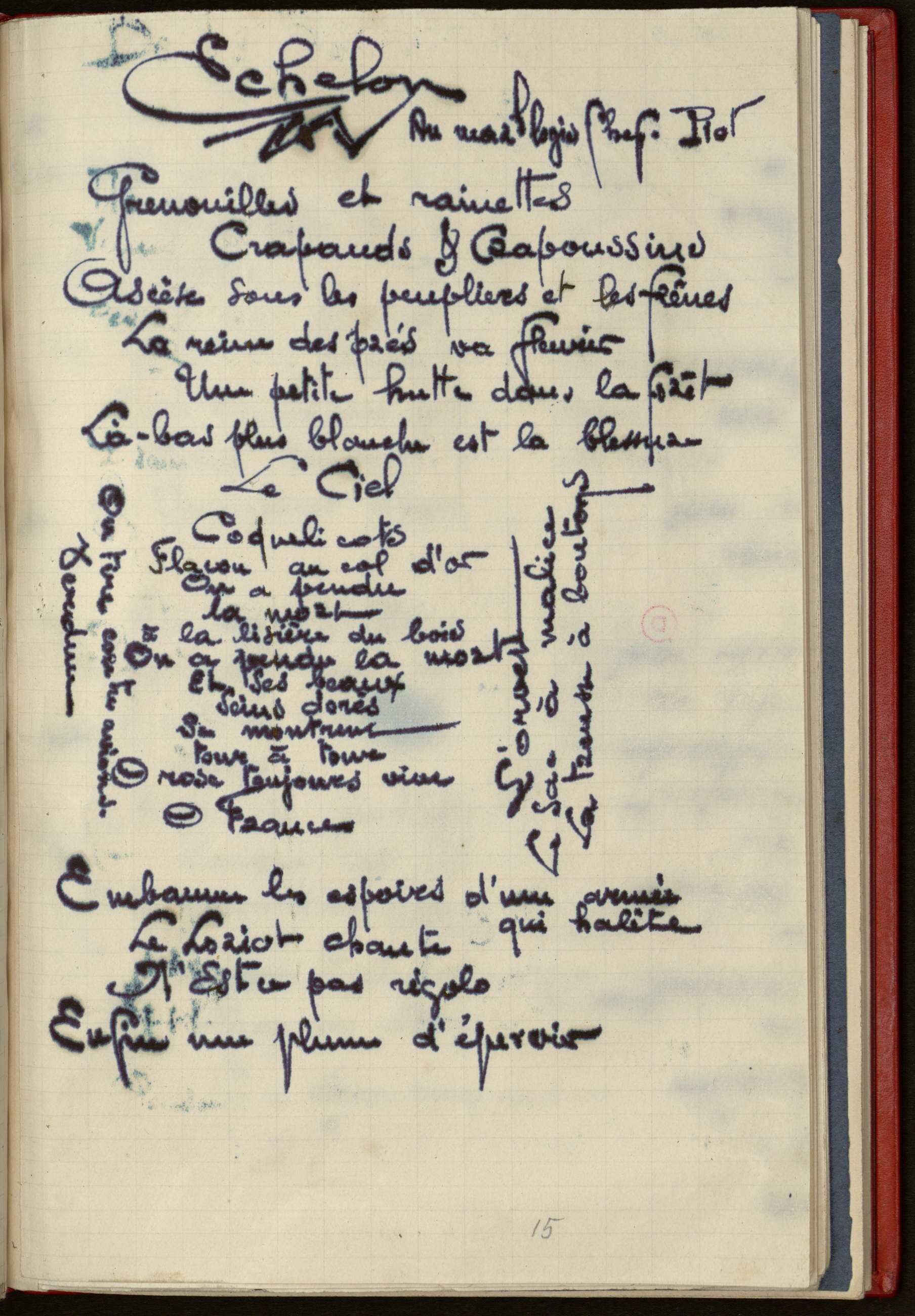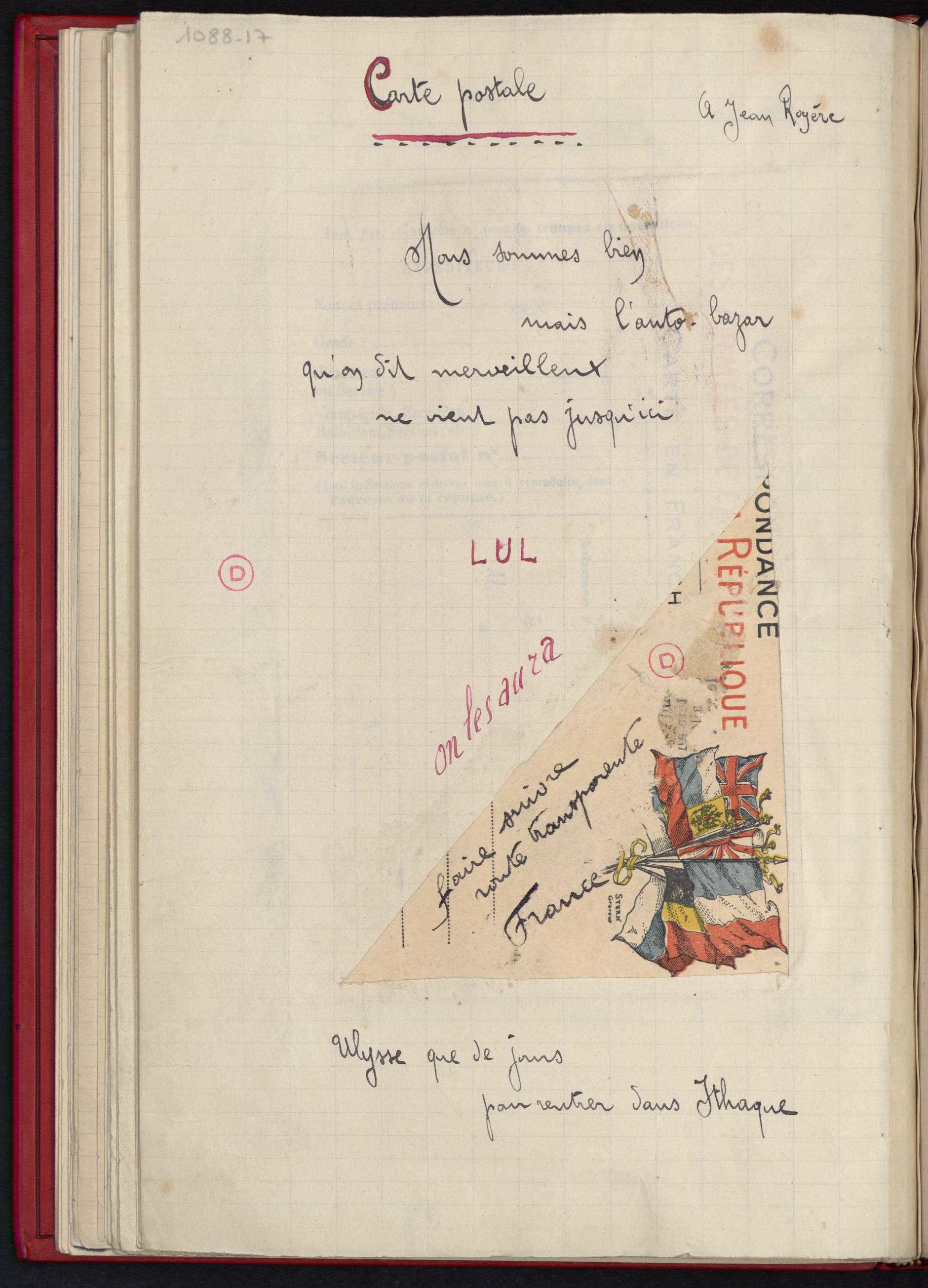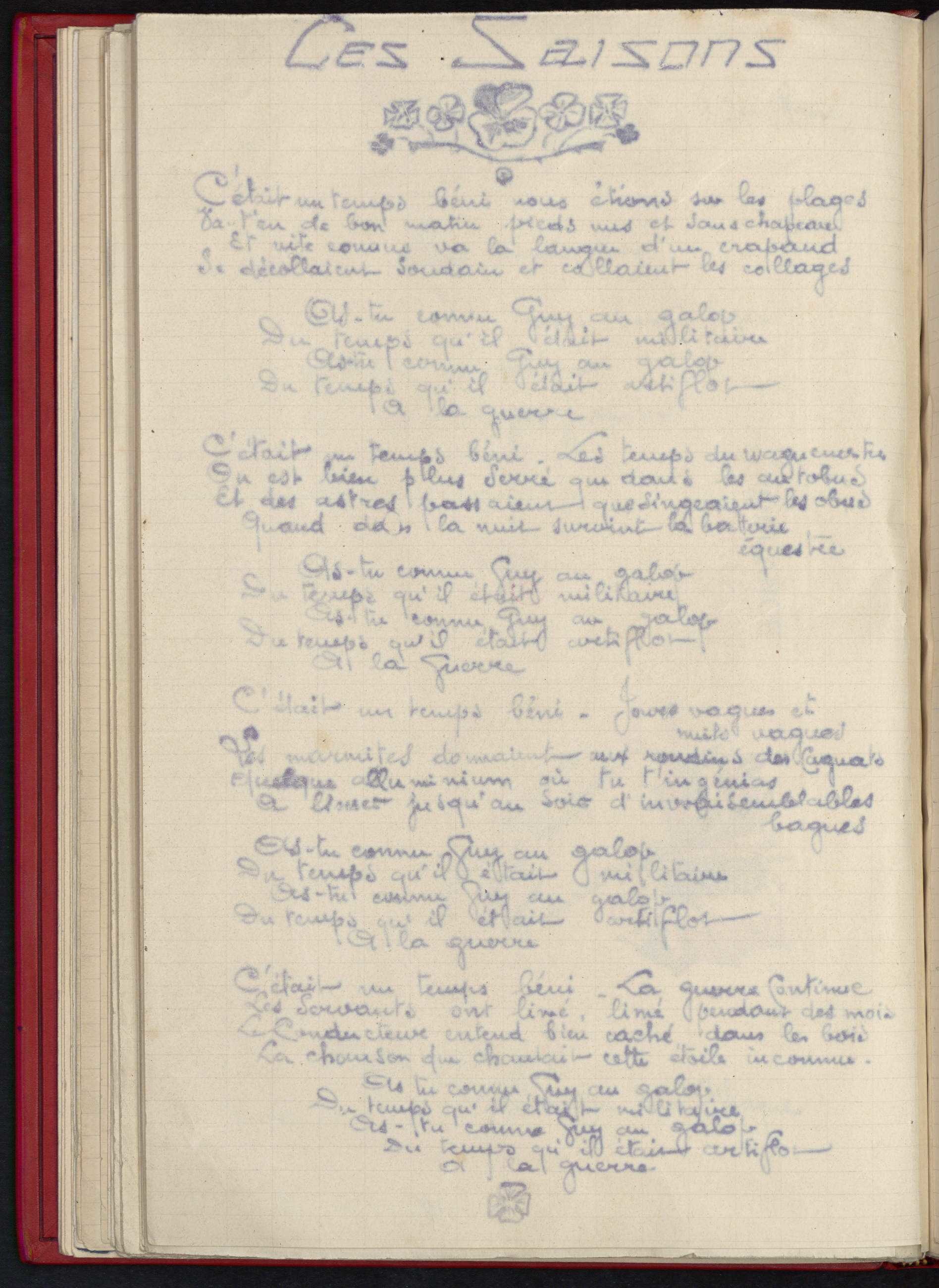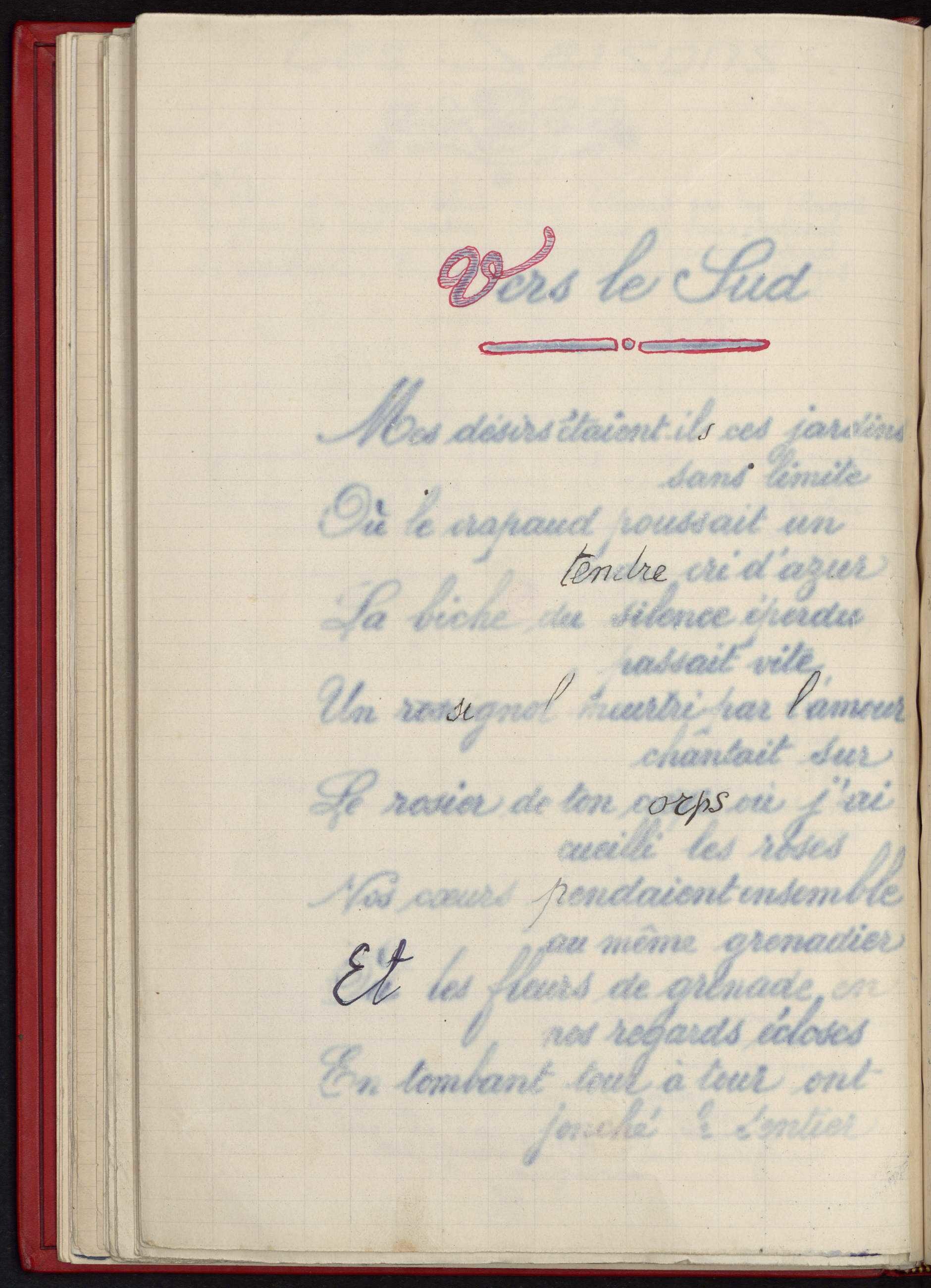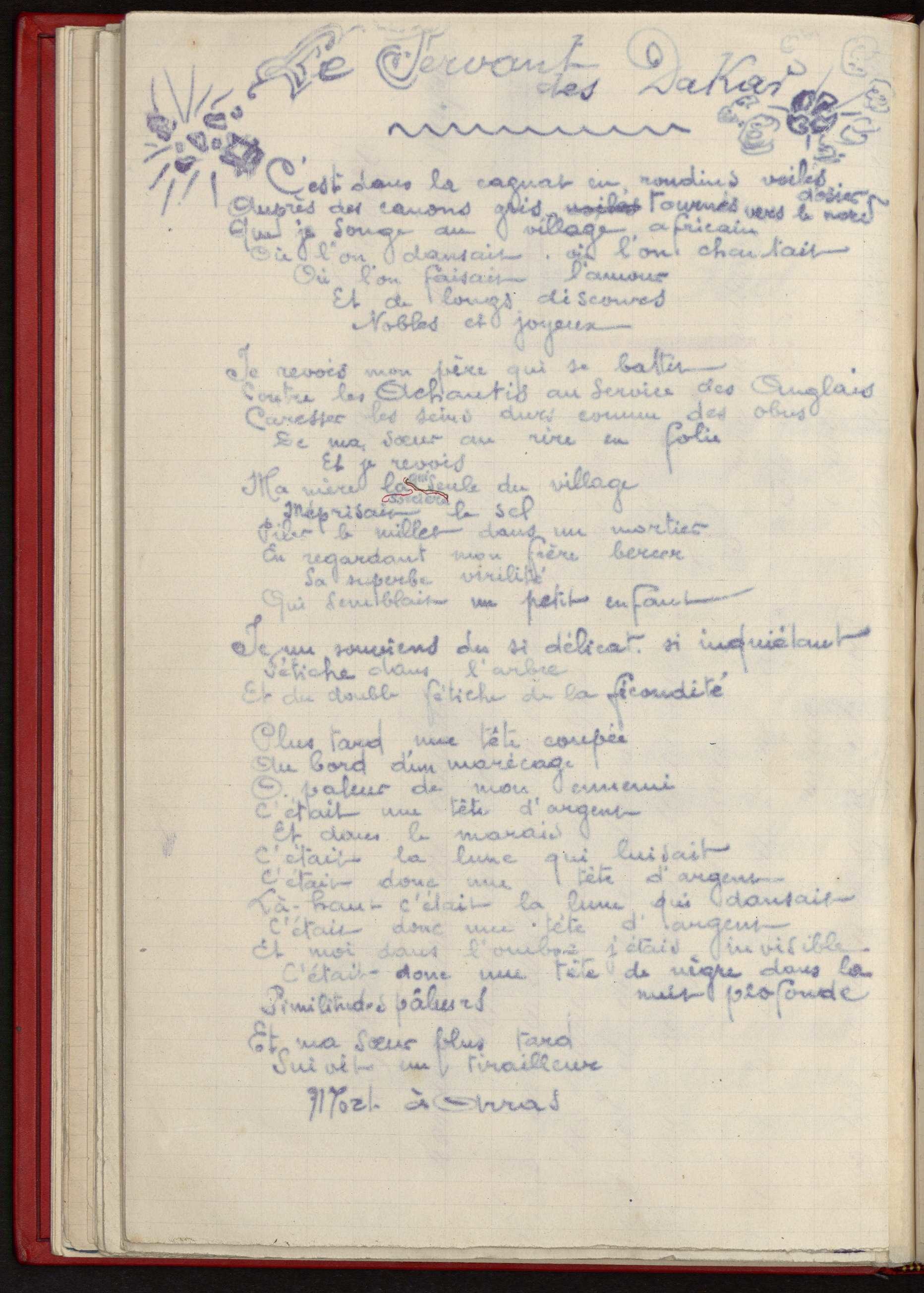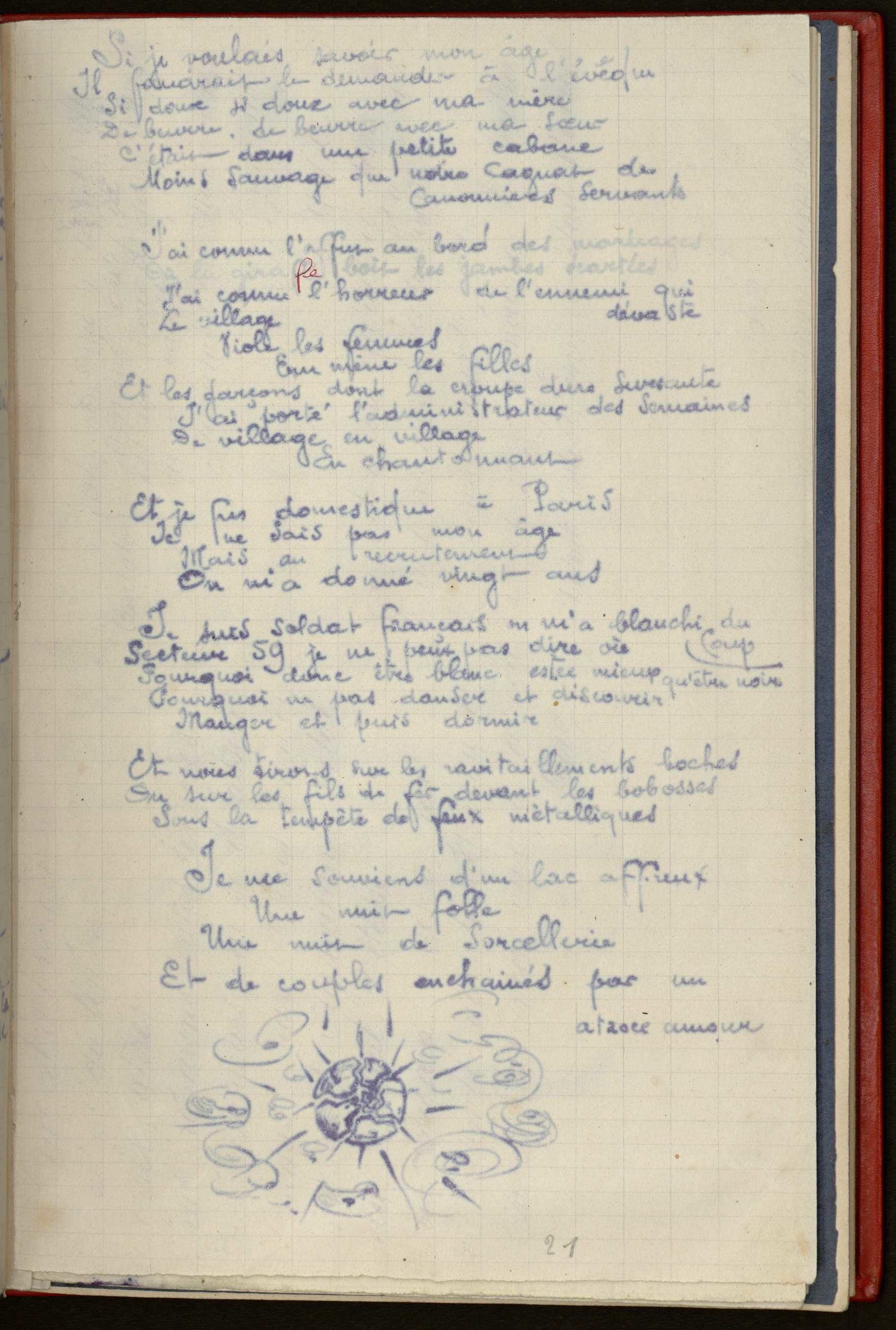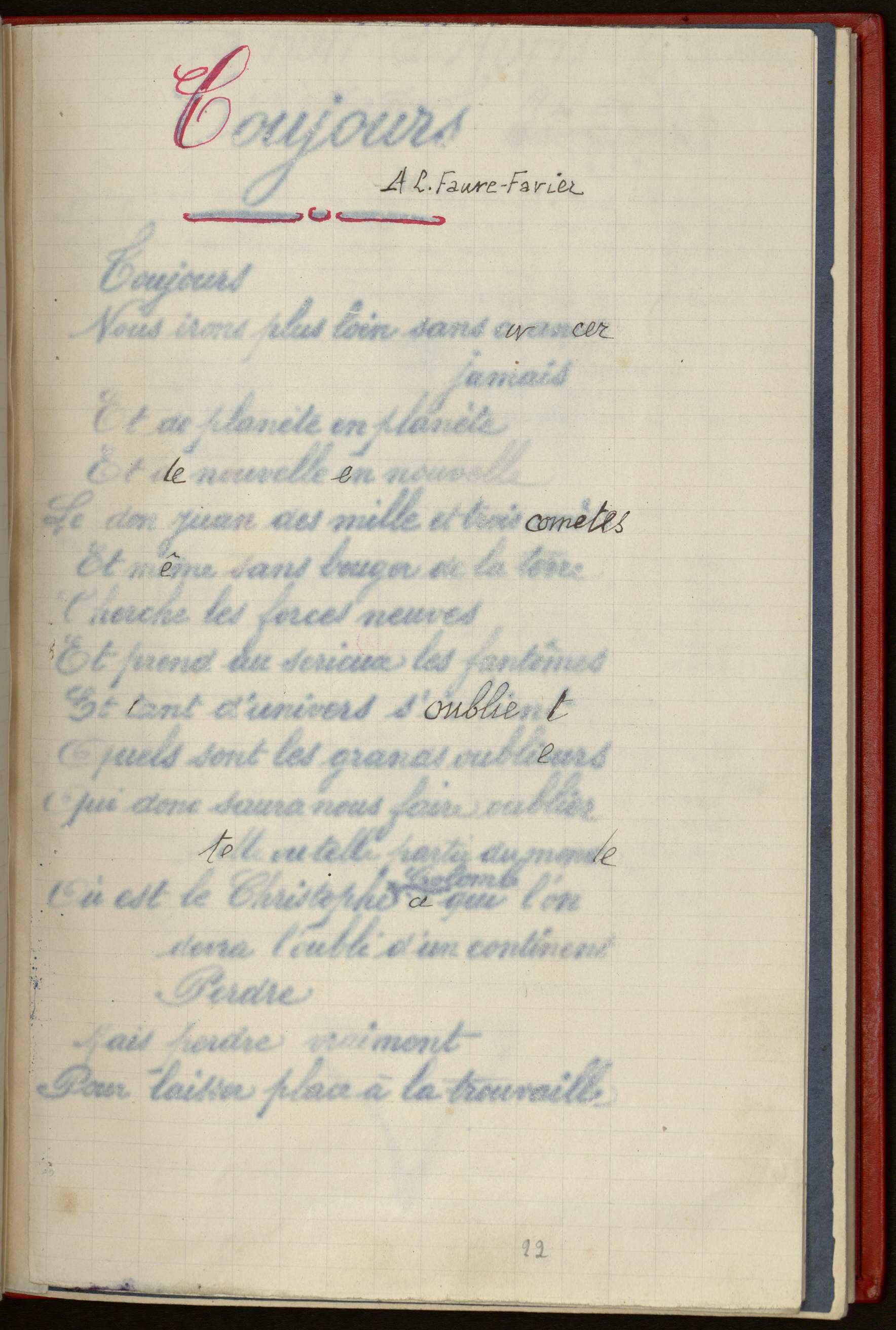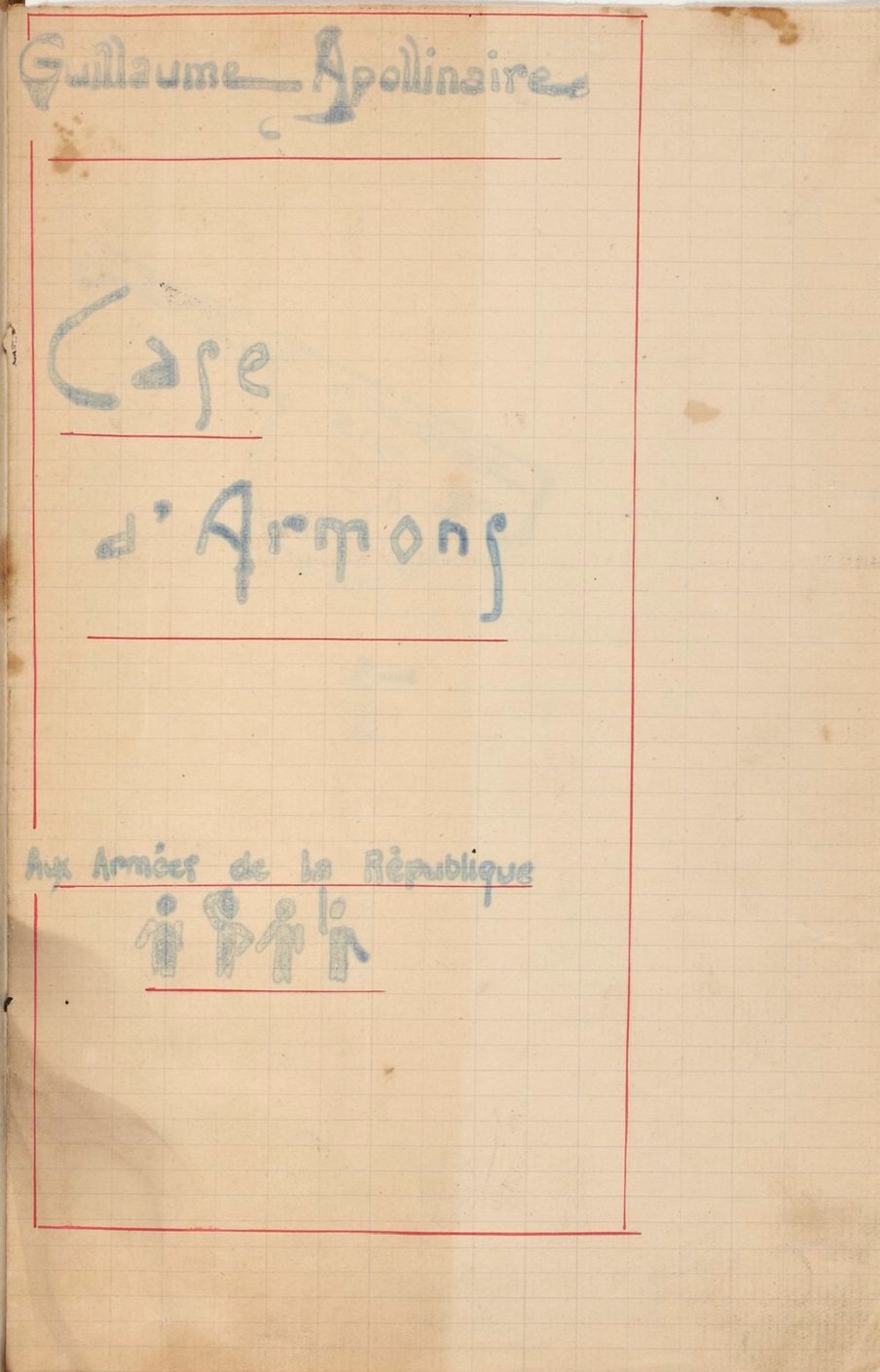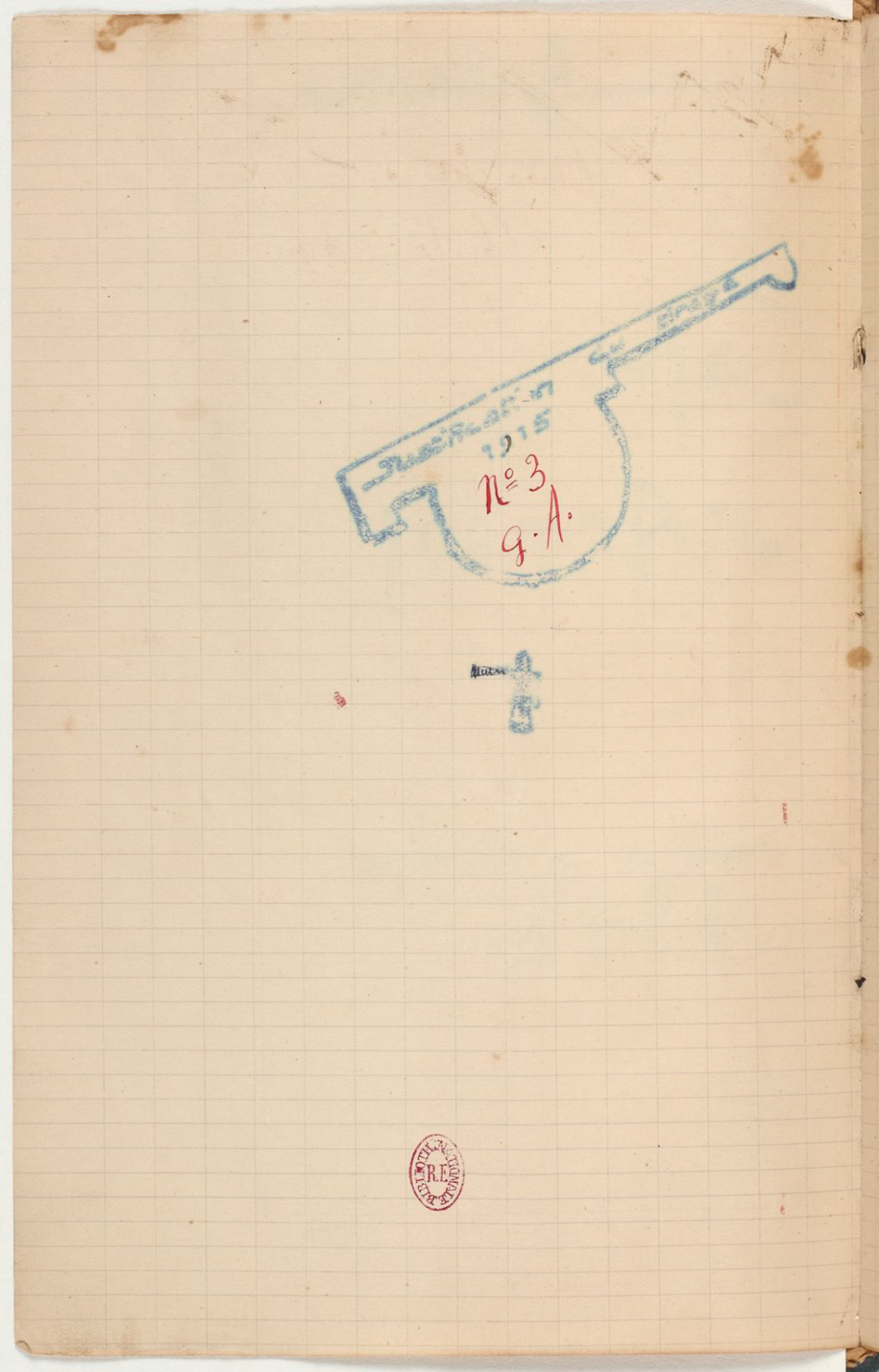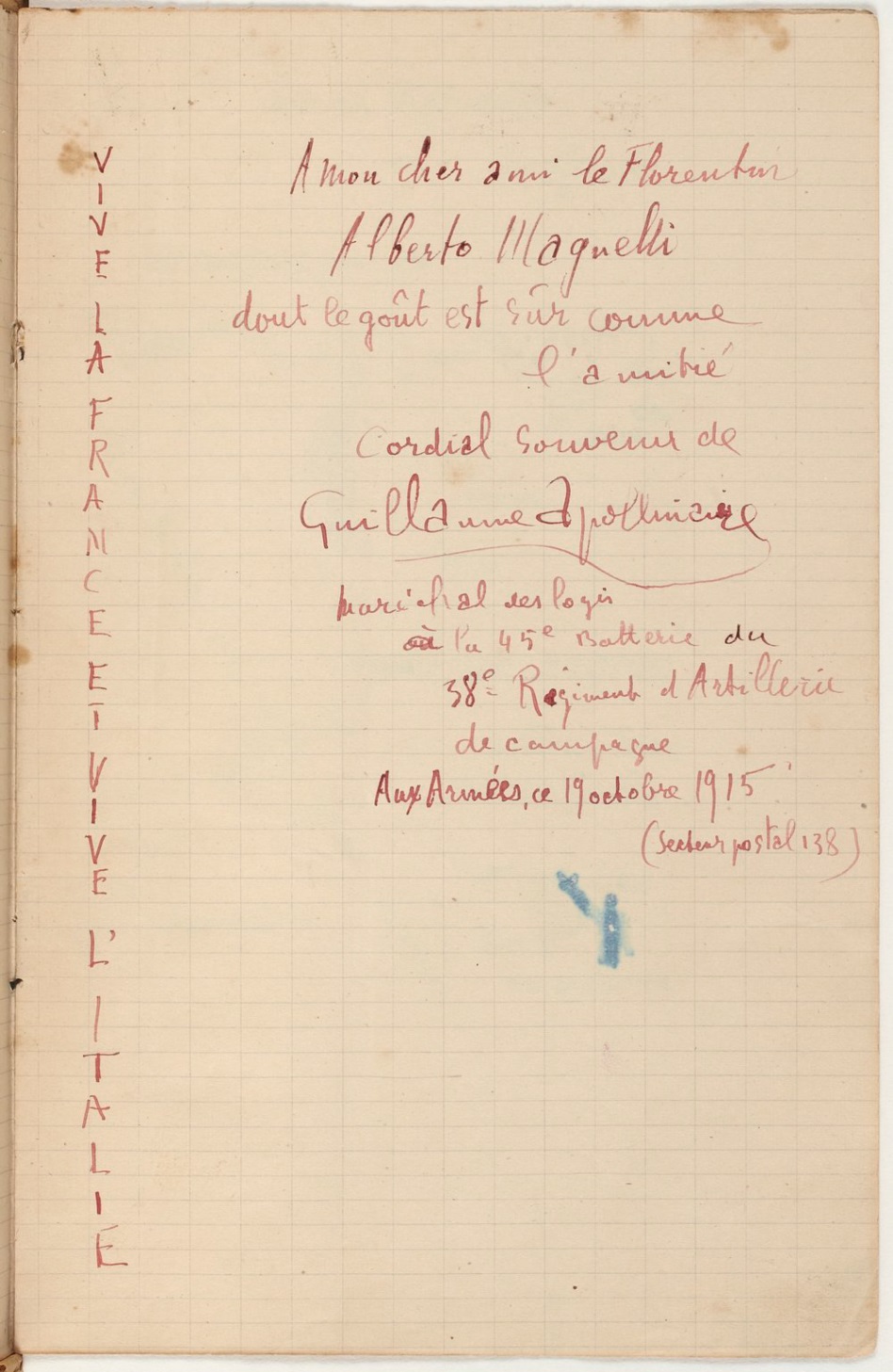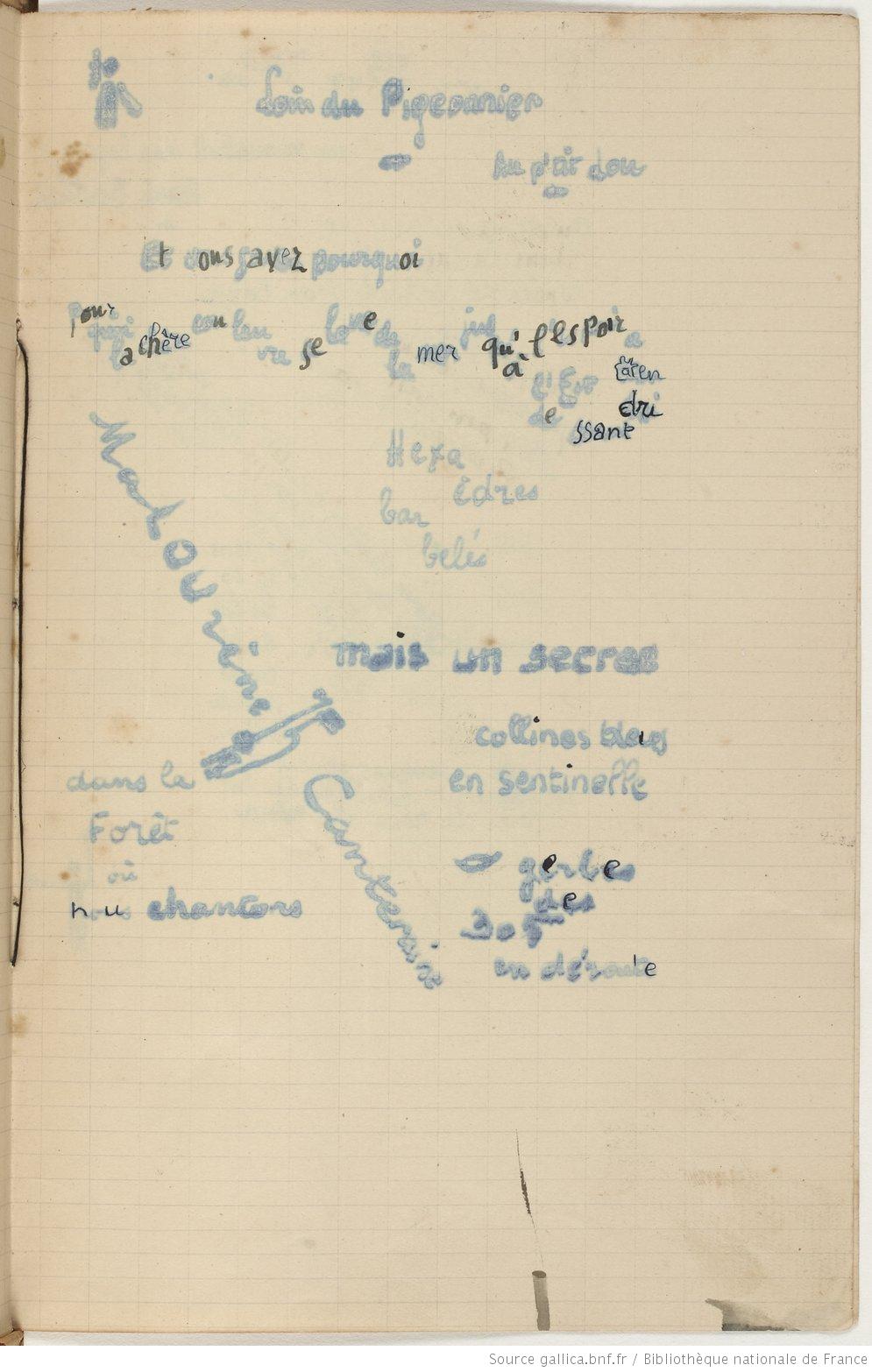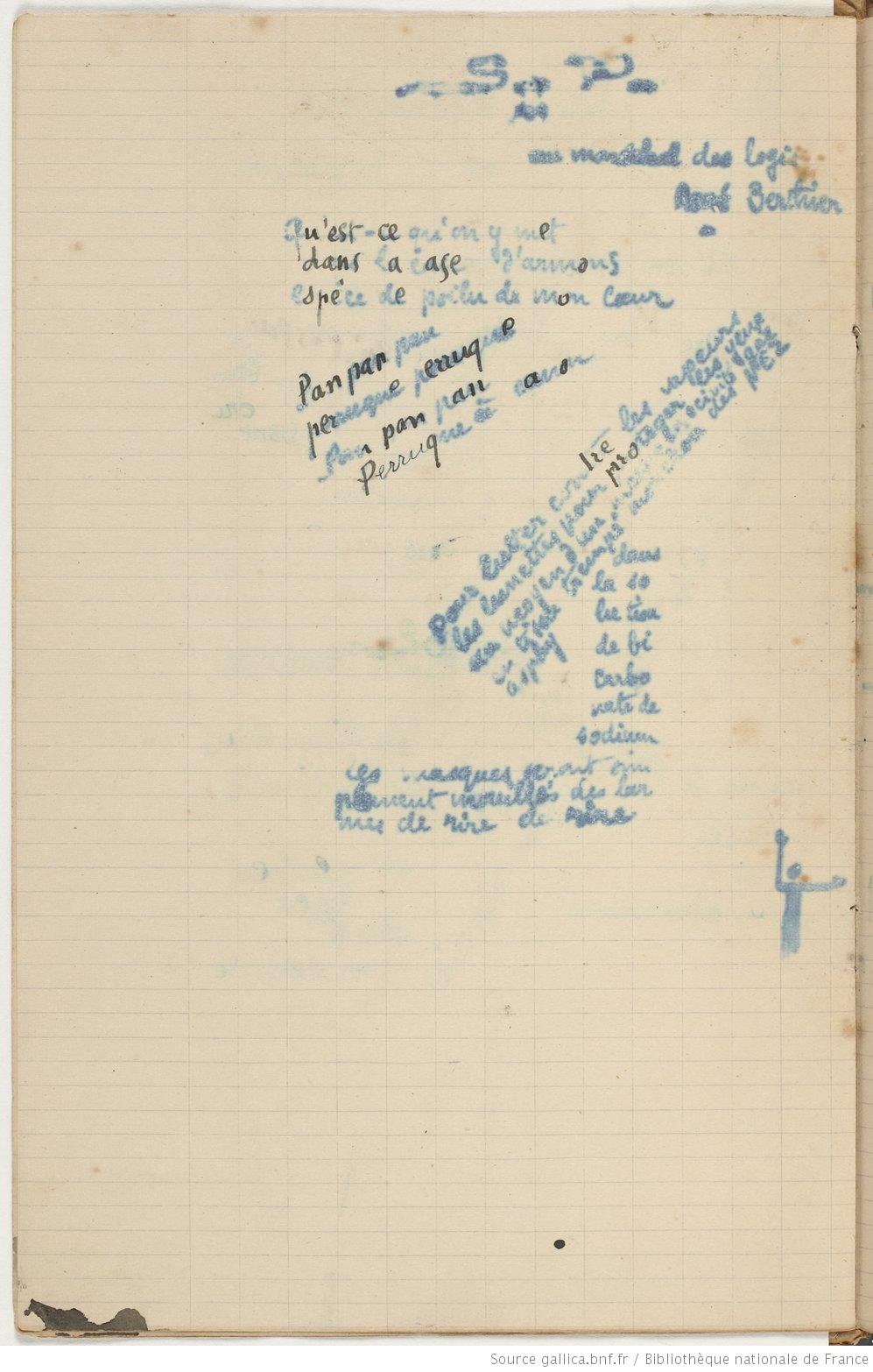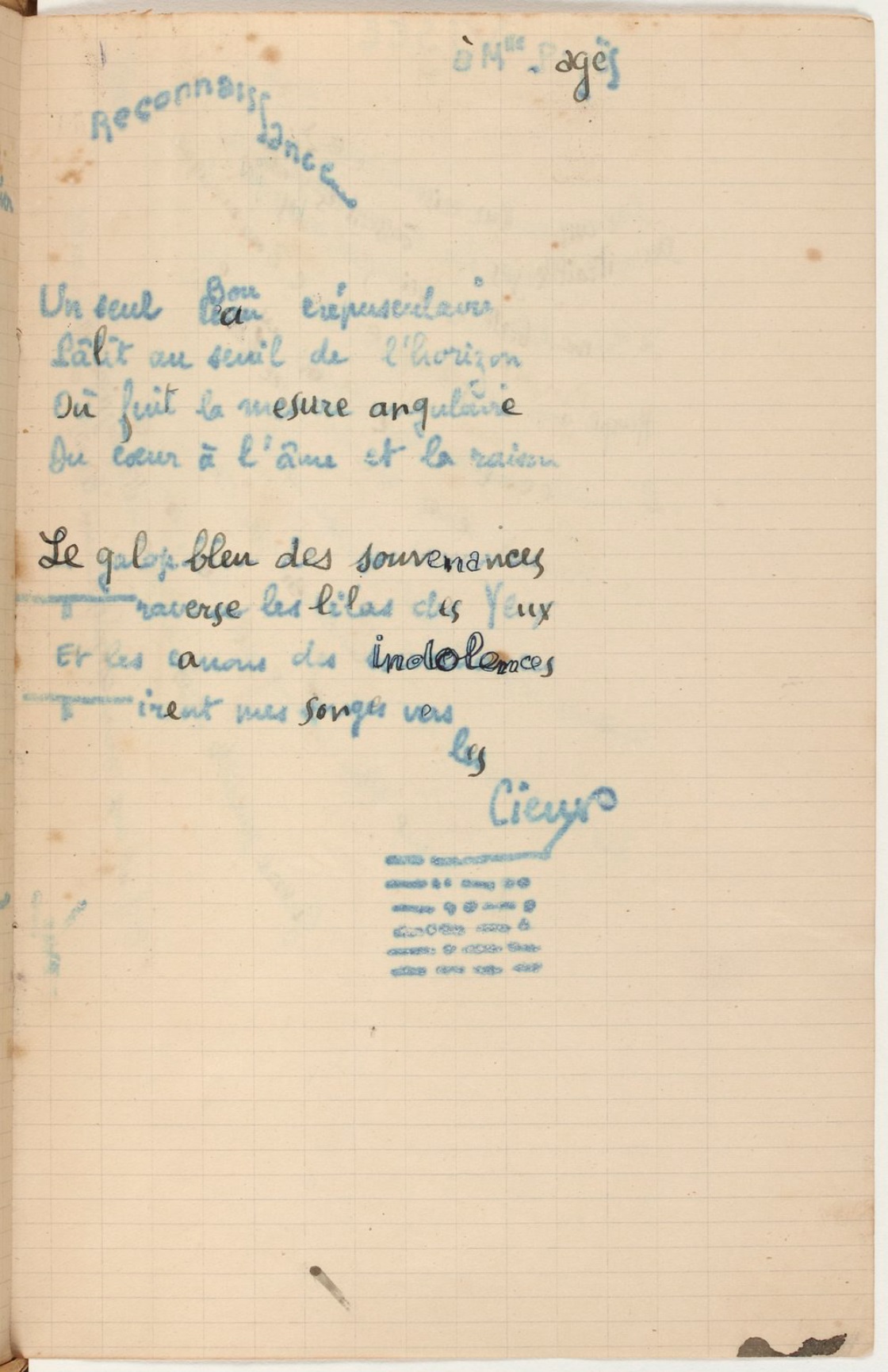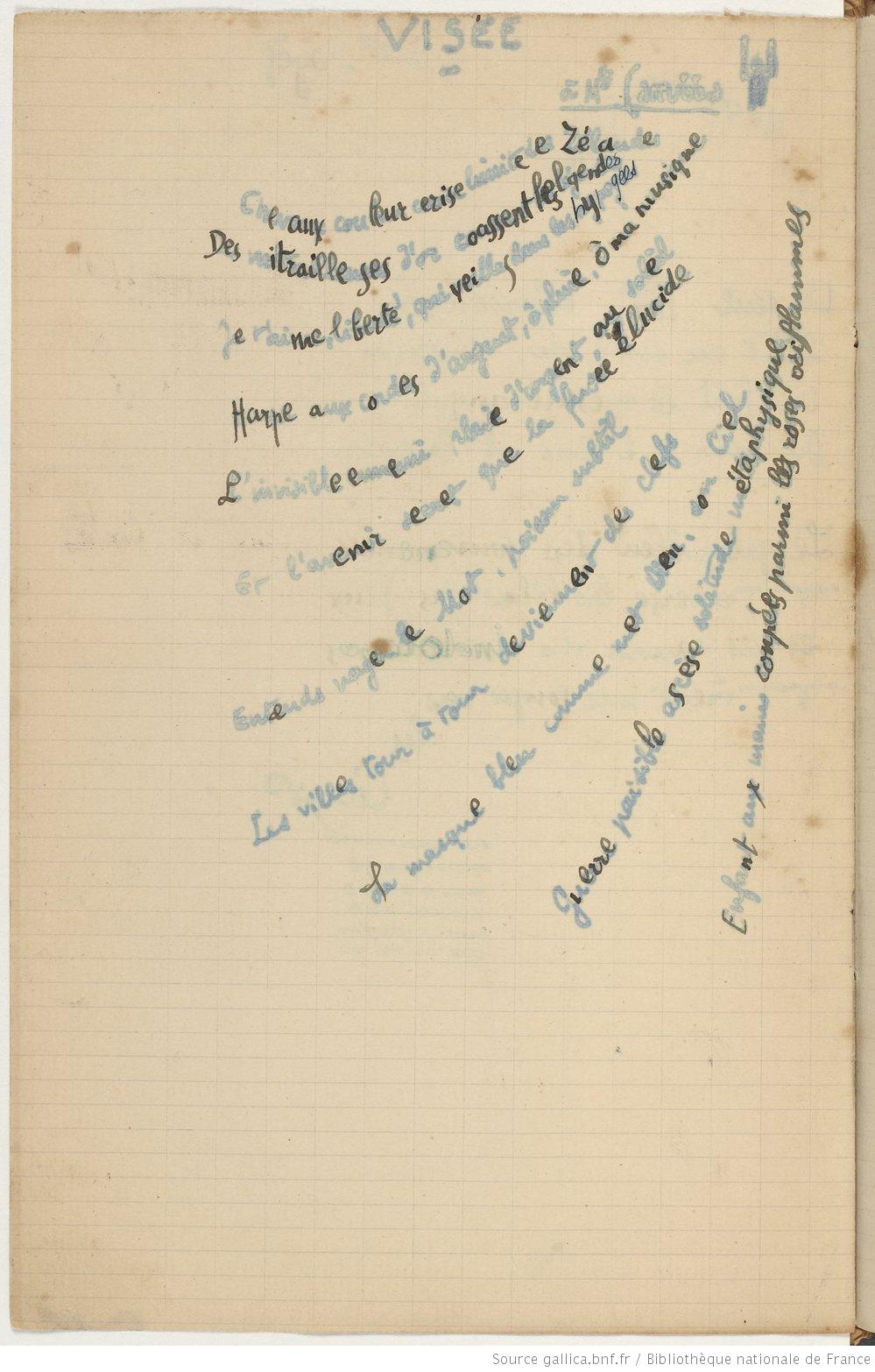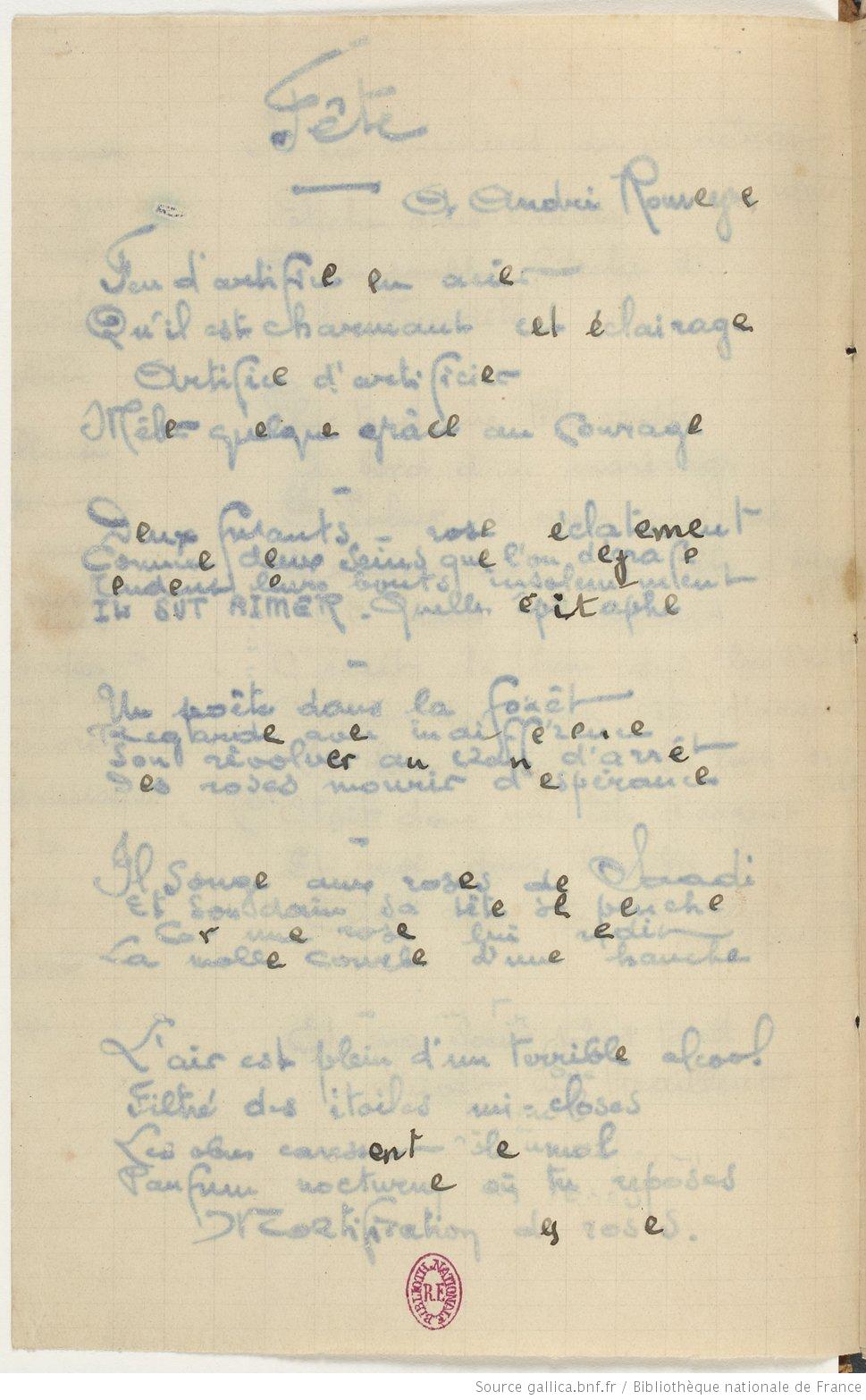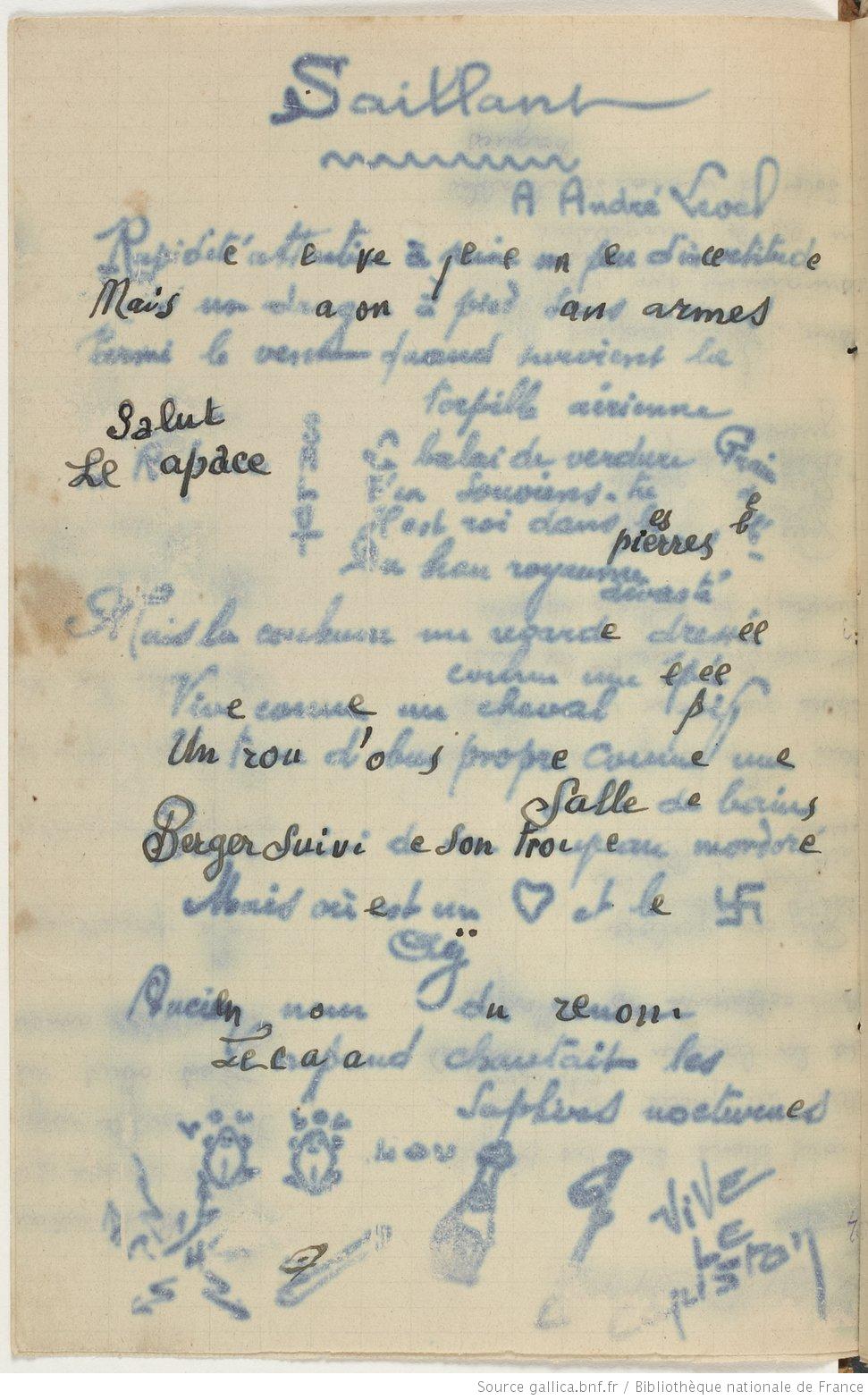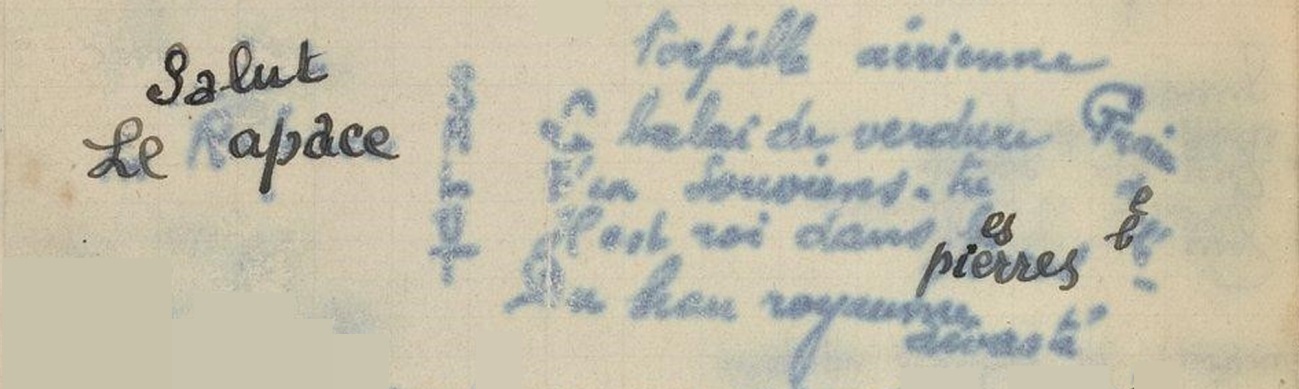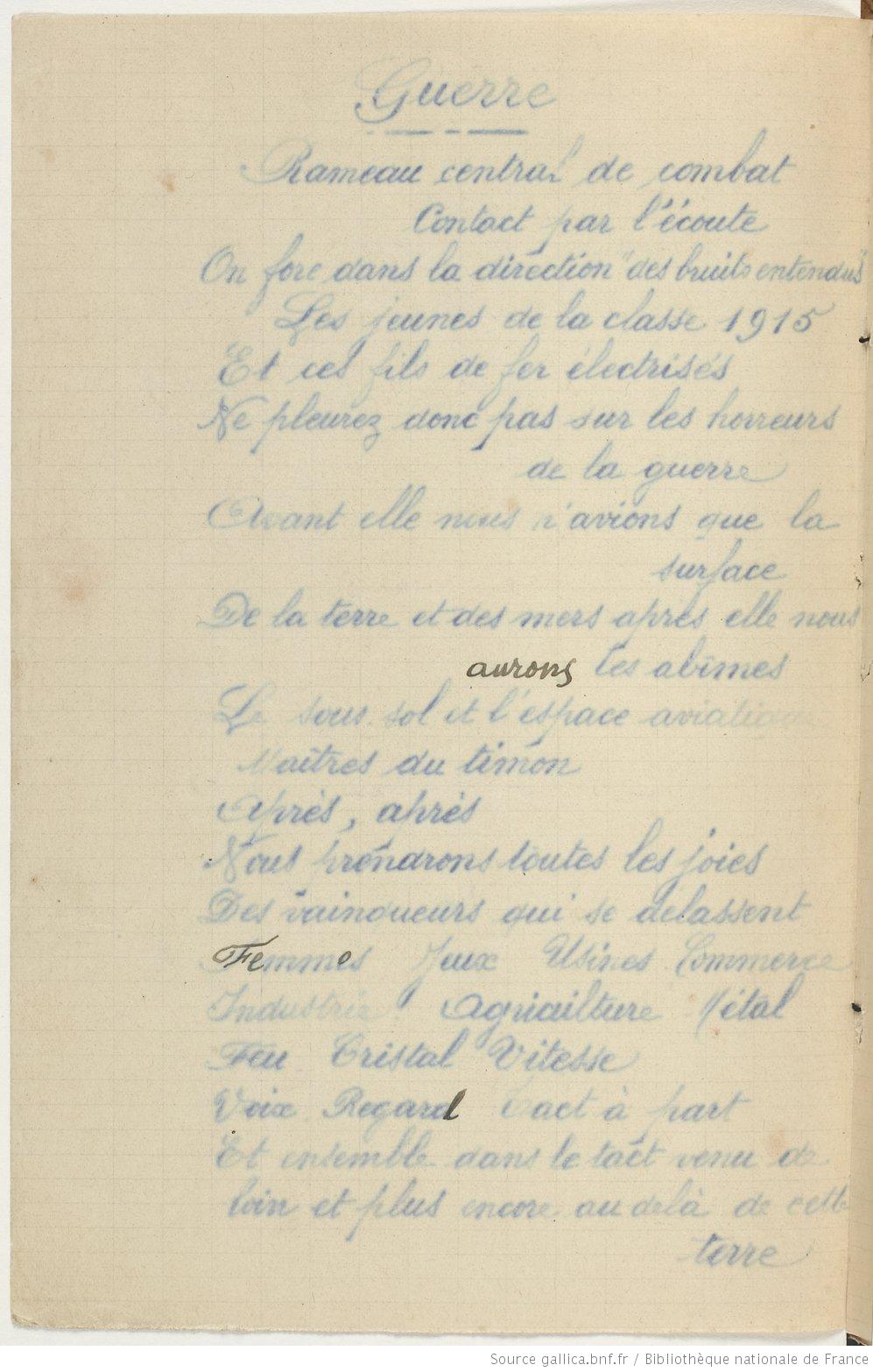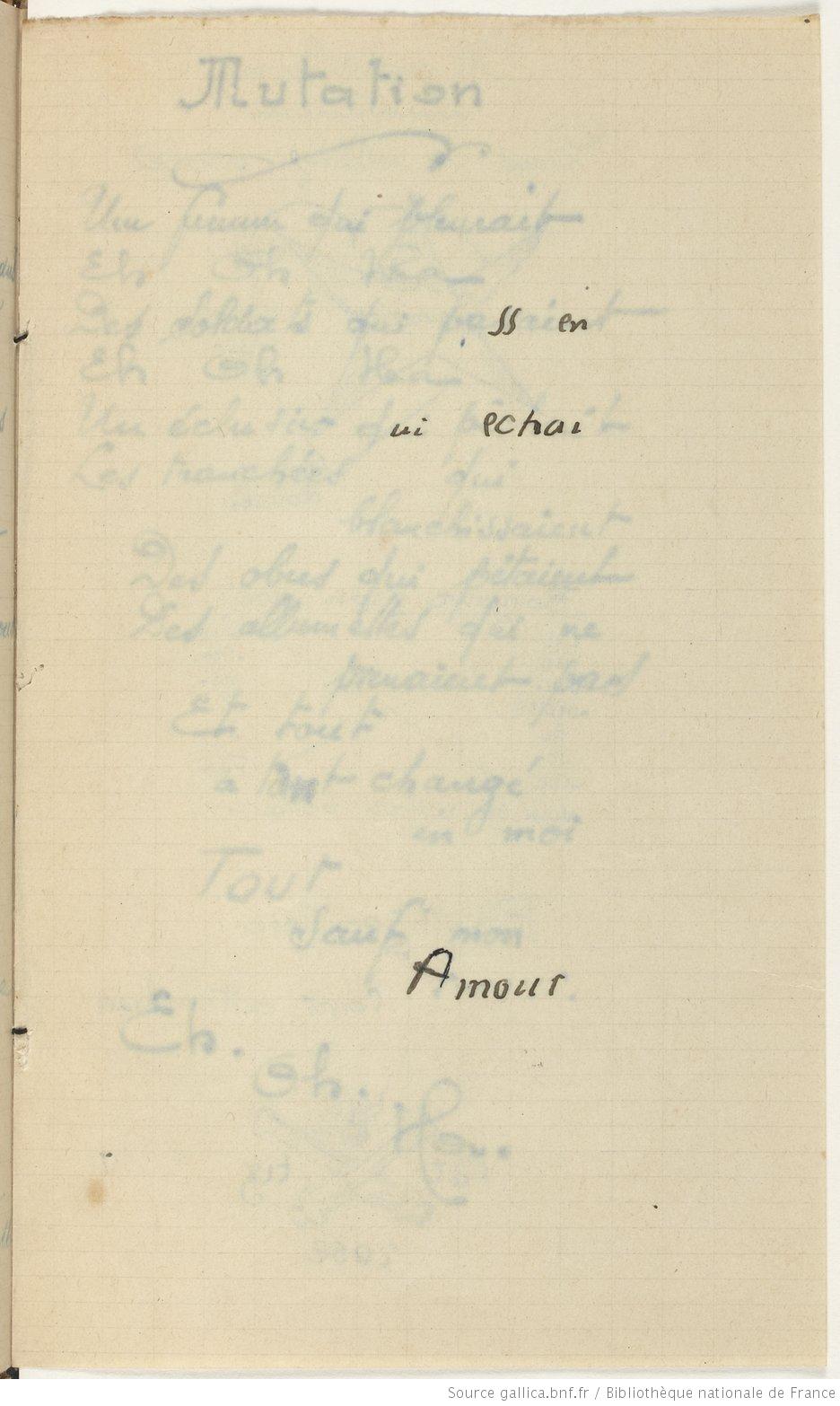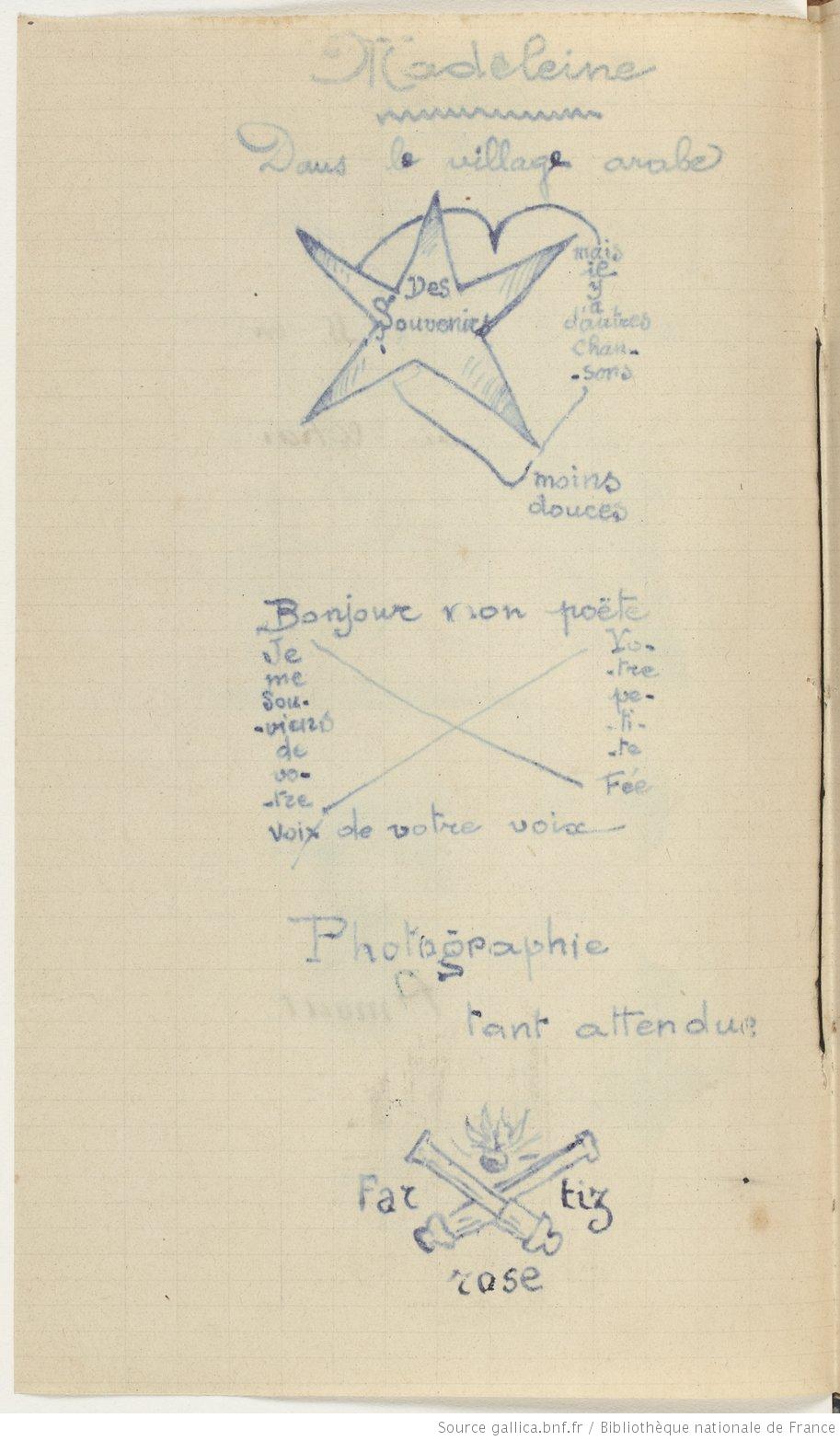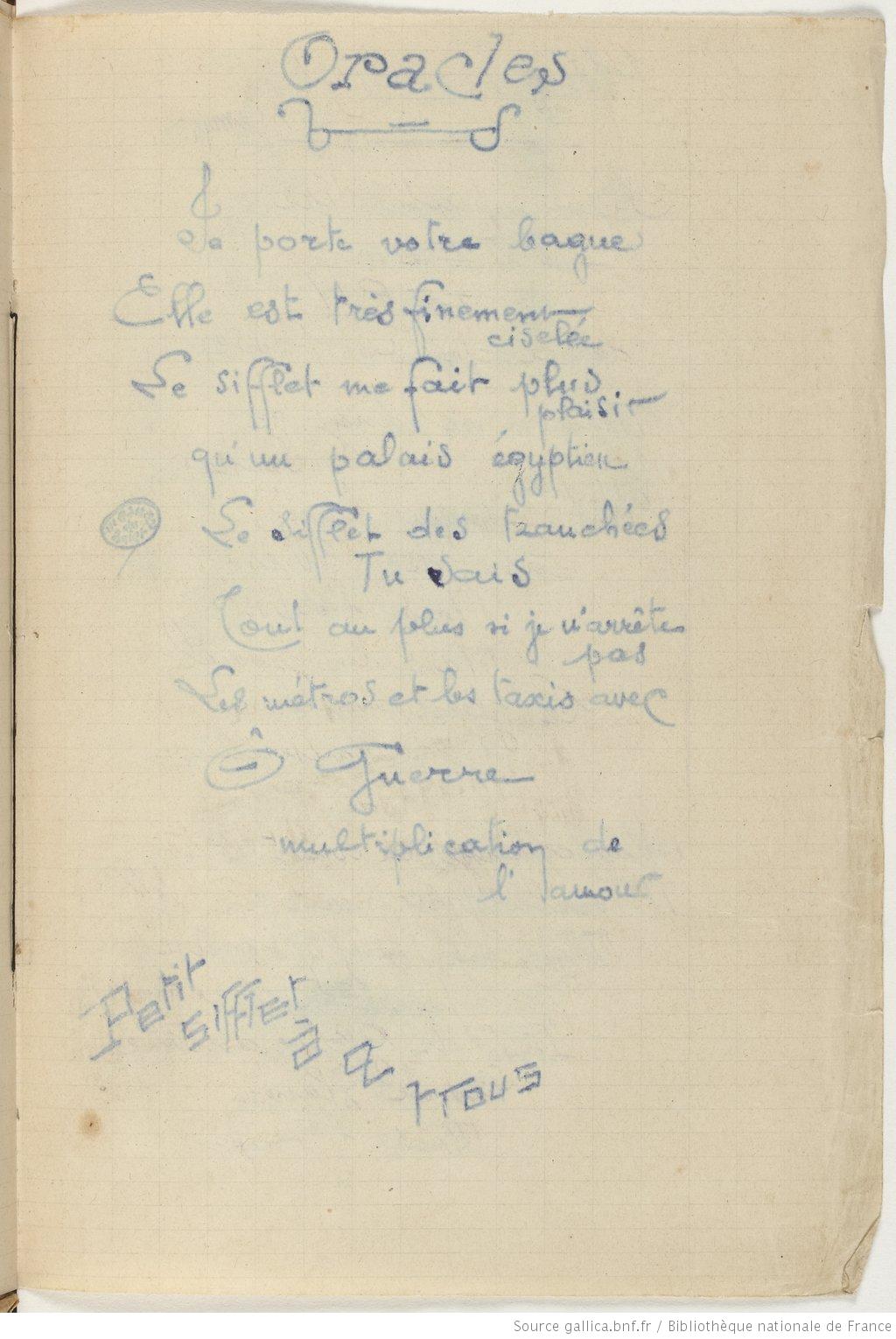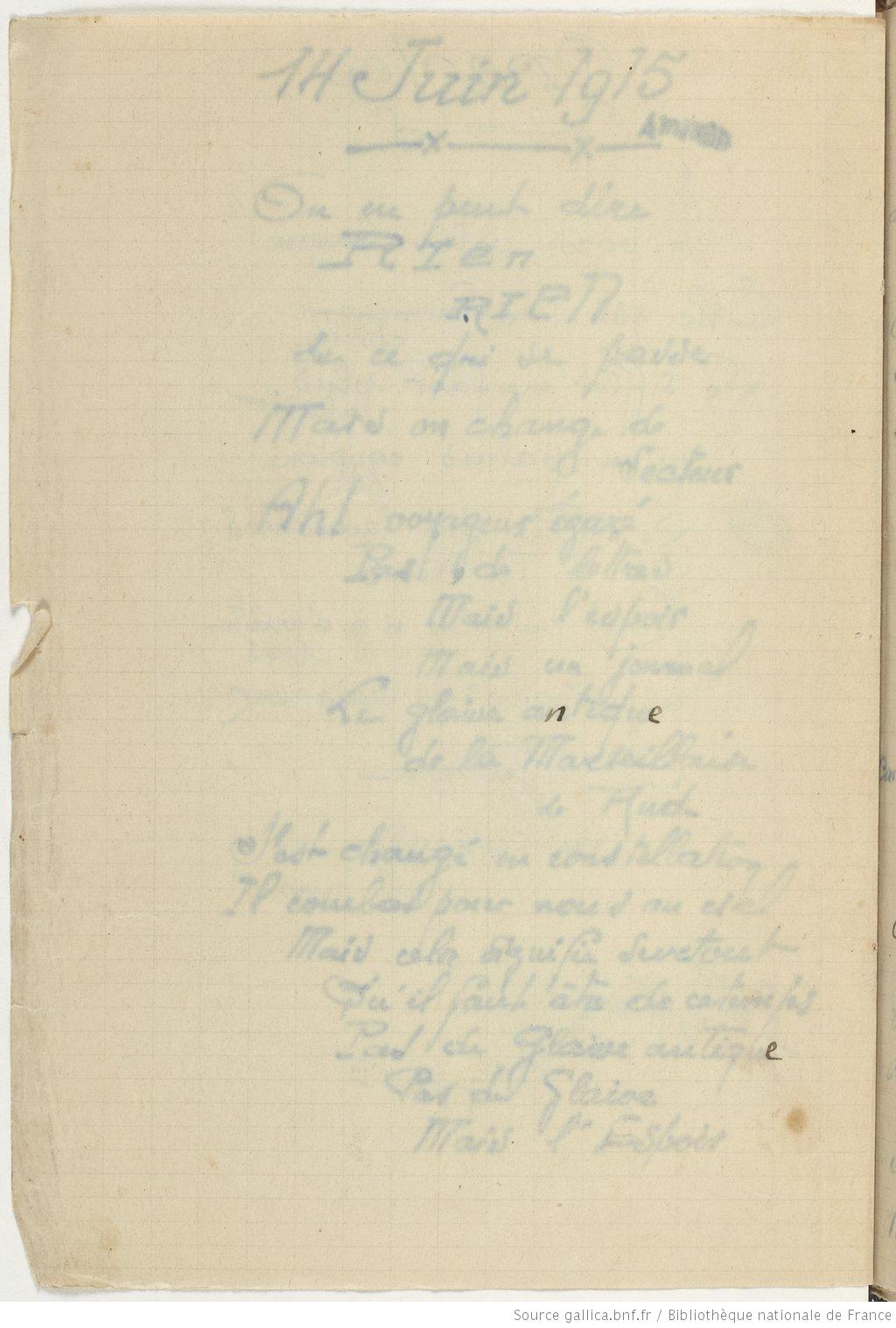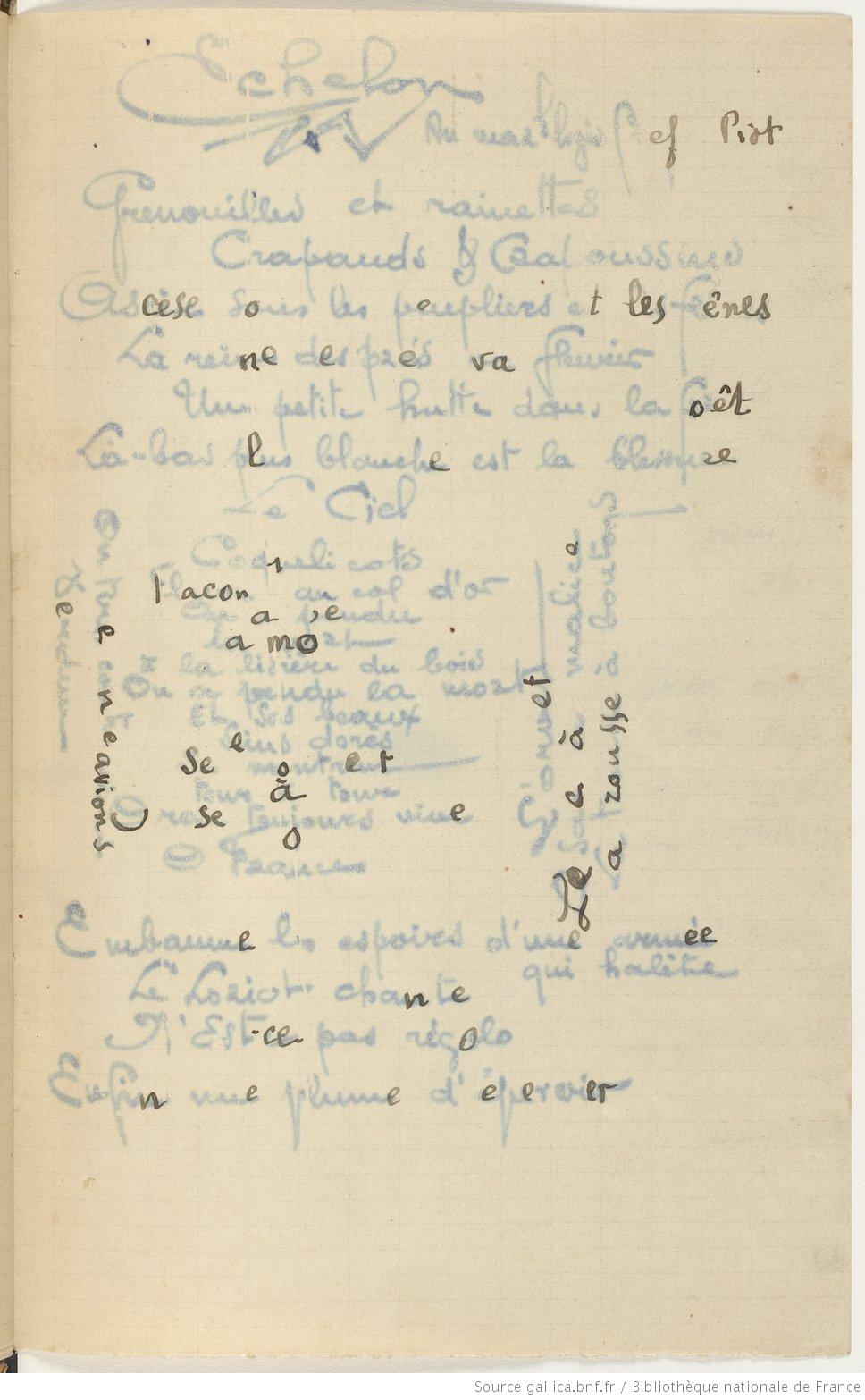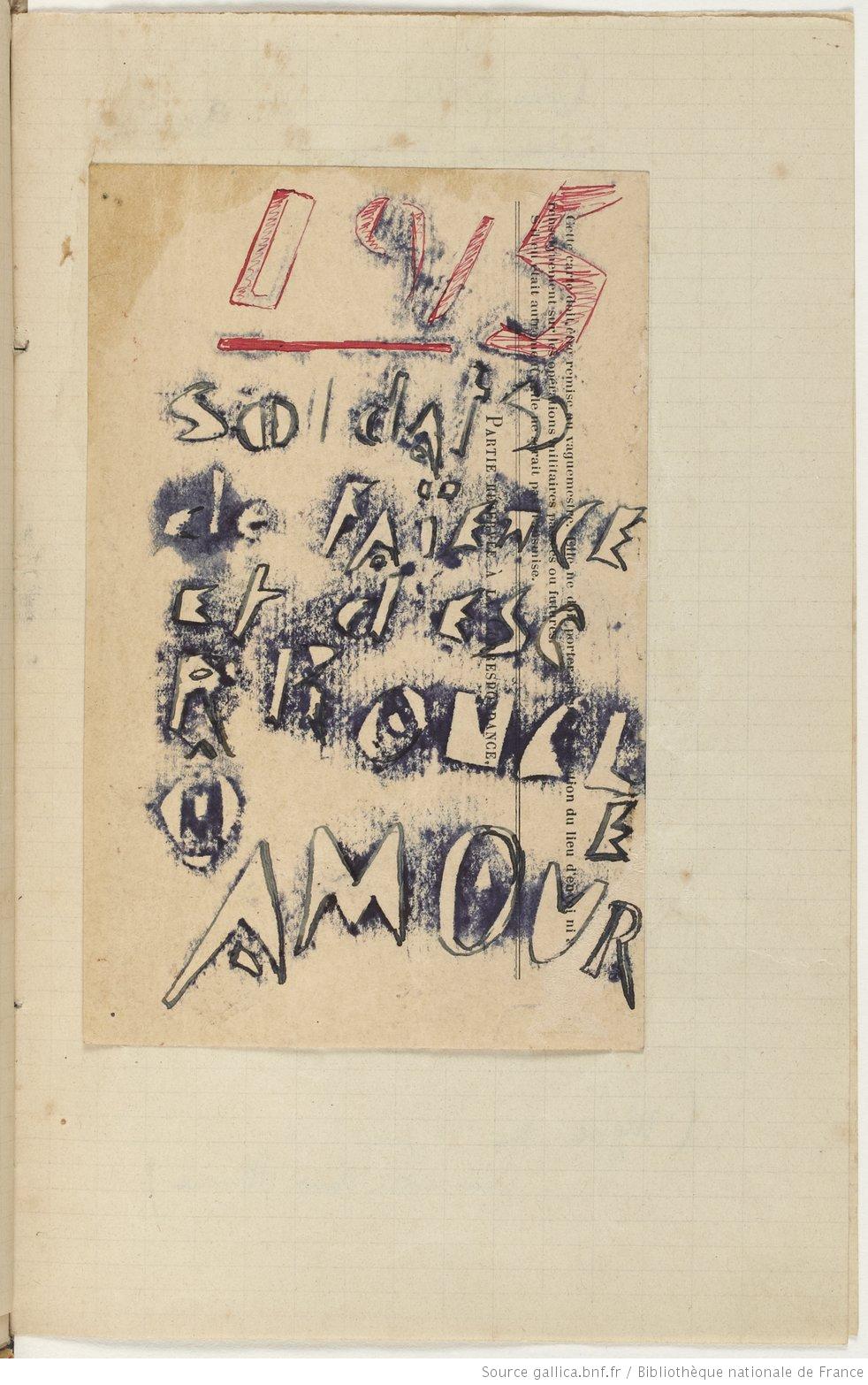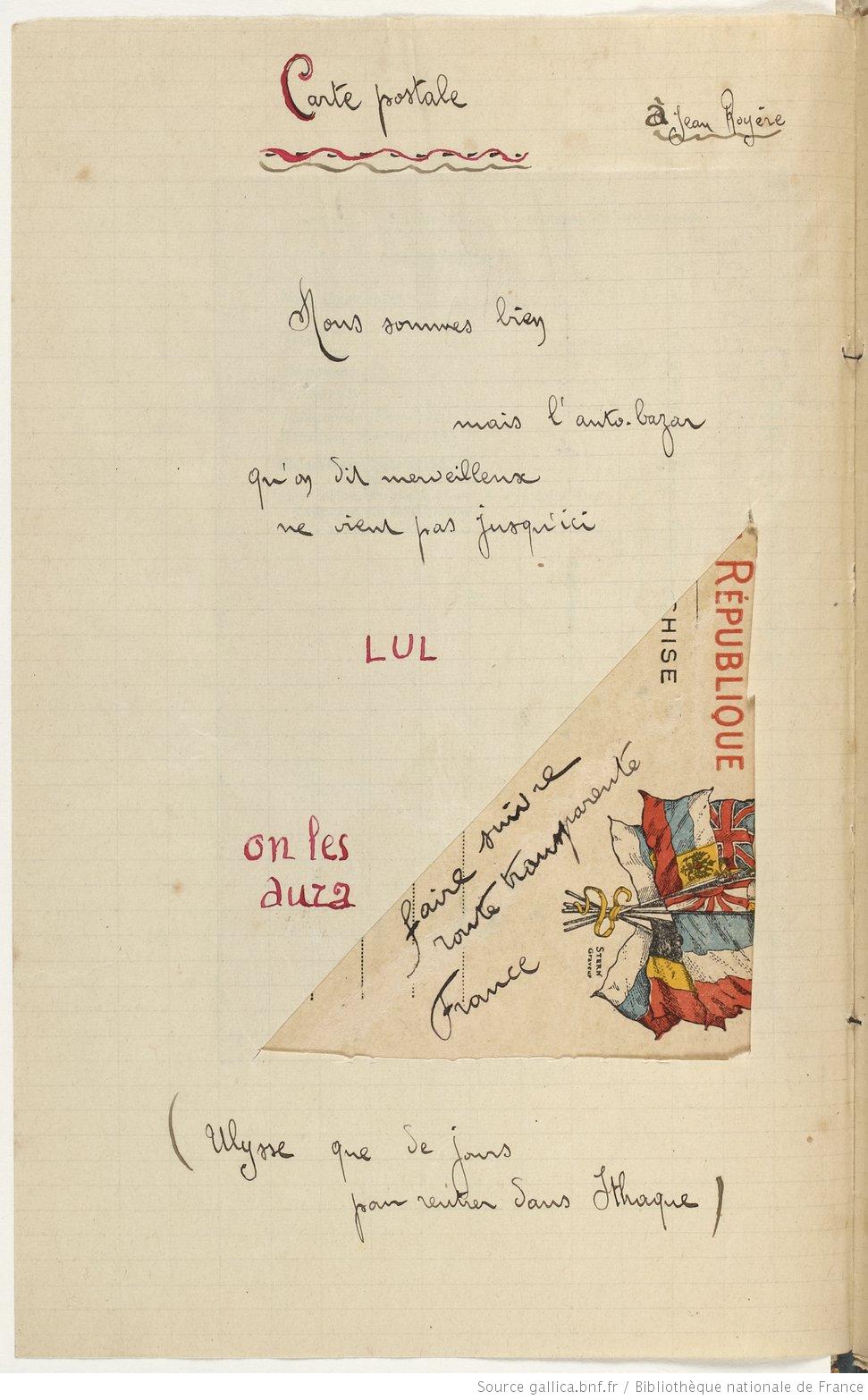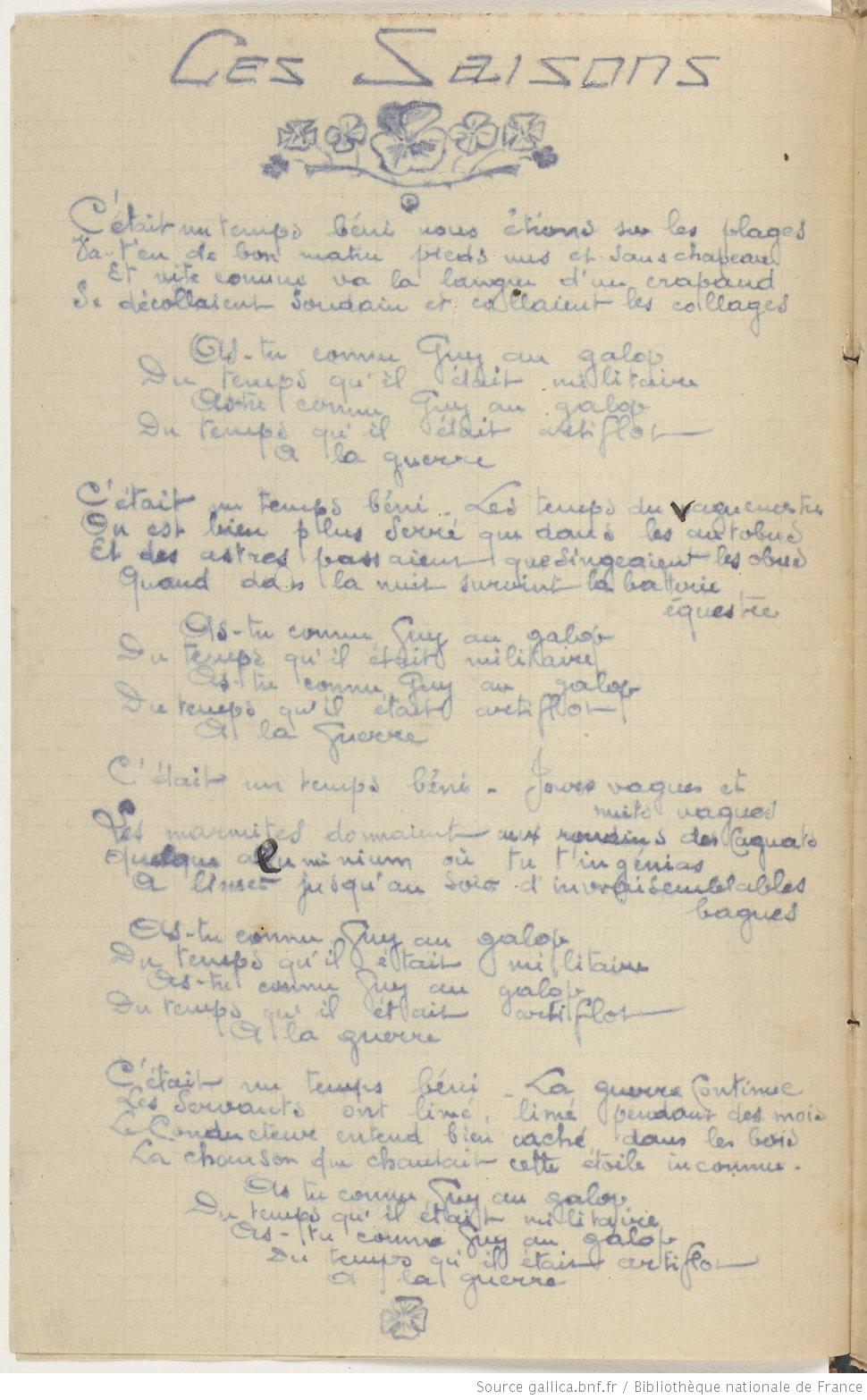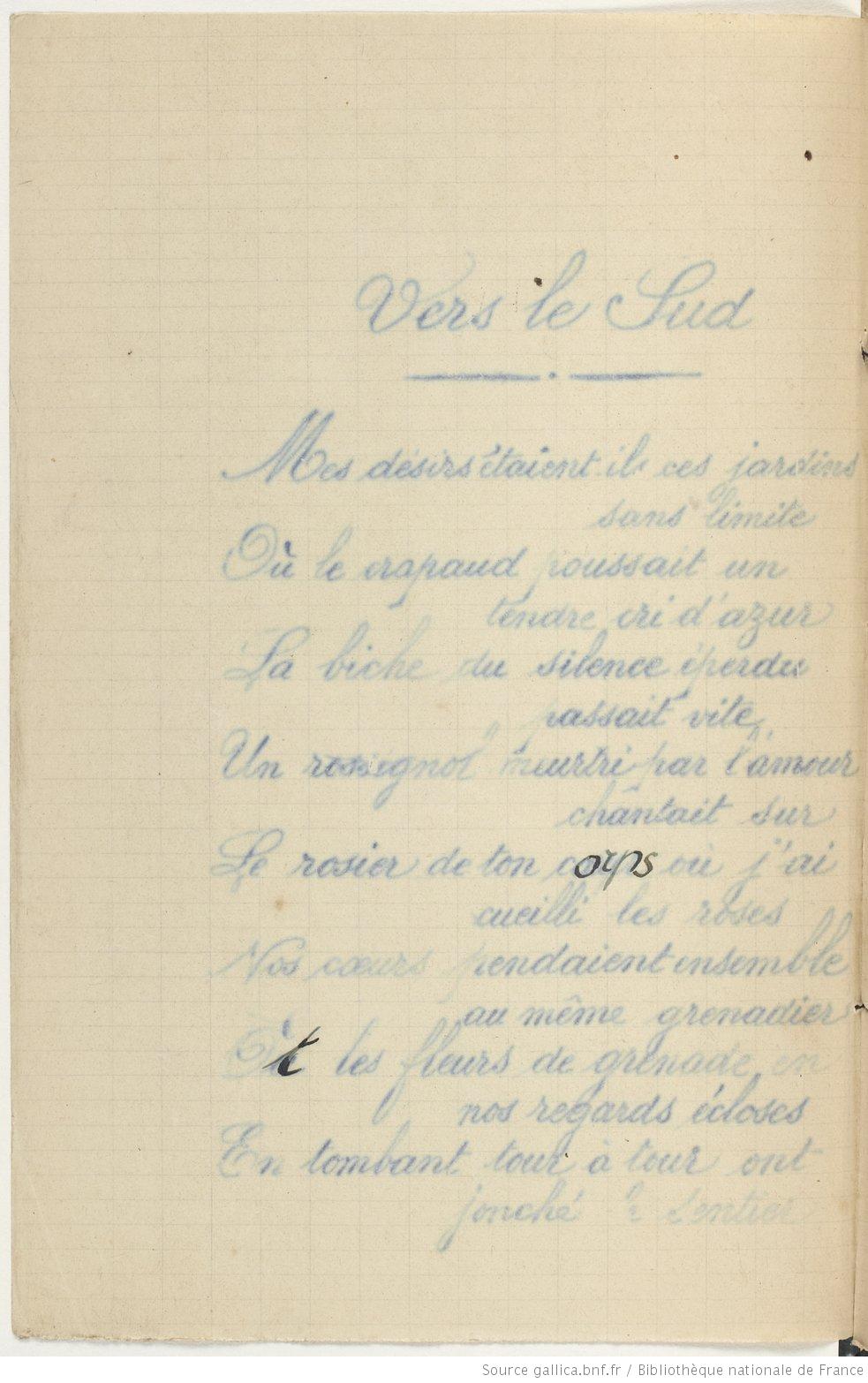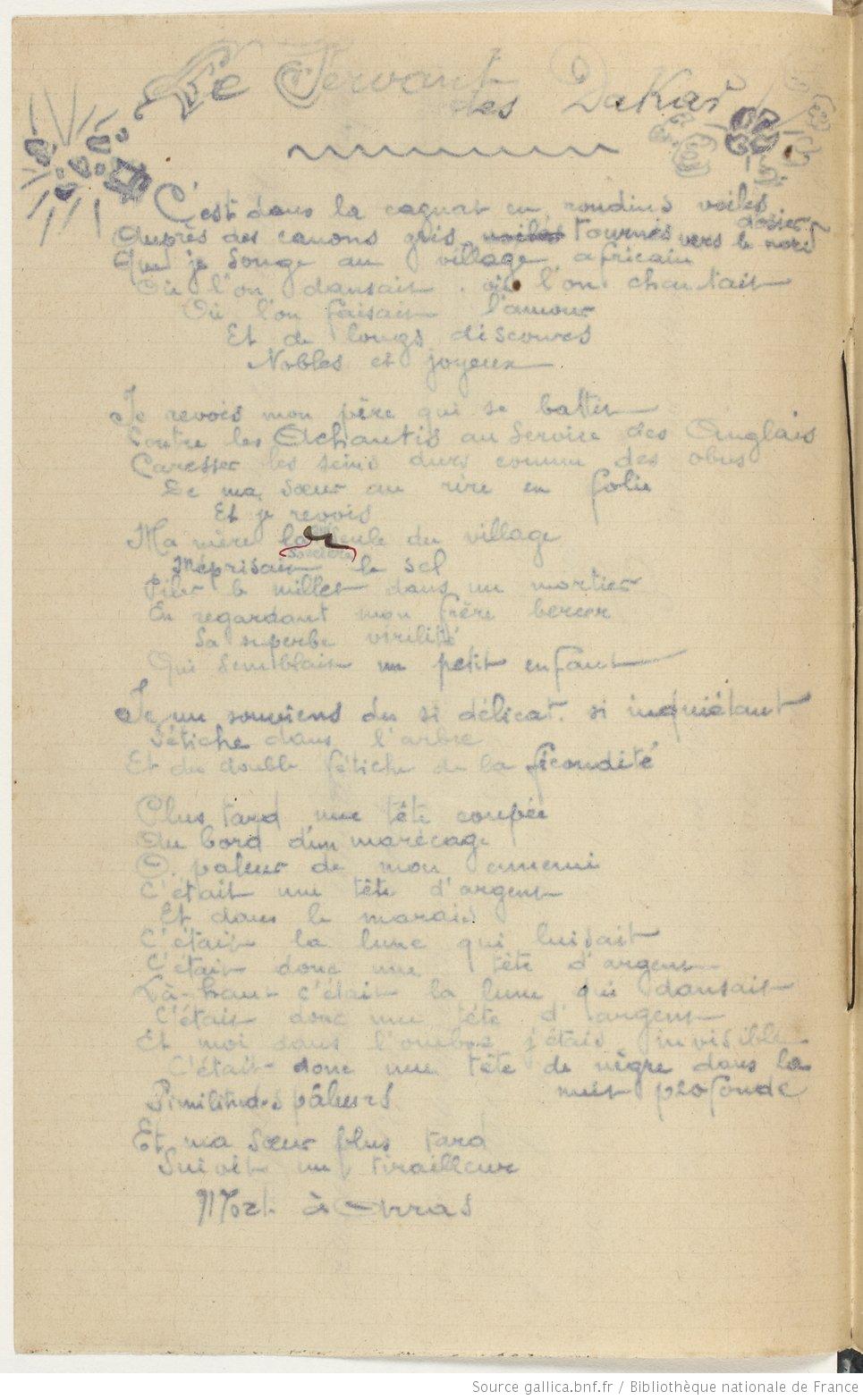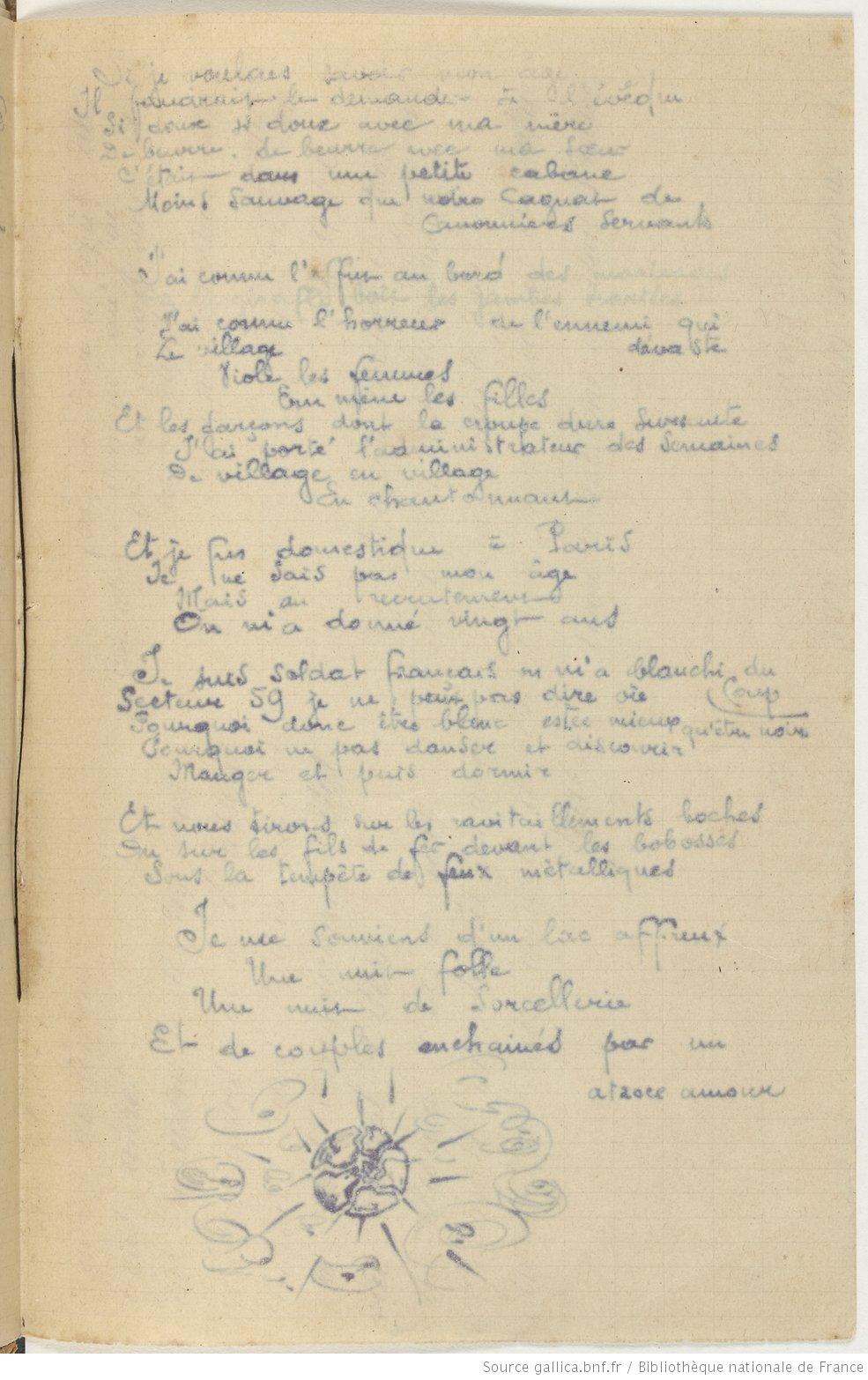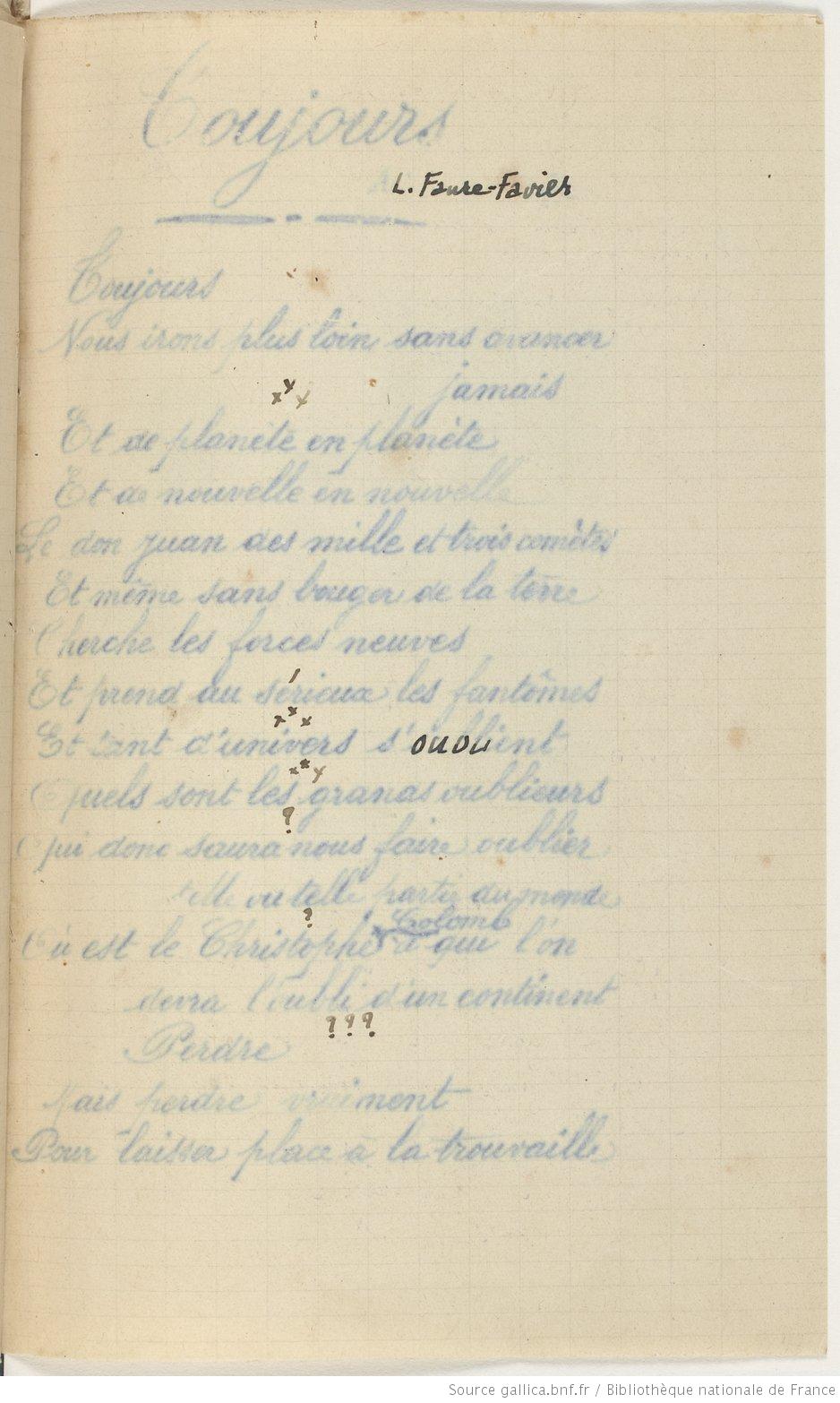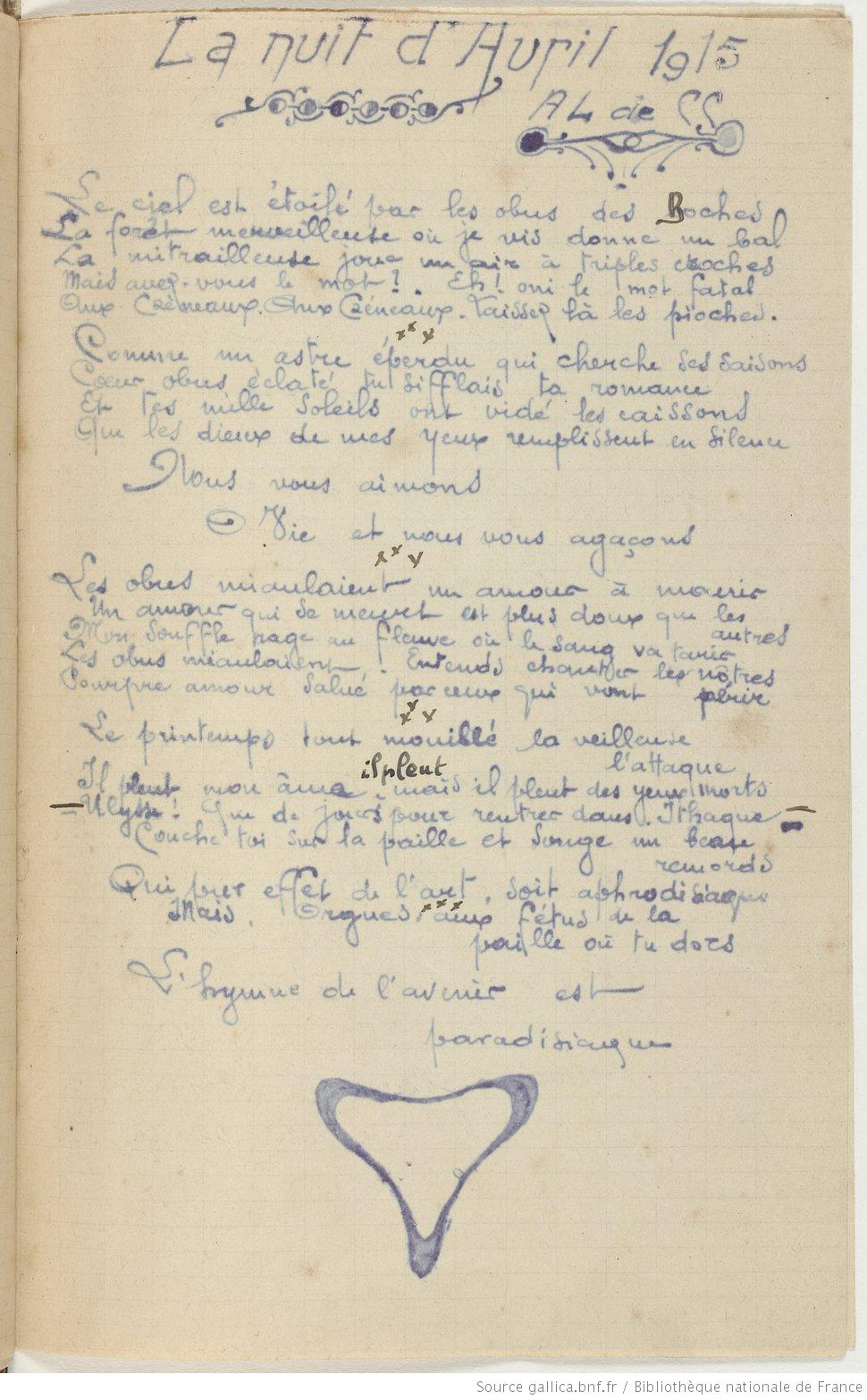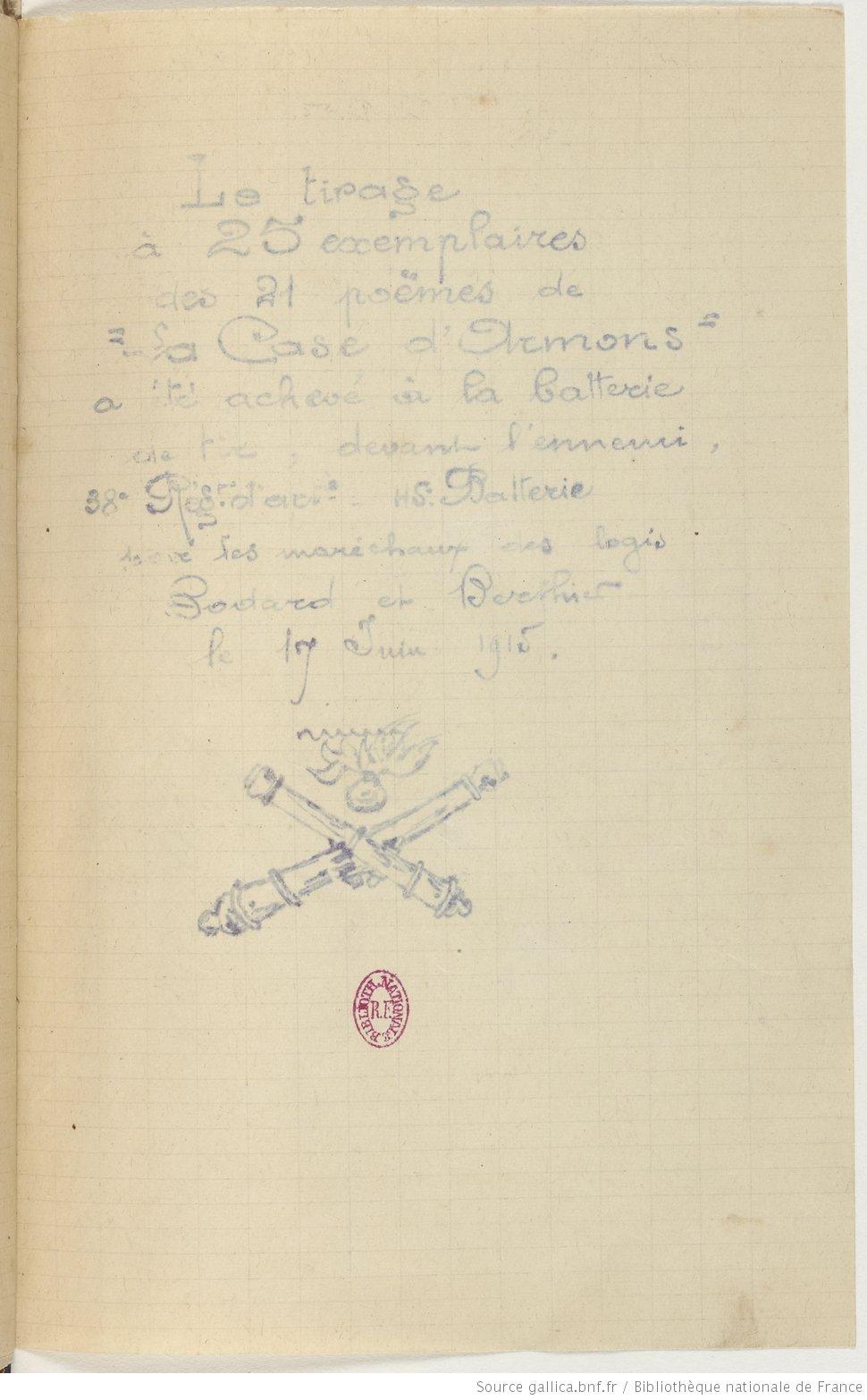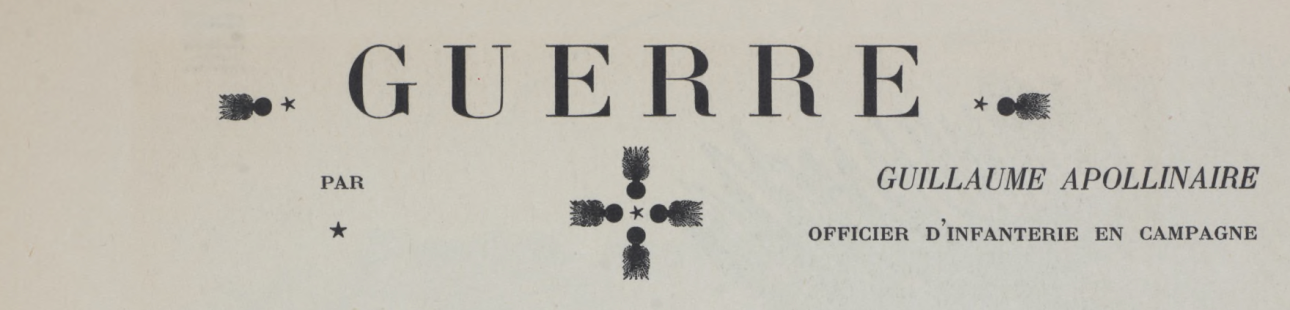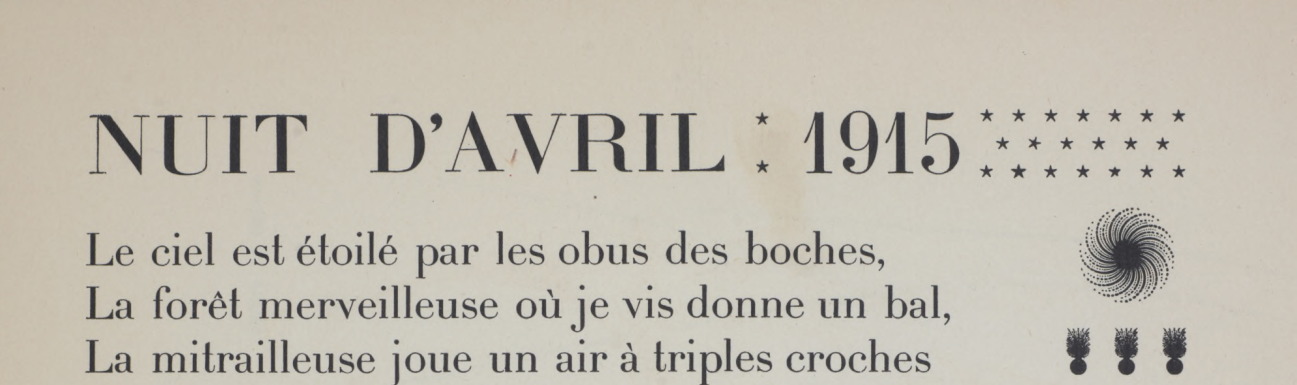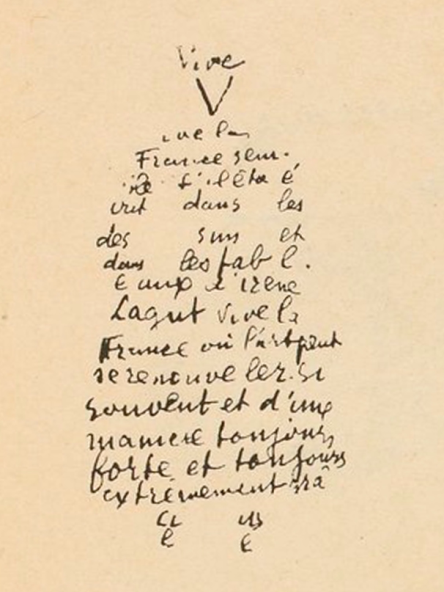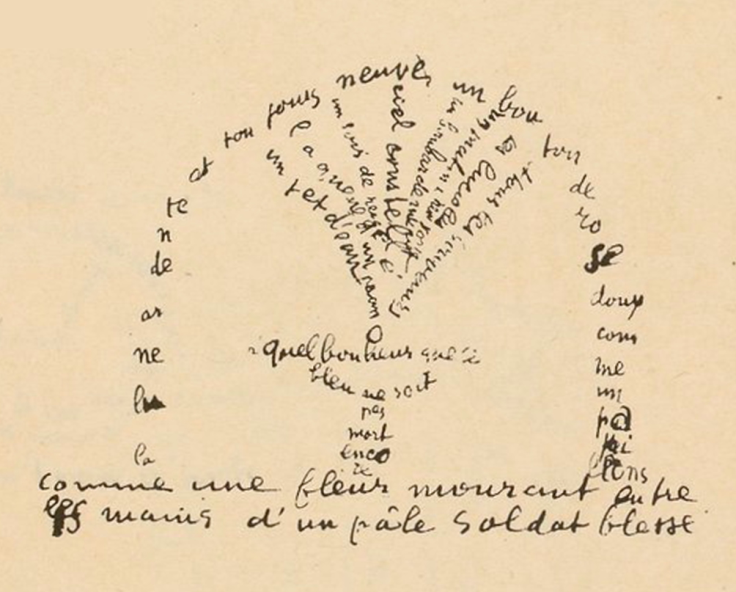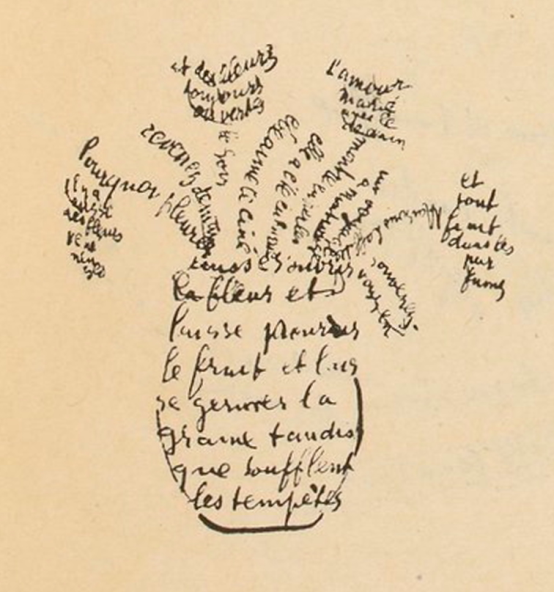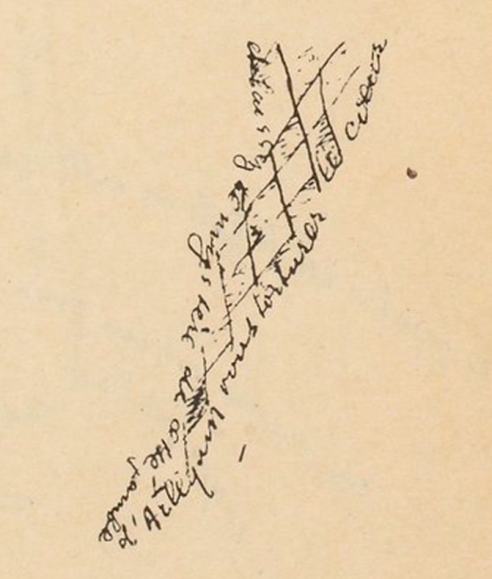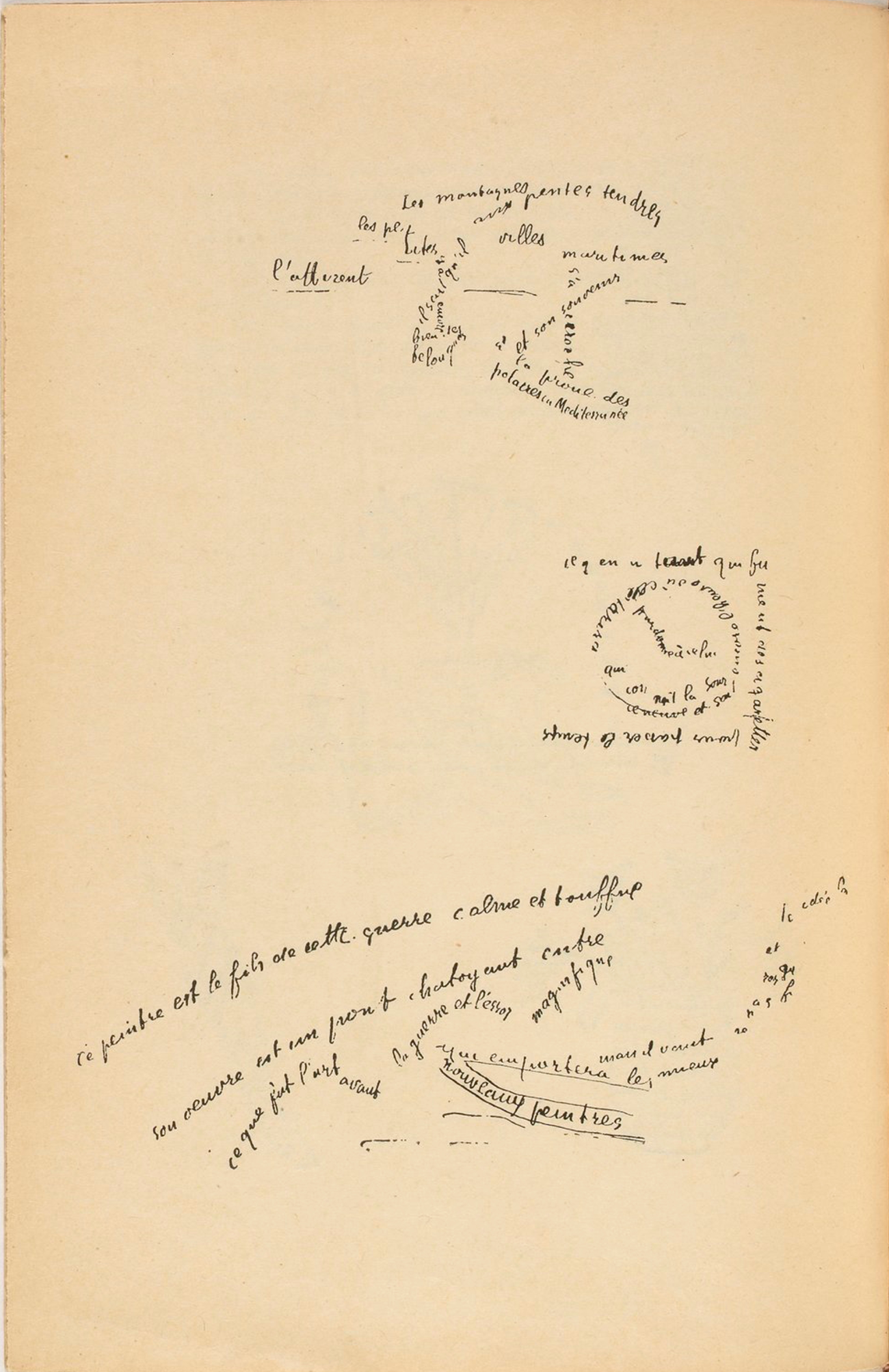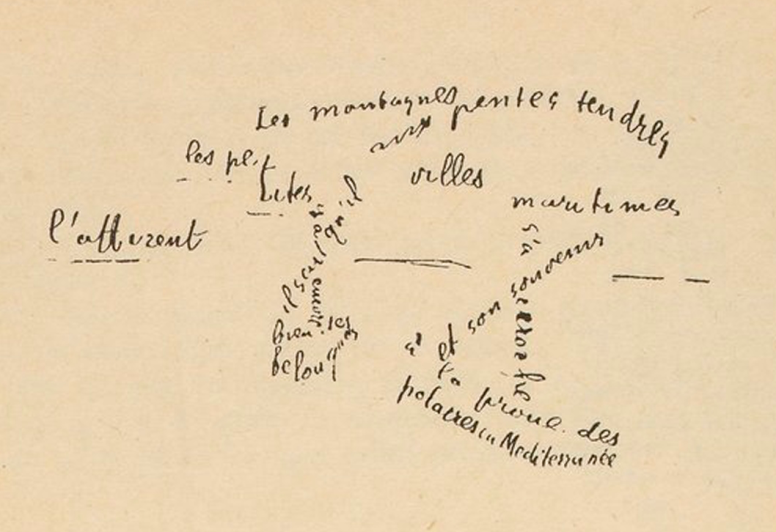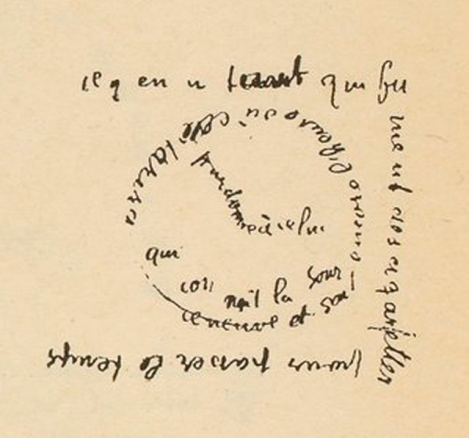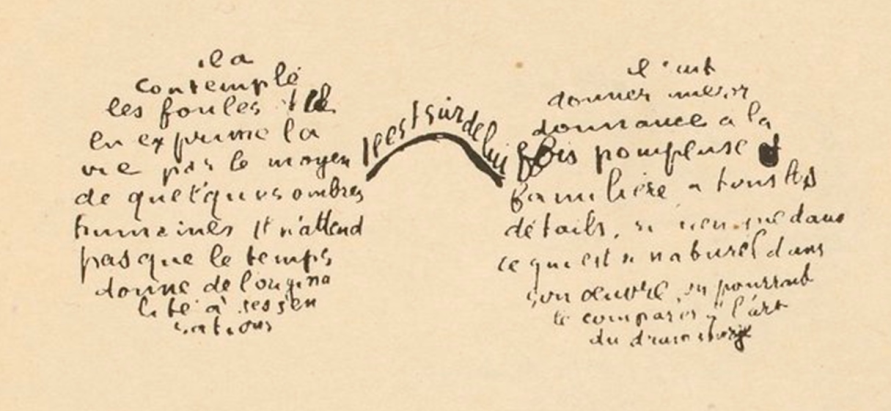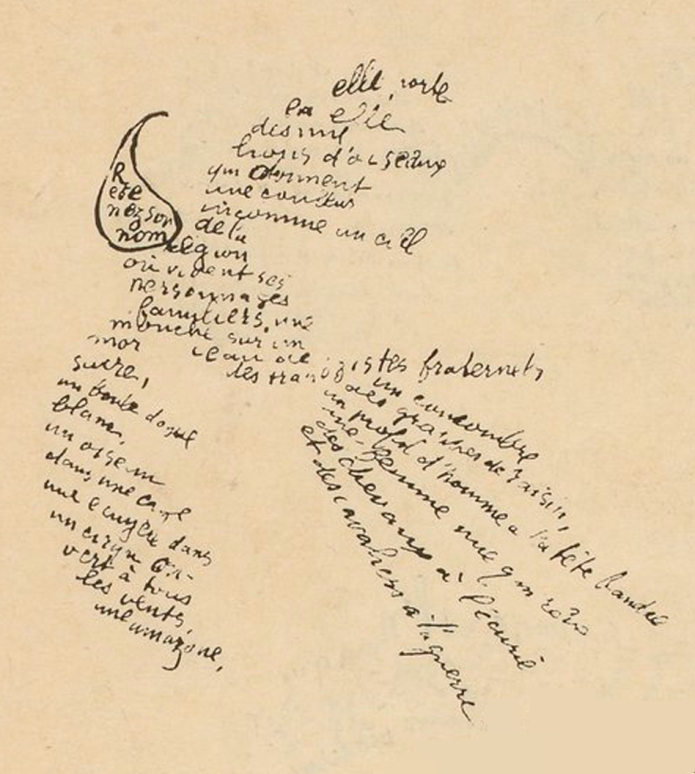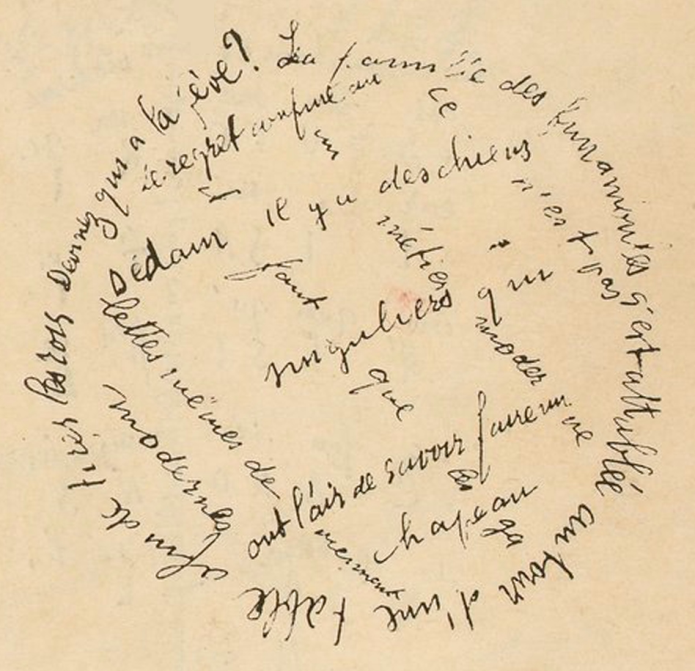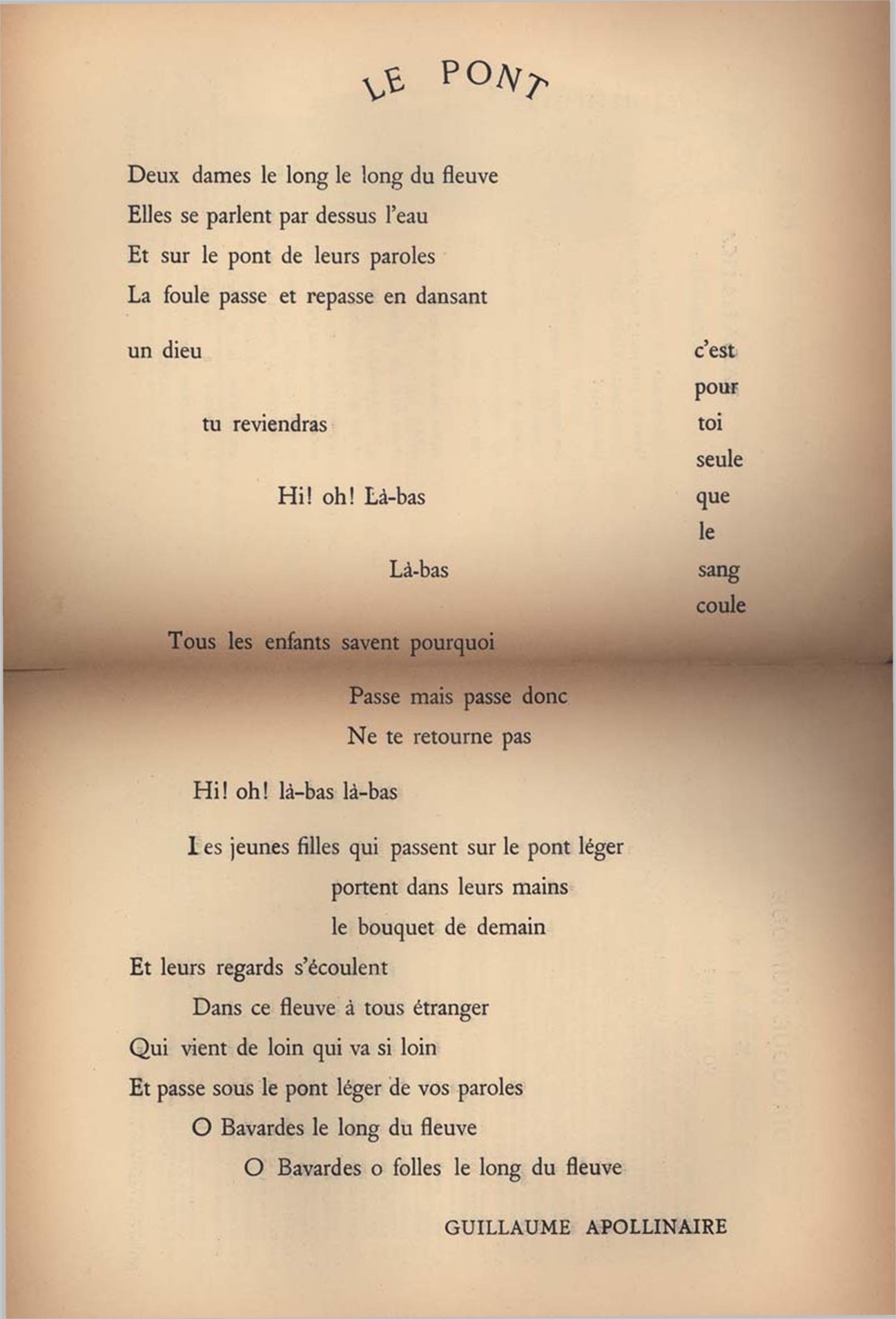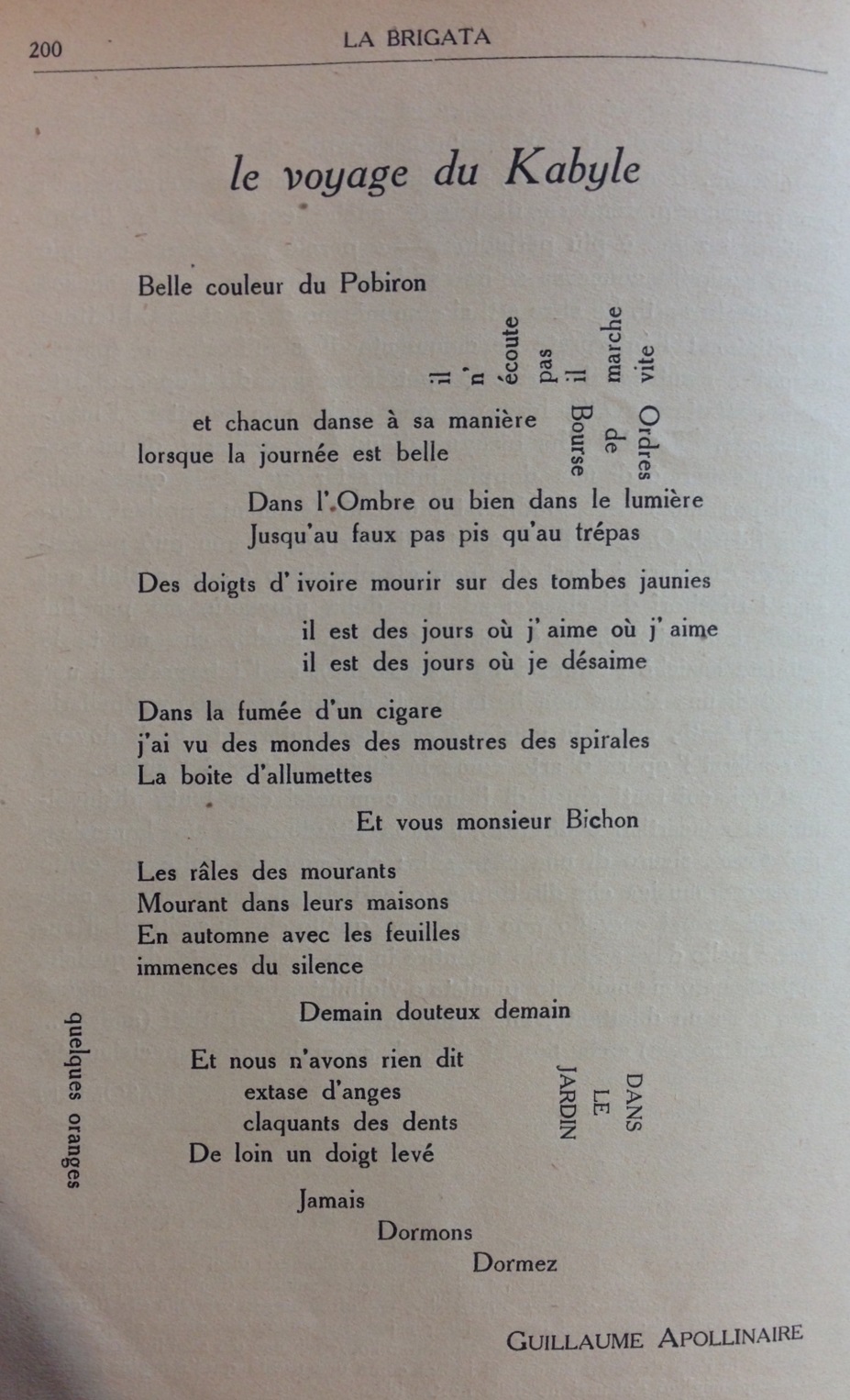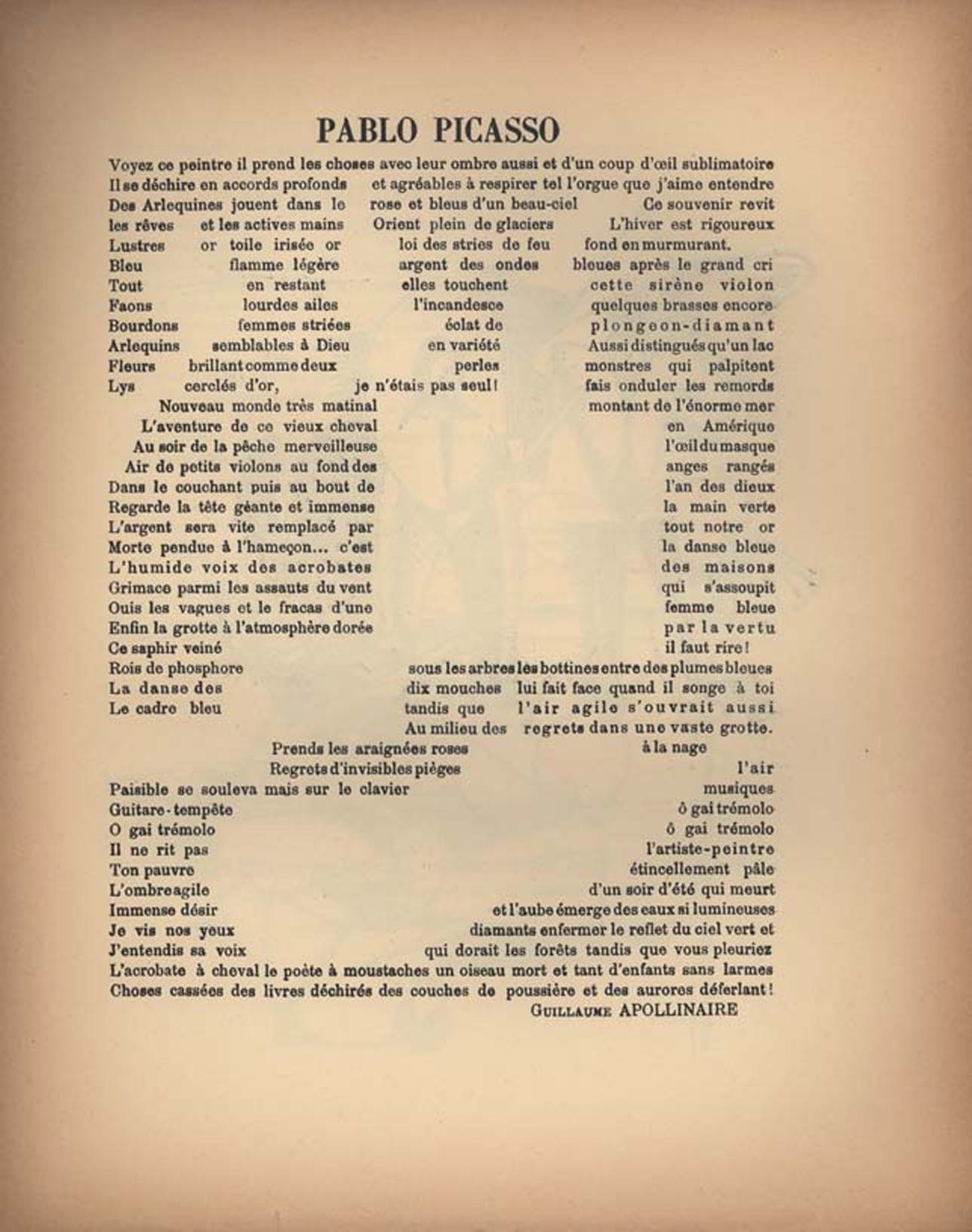1902 §
La Grande France , mai 1902Élégie du voyageur aux pieds blessés5 6 §
Marche le gars ! Marche en gaîté,
Ce calme jour d’un calme été,
Où, sauf la source, tout se tait.
Va parmi les grandes fougères,
Les myrtilles et les bruyères
Où tant d’abeilles butinèrent.
La source est là comme un œil clos,
Pleurant avec de frais sanglots
La naissance triste de l’eau.
L’eau pure deviendra l’eau sale,
La source enfante et pleure ou râle,
Déplorée par les saules pâles.
Roule de vulgaires pensées,
Vieilles et saines et sensées,
Le gars ! ô l’homme aux pieds blessés !
Au bois tu n’as point vu de faunes ;
Des nymphes tu n’eus pas l’aumône
D’un iris bleu, d’un iris jaune.
Tu foules les dieux sous tes pas
Au vert bâton que tu coupas
Un dieu meurt — tu ne le sais pas ! —
Ah ! marche l’homme sans déesses
Ni tutélaires ni traîtresses,
Marche et tue les dieux quand ils naissent.
Tue les dieux nés de nos clairs yeux
Et dans nos âmes ; le sang pieux
De tes pieds console les dieux.
Les faunes roux et les satyres
En te voyant feignent de rire
Et troublent l’eau quand tu t’y mires.
Tu marches saluant les croix,
Du bord des routes qui poudroient.
Tout rouges de ton sang et froids,
Les dieux narquois partout se meurent
Et s’émeuvent les enchanteurs,
Les fleurs se fanent, les fées pleurent.
Guillaume Apollinaire
La Revue blanche , décembre 1902L’Ermite7 §
Un ermite déchaux, près d’un crâne blanchi,
Cria : « Je vous maudis martyres et détresses,
Trop de tentations malgré moi me caressent.
Tentations de lune et de logomachies.
Trop d’étoiles s’enfuient quand je dis mes prières.
O chef de morte ! O vieil ivoire ! Orbites ! Trous
Des narines rongées ! J’ai faim ! Mes cris s’enrouent.
Voici donc pour mon jeûne un morceau de gruyère.
Tu es un crâne féminin, certainement,
Car le gruyère est fait avec du lait de vache,
O crâne dont j’ai peur en mon âme bravache !
O tête, j’ai baisé tes dents comme un amant.
Entendez-vous, Seigneur, quand d’horreur je l’écrase,
Craquer comme une noix le crâne féminin ?
Ayez pitié, Seigneur, de mes soupirs bénins.
Doux Seigneur, pardonnez au printemps qui viédaze.
Flagellez, flagellez les nuées du coucher
Qui tendent sans espoir de si jolis culs roses.
Et, c’est le soir, les fleurs de jour déjà se closent
Et les souris dans l’ombre incantent le plancher.
Les humains savent tant de jeux : l’amour, la mourre.
L’amour, jeu des nombrils ou jeu de la grande oie.
La mourre, jeu du nombre illusoire des doigts.
Seigneur, faites, Seigneur, qu’un jour je m’énamoure.
J’attends celle qui me tendra ses doigts menus.
Combien de signes blancs aux ongles ? Les paresses,
Les mensonges. Pourtant j’attends qu’elle les dresse
Ses mains enamourées devant moi, l’Inconnue.
Seigneur que t’ai-je fait ? Vois, je suis unicorne.
Pourtant, malgré son bel effroi concupiscent,
Comme un poupon chéri, mon sexe est innocent
D’être anxieux, seul et debout, comme une borne.
Seigneur, le Christ est nu. Jetez, jetez sur lui
La robe sans couture. Eteignez les ardeurs.
Au puits vont se noyer tant de tintements d’heures,
Quand isochrones, choient des gouttes d’eau de pluie.
J’ai veillé trente nuits sous les lauriers-roses.
As-tu sué du sang, Christ dans Gethsémani ?
Crucifié, réponds ! Dis non ! Moi, je le nie,
Car j’ai trop espéré en vain l’hématidrose.
J’écoutais à genoux toquer les battements
Du cœur. Le sang, toujours, roulait en ses artères
Qui sont de vieux coraux ou qui sont des clavaires,
Et je sentais l’aorte avare éperdument.
Une goutte tomba. Sueur ? et sa couleur ?
Lueur ! le sang est rouge ! et j’ai ri des damnés !
Puis enfin j’ai compris que je saignais du nez
À cause des parfums violents de mes fleurs.
Et j’ai ri du vieil ange qui n’est point venu
De vol très indolent me tendre un beau calice.
J’ai ri de l’aile grise et j’ôte mon cilice
Tissé de crins soyeux par de cruels canuts.
Vertuchou ! riotant des vulves des papesses,
Des saintes sans tétons. J’irai vers les cités
Et peut-être y mourir pour ma virginité,
Parmi les mains, les peaux, les mots et les promesses.
Malgré les autans bleus, je me dresse divin
Comme un rayon de lune adoré par la mer.
En vain, j’ai supplié tous les saints aémères,
Aucun n’a consacré mes doux pains sans levain.
Et je marche, je fuis, ô nuit, Lilith ulule
Et clame vainement et je vois de grands yeux
S’ouvrir tragiquement. O nuit, je vois tes cieux
L’étoiler calmement de splendides pilules.
Un squelette de reine innocente est pendu
À un long fil d’étoile en désespoir sévère.
La nuit, les bois sont noirs et se meurt l’espoir vert
Quand meurt le jour avec un râle inattendu.
Et je marche, je fuis. O jour, l’émoi de l’aube
Ferma le regard fixe et doux de vieux rubis
Des hiboux et voici le regard des brebis
Et des truies aux tétins roses comme des lobes.
Des corbeaux éployés comme des tildes font
Une ombre vaine aux pauvres champs de seigle mûr,
Non loin des bourgs où des chaumières sont impures
D’avoir des hiboux morts cloués à leur plafond.
Mes kilomètres longs, mes tristesses plénières,
Les squelettes de doigts terminant les sapins
Ont égaré ma route et mes rêves poupins
Souvent et j’ai dormi au sol des sapinières.
Enfin, ô soir pâmé, au bout de mes chemins
La ville m’apparut, très grave, au son des cloches,
Et ma luxure meurt à présent que j’approche.
En entrant j’ai béni les foules des deux mains.
Cité, j’ai ri de tes palais tels que des truffes
Blanches, au sol fouillé de clairières bleues.
Or, mes désirs s’en vont tous à la queue leu-leu.
Ma migraine pieuse a coiffé sa cucuphe.
Car toutes sont venues m’avouer leurs péchés,
Et, Seigneur, je suis saint par le vœu des amantes
Zélotide et Lorie, Louise et Diamante
Ont dit ; Tu peux savoir, ô toi, l’effarouché.
Ermite, absous nos fautes jamais vénielles,
O toi, le pur et le contrit que nous aimons,
Sache nos cœurs, sache les jeux que nous aimons
Et nos baisers quintessenciés comme du miel.
Or, j’absous les aveux pourpres comme leur sang
Des poétesses nues, des fées, des fornarines.
Aucun pauvre désir ne gonfle ma poitrine
Lorsque je vois, le soir, les couples s’enlaçant.
Et je ne veux plus rien, sinon laisser se clore
Mes yeux, couple lassé, au verger pantelant
Plein du râle pompeux des groseillers sanglants
Et de la sainte cruauté des passiflores. »
Guillaume Apollinaire
1903 §
La Plume , mai 1903Avenir8 §
Quand trembleront d’effroi les puissants. les ricombres
9 ,
Quand en signe de peur ils dresseront leurs mains,
Calmes devant le feu, les maisons qui s’effondrent,
Les cadavres tout nus couchés par les chemins,
Nous irons contempler le sourire des morts.
Nous marcherons très lentement, les yeux ravis,
Foulant aux pieds sous les gibets les mandragores
10 Sans songer aux blessés, sans regretter les vies.
Il y aura du sang et sur les rouges mares
Penchés, nous mirerons nos faces calmement
Et nous regarderons aux tragiques miroirs
La chute des maisons et la mort des amants.
Or, nous aurons bien soin de garder nos mains pures
Et nous admirerons, la nuit, comme Néron
11 ,
L’incendie des cités, l’écroulement des murs
Et comme lui, indolemment, nous chanterons.
Nous chanterons le feu, la noblesse des forges
12 ,
La force des grands gars, les gestes des larrons,
Et la mort des héros et la gloire des torches
Qui font une auréole autour de chaque front,
La beauté des printemps et les amours fécondes,
La douceur des yeux bleus que le sang assouvit,
Et l’aube qui va poindre et la fraîcheur des ondes,
Le bonheur des enfants et l’éternelle vie.
Mais nous ne dirons plus ni le mythe des veuves,
Ni l’honneur d’obéir, ni le son du canon,
Ni le passé, car les clartés de l’aube neuve
Ne feront plus vibrer la statue de Memnon
13 .
Après, sous le soleil pourriront les cadavres
Et les hommes mourront, nombreux, en liberté.
— Le soleil et les morts aux terres qu’on emblave
14 Donnent la beauté blonde et la fécondité. —
Puis quand la peste aura purifié la terre,
Vivront en doux amour les bienheureux humains,
Paisibles et très purs car les lacs et les mers,
Suffiront bien à effacer le sang des mains.
Guillaume Apollinaire .
La Plume , août 1903Le Larron15 §
« Maraudeur étranger, malheureux, malhabile,
Voleur, voleur, que ne demandais-tu ces fruits ?
Mais puisque tu as faim que tu es en exil,
Il pleure, il est barbare et bon, pardonnez-lui ! »
— « Je confesse le vol des fruits doux, des fruits mûrs,
Mais ce n’est pas l’exil que je viens simuler
Et sachez que j’attends de moyennes tortures,
Injustes si je rends tout ce que j’ai volé. »
— « Issu de l’écume des mers comme Aphrodite,
Sois docile, puisque tu es beau, naufragé !
Vois, les sages te font des gestes socratiques.
Vous parlerez d’amour quand il aura mangé.
Maraudeur étranger, malhabile et malade,
Ton père fut un sphinx et ta mère une nuit
Qui charma de lueurs Zacinthe et les Cyclades,
As-tu feint d’avoir faim quand tu volas les fruits ? »
— « Possesseurs de fruits mûrs, que dirai-je aux insultes ?
Ouir ta voix ligure en nénie, ô maman !
Puisqu’ils n’eurent enfin, la pubère et l’adulte,
De prétexte sinon de s’aimer nuitamment.
Il y avait des fruits tout ronds comme des âmes
Et des amandes de pomme de pin jonchaient
Votre jardin marin où j’ai laissé mes rames
Et mon couteau punique au pied de ce pêcher.
Les citrons couleur d’huile et à saveur d’eau froide
Pendaient parmi les fleurs des citronniers tordus,
Les oiseaux de leur bec ont blessé vos grenades
Et presque toutes les figues étaient fendues. »
Il entra dans la salle aux fresques qui figurent
L’inceste solaire et nocturne dans les nues :
« Assieds-toi là, pour mieux ouïr les voix ligures
Au son des cinyres des Lydiennes nues. »
Or, les hommes ayant des masques de théâtre
Et les femmes ayant des colliers où pendait
La pierre prise au foie d’un vieux coq de Tanagre
Parlaient entre eux le langage de la Chaldée.
Les autans langoureux dehors feignaient l’automne,
Les convives c’étaient tant de couples d’amants
Qui dirent tour à tour : « Voleur, je te pardonne.
Reçois d’abord le sel puis le pain de froment.
Le brouet qui froidit sera fade à tes lèvres,
Mais l’outre en peau de bouc maintient frais le vin blanc.
Par ironie, veux-tu qu’on serve un plat de fèves
Ou des beignets de fleurs trempés dans du miel blond ? »
Une femme lui dit : « Tu n’invoques personne,
Crois-tu donc au hasard qui coule au sablier ?
Voleur, connais-tu mieux les lois malgré les hommes ?
Veux-tu le talisman heureux de mon collier ?
Larron des fruits tourne vers moi tes yeux lyriques.
Emplissez de noix la besace du héros.
Il est plus noble que le paon pythagorique,
Le dauphin, la vipère mâle ou le taureau.
*
Qui donc es-tu, toi qui nous vins grâce au vent scythe ?
Il en est tant venu par la route ou la mer,
Des conquérants fictifs rués pour la vindicte
Et des bandes souvent qui fuyaient aux éclairs.
Un homme bègue ayant au front deux jets de flammes
Passa, menant un peuple infime pour l’orgueil
De manger chaque jour les cailles et la manne
Et d’avoir vu la mer ouverte comme un œil.
Les puiseurs d’eau barbus, coiffés de bandelettes
Noires et blanches contre les maux et les sorts
Revenaient de l’Euphrate et les yeux des chouettes
Attiraient quelquefois les chercheurs de trésors.
Effrayants et fardés, les poètes barbares,
Troupe lâche, cherchaient, pour y chastes mourir,
La forêt précieuse aux oiseaux gemmipares
Où des fruits doux et vénéneux pour eux mûrirent.
Un triomphe passait gémir sous l’arc-en-ciel
Avec de blêmes laurés debout dans les chars,
Les statues suant, les scurriles, les agnelles
Et l’angoisse rauque des paonnes et des jars.
Les veuves précédaient en égrenant des grappes
Les évêques noirs révérant sans le savoir,
Au triangle isocèle ouvert au mors des chapes,
Pallas, et chantaient l’hymne à la belle, mais noire.
Les chevaucheurs nous jetèrent dans l’avenir
Les alcancies pleines de cendre ou bien de fleurs,
Nous aurons des baisers florentins sans le dire,
Mais au jardin, ce soir, tu vins, sage et voleur.
*
Ceux de ta secte adorent-ils la vie obscène :
Belphégor, le soleil, le silence ou le chien,
Parce qu’il est bien d’êre obscènes quand on s’aime ? »
Et le larron des fruits cria : « Je suis chrétien ! »
— « Ah ! Ah ! les colliers tinteront, cherront les masques.
Va-t’en, va-t’en, contre le feu l’ombre prévaut.
Ah ! Ah ! le larron de gauche dans la bourrasque
Rira de toi comme hennissent les chevaux. »
— « Larron des fruits tourne vers moi tes yeux lyriques.
Emplissez de noix la besace du héros,
Il est plus noble que le paon pythagorique,
Le dauphin, la vipère mâle ou le taureau. »
— « Ah ! Ah ! nous secouerons toute la nuit les sistres,
La voix ligure était-ce donc un talisman.
Et si tu n’es pas ne droite tu es sinistre
Comme une tache grise ou le pressentiment.
Puisque l’absolu choit, la chûte est une preuve
Qui double devient triple avant d’avoir été.
Nous avouons que les grossesses nous émeuvent ;
Les ventres pourront seuls nier l’aséité.
Vois, les vases sont pleins d’humides fleurs morales.
Va-t’en mais dénudé, puisque tout est à nous.
Ouïs du chœur des vents les cadences plagales
Et prends l’arc pour tuer l’unicorne ou le gnou.
L’ombre équivoque et tendre est le deuil de ta chair,
Et sombre, elle est humaine et puis la nôtre aussi.
Va-t’en, le crépuscule a des lueurs légères
Et puis aucun de nous ne croirait tes récits.
Il brillait et attirait comme la pantaure.
Que n’avait-il la voix et les jupes d’Orphée
Et les femmes, la nuit, feignant d’être des taures
L’eussent aimé comme on l’aima, puisqu’en effet
Il était pâle, il était beau comme un roi ladre.
Que n’avait-il la voix et les jupes d’Orphée,
La pierre prise au foie d’un vieux coq de Tanagre
Au lieu du roseau triste et du funèbre faix.
Que n’alla-t-il vivre à la cour du roi d’Edesse ?
Maigre et magique, il eût scruté le firmament,
Pâle et magique, il eût aimé des poétesses,
Juste et magique, il eût épargné les démons.
Va-t’en errer crédule et roux avec ton ombre.
Soit ! la triade est mâle et tu es vierge et froid.
Le tact est relatif mais la vue est oblongue.
Tu n’as de signe que le signe de la croix.
Vouons le vol à Sparte et l’inceste à Ninive.
Nous rentrerons demain à l’école d’Elée.
Qu’on souffle les flambeaux à cause des convives
Qui se fiant au Bègue ont peur d’être brûlés. »
Guillaume Apollinaire .
Le Festin d'Ésope , décembre 1903Série sans titre16 §
L’Adieu17 §
« J’ai cueilli ce brin de bruyère.
Mets-le sur ton cœur plus longtemps
Nous ne nous verrons plus sur terre. »
— « J’ai mis sur mon cœur la bruyère,
Et souviens-toi que je t’attends. »
Le Retour18 §
Toc, toc… « Il a fermé sa porte.
Les lys du jardin sont flétris…
Quel est donc ce mort qu’on emporte ? »
— « Tu viens de toquer à sa porte »
— « Et je suis veuve, aux pieds meurtris. »
Guillaume Apollinaire .
1909 §
Les Argonautes , février 1909Série sans titre96 §
I. Saltimbanques97 §
Dans la plaine les baladins
S’éloignent au long des jardins,
Devant l’huis des auberges grises,
Par les villages sans églises.
Et les enfants s’en vont devant,
Les autres suivent en rêvant ;
Chaque arbre fruitier se résigne
Quand de très loin ils lui font signe.
Ils ont des poids ronds ou carrés,
Des tambours, des cerceaux dorés.
L’ours et le singe, animaux sages,
Quêtent des sous sur leur passage.
II. Crépuscule (incipit : « Frôlée par les ombres des morts »)98 §
Frôlée par les ombres des morts,
Sur l’herbe où le jour s’exténue
L’Arlequine s’est mise nue
Et dans l’étang mire son corps.
Un charlatan crépusculaire
Vante les tours que l’on va faire.
Le ciel sans teinte est constellé
D’astres pâles comme du lait.
Sur les tréteaux l’Arlequin blême
Salue d’abord les spectateurs :
Des sorciers venus de Bohême,
Quelques fées et les enchanteurs.
Ayant décroché une étoile,
Il la manie à bras tendu,
Tandis que des pieds un pendu
Sonne en mesure les cymbales.
L’aveugle berce un bel enfant ;
La biche passe avec ses faons ;
Le nain regarde d’un air triste
Grandir l’Arlequin trismégiste.
Guillaume Apollinaire .
Les Marges , mars 1909Poèmes (Trois petits Poèmes)99 §
Chanson (incipit : « Les myrtilles sont pour la dame100 101 §
Les myrtilles sont pour la dame
Qui n’est pas là,
La marjolaine est pour mon âme
102 Tralala !
Le chêvrefeuille est pour la belle
Irrésolue.
Quand cueillerons-nous les airelles
103 ?
Mais laissons pousser sur la tombe,
O folle ! ô fou !
Le romarin en touffes sombres,
Laïtou !
Les Marges , avril 1909Le Départ (incipit : « Maudite celle-là qui ayant renoncé106 §
Maudite celle-là qui ayant renoncé
A n’être qu’une amante aime la chaste Gloire ;
Le surnom de sa Vie sera le Désespoir
Et le rire de tous l’écho de sa Pensée.
O douce Vie, ô doux Amour que je rebute
Tendresse du Printemps qui me fait défaillir,
Un vol d’oiseaux divins monte comme un soupir
Dans le firmament clair de mes pures disputes.
Adieu, adieu ! vous qui m’aimiez, oubliez-moi !
Laissez-moi seule, triste et noire, dans la gare
Attendre, les yeux secs, l’heure de mon départ,
Puisque, vous le savez, je ne vous aime pas.
Rayons d’un regard d’homme, ô cordes de ma lyre,
C’est vous qui résonnez quand je chante ; c’est vous,
La cause de l’impossible amour que j’avoue
Et qui m’avez donné la force de le dire.
Et cette lyre accorde et mon cœur et ses yeux ;
Lyre, trop vieille image, mot délicieux.
Le paysage fuit et sans qu’il m’en souvienne,
O train joyeux, quel bruit tu mènes
107 !…
Louise LALANNE.
Les Visages de la vie , printemps 1909Au jardin des cyprès, je filais en rêvant,
Suivant longtemps des yeux les flocons que le vent
Prenait à ma quenouille, ou bien par les allées
Jusqu’au bassin mourant que pleurent les saulaies
Je marchais à pas lents, m’arrêtant aux jasmins,
Me grisant du parfum des lys, tendant les mains
Vers les iris fées gardés par les grenouilles.
Et pour moi les cyprès n’étaient que des quenouilles,
Et mon jardin, un monde où je vivais exprès
Pour y filer un jour les éternels cyprès.
Louise Lalanne .
Le Voile de Pourpre , mai 1909Poèmes rhénans110 §
Le Jour des Morts111 §
Les enfants des morts vont jouer
Dans le cimetière
Martin Gertrude Hans et Henri
Nul coq n’a chanté aujourd’hui
Kikiriki.
Les vieilles femmes
Tout en pleurant cheminent
Et les bons ânes
Braillent hi han et se mettent à brouter les fleurs
Des couronnes mortuaires
C’est le jour des morts et de toutes leurs âmes.
Les enfants et les vieilles femme
112 Allument des bougies et des cierges
Sur chaque tombe catholique.
Les voiles des vieilles,
Les nuages du ciel
Sont comme les barbes de biques.
L’air tremble de flammes et de prières
Le cimetière est un beau jardin
Plein de saules gris et de romarins
Il vous vient souvent des amis qu’on enterre
Ah ! que vous êtes bien dans le beau cimetière
Vous, mendiants morts saouls de bière,
Vous, les aveugles comme le destin
113 Vous, les beaux gars morts à la guerre
Et vous, petits enfants, morts en prière.
Ah ! que vous êtes bien dans le beau cimetière
Vous, bourguemestres, vous, bateliers,
Et vous, conseillers de régence,
Vous aussi, tsiganes sans papiers,
La vie vous pourrit dans la panse,
La croix nous pousse entre les pieds
114 .
Le vent du Rhin ulule avec tous les hiboux,
Il éteint les cierges que toujours les enfants rallument
Et les feuilles mortes
Viennent couvrir les morts.
Des enfants morts parlent parfois avec leur mère,
Et des mortes parfois voudraient bien revenir.
Oh ! je ne veux pas que tu sortes
L’automne est plein de mains coupées
Non, non, ce sont des feuilles mortes
Ce sont les mains des chères mortes
115 Ce sont tes mains coupées.
Nous avons tant pleuré aujourd’hui
Avec ces morts, leurs enfants et les vieilles femmes
Sous le ciel sans soleil
Au cimetière plein de flammes,
Puis, dans le vent, nous nous en retournâmes…
A nos pieds roulaient des châtaignes
Dont les bogues étaient
Comme le cœur blessé de la madone
Dont on doute si elle eut la peau
Couleur des châtaignes d’automne…
Honnef , novembre 1901.
Vent nocturne116 §
Oh ! les cimes des pins grincent en se heurtant
Et l’on entend aussi se lamenter l’autan
Et, du fleuve prochain à grand’voix triomphales
Les elfes rire au vent ou corner aux rafales
Attys, Attys, Attys charmant et débraillé
C’est ton nom qu’en la nuit les elfes ont raillé
Parce qu’un de tes pins s’abat au vent gothique.
La forêt fuit au loin comme une armée antique
Dont les lances, ô pins, s’agitent au tournant…
Les villages éteints méditent maintenant
Comme des vierges, des vieillards et des poètes
Et ne s’éveilleront au pas de nul venant
Ni quand sur leurs pigeons fondront les gypaètes.
Neu Gluck , 1901.
Le ciel et les oiseaux venaient se reposer
Sur deux cyprès que le vent tiède enlaçait presque
Comme un couple d’amants à leur dernier baiser.
La maison, près du Rhin, était si romanesque.
Avec ses grandes fenêtres, son toit pointu
Sur lequel criait, par instants, la girouette
Au vent qui demandait si doucement : « Qu’as-tu ? »
Et sur la porte était clouée une chouette
118 .
Nous parlions dans le vent auprès d’un petit mur
Ou lisions l’inscription d’une pierre mise
A cette place en souvenir d’un meurtre et sur
Laquelle bien souvent tu t’es longtemps assise :
« Gottfried apprenti de Brühl, l’an seize cent trente
« Ici fut assassiné,
« Sa fiancée en eut une douleur touchante
« Requiem aeternam dona ei, Domine. »
119 Le soleil au déclin empourprait la montagne
Et notre amour saignait comme les groseillers
120 Puis étoilant ce pâle automne d’Allemagne,
La nuit, pleurant des lueurs, mourait à nos pieds
Et notre amour ainsi se mêlait à la mort.
Au loin, près d’un feu, chantaient des bohémiennes.
Un train passait, les yeux ouverts sur l’autre bord…
Nous regardions longtemps les villes riveraines.
Honnef , 1901.
Crépuscule (incipit : « Ruines au bord du vieux Rhin »)121 §
Ruines au bord du vieux Rhin
On s’embrasse bien dans votre ombre.
Les mariniers qui voient de loin,
Nous envoient des baisers sans nombre.
La nuit arrive tout à coup
Comme l’amour dans ces ruines.
Du Rhin, là-bas, sortent le cou,
Des niebelungs et des ondines
122 .
Ne craignons rien des nains barbus
Qui dans les vignes se lamentent
Parce qu’ils n’ont pas assez bu…
Ecoutons les muses qui chantent.
Honnef , 1901.
Les Sapins123 §
Les sapins en bonnets pointus
De longues robes revêtus
Comme des astrologues
Saluent leurs frères abattus,
Les bateaux qui sur le Rhin voguent.
Dans les sept arts endoctrinés
Par les vieux sapins, leurs aînés
Qui sont de grands poètes,
Ils se savent prédestinés
A briller plus que des planètes
A briller doucement, changés
En étoiles et enneigés.
Aux Noëls bienheureuses
Fêtes des sapins ensongés
Aux longues branches langoureuses.
Les sapins, beaux musiciens,
Chantent des noëls anciens
Au vent des soirs d’automne
Ou bien graves magiciens
Incantent le ciel, quand il tonne.
Des rangées de blancs chérubins
Remplacent l’hiver, les sapins
Et balancent leurs ailes.
L’été, ce sont de grands-rabbins
Ou bien de vieilles demoiselles.
Sapins, médecins divagants,
Ils vont, offrant leurs bons onguents.
Quand la montagne accouche.
De temps en temps sous l’ouragan
Un vieux sapin geint et se couche.
Neu Gluck , 1901.
La Vierge à la fleur de haricot à Cologne124 125 §
La Vierge au brin fleuri est une Vierge blonde
Et son petit Jésus est blond comme elle l’est ;
Ses yeux sont bleus et purs comme le ciel ou l’onde
Et l’on conçoit qu’elle ait conçu du Paraclet
126 .
Deux Saintes veillant dans les volets du tryptique
Pensent béatement aux martyres passés
Et s’extasient d’ouïr le plain-chant des cantiques
127 Des petits anges blancs dans le ciel entassés.
Les trois dames et l’enfant vivaient à Cologne,
Le haricot poussait dans un jardin rhénan
Et le peintre ayant vu de hauts vols de cigognes
Peignit les séraphins qui chantent maintenant.
Et c’est la Vierge la plus douce du royaume.
Elle vécut au bord du Rhin pieusement
Priant devant son portrait que maître Guillaume
Peignit par piété de chrétien ou d’amant.
Cologne , 1901.
Guillaume Apollinaire .
Mercure de France , 1er mai 1909La Chanson du Mal-Aimé128 §
[« Un soir de demi-brume, à Londres »] §
Un soir de demi-brume, à Londres,
Un voyou, qui ressemblait à
Mon amour, vint à ma rencontre,
Et le regard qu’il me jeta
Me fit baisser les yeux de honte.
Je suivis ce mauvais garçon
Qui sifflotait, mains dans les poches ;
Nous semblions, entre les maisons,
Onde ouverte de la mer rouge,
Lui, les Hébreux, moi, Pharaon.
Que tombent ces vagues de briques
Si tu ne fus pas bien aimée !
Je suis le souverain d’Egypte,
Sa sœur-épouse, son armée,
Si tu n’es pas l’amour unique !
Au tournant d’une rue brûlant
De tous les feux de ses façades,
Plaies du brouillard sanguinolent
Où se lamentaient les façades,
Une femme lui ressemblant
— C’était son regard d’inhumaine,
La cicatrice à son cou nu, —
Sortit saoule d’une taverne
Au moment où je reconnus
La fausseté de l’amour même…
Lorsqu’il fut de retour enfin
Dans sa patrie, le sage Ulysse,
Son vieux chien de lui se souvint ;
Près d’un tapis de haute lisse
Sa femme attendait qu’il revînt.
L’époux royal de Sacontale,
Las de vaincre, se réjouit
Lorsqu’il la retrouva plus pâle,
D’attente et d’amour yeux pâlis,
Caressant sa gazelle mâle.
J’ai pensé à ces rois heureux
Lorsque le faux amour et celle
Dont je suis encore amoureux,
Heurtant leurs ombres infidèles,
Me rendirent si malheureux.
Regrets sur quoi l’enfer se fonde,
Qu’un ciel d’oubli s’ouvre à mes vœux !
Pour son baiser les rois du monde
Seraient morts ; des pauvres fameux
Pour elle eussent vendu leur ombre.
J’ai hiverné dans mon passé.
Revienne le soleil de Pâques
Pour chauffer un cœur plus glacé
Que les quarante de Sébaste
Moins que ma vie, martyrisés…
Mon beau navire, ô ma mémoire,
Avons-nous assez navigué
Dans une onde mauvaise à boire ?
Avons-nous assez divagué
De la belle aube au triste soir ?…
Adieu, faux amour confondu
Avec la femme qui s’éloigne,
Avec celle que j’ai perdue
L’année dernière, en Allemagne
129 Et que je ne reverrai plus !
Voie lactée, ô sœur lumineuse,
Des blancs ruisseaux de Chanaan
Et des corps blancs des amoureuses,
Nageurs morts, suivrons-nous d’ahan
Ton cours vers d’autres nébuleuses ?
Je me souviens d’une autre année,
C’était l’aube d’un jour d’avril.
J’ai chanté ma joie bien-aimée,
Chanté l’amour à voix virile
Au moment d’amour de l’année :
*
Aubade chantée à Lætare un an passé §
C’est le printemps, viens-t’en, Pâquette,
Te promener au bois joli.
Les poules dans la cour caquètent,
L’aube au ciel fait de roses plis,
L’amour chemine à ta conquête.
Mars et Vénus sont revenus ;
Ils s’embrassent à bouches folles
Devant des sites ingénus
Où sous les roses qui feuillolent
De beaux dieux roses dansent nus.
Viens, ma tendresse est la régente
De la floraison qui paraît.
La nature est belle et touchante,
Pan sifflote dans la forêt,
Les grenouilles humides chantent.
*
[« Beaucoup de ces dieux ont péri »] §
Beaucoup de ces dieux ont péri ;
C’est sur eux que pleurent les saules.
Le grand Pan, l’amour, Jésus-Christ
Sont bien morts et les chats miaulent
Dans la cour ; je pleure à Paris,
Moi qui sais des lais pour les reines,
Les complaintes de mes années,
Des hymnes d’esclave aux murènes,
La romance du mal-aimé,
Et des chansons pour les sirènes.
L’amour est mort, j’en suis tremblant,
J’adore de belles idoles :
Les souvenirs lui ressemblant ;
Comme la femme de Mausole
Je reste fidèle et dolent.
Je suis fidèle comme un dogue
Au maître, le lierre au tronc,
Et les Cosaques Zaporogues
Ivrognes, pieux et larrons
Aux steppes et au décalogue.
« Portez, comme un joug, le croissant
« Qu’interrogent les astrologues.
« Je suis le Sultan tout puissant,
« O mes cosaques Zaporogues
« Votre Seigneur éblouissant.
« Devenez mes sujets fidèles »,
Leur avait écrit le Sultan.
Ils rirent à cette nouvelle,
Puis répondirent à l’instant
A la lueur d’une chandelle :
« Plus criminel que Barrabas,
« Cornu comme les mauvais anges,
« Quel Belzébuth es-tu là-bas,
« Nourri d’immondice et de fange ?
« Nous n’irons pas à tes sabbats. »
Voie lactée, ô sœur lumineuse
Des blancs ruisseaux de Chanaan
Et des corps blancs des amoureuses,
Nageurs morts, suivrons-nous d’ahan
Ton cours vers d’autres nébuleuses ?
Regret des jeux de la putain
Et belle comme une panthère !
Amour, vos baisers florentins
Avaient une saveur amère
Qui a rebuté nos destins.
Ses regards laissaient une traîne
D’étoiles dans les soirs tremblants ;
Dans ses yeux nageaient les sirènes,
Et nos baisers mordus, sanglants,
Faisaient pleurer nos fées marraines.
Mais, en vérité, je t’attends
Avec mon cœur, avec mon âme,
Et sur le pont des Reviens-t’en
Si jamais revient cette femme,
Je lui dirai : « Je suis content ! »
… Mon cœur et ma tête se vident,
Tout le ciel s’écoule par eux ;
O mes tonneaux des Danaïdes,
Comment faire pour être heureux,
Comme un petit enfant candide ?
Je ne veux jamais l’oublier
Ma colombe, ma blanche rade,
O marguerite exfoliée
Mon île au loin, ma Désirade,
Ma rose, mon giroflier…
Les satyres et les pyraustes,
Les êgypans, les feux follets,
Et les destins damnés ou faustes,
La corde au cou comme à Calais,
Sur ma douleur quel holocauste !
Douleur qui doubles les destins,
La licorne et le capricorne
— Mon âme et mon corps incertain —
Te fuient, ô bûcher divin qu’ornent
Des astres, des fleurs du matin !
Malheur, dieu pâle aux yeux d’ivoire,
Tes prêtres fous t’ont-ils paré ?
Tes victimes en robe noire
Ont-elles vainement pleuré ?
Malheur, dieu qu’il ne faut pas croire !
Et toi, qui me suis en rampant,
Dieu de mes dieux morts en automne,
Tu mesures combien d’empans
J’ai droit que la terre me donne,
O mon ombre, ô mon vieux serpent !
Au soleil, parce que tu l’aimes,
Je t’ai menée, souviens-t’en bien,
Ténébreuse épouse que j’aime.
Tu es à moi en n’étant rien,
O mon ombre en deuil de moi-même…
… L’hiver est mort tout enneigé ;
On a brûlé les ruches blanches.
Dans les jardins et les vergers
Les oiseaux chantent sur les branches,
Le printemps clair, l’avril léger.
Mort d’immortels argyraspides !
La neige aux boucliers d’argent
Fuit les dendrophores livides
Du printemps cher aux pauvres gens
Qui resourient les yeux humides.
Et moi j’ai le cœur aussi gros
Qu’un cul de dame damascène.
O mon amour, je t’aimais trop,
Et maintenant j’ai trop de peine.
Les sept épées hors du fourreau !…
Sept épées de mélancolie
Sans morfil, ô claires douleurs,
Sont dans mon cœur et la folie
Veut raisonner pour mon malheur,
Comment voulez-vous que j’oublie ?
*
Les Sept Épées §
La première est toute d’argent
Et son nom tremblant, c’est Paline ;
Sa lame, un ciel d’hiver neigeant ;
Son destin sanglant, gibeline ;
Vulcain mourut en la forgeant.
La seconde, nommée Noubosse,
Est un bel arc-en-ciel joyeux ;
Les dieux s’en servent à leurs noces ;
Elle a tué trente Bé-Rieux
Et fut douée par Carabosse.
La troisième, bleu féminin,
N’en est pas moins un chibriape
Appelé Lul de Faltenin
Et que porte sur une nappe,
Devant l’antipapesse, un nain.
La quatrième, Malourène,
Est un fleuve vert et doré ;
C’est le soir quand les riveraines
Y baignent leurs corps adorés
Et des champs de rameurs s’y traînent.
La cinquième, Sainte-Fabeau,
C’est la plus belle des quenouilles ;
C’est un cyprès sur un tombeau
Où les quatre vents s’agenouillent,
Et chaque nuit c’est un flambeau.
La sixième, métal de gloire,
C’est l’ami aux si douces mains
Dont chaque matin nous sépare :
« Adieu, voilà votre chemin. »
Les coqs s’épuisaient en fanfares.
Et la septième s’exténue,
Une femme, une rose morte :
« Merci, que le dernier venu
« Sur mon amour ferme la porte.
« Je ne vous ai jamais connue. »
*
[« Voie lactée, ô sœur lumineuse »] §
Voie lactée, ô sœur lumineuse
Des blancs ruisseaux de Chanaan
Et des corps blancs des amoureuses,
Nageurs morts, suivrons-nous d’ahan
Ton cours vers d’autres nébuleuses ?
Les démons du hasard selon
Le chant du firmament nous mènent.
A sons perdus, leurs violons
Font danser notre race humaine
Sur la descente, à reculons.
Destins, destins impénétrables,
Rois secoués par la folie…
Et ces grelottantes étoiles…
De fausses femmes dans vos lits
Aux déserts que l’histoire accable.
Luitpold, le vieux prince régent,
Tuteur de deux royautés folles,
Sanglote-t-il en y songeant
Quand vacillent les lucioles,
Mouches dorées de la Saint-Jean ?
Près d’un château sans châtelaine,
La barque aux barcarols chantants,
Sur un lac blanc et sous l’haleine
Des vents qui tremblent au printemps
Voguait, cygne mourant, sirène.
Un jour, le roi, dans l’eau d’argent,
Se noya, puis, la bouche ouverte,
Il s’en revint en surnageant
Sur la rive dormir inerte,
Face tournée au ciel changeant…
… Juin, ton soleil, ardente lyre,
Brûle mes doigts endoloris.
Triste et silencieux délire,
J’erre à travers mon beau Paris
Sans avoir le cœur d’y mourir.
Les dimanches s’y éternisent
Et les orgues de Barbarie
Y sanglotent dans les cours grises ;
Les fleurs, aux balcons de Paris,
Penchent comme la tour de Pise.
Soirs de Paris, ivres du gin
Flambant de l’électricité.
Les tramways, feux verts sur l’échine,
Musiquent, au long des portées
De rails, leur folie de machines.
Les cafés gonflés de fumée
Crient tout l’amour de leurs tziganes,
De tous leurs siphons enrhumés,
De leurs garçons vêtus d’un pagne,
Vers toi, toi que j’ai tant aimée,
Moi, qui sais des lais pour les reines,
Les complaintes de mes années,
Des hymnes d’esclave aux murènes,
La romance du mal-aimé.
Et des chansons pour les sirènes.
1903.
Guillaume Apollinaire .
Vers et Prose , juillet-août-septembre 1909L’Obituaire130 §
S’étendant sur les côtés du cimetière,
L’obituaire l’encadrait comme un cloître.
A l’intérieur de ses vitrines
Pareilles à celles des boutiques de modes,
Au lieu de sourire debout,
Les mannequins grimaçaient pour l’éternité.
Arrivé à Munich depuis quinze ou vingt jours,
J’étais entré pour la première fois,
Et par hasard,
Dans ce cimetière presque désert,
Et je claquais des dents
Devant toute cette bourgeoisie
Exposée et vêtue le mieux possible
En attendant la sépulture.
Soudain,
Rapide comme ma mémoire,
Les yeux se rallumèrent
De cellule vitrée en cellule vitrée,
Le ciel se peupla d’une apocalypse
Vivace
Et la terre, plate à l’infini
Comme avant Galilée,
Se couvrit de mille mythologies immobiles.
Un ange en diamant brisa toutes les vitrines
Et les morts m’accostèrent
Avec des mines de l’autre monde.
Mais leur visage et leurs attitudes
Devinrent bientôt moins funèbres.
Le ciel et la terre perdirent
Leur aspect fantasmagorique.
Les morts se réjouissaient
De voir leurs corps trépassés entre eux et la lumière.
Ils riaient de leur ombre et l’observaient
Comme si véritablement
C’eût été leur vie passée.
Alors, je les dénombrai.
Ils étaient quarante-neuf hommes,
Femmes et enfants
Qui embellissaient à vue d’œil
Et me regardaient maintenant
Avec tant de cordialité,
Tant de tendresse même,
Que les prenant en amitié
Tout à coup,
Je les invitai à une promenade
Loin de l’obituaire.
Et tous bras dessus, bras dessous,
Fredonnant des airs militaires,
(Oui, tous vos péchés sont absous)
Nous quittâmes le cimetière.
Nous traversâmes la ville
Et rencontrions souvent
Des parents, des amis qui se joignaient
A la petite troupe des morts récents.
Tous étaient si gais,
Si charmants, si bien portants
Que bien malin qui aurait pu
Distinguer les morts des vivants.
Puis, dans la campagne,
On s’éparpilla.
Deux chevau-légers nous rejoignirent.
On leur fit fête.
Ils coupèrent du bois de viorne
Et de sureau
Dont ils firent des sifflets
Qu’ils distribuèrent aux enfants.
Plus tard, dans un bal champêtre,
Les couples mains sur les épaules,
Dansèrent au son aigre des cithares.
Ils n’avaient pas oublié la danse,
Ces morts et ces mortes !
On buvait aussi,
Et, de temps à autre, une cloche
Annonçait qu’un nouveau tonneau
Allait être mis en perce.
Une morte, assise sur un banc,
Près d’un buisson d’épine-vinette,
Laissait un étudiant,
Agenouillé à ses pieds,
Lui parler de fiançailles :
— Je vous attendrai
Dix ans, vingt ans, s’il le faut.
Votre volonté sera la mienne. —
— Je vous attendrai
Toute votre vie…
Répondait la morte.
Des enfants
De ce monde ou bien de l’autre
Chantaient de ces rondes
Aux paroles absurdes et lyriques
Qui, sans doute, sont les restes
Des plus anciens monuments
Poétiques
De l’humanité.
L’étudiant passa une bague
A l’annulaire de la jeune morte :
— Voici le gage de mon amour,
De nos fiançailles.
Ni le temps, ni l’absence
Ne nous feront oublier nos promesses.
Et un jour, nous aurons une belle noce,
Des touffes de myrte
A nos vêtements et dans vos cheveux,
Un beau sermon à l’église,
De longs discours après le banquet
Et de la musique,
De la musique. —
— Nos enfants, dit la fiancée,
Seront plus beaux, plus beaux encore,
Hélas ! la bague était brisée,
Que s’ils étaient d’argent ou d’or,
D’émeraude ou de diamant,
Seront plus clairs, plus clairs encore,
Que les astres du firmament,
Que la lumière de l’aurore,
Que vos regards mon fiancé,
Auront meilleure odeur encore,
Hélas ! la bague était brisée,
Que le lilas qui vient d’éclore,
Que le thym, la rose ou qu’un brin
De lavande ou de romarin.
Les musiciens s’en étant allés,
Nous continuâmes la promenade.
Au bord d’un lac,
On s’amusa à faire des ricochets,
Avec des cailloux plats,
Sur l’eau qui dansait à peine.
Des barques étaient amarrées
Dans un havre,
On les détacha
Après que toute la troupe se fût embarquée,
Et quelques morts ramaient
Avec autant de vigueur que les vivants.
A l’avant du bateau que je gouvernais,
Un mort parlait avec une jeune femme
Vêtue d’une robe jaune,
D’un corsage noir
Avec des rubans bleus et d’un chapeau gris
Orné d’une seule petite plume défrisée.
— Je vous aime, disait-il,
Comme le pigeon aime la colombe,
Comme l’insecte nocturne
Aime la lumière. —
— Trop tard, répondait la vivante.
Repoussez, repoussez cet amour défendu,
Je suis mariée.
Voyez l’anneau qui brille,
Mes mains tremblent,
Je pleure et je voudrais mourir.
Les barques étaient arrivées
A un endroit où les chevau-légers
Savaient qu’un écho répondait de la rive.
On ne se lassait point de l’interroger.
Il y eut des questions si extravagantes
Et des réponses tellement pleines d’à-propos
Que c’était à mourir de rire,
Et le mort disait à la vivante :
— Nous serions si heureux ensemble !
Sur nous l’eau se refermera,
Mais vous pleurez et vos mains tremblent,
Aucun de nous ne reviendra. —
On reprit terre et ce fut le retour.
Les amoureux s’entr’aimaient,
Et par couples aux belles bouches,
Marchaient à distances inégales.
Les morts avaient choisi les vivantes,
Et les vivants,
Des mortes.
Un genévrier, parfois,
Faisait l’effet d’un fantôme.
Les enfants déchiraient l’air
En soufflant, les joues creuses,
Dans leurs sifflets de viorne,
Ou de sureau,
Tandis que les militaires
Chantaient des tyroliennes
En se répondant comme on le fait
Dans la montagne.
Dans la ville,
Notre troupe diminua peu à peu.
On se disait au revoir,
A demain,
A bientôt.
Beaucoup entraient dans les brasseries.
Quelques-uns nous quittèrent
Devant une boucherie canine
Pour y acheter leur repas du soir.
Bientôt, je restai seul avec ces morts
Qui s’en allaient tout droit
Au cimetière
Où,
Dans l’obituaire,
Je les reconnus, couchés, immobiles,
Et bien vêtus,
Attendant la sépulture derrière les vitrines.
Ils ne se doutaient pas
De ce qui s’était passé,
Mais les vivants en gardaient le souvenir.
C’était un bonheur inespéré
Et si certain
Qu’ils ne craignaient point de le perdre.
Ils vivaient si noblement
Que ceux, qui, la veille encore,
Les regardaient comme leurs égaux
Ou même quelque chose de moins,
Admiraient maintenant
Leur puissance, leur richesse et leur génie.
Car, y a-t-il rien qui vous élève
Comme d’avoir aimé un mort ou une morte ?
On devient si pur qu’on en arrive
Dans les glaciers de la mémoire
A se confondre avec le souvenir.
On est fortifié pour la vie
Et l’on n’a plus besoin de personne.
GUILLAUME APOLLINAIRE
1912 §
Arthénice , 1912Immortalité158 §
O mon très cher amour, toi, mon œuvre, et que j’aime
159 ,
A jamais j’allumai le feu de ton regard,
Je t’aime comme j’aime une belle œuvre d’art,
Une noble statue, un magique poème.
Tu seras, mon aimée, un témoin de moi-même ;
Je te crée à jamais pour qu’après mon départ
Tu transmettes mon nom aux hommes en retard,
Toi, la vie et l’amour, ma gloire et mon emblème ;
Et je suis soucieux de ta grande beauté
Bien plus que tu ne peux toi-même en être fière :
C’est moi qui l’ai conçue et faite tout entière.
Ainsi, belle œuvre d’art, nos amours ont été
Et seront l’ornement du ciel et de la terre,
O toi, ma créature et ma divinité !
Guillaume APOLLINAIRE.
Toutes les Lyres , 1912Guillaume Apollinaire160 161 §
Nuit rhénane162 §
Mon verre est plein d’un vin trembleur comme une flamme.
Ecoutez la chanson lente d’un batelier
Qui raconte avoir vu, sous la lune, sept femmes
Tordre leurs cheveux verts et longs jusqu’à leurs pieds.
Debout, chantez plus haut en dansant une ronde,
Que je n’entende plus le chant du batelier,
Et mettez près de moi toutes les filles blondes
Au regard immobile, aux nattes repliées.
Le Rhin, le Rhin est ivre, où les vignes se mirent.
Tout l’or des nuits tombe, en tremblant, s’y refléter.
La voix chante toujours, à en râle-mourir,
Ces fées aux cheveux verts qui incantent l’été.
Mon verre s’est brisé comme un éclat de rire.
Honnef, Mai 1902.
Les Colchiques163 §
Le pré est vénéneux mais joli en automne.
Les vaches y paissant lentement s’empoisonnent.
Le colchique couleur de cerne et de lilas
Y fleurit. Tes yeux sont comme cette fleur-là,
Violâtres comme leur cerne et comme cet automne,
Et ma vie pour tes yeux lentement s’empoisonne.
Les enfants de l’école viennent avec fracas,
Vêtus de hoquetons, jouant de l’harmonica.
Ils cueillent les colchiques qui sont comme des mères,
Filles de leurs filles, et sont comme tes paupières
Qui battent, comme les fleurs battent au vent dément.
Le gardien du troupeau chantonne en allemand,
Tandis que lentes et meuglant, les vaches abandonnent
Pour toujours ce grand pré mal fleuri par l’automne.
Neu Glück, Septembre 1901.
Le Vent nocturne164 §
Oh ! les cimes des pins grincent en se heurtant ;
Et l’on entend aussi se lamenter l’autan,
Et, du fleuve prochain, à grand’voix triomphales,
Les elfes rire au vent ou corner aux rafales.
Attys, Attys, Attys, charmant et débraillé,
C’est ton nom qu’en la nuit les elfes ont raillé
Parce qu’un de tes pins s’abat au vent gothique.
La forêt fuit au loin comme une armée antique
Dont les lances, ô pins, s’agitent au tournant.
Les villages éteints méditent maintenant,
Comme les vierges, les vieillards et les poètes,
Et ne s’éveilleront aux pas de nul venant,
Ni quand sur leurs pigeons fondront les gypaètes.
Neu Glück, Octobre 1901.
J’adore un christ de bois qui pâtit sur la route.
Une chèvre attachée à la croix noire broute.
A la ronde les bourgs souffrent la passion
Du Christ dont ma lâtrie aime la fiction.
La chèvre a regardé les hameaux qui défaillent
A l’heure où, fatigués, les hommes qui travaillent
Au verger pâle, au bois plaintif ou dans le champ,
En rentrant tourneront leurs faces au couchant
Embaumé par les foins d’occidental cinname,
Au couchant où, sanglant et rond comme mon âme,
Le grand soleil païen fait mourir, en mourant,
Avec les bourgs lointains, le christ indifférent.
Neu Glück, 1901.
La Tsigane166 §
La Tsigane savait d’avance
Nos deux vies barrées par les nuits.
Nous lui dîmes adieu, et puis…
De ce puits sortit l’Espérance.
L’amour, lourd comme un ours privé,
Dansa debout quand nous voulûmes ;
Et l’oiseau bleu perdit ses plumes
Et les mendiants leurs Ave.
On sait très bien que l’on se damne,
Mais l’espoir d’aimer en chemin
Nous fait penser, main dans la main,
A ce qu’a prédit la Tsigane.
Le Signe de l’Automne167 §
Je suis soumis au Chef du Signe de l’Automne,
Partant, j’aime les fruits, je déteste les fleurs,
Je regrette chacun des baisers que je donne,
Tel un noyer gaulé dit au vent ses douleurs.
Mon Automne éternelle, ô ma saison mentale,
Les mains des amantes d’antan jonchent ton sol,
Une épouse me suit, c’est mon ombre fatale,
Les colombes, ce soir, prennent leur dernier vol…
Les Soirées de Paris , février 1912
Per te præsentit aruspex
169
170
§
O mon très cher amour, toi, mon œuvre et que j’aime
171 ,
A jamais j’allumai le feu de ton regard,
Je t’aime comme j’aime une belle œuvre d’art,
Une noble statue, un magique poème.
Tu seras, mon aimée, un témoin de moi-même.
Je te crée à jamais pour qu’après mon départ,
Tu transmettes mon nom aux hommes en retard
Toi, la vie et l’amour, ma gloire et mon emblème ;
Et je suis soucieux de ta grande beauté
Bien plus que tu ne peux toi-même en être fière :
C’est moi qui l’ai conçue et faite tout entière.
Ainsi, belle œuvre d’art, nos amours ont été
Et seront l’ornement du ciel et de la terre,
O toi, ma créature et ma divinité !
Le Pont Mirabeau172 173 §
Sous le pont Mirabeau coule la Seine.
Et nos amours, faut-il qu’il m’en souvienne ?
La joie venait toujours après la peine.
Vienne la nuit. sonne l’heure,
Les jours s’en vont, je demeure.
Les mains dans les mains, restons face à face
Tandis que sous le pont de nos bras passe
Des éternels regards l’onde si lasse.
Vienne la nuit, sonne l’heure,
Les jours s’en vont, je demeure.
L’amour s’en va comme cette eau courante,
L’amour s’en va ; comme la vie est lente
Et comme l’Espérance est violente !
Vienne la nuit, sonne l’heure,
Les jours s’en vont, je demeure.
Passent les jours et passent les semaines,
Ni temps passé, ni les amours reviennent ;
Sous le pont Mirabeau coule la Seine.
Vienne la nuit, sonne l’heure,
Les jours s’en vont, je demeure.
GUILLAUME APOLLINAIRE .
Les Soirées de Paris , mai 1912Un homme a traversé le désert sans rien boire
Et parvient une nuit sur les bords de la mer
Il a plus soif encore à voir le flot amer
Cet homme est mon désir, la mer est ta victoire.
Tout habillé de bleu quand il a l’âme noire
Au pied d’une potence un beau masque prend l’air
Comme si de l’amour — ce pendu jaune et vert —
Je voulais que brûlât l’horrible main de gloire
176 .
Le pendu, le beau masque et cet homme altéré
Descendent dans l’enfer que je creuse moi-même
Et l’enfer c’est toujours : « Je voudrais qu’elle m’aime. »
Et n’aurais-je jamais une chose à mon gré
Sinon l’amour, du moins une mort aussi belle.
Dis-moi, le savais-tu, que mon âme est mortelle ?
GUILLAUME APOLLINAIRE .
Les Rubriques nouvelles , juin 1912Merlin et la vieille femme177 §
Le soleil ce jour-là, s’étalait comme un ventre
Maternel, qui saignait lentement sur le ciel ;
La lumière est ma mère, ô lumière sanglante !
Les nuages coulaient comme un flux menstruel.
Au carrefour où nulle fleur si non la rose
Des vents, mais sans épine n’a fleuri l’hiver.
Merlin guettait la vie et l’éternelle cause
Qui fait mourir et puis renaître l’univers.
Une vieille, sur une mule à chape verte,
S’en vînt, suivant la berge du fleuve, en aval,
Et l’antique Merlin dans la plaine déserte
Se frappait la poitrine en s’écriant : « Rival !
« O mon être glacé dont le destin m’accable,
« Dont ce soleil de chair grelotte, veux-tu voir,
« Ma mémoire venir et m’aimer, ma semblable,
« Et quel fils malheureux et beau je veux avoir ? »
Son geste fit crouler l’orgueil des cataclysmes,
Le soleil en dansant remuait son nombril
Et soudain le printemps d’amour et d’héroïsme
Amena par la main un jeune jour d’avril.
Les voies qui viennent de l’ouest étaient couvertes
D’ossements, d’herbes drues, de destinées et de fleurs,
De monuments tremblants, et de charognes vertes,
Quand les vents apportaient des joies et des malheurs.
Laissant sa mule, à petits pas, s’en vint l’amante ;
A petits coups, le vent défripait ses atours.
Puis les pâles amants joignant leurs mains démentes
L’entrelaces de leurs doigts fut leur seul laps d’amour.
Elle balla, mimant un rythme d’existence,
Criant : « Depuis cent ans j’espérais ton appel.
« Les astres de ta vie influaient sur ma danse ;
« Morgane regardait du haut du mont Gibel.
« Ah ! qu’il fait doux danser quand pour vous se déclare
« Un mirage, incertain et que les vents d’horreur
« Feignent d’être le rire de la lune hilare
« Et d’effrayer les fantômes avant-coureurs.
« J’ai fait des gestes blancs parmi les solitudes,
« Des lémures couraient peupler les cauchemars.
« Mes tournoiements exprimaient les béatitudes
« Qui toutes ne sont rien qu’un pur effet de l’Art.
« Je n’ai jamais cueilli que la fleur d’aubépine,
« Aux printemps finissants qui voulaient défleurir,
« Quand les oiseaux de proie proclamaient leurs rapines
« D’agneaux mort nés et d’enfants-dieux qui vont mourir.
« Et j’ai vieilli, vois-tu, pendant ta vie, je danse,
« Mais, j’eusse été tôt lasse et l’aubépine en fleur
« Cet avril aurait eu la pauvre confidence
« D’un corps de vieille morte en mimant la douleur. »
……………………………………………………………….
Et leurs mains s’élevaient comme un vol de colombes,
Clarté sur qui la nuit fondit comme un vautour.
Puis, Merlin s’en alla vers l’est, disant : « Qu’il monte
« Le fils de la Mémoire, égale de l’amour.
« Qu’il monte de la fange ou soit une ombre d’homme
« Il sera bien mon fils, mon ouvrage immortel
« Le front nimbé de feu, sur le chemin de Rome
« Il marchera tout seul en regardant le ciel.
« La dame qui m’attend se nomme Viviane
« Et vienne le printemps des nouvelles douleurs.
« Couché parmi la marjolaine et les pas d’ânes,
« Je m’éterniserai sous l’aubépine en fleurs.
Guillaume Apollinaire .
Les Soirées de Paris , juillet 1912
Rosemonde179 §
Longtemps au pied du perron de
La maison où entra la dame
Que j’avais suivie pendant deux
Bonnes heures à Amsterdam
Mes doigts jeterent des baisers
Mais le canal était désert
Le quai aussi et nul ne vit
Comment mes baisers retrouvèrent
Celle à qui j’ai donné ma vie
Un jour pendant plus de deux heures.
Je la surnommai Rosemonde
Voulant pouvoir me rappeler
Sa bouche fleurie en Hollande
Puis lentement je m’en allai
Pour quêter la Rose du Monde.
Marie-Sibylle180 §
Dans la haute rue, à Cologne,
Elle allait et venait le soir,
Offerte à tous, en tout mignonne
Puis buvait, lasse des trottoirs,
Très tard, dans des brasseries borgnes.
Elle se mettait sur la paille
Pour un maquereau roux et rose,
C’était un Juif, il sentait l’ail
Et l’avait, venant de Formose,
Tirée d’un bordel de Shangaï.
Je connais gens de toutes sortes,
Ils n’égalent pas leurs destins,
Indécis comme feuilles mortes
Leurs yeux sont des feux mal éteints,
Leurs cœurs bougent comme leurs portes.
Clotilde181 §
L’anémone et l’ancolie
Ont pourri dans le jardin
Où dort la Mélancolie
Entre l’Amour et le Dédain.
Il y vient aussi nos ombres
Que la nuit dissipera,
Le soleil qui les rend sombres
Avec elles disparaîtra.
Les déités des eaux vives
Laissent couler leurs cheveux…
Passe ! Il faut que tu poursuives
Cette belle ombre que tu veux.
GUILLAUME APOLLINAIRE .
Les Soirées de Paris , septembre 1912
Le Voyageur183 §
Ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant !
La vie est variable aussi bien que l’Euripe.
Tu regardais le banc des nuages descendre
Avec le paquebot orphelin vers les fièvres futures,
Et de tous ces regrets, de tous ces repentirs
Te souviens-tu ?
Vagues, poissons arqués, fleurs surmarines !
Une nuit, c’était la mer
Et les fleuves s’y répandaient.
Je m’en souviens, je m’en souviens encore.
Un soir je descendis dans une auberge triste
Auprès de Luxembourg :
Dans le fond de la salle il s’envolait un Christ.
Quelqu’un avait un furet,
Un autre un hérisson,
L’on jouait aux cartes,
Et toi, tu m’avais oublié.
Te souviens-tu du long orphelinat des gares ?
Nous trouvâmes des villes qui tout le jour tournaient
Et vomissaient la nuit le soleil des journées.
O matelots, ô femmes sombres, et vous, mes compagnons
Souvenez-vous-en.
Deux matelots qui ne s’étaient jamais quittés,
Deux matelots qui ne s’étaient jamais parlé,
Le plus jeune en mourant tomba sur le côté.
Chers compagnons :
Sonneries électriques des gares, chant des moissonneurs
Traîneau d’un boucher, régiment des rues sans nombre
Cavalerie des ponts, nuits livides de l’alcool,
Les villes que j’ai vues vivaient comme des folles
Te souviens-tu des banlieues et du troupeau plaintif des paysages ?
Les cyprès projetaient sous la lune leurs ombres ;
J’écoutais cette nuit, au déclin de l’été,
Un oiseau langoureux et toujours irrité
Et le bruit éternel d’un fleuve large et sombre
Mais tandis que, mourants, roulaient vers l’estuaire
Tous les regards, tous les regards de tous les yeux
Les bords étaient déserts, herbus, silencieux
Et la montagne à l’autre rive était très claire.
Alors sans bruit, sans qu’on pût voir rien de vivant,
Contre le mont passèrent des ombres vivaces,
De profil ou soudain tournant leurs vagues faces
Et tenant l’ombre de leurs lances en avant.
Les ombres, contre le mont perpendiculaire,
Grandissaient ou parfois s’abaissaient brusquement,
Et ces ombres barbues pleuraient humainement
En glissant pas à pas sur la montagne claire.
Qui donc reconnais-tu sur ces vieilles photographies ?
Te souviens-tu du jour où une abeille tomba dans le feu ?
C’était, tu t’en souviens, à la fin de l’été.
Deux matelots qui ne s’étaient jamais quittés :
L’aîné portait au cou une chaîne de fer,
Le plus jeune mettait ses cheveux blonds en tresse.
Ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant !
La vie est variable aussi bien que l’Euripe.
Sur la côte du Texas,
Entre Mobile et Galveston, il y a
Un grand jardin tout plein de roses ;
Il contient aussi une villa
Qui est une grande rose.
Une femme se promène souvent
Dans le jardin toute seule,
Et quand je passe sur la route, bordée de tilleuls,
Nous nous regardons.
Comme cette femme est mennonite
Ses rosiers et ses vêtements n’ont pas de boutons,
Il en manque trois à mon veston,
La dame et moi suivons le même rite…
Cors de chasse185 §
Notre histoire est noble et tragique
Comme le masque d’un tyran.
Nul drame hasardeux ou magique,
Aucun détail indifférent
Ne rend notre amour pathétique.
Et Thomas de Quincey buvant
L’opium poison doux et chaste
A sa pauvre Anne allait rêvant.
Passons, passons, puisque tout passe,
Je me retournerai souvent.
Les souvenirs sont cors de chasse
Dont meurt le bruit parmi le vent.
GUILLAUME APOLLINAIRE.
Les Soirées de Paris , octobre 1912 Vous y dansiez, petite fille,
Y danserez-vous. mère-grand !
187 C’est la màclotte qui sautille,
188 Toutes les cloches sonneront.
Quand donc reviendrez-vous, Marie ?
Les masques sont silencieux
Et la musique est si lointaine
Qu’elle semble venir des cieux.
Oui, je veux vous aimer, mais vous aimer à peine
Et mon mal est délicieux.
Les brebis s’en vont dans la neige,
Flocons de laine et cieux d’argent,
Des soldats passent et que n’ai-je
Un cœur à moi, ce cœur changeant,
Changeant et puis encore que sais-je !
Sais-je où s’en iront tes cheveux
Crépus comme mer qui montonne ?
189 Sais-je où s’en iront tes cheveux
Et tes mains, feuilles de l’automne
Que jonchent aussi nos aveux ?
Je passais au bord de la Seine,
Un livre ancien sous le bras.
Le fleuve est pareil à ma peine,
Il s’écoule et ne tarit pas
Quand donc finira la semaine !
GUILLAUME APOLLINAIRE.
Vers et Prose , octobre-novembre-décembre 1912Poèmes §
Le Larron190 §
Maraudeur étranger malheureux malhabile
Voleur voleur que ne demandais-tu ces fruits
Mais puisque tu as faim que tu es en exil
Il pleure il est barbare et bon pardonnez-lui
Je confesse le vol des fruits doux des fruits mûrs
Mais ce n’est pas l’exil que je viens simuler
Et sachez que j’attends de moyennes tortures
Injustes si je rends tout ce que j’ai volé
Issu de l’écume des mers comme Aphrodite
Sois docile puisque tu es beau naufragé
Vois les sages te font des gestes socratiques
Vous parlerez d’amour quand il aura mangé
Maraudeur étranger malhabile et malade
Ton père fut un sphinx et ta mère une nuit
Qui charma de lueurs Zacinthe et les Cyclades
As-tu feint d’avoir faim quand tu volas les fruits
Possesseurs de fruits mûrs que dirai-je aux insultes
Ouïr ta voix ligure en nénie ô maman
Puisqu’ils n’eurent enfin la pubère et l’adulte
De prétexte sinon que s’aimer nuitamment
Il y avait des fruits tout ronds comme des âmes
Et des amandes de pomme de pin jonchaient
Votre jardin marin où j’ai laissé mes rames
Et mon couteau punique au pied de ce pêcher
Les citrons couleur d’huile et à saveur d’eau froide
Pendaient parmi les fleurs des citronniers tordus
Les oiseaux de leur bec ont blessé vos grenades
Et presque toutes les figues étaient fendues
Il entra dans la salle aux fresques qui figurent
L’inceste solaire et nocturne dans les nues
Assieds-toi là pour mieux ouïr les voix ligures
Au son des cinyres des Lydiennes nues
Or les hommes ayant des masques de théâtre
Et les femmes ayant des colliers où pendait
La pierre prise au foie d’un vieux coq de Tanagre
Parlaient entre eux le langage de la Chaldée
Les autans langoureux dehors feignaient l’automne
Les convives c’étaient tant de couples d’amants
Qui dirent tour à tour Voleur je te pardonne
Reçois d’abord le sel puis le pain de froment
Le brouet qui froidit sera fade à tes lèvres
Mais l’outre en peau de bouc maintient frais le vin blanc
Par ironie veux-tu qu’on serve un plat de fèves
Ou des beignets de fleurs trempés dans du miel blond
Une femme lui dit Tu n’invoques personne
Crois-tu donc au hasard qui coule au sablier
Voleur connais-tu mieux les lois malgré les hommes
Veux-tu le talisman heureux de mon collier
Larron des fruits tourne vers moi tes yeux lyriques
Emplissez de noix la besace du héros
Il est plus noble que le paon pythagorique
Le dauphin la vipère mâle ou le taureau
*
Qui donc es-tu toi qui nous vins grâce au vent scythe
Il en est tant venu par la route ou la mer
Conquérants égarés qui s’éloignent trop vite
Et des bandes souvent qui fuyaient aux éclairs
Un homme bègue ayant au front deux jets de flammes
Passa menant un peuple infime pour l’orgueil
De manger chaque jour les cailles et la manne
Et d’avoir vu la mer ouverte comme un œil
Les puiseurs d’eau barbus coiffés de bandelettes
Noires et blanches contre les maux et les sorts
Revenaient de l’Euphrate et les yeux des chouettes
Attiraient quelquefois les chercheurs de trésors
Cet insecte jaseur ô poète barbare
Regagnait chastement à l’heure d’y mourir
La forêt précieuse aux oiseaux gemmipares
Aux crapauds que l’azur et les sources mûrirent
Un triomphe passait gémir sous l’arc-en-ciel
Avec de blêmes laurés debout dans les chars
Les statues suant les scurriles les agnelles
Et l’angoisse rauque des paonnes et des jars
Les veuves précédaient en égrenant des grappes
Les évêques noirs révérant sans le savoir
Au triangle isocèle ouvert au mors des chapes
Pallas et chantaient l’hymne à la belle mais noire
Les chevaucheurs nous jetèrent dans l’avenir
Les alcancies pleines de cendre ou bien de fleurs
Nous aurons des baisers florentins sans le dire
Mais au jardin ce soir tu vins sage et voleur
*
Ceux de ta secte adorent-ils un signe obscène
Belphégor le soleil le silence ou le chien
Cette furtive ardeur des serpents qui s’entr’aiment
Et le larron des fruits cria Je suis chrétien
Ah Ah les colliers tinteront cherront les masques
Va-t’en va-t’en contre le feu l’ombre prévaut
Ah Ah le larron de gauche dans la bourrasque
Rira de toi comme hennissent les chevaux
Larron des fruits tourne vers moi tes yeux lyriques
Emplissez de noix la besace du héros
Il est plus noble que le paon pythagorique
Le dauphin la vipère mâle ou le taureau
Ah Ah nous secouerons toute la nuit les sistres
La voix ligure était-ce donc un talisman
Et si tu n’es pas ne droite tu es sinistre
Comme une tache grise ou le pressentiment
Puisque l’absolu choit la chute est une preuve
Qui double devient triple avant d’avoir été
Nous avouons que les grossesses nous émeuvent
Les ventres pourront seuls nier l’aséité
Vois les vases sont pleins d’humides fleurs morales
Va-t’en mais dénudé puisque tout est à nous
Ouïs du chœur des vents les cadences plagales
Et prends l’arc pour tuer l’unicorne ou le gnou
L’ombre équivoque et tendre est le deuil de ta chair
Et sombre elle est humaine et puis la nôtre aussi
Va-t’en le crépuscule a des lueurs légères
Et puis aucun de nous ne croirait tes récits
Il brillait et attirait comme la pantaure
Que n’avait-il la voix et les jupes d’Orphée
Et les femmes la nuit feignant d’être des taures
L’eussent aimé comme on l’aima puisqu’en effet
Il était pâle il était beau comme un roi ladre
Que n’avait-il la voix et les jupes d’Orphée
La pierre prise au foie d’un vieux coq de Tanagre
Au lieu du roseau triste et du funèbre faix
Que n’alla-t-il vivre à la cour du roi d’Edesse
Maigre et magique il eût scruté le firmament
Pâle et magique il eût aimé des poétesses
Juste et magique il eût épargné les démons
Va-t’en errer crédule et roux avec ton ombre
Soit la triade est mâle et tu es vierge et froid
Le tact est relatif mais la vue est oblongue
Tu n’as de signe que le signe de la croix
Vouons le vol à Sparte et l’inceste à Ninive
Nous rentrerons demain à l’école d’Elée
Qu’on souffle les flambeaux à cause des convives
Qui se fiant au Bègue ont peur d’être brûlés
Dans le palais de Rosemonde191 §
Vers le palais de Rosemonde au fond du Rêve
Mes rêveuses pensées pieds nus vont en soirée
Le palais don du roi comme un roi nu s’élève
Des chairs fouettées des roses de la roseraie
On voit venir au fond du jardin mes pensées
Qui sourient du concert joué par les grenouilles
Elles ont envie des cyprès grandes quenouilles
Et le soleil miroir des roses s’est brisé
Le stigmate sanglant des mains contre les vitres
Quel archer mal blessé du couchant le troua
La résine qui rend amer le vin de Chypre
Ma bouche aux agapes d’agneau blanc l’éprouva
Sur les genoux pointus du monarque adultère
Sur le mai de son âge et sur son trente et un
Madame Rosemonde roule avec mystère
Ses petits yeux tout ronds pareils aux yeux des Huns
Dame de mes pensées au cul de perle fine
Dont ni perle ni cul n’égale l’Orient
Qui donc attendez-vous Mes plus belles voisines
De rêveuses pensées en marche à l’Orient
Toc toc Entrez dans l’antichambre Le jour baisse
La veilleuse dans l’ombre est un bijou d’or cuit
Pendez vos têtes aux patères par les tresses
Le ciel presque nocturne a des lueurs d’aiguilles
On entra dans la salle à manger les narines
Reniflaient une odeur de graisse et de graillon
On eut vingt potages dont trois couleur d’urine
Et le roi prit deux œufs pochés dans du bouillon
Puis les marmitons apportèrent les viandes
Des rôtis de pensées mortes dans mon cerveau
Mes beaux rêves mort-nés en tranches bien saignantes
Et mes souvenirs faisandés en godiveaux
Or ces pensées mortes depuis des millénaires
Avaient le fade goût des grands mammouths gelés
Les os ou songe-creux venaient des ossuaires
En danse macabre aux plis de mon cervelet
Et tous ces mets criaient des choses non pareilles
Mais nom de Dieu
Ventre affamé n’a pas d’oreilles
Et les convives mastiquaient à qui mieux mieux
Ah nom de Dieu qu’ont donc crié ces entrecôtes
Ces grands pâtés os à la moelle et mirotons
Langues de feu où sont-elles mes pentecôtes
Pour mes pensées de tous pays de tous les temps
La Porte192 §
La porte de l’hôtel sourit terriblement
Qu’est-ce que cela peut me faire ô ma maman
D’être cet employé pour qui seul rien n’existe
Pi-mus couples allant dans la profonde eau triste
Anges frais débarqués à Marseille hier matin
J’entends mourir et remourir un chant lointain
Humble comme je suis qui ne suis rien qui vaille
Enfant je t’ai donné ce que j’avais travaille
Vous y dansiez petite fille
Y danserez-vous mère grand
C’est la Marlotte qui sautille
Toutes les cloches sonneront
Quand donc reviendrez-vous Marie
Les masques sont silencieux
Et la musique est si lointaine
Qu’elle semble venir des cieux
Oui je veux vous aimer mais vous aimer à peine
Et mon mal est délicieux
Les brebis s’en vont dans la neige
Flocons de laine et ceux d’argent
Des soldats passent et que n’ai-je
Un cœur à moi ce cœur changeant
Changeant et puis encor que sais-je
Sais-je où s’en iront tes cheveux
Crêpus comme mer qui moutonne
Sais-je où s’en iront tes cheveux
Et tes mains feuilles de l’automne
Que jonchent aussi nos aveux
Je passais au bord de la Seine
Un livre ancien sous le bras
Le fleuve est pareil à ma peine
Il s’écoule et ne tarit pas
Quand donc finira la semaine
J’ai cueilli ce brin de bruyère
L’automne est morte souviens-t’en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t’attends
Toc toc Il a fermé sa porte
Les lis du jardin sont flétris
Quel est donc ce mort qu’on emporte
Tu viens de toquer à sa porte
Et trotte trotte
Trotte la petite souris
GUILLAUME APOLLINAIRE
Poème & Drame , novembre 1912Oiseau tranquille au vol inverse, oiseau
Qui nidifie en l’air,
A la limite où notre sol brille déjà,
Baisse ta deuxième paupière, la terre t’éblouit
Quand tu lèves la tête.
Et moi aussi de près, je suis sombre et terne,
Une brume qui vient d’obscurcir les lanternes,
Une main qui tout à coup, se pose devant les yeux,
Une voûte entre vous et toutes les lumières
Et je m’éloignerai, m’illuminant au milieu d’ombres
Et d’alignements d’yeux des astres bien-aimés.
Oiseau tranquille, au vol inverse, oiseau
Qui nidifie en l’air,
A la limite où brille déjà ma mémoire,
Baisse ta deuxième paupière
Ni à cause du soleil, ni à cause de la terre,
Mais pour ce feu oblong dont l’intensité ira s’augmentant
Au point qu’il deviendra un jour l’unique lumière.
Un jour,
Un jour je m’attendais moi-même,
Je me disais, Guillaume, il est temps que tu viennes
Pour que je sache enfin celui-là que je suis,
Moi qui connais les autres.
Je les connais par les cinq sens et quelques autres.
Il me suffit de voir leurs pieds pour pouvoir refaire ces gens à milliers.
De voir leurs pieds paniques, un seul de leurs cheveux,
Ou leur langue quand il me plaît de faire le médecin,
Ou leurs enfants quand il me plaît de faire le prophète,
Les vaisseaux des armateurs, la plume de mes confrères,
La monnaie des aveugles, les mains des muets,
Ou bien encore, à cause du vocabulaire et non à cause de l’écriture,
Une lettre écrite par ceux qui ont vingt ans et au-dessus.
Il me suffit de sentir l’odeur de leurs églises,
L’odeur des fleuves dans leurs villes,
Le parfum des fleurs dans les jardins publics,
L’odeur d’un petit chien, ô Corneille Agrippa, m’eût suffi
Pour décrire exactement tes concitoyens de Cologne,
Leurs rois-mages et la ribambelle ursuline
Qui t’inspirait l’erreur touchant toutes les femmes.
Il me suffit de goûter la saveur du laurier qu’on cultive
Pour que j’aime ou que je baffoue,
Et de toucher les vêtements
Pour ne pas douter si l’on est frileux ou non
O gens que je connais,
Il me suffit d’entendre le bruit de leurs pas
Pour pouvoir indiquer à jamais la direction qu’ils ont prise.
Il me suffit de tous ceux-là pour me croire le droit
De ressusciter les autres. Un jour je m’attendais moi-même.
Je me disais, Guillaume, il est temps que tu viennes,
Et d’un lyrique pas s’avançaient ceux que j’aime
Parmi lesquels je n’étais pas.
Les géants couverts d’algues passaient dans leurs villes
Sous-marines où les tours seules étaient des îles.
Et cette mer avec les clartés de ses profondeurs
Coulait, sang de mes veines et fait battre mon cœur.
Puis, sur terre il venait mille peuplades blanches
Dont chaque homme tenait une rose à la main
Et le langage qu’ils inventaient en chemin
Je l’appris de leur bouche et je le parle encore.
Le cortège passait et j’y cherchais mon corps,
Tous ceux qui survenaient et n’étaient pas moi-même,
Amenaient un à un les morceaux de moi-même,
On me bâtit peu à peu comme on élève une tour,
Les peuples s’entassaient, puis je parus moi-même
Qu’ont formé tous les corps et les choses humaines.
Temps passés, trépassés, les dieux qui me formâtes
Je ne vis que passant ainsi que vous passâtes
Et détournant mes yeux de ce vide avenir
En moi-même je vois tout le Passé grandir.
Rien n’est mort que ce qui n’existe pas encore
Près du passé luisant demain est incolore,
Il est informe aussi près de ce qui parfait
Présente tout ensemble et l’effort et l’effet.
GUILLAUME APOLLINAIRE
Les Soirées de Paris , novembre 1912Vendémiaire197 §
Hommes de l’avenir souvenez-vous de moi
Je vivais à l’époque où finissaient les rois
Tour à tour ils mouraient silencieux et tristes
Et trois fois courageux devenaient trismégistes
Que Paris était beau à la fin de septembre
Chaque nuit devenait une vigne où les pampres
Répandaient leur clarté sur la ville et là-haut
Astres mûrs becquetés par les ivres oiseaux
De ma gloire attendaient la vendange de l’aube
Un soir passant le long des quais déserts et sombres
En rentrant à Auteuil j’entendis une voix
Qui chantait gravement se taisant quelquefois
Pour que parvînt aussi sur les bords de la Seine
La plainte d’autres voix limpides et lointaines
Et j’écoutai longtemps tous ces chants et ces cris
Qu’éveillait dans la nuit la chanson de Paris
J’ai soif villes de France et d’Europe et du monde
Venez toutes couler dans ma gorge profonde
Je vis alors que déjà ivre dans la vigne Paris
Vendangeait le raisin le plus doux de la terre
Ces grains miraculeux qui aux treilles chantèrent
Et Rennes répondit avec Quimper et Vannes
Nous voici ô Paris nos maisons nos habitants
Ces grappes de nos sens qu’enfanta le soleil
Se sacrifient pour te désaltérer trop avide merveille
Nous t’apportons tous les cerveaux les cimetières les murailles
Ces berceaux pleins de cris que tu n’entendras pas
Et d’amont en aval nos pensées ô rivières
Les oreilles des écoles et nos mains rapprochées
Aux doigts allongés nos mains les clochers
Et nous t’apportons aussi cette souple raison
Que le mystère clot comme une porte la maison
Ce mystère courtois de la galanterie
Ce mystère fatal fatal d’une autre vie
Double raison qui est au delà de la beauté
Et que la Grèce n’a pas connue ni l’Orient
Double raison de la Bretagne où lame à lame
L’océan châtre peu à peu l’ancien continent
Et les villes du Nord répondirent gaiement
O Paris nous voici boissons vivantes
Les viriles cités où dégoisent et chantent
Les métalliques saints de nos saintes usines
Nos cheminées à ciel ouvert engrossent les nuées
Comme fit autrefois l’Ixion mécanique
Et nos mains innombrables
Usines manufactures fabriques mains
Oui mains où les ouvriers nus semblables à nos doigts
Fabriquent du réel à tant par heure
Nous te donnons tout cela
Et Lyon répondit tandis que les anges de Fourvières
Tissaient un ciel nouveau avec la soie des prières
Désaltère-toi Paris avec les divines paroles
Que mes lèvres le Rhône et la Saône murmurent
Toujours le même culte de sa mort renaissant
Divise ici les saints et fait pleuvoir le sang
Heureuse pluie ô gouttes tièdes ô douleur
Un enfant regarde les fenêtres s’ouvrir
Et des grappes de têtes à d’ivres oiseaux s’offrir
Les villes du Midi répondirent alors
Noble Paris seule raison qui vis encore
Qui fixes notre humeur selon ta destinée
Et toi qui te retires Méditerranée
Partagez-vous nos corps comme on rompt les hosties
Ces très-hautes amours et leur danse orpheline
Deviendront à Paris le vin pur que tu aimes
Et un râle infini qui venait de Sicile
Signifiait en battement d’ailes ces paroles
Les raisins de nos vignes on les a vendangés
Et ces grappes de morts dont les grains allongés
Ont la saveur du sang de la terre et du sel
Les voici pour ta soif ô Paris sous le ciel
Obscurci de nuées faméliques
Que caresse Ixion le créateur oblique
Et où naissent sur la mer tous les corbeaux d’Afrique
O raisins et ces yeux ternes et en famille
L’avenir et la vie dans ces treilles s’ennuyent
Mais où est le regard lumineux des sirènes
Il trompa les marins qu’aimaient ces oiseaux-là
Il ne tournera plus sur l’écueil de Scylla
Où chantaient les trois voix suaves et sereines
Le détroit tout-à-coup avait changé de face
Visages de la chair de l’onde de tout
Ce que l’on peut imaginer
Vous n’êtes que des masques sur des faces masquées
Il souriait jeune nageur entre les rives
Et les noyés flottant sur son onde nouvelle
Fuyaient en le suivant les chanteuses plaintives
Elles dirent adieu au gouffre et à l’écueil
A leurs pâles époux couchés sur les terrasses
Puis ayant pris leur vol vers le brûlant soleil
Les suivirent dans l’onde où s’enfoncent les astres
Lorsque la nuit revint couverte d’yeux ouverts
Errer au site où l’hydre a sifflé et hiver
198 Et j’entendis soudain ta voix impérieuse
O Rome
Maudire d’un seul coup mes anciennes pensées
Et ce ciel où l’amour guide les destinées
Les feuillards repoussés sur l’arbre de la croix
Et même la fleur de lys qui meurt au Vatican
Macèrent dans le vin que je t’offre et qui a
La saveur du sang pur de celui qui connaît
Une autre liberté végétale dont tu
Ne sais pas que c’est elle la suprême vertu
Une couronne du trirègne est tombée sur les dalles
Les hiérarques la foulent sous leurs sandales
O splendeur démocratique qui pâlit
Vienne la nuit royale où l’on tuera les bêtes
La louve avec l’agneau l’aigle avec la colombe
Une foule de rois ennemis et cruels
Ayant soif comme toi dans la vigne éternelle
Sortiront de la terre et viendront dans les airs
Pour boire de mon vin par deux fois millénaire
La Moselle et le Rhin se joignent en silence
C’est l’Europe qui prie nuit et jour à Coblence
Et moi qui m’attardais sur le quai à Auteuil
Quand les heures tombaient parfois comme les feuilles
Du cep lorsqu’il fut temps j’entendis la prière
Qui joignait la limpidité de ces rivières
Le vin de ton pays est meilleur que celui
Qui pousse sur nos bords mais aux pampres du Nord
Tous les grains ont mûri pour cette soif terrible
Mes grappes d’hommes forts saignent dans le pressoir
Tu boiras à longs traits tout le sang de l’Europe
Parce que tu es beau et que seul tu es noble
Parce que c’est dans toi que Dieu peut devenir
Et tous mes vignerons dans ces belles maisons
Qui reflètent le soir leurs feux dans nos deux eaux
Dans ces belles maisons nettement blanches et noires
Sans savoir que tu es la réalité chantent ta gloire
Mais nous liquides mains jointes pour la prière
Nous menons vers le sel les eaux aventurières
Et la ville entre nous comme entre des ciseaux
Ne reflète en dormant nul feu dans ses deux eaux
Dont quelque sifflement lointain parfois s’élance
Troublant dans leur sommeil les filles de Coblence
Les villes répondaient maintenant par centaines
Je ne distinguais plus leurs paroles lointaines
Et Trèves la ville ancienne
A leur voix mêlait la sienne
L’univers tout entier concentré dans ce vin
Qui contenait les mers les animaux les plantes
Les cités les destins et les astres qui chantent
Les hommes à genoux sur la rive du ciel
Et le docile fer notre bon compagnon
Le feu qu’il faut aimer comme on s’aime soi-même
Tous les fiers trépassés qui sont un sous mon front
L’éclair qui luit ainsi qu’une pensée naissante
Tous les noms six par six les nombres un à un
Des kilos de papier tordus comme des flammes
Et ceux-là qui sauront blanchir nos ossements
Les bons vers immortels qui s’ennuient patiemment
Des armées rangées en bataille
Des forêts de crucifix et mes demeures lacustres
Au bord des yeux de celle que j’aime tant
Les fleurs qui s’écrient hors de bouches
Et tout ce que je ne sais pas dire
Tout ce que je ne connaitrai jamais
Tout cela tout cela changé en ce vin pur
Dont Paris avait soif
Me fut alors présenté
Actions belles journées sommeils terribles
Végétation accouplements musiques éternelles
Mouvements adorations douleur divine
Mondes qui vous ressemblez et qui nous ressemblez
Je vous ai bu et ne fus pas désaltéré
Mais je connus dès lors quelle saveur a l’univers
Je suis ivre d’avoir bu tout l’univers
Sur le quai d’où je voyais l’onde couler et dormir les bélandres
Ecoutez mes chants d’universelle ivrognerie
Et la nuit de septembre s’achevait lentement
Les feux rouges des ponts s’éteignaient dans la Seine
Les étoiles mouraient le jour naissait à peine
GUILLAUME APOLLINAIRE
Anthologie des poètes nouveaux , novembre 1912Guillaume Apollinaire199 200 §
L’Émigrant de Landor Road201 §
Le chapeau à la main, il entra, du pied droit
Chez un tailleur très chic et fournisseur du roi.
Ce commerçant venait de couper quelques têtes
De mannequins vêtus comme il faut qu’on se vête.
La foule, en tous les sens, remuait en mêlant
Des ombres sans amour qui se traînaient par terre
Et des mains, vers le ciel plein de lacs de lumière,
S’envolaient quelquefois comme des oiseaux blancs :
« Mon bateau partira demain pour l’Amérique
Et je ne reviendrai jamais.
Avec l’argent gagné dans les prairies lyriques,
Guider mon ombre aveugle en ces rues que j’aimais ;
Car revenir, c’est bon pour un soldat des Indes !
Les boursiers ont vendu tous mes crachats d’or fin ;
Mais, habillé de neuf, je veux dormir enfin
Sous des arbres pleins d’oiseaux muets et de singes. »
Les mannequins, pour lui, s’étant déshabillés,
Battirent leurs habits, puis les lui essayèrent.
Le vêtement d’un lord mort sans avoir payé,
Au rabais, l’habilla comme un millionnaire.
Au-dehors, les années
Regardaient la vitrine,
Les mannequins victimes,
Et passaient enchaînées.
Intercalées dans l’an, c’étaient les journées veuves,
Les vendredis sanglants et lents d’enterrements.
Des blancs et de tout noirs, vaincus des cieux qui pleuvent
Quand la femme du diable a battu son amant.
Puis, dans un port d’automne aux feuilles indécises,
Quand les mains de la foule y feuillolaient aussi,
Sur le pont du vaisseau, il posa sa valise,
Et s’assit.
Les vents de l’Océan en soufflant leurs menaces,
Laissaient dans ses cheveux de longs baisers mouillés.
Des émigrants tendaient, vers le port, leurs mains lasses
Et d’autres, en pleurant, s’étaient agenouillés.
Il regarda longtemps les rives qui moururent.
Seuls, des bateaux d’enfant tremblaient à l’horizon.
Un tout petit bouquet, flottant à l’aventure,
Couvrit l’Océan, d’une immense floraison.
Il aurait voulu ce bouquet, comme la gloire,
Jouer dans d’autres mers parmi tous les dauphins,
Et l’on tissait, dans sa mémoire,
Une tapisserie sans fin
Qui figurait son histoire.
Mais pour noyer, comme des poux,
Ces tisseuses têtues qui, sans cesse, interrogent,
Il se maria comme un doge,
Aux cris d’une sirène moderne, sans époux.
Gonfle-toi vers la nuit, ô mer ! Les yeux des squales
Jusqu’à l’aube ont guetté, de loin, avidement,
Des cadavres de jours rongés par les étoiles,
Parmi le bruit des flots et des derniers serments.
La Maison des Morts202 §
S’étendant sur les côtés du cimetière,
La Maison des Morts l’encadrait comme un cloître
A l’intérieur de ses vitrines
Pareilles à celles des boutiques de modes,
Au lieu de sourire debout,
Les mannequins grimaçaient pour l’éternité.
Arrivé à Munich depuis quinze ou vingt jours,
J’étais entré pour la première fois,
Et par hasard,
Dans ce cimetière presque désert,
Et je claquais des dents
Devant toute cette bourgeoisie
Exposée et vêtue le mieux possible
En attendant la sépulture,
Soudain,
Rapide comme ma mémoire.
Les yeux se rallumèrent
De cellule vitrée en cellule vitrée,
Le ciel se peupla d’une apocalypse
Vivace
Et la terre, plate à l’infini
Comme avant Galilée,
Se couvrit de mille mythologies immobiles.
Un ange en diamant brisa toutes les vitrines
Et les morts m’accostèrent
Avec des mines de l’autre monde.
Mais leur visage et leurs attitudes
Devinrent bientôt moins funèbres.
Le ciel et la terre perdirent
Leur aspect fantasmagorique.
Les morts se réjouissaient
De voir leurs corps trépassés entre eux et la lumière.
Ils riaient de leur ombre et l’observaient
Comme si véritablement
C’eût été leur vie passée.
Alors, je les dénombrai.
Ils étaient quarante-neuf hommes.
Femmes et enfants
Qui embellissaient à vue d’œil
Et me regardaient maintenant
Avec tant de cordialité,
Tant de tendresse même,
Que les prenant en amitié
Tout à coup,
Je les invitai à une promenade
Loin des arcades de leur Maison.
Et tous bras dessus, bras dessous,
Fredonnant des airs militaires,
(Oui, tous vos péchés sont absous)
Nous quittâmes le cimetière.
Nous traversâmes la ville
Et rencontrions souvent
Des parents, des amis qui se joignaient
A la petite troupe des morts récents.
Tous étaient si gais,
Si charmants, si bien portants
Que bien malin qui aurait pu
Distinguer les morts des vivants.
Puis, dans la campagne,
On s’éparpilla.
Deux chevau-légers nous rejoignirent.
On leur fit fête.
Ils coupèrent du bois de viorne
Et de sureau
Dont ils firent des sifflets
Qu’ils distribuèrent aux enfants.
Plus tard, dans un bal champêtre,
Les couples, mains sur les épaules,
Dansèrent au son aigre des cithares.
Ils n’avaient pas oublié la danse,
Ces morts et ces mortes :
On buvait aussi,
Et, de temps à autre, une cloche
Annonçait qu’un nouveau tonneau
Allait être mis en perce.
Une morte, assise sur un banc,
Près d’un buisson d’épine-vinette,
Laissait un étudiant
Agenouillé à ses pieds,
Lui parler de fiançailles :
‒ Je vous attendrai
Dix ans, vingt ans s’il le faut.
Votre volonté sera la mienne.
‒ Je vous attendrai
Toute votre vie…
Répondait la morte.
Des enfants
De ce monde ou bien de l’autre
Chantaient de ces rondes
Aux paroles absurdes et lyriques
Qui, sans doute, sont les restes
Des plus anciens monuments
Poétiques
De l’humanité.
L’étudiant passa une bague
A l’annulaire de la jeune morte :
Voici le gage de mon amour,
De nos fiançailles.
Ni le temps, ni l’absence
Ne nous feront oublier nos promesses.
Et un jour, nous aurons une belle noce,
Des touffes de myrte
A nos vêtements et dans vos cheveux.
Un beau sermon à l’église,
De longs discours après le banquet
Et de la musique,
De la musique.
‒ Nos enfants, dit la fiancée,
Seront plus beaux, plus beaux encore,
Hélas ! la bague était brisée,
Que s’ils étaient d’argent ou d’or,
D’émeraude ou de diamant,
Seront plus clairs, plus clairs encore,
Que les astres du firmament,
Que la lumière de l’aurore,
Que vos regards mon fiancé,
Auront meilleure odeur encore,
Hélas ! la bague était brisée,
Que le lilas qui vient d’éclore,
Que le thym, la rose ou qu’un brin
De lavande ou de romarin.
Les musiciens s’en étant allés,
Nous continuâmes la promenade.
Au bord d’un lac,
On s’amusa à faire des ricochets
Avec des cailloux plats,
Sur l’eau qui dansait à peine.
Des barques étaient amarrées
Dans un havre ;
On les détacha
Après que toute la troupe se fût embarquée,
Et quelques morts ramaient
Avec autant de vigueur que les vivants,
A l’avant du bateau que je gouvernais,
Un mort parlait avec une jeune femme
Vêtue d’une robe jaune,
D’un corsage noir
Avec des rubans bleus et d’un chapeau gris
Orné d’une seule plume défrisée.
‒ Je vous aime, disait-il,
Comme le pigeon aime la colombe,
Comme l’insecte nocturne
Aime la lumière.
‒ Trop tard, répondait la vivante.
Repoussez, repoussez cet amour défendu.
Je suis mariée.
Voyez l’anneau qui brille,
Mes mains tremblent,
Je pleure et je voudrais mourir.
Les barques étaient arrivées
A un endroit où les chevau-légers
Savaient qu’un écho répondait de la rive.
On ne se lassait point de l’interroger.
Il y eut des questions si extravagantes
Et des réponses tellement pleines d’à-propos
Que c’était à mourir de rire,
Et le mort disait à la vivante :
‒ Nous serions si heureux ensemble !
Sur nous l’eau se refermera,
Mais vous pleurez et vos mains tremblent,
Aucun de nous ne reviendra.
On reprit terre et ce fut le retour.
Les amoureux s’entr’aimaient,
Et par couples aux belles bouches,
Marchaient à distances inégales.
Les morts avaient choisi les vivantes,
Et les vivants,
Des mortes.
Un genévrier, parfois,
Faisait l’effet d’un fantôme.
Les enfants déchiraient l’air
En soufflant, les joues creuses,
Dans leurs sifflets de viorne,
Ou de sureau,
Tandis que les militaires
Chantaient des tyroliennes
En se répondant comme on le fait
Dans la montagne.
Dans la ville,
Notre troupe diminua peu à peu.
On se disait au revoir,
À demain,
À bientôt.
Beaucoup entraient dans les brasseries.
Quelques-uns nous quittèrent
Devant une boucherie canine
Pour y acheter leur repas du soir.
Bientôt, je restai seul avec ces morts
Qui s’en allaient tout droit
Au cimetière
Où,
Sous les Arcades,
Je les reconnus, couchés, immobiles.
Et bien vêtus,
Attendant la sépulture derrière les vitrines.
Ils ne se doutaient pas
De ce qui s’était passé,
Mais les vivants en gardaient le souvenir.
C’était un bonheur inespéré
Et si certain
Qu’ils ne craignaient point de le perdre.
Ils vivaient si noblement
Que ceux, qui, la veille encore,
Les regardaient comme leurs égaux
Ou même quelque chose de moins,
Admiraient maintenant
Leur puissance, leur richesse et leur génie.
Car, y a-t-il rien qui vous élève
Comme d’avoir aimé un mort ou une morte ?
On devient si pur qu’on en arrive
Dans les glaciers de la mémoire
A se confondre avec le souvenir.
On est fortifié pour la vie
Et l’on n’a plus besoin de personne.
Le Brasier203 §
I [apo-P_1912-11-09_anthologie-poetes_p026a] §
J’ai jeté dans le noble feu
Que je transporte et que j’adore
De vives mains et même feu
Ce passé, ces têtes de morts.
Flamme, je fais ce que tu veux.
Le galop soudain des étoiles
N’étant que ce qui deviendra
Se mêle au hennissement mâle
Des centaures dans leurs haras
Et des grand plaintes végétales.
Où sont ces têtes que j’avais ?
Où est le Dieu de ma jeunesse ?
L’amour est devenu mauvais.
Qu’au Brasier les flammes renaissent !
Mon âme au soleil se dévêt.
Dans la plaine ont poussé des flammes,
Nos cœurs pendent aux citronniers,
Les têtes coupées qui m’acclament
Et les astres qui ont saigné
Ne sont que des têtes de femmes.
Le fleuve épinglé sur la ville
T’y fixe comme un vêtement :
Partant, à l’Amphion, docile,
Tu subis tous les tons charmants
Qui rendent les pierres agiles.
II [apo-P_1912-11-09_anthologie-poetes_p027] §
Je flambe dans le brasier à l’ardeur adorable
Et les mains des croyants m’y rejettent multiple, innombrablement ;
Les membres des intercis flambent auprès de moi,
Eloignez du brasier les ossements,
Je suffis pour l’éternité à entretenir le feu de mes délices
Et des oiseaux protègent de leurs ailes ma face et le soleil.
O mémoire, combien de races qui forlignent
Des Tyndarides aux vipères ardentes de mon bonheur,
Et les serpents ne sont-ils que les cous des cygnes
Qui étaient immortels et n’étaient pas chanteurs !
Voici ma vie renouvelée,
De grands vaisseaux passent et repassent,
Je trempe une fois encore mes mains dans l’Océan,
Voici le paquebot et ma vie renouvelée,
Ses flammes sont immenses.
Il n’y a plus rien de commun entre moi
Et ceux qui craignent les brûlures.
III [apo-P_1912-11-09_anthologie-poetes_p028] §
Descendant des hauteurs où pense la lumière,
Jardins rouant plus haut que tous les ciels mobiles,
L’avenir masqué flambe en traversant les cieux
‒ Nous attendons ton bon plaisir, ô mon amie. ‒
J’ose à peine regarder la divine mascarade.
‒ Quand bleuira sur l’horizon la Désirade ? ‒
Au delà de notre atmosphère s’élève un théâtre
Que construisit le ver Zamir, sans instrument…
Puis, le soleil revint ensoleiller les places
D’une ville marine apparue contremont ;
Sur les toits se reposaient les colombes lasses.
Et le troupeau de sphinx regagne la sphingerie
A petits pas. Il écoulera le chant du pâtre toute la vie,
Là haut, le théâtre est bâti avec le feu solide
Comme les astres dont se nourrit le vide.
Et voici le spectacle
Et pour toujours je suis assis dans un fauteuil
Ma tête, mes genoux, mes coudes, vain pentacle.
Les flammes ont poussé sur moi comme des feuilles.
Les acteurs inhumains, claires bêtes nouvelles,
Donnent des ordres aux hommes apprivoisés,
O Terre,
O Déchirée que les fleuves ont reprisée.
J’aimerais mieux nuit et jour dans les sphingeries
Vouloir savoir pour qu’enfin on m’y dévorât.
Les Soirées de Paris , décembre 1912A la fin tu es las de ce monde ancien
Bergère ô tour Eiffel le troupeau des ponts bêle ce matin
Tu en as assez de vivre dans l’antiquité grecque et romaine
Ici même les automobiles ont l’air d’être anciennes
La Religion seule est restée toute neuve la Religion
Est restée simple comme les hangars de Port Aviation
Seul en Europe tu n’es pas antique ô Christianisme
L’Européen le plus moderne c’est toi pape Pie X
Et toi que les fenêtres observent la honte te retient
D’entrer dans une église et de t’y confesser ce matin
Tu lis les prospectus les catalogues les affiches qui chantent tout haut
Voilà la poésie ce matin et pour la prose il y a les journaux
Il y a les livraisons à 25 centimes pleines d’aventures policières
O portraits des grands hommes et mille titres divers
J’ai vu ce matin une jolie rue dont j’ai oublié le nom
Neuve et propre du soleil elle était le clairon
Les Directeurs les Ouvriers et les belles sténo-dactylographes
Du lundi matin au samedi soir quatre fois par jour y passent
Le matin par trois fois la sirène y gémit
Une cloche rageuse y aboie vers midi
Les inscriptions des enseignes et des murailles
Les plaques les avis à la façon des perroquets criaillent
J’aime la grâce de cette rue industrielle
Située à Paris entre la rue Aumont-Thiéville et l’avenue des Ternes
Voilà la jeune rue et tu n’es encore qu’un petit enfant
Ta mère ne t’habille que de bleu et de blanc
Tu es très pieux et avec le plus ancien de tes camarades René Dalize
Vous n’aimez rien tant que les pompes de l’Église
Il est neuf heures le gaz est baissé tout bleu vous sortez du dortoir en cachette
Vous priez toute la nuit dans la chapelle du collège
Et dans l’éternelle et adorable profondeur améthyste
Tourne à jamais la flamboyante gloire du Christ
C’est le beau lys que malgré tout nous tous nous cultivons
C’est la torche aux cheveux roux que n’éteint pas le vent
C’est le fils pâle et vermeil de la douloureuse mère
C’est l’arbre toujours touffu de toutes les prières
C’est la double potence de l’honneur et de l’éternité c’est l’étoile à six branches
C’est Dieu qui meurt le vendredi et ressuscite le dimanche
C’est le Christ qui monte au ciel mieux que les aviateurs
Il détient le record du monde pour la hauteur
Pupille Christ de l’œil Vingtième pupille des siècles il sait y faire
Et changé en oiseau ce siècle comme Jésus monte dans l’air
Les diables dans les abîmes lèvent la tête pour le regarder
Ils disent qu’il imite Simon Mage en Judée
Ils crient s’il sait voler qu’on l’appelle voleur
Les anges voltigent autour du joli voltigeur
Icare Enoch Elie Apollonius de Thyane
Flottent autour du premier aéroplane
Ils s’écartent parfois pour laisser passer ceux qui transporte la Sainte-Eucharistie
Ces prêtres qui montent éternellement en élevant l’hostie
L’avion se pose enfin sans refermer les ailes
Le ciel s’emplit alors de millions d’hirondelles
A tire d’aile viennent les corbeaux les faucons les hiboux
D’Afrique arrivent les ibis les flamants les marabouts
L’oiseau Roc célébré par les conteurs et les poètes
Plane tenant dans les serres le crâne d’Adam la première tête
L’aigle fond de l’horizon en poussant un grand cri
Et d’Amérique vient le petit colibri
De Chine sont venus les pi-his longs et souples
Qui n’ont qu’une seule aile et qui volent par couples
Puis s’en vient la colombe esprit immaculé
Qu’escortent l’oiseau-lyre et le paon ocellé
Le phénix ce bûcher qui soi-même s’engendre
Un instant voile tout de son ardente cendre
Les sirènes laissant les périlleux détroits
Arrivent en chantant bellement toutes trois
Et tous aigle phénix et pi-his de la Chine
Fraternisent avec la volante machine
Maintenant tu marches dans Paris tout seul parmi la foule
Des troupeaux d’autobus mugissants près de toi roulent
L’angoisse de l’amour te serre le gosier
Comme si tu ne devais jamais plus être aimé
Si tu vivais dans l’ancien temps tu entrerais dans un monastère
Et vous avez honte quand vous vous surprenez à dire une prière
Tu te moques de toi et comme le feu de l’enfer ton rire pétille
Les étincelles de ton rire dorent le fond de ta vie
C’est un tableau pendu dans un sombre musée
Et quelquefois tu vas le regarder de près
Aujourd’hui tu marches dans Paris les femmes sont ensanglantées
C’était et je voudrais ne pas m’en souvenir c’était au déclin de la beauté
Entourée de flammes ferventes Notre-Dame m’a regardé à Chartres
Le sang de votre Sacré-Cœur m’a inondé à Montmartre
Je suis malade d’ouïr les paroles bienheureuses
L’amour dont je souffre est une maladie honteuse
L’image qui te possède te fait sourire dans l’insomnie et dans l’angoisse
Et c’est toujours près de toi la métive qui passe
Maintenant tu es au bord de la Méditerranée
Sous les citronniers qui sont en fleur toute l’année
Avec tes amis tu te promènes en barque
L’un est Nissard il y a un Mentonasque et deux Turbiasques
Nous regardons avec effroi les poulpes des profondeurs
Et parmi les algues nagent les poissons images du Sauveur
Tu es dans le jardin d’une auberge aux environs de Prague
Tu te sens tout heureux une rose est sur la table
Et tu observes au lieu d’écrire ton conte en prose
La cétoine qui dort dans le cœur de la rose
Epouvanté tu te vois dessiné dans les agates de Saint-Vit
Tu étais triste à mourir le jour où tu t’y vis
Tu ressembles au Lazare affolé par le jour
Les aiguilles de l’horloge du quartier juif vont à rebours
Et tu recules aussi dans ta vie lentement
En montant au Hradchin et le soir en écoutant
Dans les tavernes chanter des chansons tchèques
Te voici à Marseille au milieu des pastèques
Te voici à Coblence à l’hôtel du Géant
Te voici à Rome assis sous un néflier du Japon
Te voici à Amsterdam avec une jeune fille que tu trouves belle et qui est laide
Elle doit se marier avec un étudiant de Leyde
On y loue des chambres en latin Cubicula locanda
Je m’en souviens j’y ai passé trois jours et autant à Gouda
Tu es à Paris chez le juge d’instruction
Comme un criminel on te met en état d’arrestation
Tu as fait de douloureux et de joyeux voyages
Avant de t’apercevoir du Mensonge et de l’Age
Tu as souffert de l’amour à vingt et à trente ans
J’ai vécu comme un fou et j’ai perdu mon temps
Tu n’oses plus regarder la croix et à tous moments tu voudrais sangloter
Sur moi sur celle que j’aime sur tout ce qui m’a épouvanté
Tu regardes les yeux pleins de larmes ces pauvres émigrants
Ils croient en Dieu ils prient les femmes allaitent des enfants
Ils emplissent de leur odeur le hall de la gare Saint-Lazare
Ils ont foi dans leur étoile comme les rois mages
Ils espèrent gagner de l’argent dans l’Argentine
Et revenir dans leur pays après avoir fait fortune
Des familles transportent un édredon rouge comme vous transportez votre cœur
Cet édredon et nos rêves sont aussi irréels
Beaucoup de ces émigrants restent ici et se logent
Rue des Rosiers ou rue des Ecouffes dans des bouges
Je les ai vu souvent le soir ils prennent l’air dans la rue
Et se déplacent rarement comme les pièces aux échecs
Il y a surtout des juifs leurs femmes portent perruque
Elles restent assises exsangues au fond des boutiques
Tu es debout devant le zinc d’un bar crapuleux
Tu prends un café à deux sous parmi les malheureux
Tu es la nuit dans un grand restaurant
On chante on danse on boit du champagne
Ces femmes ne sont pas méchantes elles ont des soucis cependant
Toutes même la plus laide a fait souffrir son amant
Elle est la fille d’un sergent de ville de Jersey
Ses mains que je n’avais pas vues sont dures et gercées
J’ai une pitié immense pour les coutures de son ventre
J’humilie maintenant à une pauvre fille au rire horrible ma bouche
La nuit s’éloigne ainsi qu’une belle métive
C’est Ferdine la fausse ou Léa l’attentive
Et tu bois cet alcool brûlant comme ta vie
Ta vie que tu bois comme une eau-de-vie
Tu marches vers Auteuil tu veux aller chez toi à pied
Dormir parmi tes fétiches d’Océanie et de Guinée
Ils sont des Christ d’une autre forme et d’une autre croyance
Ce sont les Christ inférieurs des obscures espérances
Adieu Adieu
Soleil levant cou tranché
GUILLAUME APOLLINAIRE.
1913 §
Carte postale, janvier 1913
Poème sans titre (incipit : « Au nord au sud »)206 207 §
Au nord au sud
Zénith nadir
Et les grands cris de l’est
L’Océan à l’ouest se goufle
La tour à la roue
S’adresse
Guillaume Apollinaire
L’Heure qui sonne , janvier 1913Le Brasier208 §
A mon ami, le grand poète
J’ai jeté dans le noble feu
Que je transporte et que j’adore
De vives mains et même feu
Ce passé, ces têtes de morts.
Flamme, je fais ce que tu veux.
Le galop soudain des étoiles
N’étant que ce qui deviendra
Se mêle au hennissement mâle
Des centaures dans leurs haras
Et des grandes plaintes végétales.
Où sont ces têtes que j’avais ?
Où est le Dieu de ma jeunesse ?
L’amour est devenu mauvais.
Qu’au brasier les flammes renaissent !
Mon âme au soleil se dévêt.
Dans la plaine ont poussé des flammes,
Nos cœurs pendent aux citronniers,
Les têtes coupées qui m’acclament
Et les astres qui ont saigné
Ne sont que des têtes de femmes,
Le fleuve épinglé sur la ville
T’y fixe comme un vêtement
Partant, à l’amphion, docile,
Tu subis tous les tons charmants
Qui rendent les pierres agiles.
II §
Je flambe dans le brasier à l’ardeur adorable,
Et les mains des croyants m’y rejettent multiple, innombrablement
Les membres des intercis flambent auprès de moi,
Éloignez du brasier les ossements,
Je suffis pour l’éternité à entretenir le feu de mes délices
Et des oiseaux protègent de leurs ailes ma face et le soleil.
O mémoire, combien de races qui forlignent
Des Tyndarides aux vipères ardentes de mon bonheur,
Et les serpents ne sont ils que les cous des cygnes
Qui étaient immortels et n’étaient pas chanteurs.
Voici ma vie renouvelée,
De grands vaisseaux passent et repassent.
Je trempe une fois encore mes mains dans l’Océan.
Voici le paquebot et ma vie renouvelée
Ses flammes sont immenses.
Il n’y a plus rien de commun entre moi
Et ceux qui craignent les brûlures.
III §
Descendant des hauteurs où pense la lumière
Jardins rouant plus haut que tous les ciels mobiles,
L’avenir masqué flambe en traversant les cieux.
Nous attendons ton bon plaisir, ô mon amie,
J’ose à peine regarder la divine mascarade
— Quand bleuira sur l’horizon la Désirade ? —
Au delà de notre atmosphère s’élève un théâtre
Que construisit le ver Zamir sans instrument,
Puis le soleil revint ensoleiller les places
D’une ville marine apparue contremont
Sur les toits se reposaient les colombes lasses.
Et le troupeau de sphinx regagne la sphingerie
A petits pas. Il orra le chant du pâtre toute la vie.
Là-haut, le théâtre est bâti avec le feu solide
Comme les astres dont se nourrit le vide.
Et voici le spectacle
Et pour toujours je suis assis dans un fauteuil.
Ma tête, mes genoux, mes coudes, vain pentacle
Les flammes ont poussé sur moi comme des feuilles.
Les acteurs inhumains, claires bêtes nouvelles,
Donnent des ordres aux hommes apprivoisés
O Déchirée que les fleuves ont reprisée.
J’aimerais mieux nuit et jour dans les sphingeries,
Vouloir savoir pour qu’enfin on m’y dévorât.
Guillaume APOLLINAIRE
Poème & Drame , janvier 1913Série sans titre209 §
Les Fenêtres210 §
Du rouge au vert tout le jaune se meurt
Quand chantent les aras dans les forêts natales
Abatis de pihis
Il y a un poème à faire sur l’oiseau qui n’a qu’une aile
Nous l’enverrons en message téléphonique
Traumatisme géant
Il fait couler les yeux
Voilà une jolie jeune feuille parmi les jeunes Turinaises
Le pauvre jeune homme se mouchait dans sa cravate blanche
Tu soulèveras le rideau
Et maintenant voilà que s’ouvre la fenêtre
Araignées quand les mains tissaient la lumière
Beauté, pâleur, insondables violets
Nous tenterons en vain de prendre du repos
On commencera à minuit
Quand on a le temps on a la liberté
Bigorneaux bottes multiples soleils et l’oursin du couchant,
Une vieille paire de chaussures jaunes devant la fenêtre
Tours
Les Tours ce sont les rues
Puits
Puits ce sont les places
Puits
Arbres creux qui abritent les Câpresses vagabondes
Les Chabins chantent des airs à mourir
Aux Chabines marronnes
Et l’oie Oua-oua trompette au Nord
Où les chasseurs de ratons
Raclent les pelleteries
Étincelant diamant
Vancouver
Où le train blanc de neige et de feux nocturnes fuit l’hiver
O Paris
Du rouge au vert tout le jaune se meurt
Paris, Vancouver, Hyère, Maintenon, New-York et les Antilles
La fenêtre s’ouvre comme une orange
Le beau fruit de la lumière
Veille (incipit : « Pipes de nuit pipes du jour »)211 212 §
Pipes de nuit pipes du jour
Tout l’opium ô chevelures
Les cheveux bruns de mon amour
Et ces lenteurs tandis que dure
L’éveil des monstres tour à tour
Passant mêle à ta vie l’orgueil et la bonté
Surmonte l’ennemi et bois à sa santé
Honore ton outil sans le laisser inerte
Brise-le par amour au moment de ta perte
Et méprise ceci Jouir sans en pleurer
La vigne sans ivresse et le champ sans ivraie
GUILLAUME APOLLINAIRE
R. Delaunay [album], janvier 1913A Robert Delaunay
Du rouge au vert tout le jaune se meurt
Quand chantent les aras dans les forêts natales
Abatis de pi-his
Il y a un poème à faire sur l’oiseau qui n’a qu’une aile
Nous l’enverrons en message téléphonique
Traumatisme géant
Il fait couler les yeux
Voilà une jolie jeune fille parmi les jeunes Turinaises
Le pauvre jeune homme se mouchait dans sa cravate blanche
Tu soulèveras le rideau
Et maintenant voilà que s’ouvre la fenêtre
Araignées quand les mains tissaient la lumière
Beauté Pâleur d’insondables violets
Nous tenterons en vain de prendre du repos
On commencera à minuit
Quand on a le temps on a la liberté
Bigorneaux Lottes Multiples Soleils et l’Oursin du Couchant
Une vieille paire de chaussures jaunes devant la fenêtre
Tours
Les tours ce sont les rues
Puits
Puits
Ce sont les places
Puits
Arbres creux qui enlacent les Capresses vagabondes
Les Chabins chantent des airs à mourir
Aux Chabines marronnes
Et l’oie Oua-Oua trompette au nord
Où les chasseurs de ratons
Raclent les pelleteries
Étincelant diamant
Vancouver
Où le train blanc de neige et de feux nocturnes fuit l’hiver
O Paris
Du rouge au vert tout le jaune se meurt
Paris Vancouver Lyon Maintenon New-York et les Antilles
La fenêtre s’ouvre comme une orange
Le beau fruit de la lumière
Guillaume APOLLINAIRE
Der Sturm , mars 1913 (3e livraison)A la fin tu es las de ce monde ancien
Bergère ô tour Eiffel le troupeau des ponts bêle ce matin
Tu en as assez de vivre dans l’antiquité grecque et romaine
Ici même les automobiles ont l’air d’être anciennes
La Religion seule est restée toute neuve la Religion
Est restée simple comme les hangars de Port Aviation
Seul en Europe tu n’es pas antique ô Christianisme
L’Européen le plus moderne c’est toi pape Pie X
Et toi que les fenêtres observent la honte te retient
D’entrer dans une église et de t’y confesser ce matin
Tu lis les prospectus les catalogues les affiches qui chantent tout haut
Voilà la poésie ce matin et pour la prose il y a les journaux
Il y a les livraisons à 25 centimes pleines d’aventures policières
O portraits des grands hommes et mille titres divers
J’ai vu ce matin une jolie rue dont j’ai oublié le nom
Neuve et propre du soleil elle était le clairon
Les Directeurs les Ouvriers et les belles sténodactylographes
Du lundi matin au samedi soir quatre fois par jour y passent
Le matin par trois fois la sirène y gémit
Une cloche rageuse y aboie vers midi
Les inscriptions des enseignes et des murailles
Les plaques les avis à la façon des perroquets criaillent
J’aime la grâce de cette rue industrielle
Située à Paris entre la rue Aumont-Thiéville et l’avenue des Ternes
Voilà la jeune rue et tu n’es encore qu’un petit enfant
Ta mère ne t’habille que de bleu et de blanc
Tu es très pieux et avec le plus ancien de tes camarades René Dalize
Vous n’aimez rien tant que les pompes de l’Eglise
Il est neuf heures le gaz est baissé tout bleu vous sortez du dortoir en cachette
Vous priez toute la nuit dans la chapelle du collège
Et dans l’éternelle et adorable profondeur améthyste
Tourne à jamais la flamboyante gloire du Christ
C’est le beau lys que malgré tout nous tous nous cultivons
C’est la torche aux cheveux roux que n’éteint pas le vent
C’est le fils pâle et vermeil de la douloureuse mère
C’est larbre toujours touffu de toutes les prières
C’est la double potence de l’honneur et de l’éternité c’est l’étoile à six branches
C’est Dieu qui meurt le vendredi et ressuscite le dimanche
C’est le Christ qui monte au ciel mieux que les aviateurs
Il détient le record du monde pour la hauteur
Pupille Christ de l’œil Vingtième pupille des siècles il sait y faire
Et changé en oiseau ce siècle comme Jésus monte dans l’air
Les diables dans les abîmes lèvent la tête pour le regarder
Ils disent qu’il imite Simon Mage en Judée
Ils crient s’il sait voler qu’on l’appelle voleur
Les anges voltigent autour du joli voltigeur
Icare Enoch Elie Apollonius de Thyane
Flottent autour du premier aéroplane
Ils s’écartent parfois pour laisser passer ceux qui transporte la Sainte-Eucharistie
Ces prêtres qui montent éternellement en élevant l’hostie
L’avion se pose enfin sans refermer les ailes
Le ciel s’emplit alors de millions d’hirondelles
A tire d’aile viennent les corbeaux les faucons les hiboux
D’Afrique arrivent les ibis les flamants les marabouts
L’oiseau Roc célébré par les conteurs et les poètes
Plane tenant dans les serres le crâne d’Adam la première tête
L’aigle fond de l’horizon en poussant un grand cri
Et d’Amérique vient le petit colibri
De Chine sont venus les pi-his longs et souples
Qui n’ont qu’une seule aile et qui volent par couples
Puis s’en vient la colombe esprit immaculé
Qu’escortent l’oiseau-lyre et le paon ocellé
Le phénix ce bûcher qui soi-même s’engendre
Un instant voile tout de son ardente cendre
Les sirènes laissant les périlleux détroits
Arrivent en chantant bellement toutes trois
Et tous aigles phénix et pi-his de la Chine
Fraternisent avec la volante machine
Maintenant tu marches dans Paris tout seul parmi la foule
Des troupeaux d’autobus mugissants près de toi roulent
L’angoisse de l’amour te serre le gosier
Comme si tu ne devais jamais plus être aimé
Si tu vivais dans l’ancien temps tu entrerais dans un monastère
Et vous avez honte quand vous vous surprenez à dire une prière
Tu te moques de toi et comme le feu de l’enfer ton rire pétille
Les étincelles de ton rire dorent le fond de ta vie
C’est un tableau pendu dans un sombre musée
Et quelquefois tu vas le regarder de près
Aujourd’hui tu marches dans Paris les femmes sont ensanglantées
C’était et je voudrais ne pas m’en souvenir c’était au déclin de la beauté
Entourée de flammes ferventes Notre-Dame m’a regardé à Chartres
Le sang de votre Sacré-Cœur m’a inondé à Montmartre
Je suis malade d’ouïr les paroles bienheureuses
L’amour dont je souffre est une maladie honteuse
L’image qui te possède te fait sourire dans l’insomnie et dans l’angoisse
Et c’est toujours près de toi la métive qui passe
Maintenant tu es au bord de la Méditerranée
Sous les citronniers qui sont en fleur toute l’année
Avec tes amis tu te promènes en barque
L’un est Nissard il y a un Mentonasque et deux Turbiasques
Nous regardons avec effroi les poulpes des profondeurs
Et parmi les algues nagent les poissons images du Sauveur
Tu es dans le jardin d’une auberge aux environs de Prague
Tu te sens tout heureux une rose est sur la table
Et tu observes au lieu d’écrire ton conte en prose
La cétoine qui dort dans le cœur de la rose
Epouvanté tu te vois dessiné dans les agates de Saint-Vit
Tu étais triste à mourir le jour où tu t’y vis
Tu ressembles au Lazare affolé par le jour
Les aiguilles de l’horloge du quartier juif vont à rebours
Et tu recules aussi dans ta vie lentement
En montant au Hradchin et le soir en écoutant
Dans les tavernes chanter des chansons tchèques
Te voici à Marseille au milieu des pastèques
Te voici à Coblence à l’hôtel du Géant
Te voici à Rome assis sous un néflier du Japon
Te voici à Amsterdam avec une jeune fille que tu trouves belle et qui est laide
Elle doit se marier avec un étudiant de Leyde
On y loue des chambres en latin Cubicula locanda
Je m’en souviens j’y ai passé trois jours et autant à Gouda
Tu es à Paris chez le juge d’instruction
Comme un criminel on te met en état d’arrestation
Tu as fait de douloureux et de joyeux voyages
Avant de t’apercevoir du Mensonge et de l’Age
Tu as souffert de l’amour à vingt et à trente ans
J’ai vécu comme un fou et j’ai perdu mon temps
Tu n’oses plus regarder la croix et à tous moments tu voudrais sangloter
Sur moi sur celle que j’aime sur tout ce qui m’a épouvanté
Tu regardes les yeux pleins de larmes ces pauvres émigrants
Ils croient en Dieu ils prient les femmes allaitent des enfants
Ils emplissent de leur odeur le hall de la gare Saint-Lazare
Ils ont foi dans leur étoile comme les rois mages
Ils espèrent gagner de l’argent dans l’Argentine
Et revenir dans leur pays après avoir fait fortune
Des familles transportent un édredon rouge comme vous transportez votre cœur
Cet édredon et nos rêves sont aussi irréels
Beaucoup de ces émigrants restent ici et se logent
Rue des Rosiers ou rue des Ecouffes dans des bouges
Je les ai vu souvent le soir ils prennent l’air dans la rue
Et se déplacent rarement comme les pièces aux échecs
Il y a surtout des juifs leurs femmes portent perruque
Elles restent assises exsangues au fond des boutiques
Tu es debout devant le zinc d’un bar crapuleux
Tu prends un café à deux sous parmi les malheureux
Tu es la nuit dans un grand restaurant
On chante on danse on boit du champagne
Ces femmes ne sont pas méchantes elles ont des soucis cependant
Toutes même la plus laide a fait souffrir son amant
Elle est la fille d’un sergent de ville de Jersey
Ses mains que je n’avais pas vues sont dures et gercées
J’ai une pitié immense pour les coutures de son ventre
J’humilie maintenant à une pauvre fille au rire horrible ma bouche
La nuit s’éloigne ainsi qu’une belle métive
C’est Ferdine la fausse ou Léa l’attentive
Et tu bois cet alcool brûlant comme ta vie
Ta vie que tu bois comme une eau-de-vie
Tu marches vers Auteuil tu veux aller chez toi à pied
Dormir parmi tes fétiches d’Océanie et de Guinée
Ils sont des Christ d’une autre forme et d’une autre croyance
Ce sont les Christ inférieurs des obscures espérances
Adieu adieu
Soleil levant cou tranché
Guillaume Apollinaire
Le Gay Sçavoir , mars 1913Tu chantes avec les autres tandis que les phonographes galopent
Où sont les aveugles où s’en sont-ils allés
La seule feuille que j’aie cueillie s’est changée en plusieurs mirages
Ne m’abandonnez pas parmi cette foule de femmes au marché
Ispahan s’est fait un ciel de carreaux émaillés de bleu
Et je remonte avec vous une route aux environs de Lyon
Je n’ai pas oublié le son de la clochette d’un marchand de coco d’autrefois
J’entends déjà le son aigre de cette voix à venir
Du camarade qui se promènera avec toi en Europe tout en restant
En Amérique
Un enfant
Un veau dépouillé pendu à l’étal
Un enfant
Et cette banlieue de sable autour d’une pauvre ville au fond de l’Est
Un douanier se tenait là comme un ange
A la porte d’un misérable paradis
Et ce voyageur épileptique écumait dans la salle d’attente des premières
Engoulevent Grondin Blaireau
Et la Taupe-Ariane
Nous avions loué deux coupés dans le transsibérien
Tour à tour nous dormions le voyageur en bijouterie et moi
Mais celui qui veillait ne cachait point un revolver aimé
Tu t’es promené à Leipzig avec une femme mince déguisée en homme
Intelligence car voilà ce que c’est qu’une femme intelligente
Et il ne faudrait pas oublier les légendes
Dame-Aboude dans un tramway la nuit au fond d’un quartier désert
Je voyais une chasse tandis que je montais
Et l’ascenseur s’arrêtait à chaque étage
Entre les pierres
Entre les vêtements multicolores de la vitrine
Entre les charbons ardents du marchand de marrons
Entre deux vaisseaux norvégiens amarrés à Rouen
Il y a ton image
Elle pousse entre les bouleaux de la Finlande
Ce beau nègre en acier
La plus grande tristesse
C’est quand tu reçus une carte postale de La Corogne
Le vent vient du couchant
Le métal des caroubiers
Tout est plus triste qu’autrefois
Tous les dieux terrestres vieillissent
L’univers se plaint par ta voix
Et des êtres nouveaux surgissent
Trois par trois
GUILLAUME APOLLINAIRE.
Les Soirées de Paris , avril 1913Inscription pour le tombeau du peintre Henri Rousseau douanier219 220 §
Gentil Rousseau tu nous entends
Nous te saluons
Delaunay sa femme Monsieur Queval et moi
Laisse passer nos bagages en franchise à la porte du ciel
Nous t’apporterons des pinceaux des couleurs des toiles
Afin que tes loisirs sacrés dans la lumière réelle
Tu les consacres à peindre comme tu tiras mon portrait
La face des étoiles.
GUILLAUME APOLLINAIRE.
Montjoie ! , avril 1913Cordes faites de cris
Sons de cloches à travers l’Europe
Siècles pendus
Rails qui ligotez les nations
Nous ne sommes que deux ou trois hommes
libres de tous liens
Donnons-nous la main
Violente pluie qui peigne les fumées
Cordes
Cordes tissées
Câbles sous-marins
Tours de Babel changées en ponts
Araignées Pontifes
Tous les amoureux qu’un seul lien a liés
D’autres liens plus ténus
Blancs rayons de lumière
Cordes et Concorde
J’écris seulement pour vous exalter
O sens ô sens chéris
Ennemis du souvenir
Ennemis du désir
Ennemis du regret
Ennemis des larmes
Ennemis de tout ce que j’aime encore.
Guillaume Apollinaire .
L’Intransigeant , 19 août 1913Poème sans titre (incipit : « O Bateaux Souvenirs et vous Nuages Flottes »)222 223 §
O Bateaux Souvenirs et vous Nuages Flottes
Qui fuyez la Sirène et les feux d’un cargo
Je suis à Villequier au milieu des pilotes
224 C’est ici que mourut la fille de Hugo
Guillaume Apollinaire.
L’Intransigeant , 3 septembre 1913Poème sans titre (incipit : « Le ciel est bleu la mer est grande »)225 226 §
Le ciel est bleu la mer est grande
Je regarde peiner là-bas
Les paludiers du bourg de Batz
Et pâlir les tours de Guérande.
Guillaume Apollinaire .
Paris-Journal , 11 septembre 1913Poème sans titre (incipit : « Le vent souffle dans l’île. Il a plu, l’herbe humide »)227 §
Le vent souffle dans l’île. Il a plu, l’herbe humide
Fille de celle-là qu’il cueillait en rêvant
Prend un grand voile roux feuilles mortes devant
De Jean-Jacques Rousseau le triste tombeau vide.
L’Intransigeant , 20 septembre 1913Poème sans titre (incipit : « Ermenonville, arbres tremblants »)228 229 §
Ermenonville, arbres tremblants,
Temple de la philosophie
Que Rousseau gagnait à pas lents,
Bien fol, bien fol est qui s’y fie.
Guillaume Apollinaire.
Vers et Prose , octobre-novembre-décembre 1913Poèmes de Guillaume Apollinaire230 231 §
Dans le jardin d’Anna232 233 §
Certes si nous avions vécu en l’an dix-sept cent soixante
Est-ce bien la date que vous déchiffrez Anna sur ce banc de pierre
Et que par malheur j’eusse été allemand
Mais que par bonheur j’eusse été près de vous
Nous aurions parlé d’amour de façon imprécise
Presque toujours en français
Et pendue éperdument à mon bras
Vous m’auriez écouté vous parler de Pythagoras
En pensant aussi au café qu’on prendrait
Dans une demi-heure
Et l’automne eût été pareil à cet automne
Que l’épine-vinette et les pampres couronnent
Et brusquement parfois j’eusse salué très bas
De nobles dames grasses et langoureuses
J’aurais dégusté lentement et tout seul
Pendant de longues soirées
Le tokay épais ou la malvoisie
234 J’aurais mis mon habit espagnol
Pour aller sur la route par laquelle
Arrive dans son vieux carrosse
Ma grand’mère qui se refuse à comprendre l’allemand
J’aurais écrit des vers pleins de mythologie
Sur vos seins la vie champêtre et sur les dames
Des alentours
J’aurais souvent cassé ma canne
Sur le dos d’un paysan
J’aurais aimé entendre de la musique en mangeant
Du jambon
J’aurais juré en allemand je vous le jure
Lorsque vous m’auriez surpris embrassant à pleine bouche
Cette servante rousse
Vous m’auriez pardonné dans le bois aux myrtilles
J’aurais fredonné un moment
Puis nous aurions écouté longtemps les bruits du crépuscule
Pour tes roses
J’aurais fait
Un voyage plus long encore
Ton soleil n’est pas celui
Qui luit
Partout ailleurs
Et tes musiques qui s’accordent avec l’aube
Sont désormais pour moi
La mesure de l’art
D’après leur souvenir
Je jugerai
Mes vers les arts
Plastiques et toi-même
Visage adoré
Ispahan aux musiques du matin
Réveille l’odeur des roses de ses jardins
J’ai parfumé mon âme
A la rose
Pour ma vie entière
Ispahan grise et aux faïences bleues
Comme si l’on t’avait
Faite avec
Des morceaux de ciel et de terre
En laissant au milieu
Un grand trou de lumière
Cette
place carrée Meïdan
Grande pour le trop petit nombre
De petits ânes trottinant
Et qui savent si joliment
Braire en regardant
La barbe rougie au henné
238 Du Soleil qui ressemble
A ces jeunes marchands barbus
Abrités sous leur ombrelle blanche
Je suis ici le frère des peupliers
Reconnaissez beaux peupliers au fils d’Europe
239 O mes frères tremblants qui priez en Asie
Un passant arqué comme une corne d’antilope
Phonographe
La petite échoppe
A Rolandseck je rêvais sur la rive verte
La nonne de Roland dans l’île Nonnenwerth
243 Semblait passer ancienne parmi les fillettes
Les sept montagnes dormaient comme les bêtes
Enfin lasses qui gardaient les princesses légendaires
Et rêvant j’attendais le bac rectangulaire
Des gens descendant venaient aussi pour passer le fleuve
Trois dames au parler hanovrien
Effeuillaient sans raison des roses dans le Rhin
Qui semble une veine de Ton Corps si noble
Sur la route bordant le fleuve et tachée d’ombre
Fuyaient tremblant de peur
Comme des chevaliers indignes les autos
Tandis qu’au fil du Rhin s’en allaient des bateaux
A vapeur
La Grenouillère244 245 §
Au bord de l’île on voit
Les canots vides qui s’entre-cognent
Et maintenant
Ni le dimanche ni les jours de la semaine
Ni les peintres ni Maupassant ne se promènent
Bras nus sur leurs canots avec des femmes à grosse poitrine
Et bêtes comme chou
Petits bateaux vous me faites bien de la peine
Au bord de l’île
Montparnasse (incipit : « O porte de l’hôtel avec deux plantes vertes »)246 247 §
O porte de l’hôtel avec deux plantes vertes
Vertes qui jamais
Ne porteront de fleurs
Où sont mes fruits Où me planté-je
O porte de l’hôtel un ange est devant toi
Distribuant des prospectus
On n’a jamais si bien défendu la vertu
Donnez-moi pour toujours une chambre à la semaine
Ange barbu vous êtes en réalité
Un poète lyrique d’Allemagne
Qui voulez connaître Paris
Vous connaissez de son pavé
Ces raies sur lesquelles il ne faut pas que l’on marche
Et vous rêvez
D’aller passer votre Dimanche à Garches
Il fait un peu lourd et vos cheveux sont longs
O bon petit poète un peu bête et trop blond
Vos yeux ressemblent tant à ces deux grands ballons
Qui s’en vont dans l’air pur
A l’aventure
Hy de Park [Hyde Park]248 249 250 §
Les Faiseurs de religions
Prêchaient dans le brouillard
Les ombres près de qui nous passions
Jouaient à colin-maillard
A soixante-dix ans
Joues fraîches de petits enfants
Venez venez Éléonore
Et que sais-je encore
Regardez venir les cyclopes
Les pipes s’envolaient
Regards impénitents
Et l’Europe l’Europe
Regards sacrés
Mains énamourées
Et les amants s’aimèrent
Tant que prêcheurs prêchèrent
GUILLAUME APOLLINAIRE
Les Écrits français , décembre 1913Un fantôme de nuées252 §
Comme c’était la veille du quatorze juillet,
Vers les quatre heures de l’après-midi,
Je descendis dans la rue pour aller voir les saltimbanques.
Ces gens qui font des tours en plein air
Commencent à être rares à Paris.
Dans ma jeunesse on en voyait beaucoup plus qu’aujourd’hui.
Ils s’en sont allés presque tous en province.
Je pris le boulevard Saint-Germain
Et sur une petite place située entre Saint-Germain-des-Prés et la statue de Danton
Je rencontrai les saltimbanques.
La foule les entourait, muette et résignée à attendre.
Je me fis une place dans ce cercle afin de tout voir.
Poids formidables,
Villes de Belgique soulevées à bras tendu par un ouvrier russe de Longwy,
Haltères noirs et creux qui ont pour tige un fleuve figé,
Doigts roulant une cigarette amère et délicieuse comme la vie.
De nombreux tapis noirs couvraient le sol,
Tapis qui ont des plis qu’on ne défera pas,
Tapis qui sont presque entièrement couleur de la poussière
Et où quelques taches jaunes ou vertes ont persisté
Comme un air de musique qui vous poursuit.
Vois-tu le personnage maigre et sauvage ?
La cendre de ses pères lui sortait en barbe grisonnante.
Il portait ainsi toute son hérédité au visage.
Il semblait rêver à l’avenir
En tournant machinalement un orgue de Barbarie
Dont la lente voix se lamentait merveilleusement,
Les glouglous, les couacs et les sourds gémissements.
Les saltimbanques ne bougeaient pas.
Le plus vieux avait un maillot couleur de ce rose violâtre qu’ont aux joues certaines jeunes filles actives, mais près de la mort.
Ce rose-là se niche surtout dans les plis qui entourent souvent leur bouche,
Ou près des narines.
C’est un rose plein de traîtrise.
Cet homme portait-il ainsi sur le dos
La teinte ignoble de ses poumons.
Les bras, les bras, partout montaient la garde.
Le second saltimbanque
N’était vêtu que de son ombre.
Je le regardai longtemps.
Son visage m’échappe entièrement,
C’est un homme sans tête.
Un autre enfin avait l’air d’un voyou,
D’un apache bon et crapule à la fois.
Avec son pantalon bouffant et les accroche-chaussettes,
N’aurait-il pas eu l’apparence d’un maquereau à la Villette ?
La musique se tut et ce furent des pourparlers avec le public,
Qui sou à sou jeta sur le tapis la somme de deux francs cinquante
Au lieu des trois francs que le vieux avait fixés comme le prix des tours.
Mais, quand il fut clair que personne ne donnerait plus rien,
On se décida à commencer la séance.
De dessous l’orgue sortit un tout petit saltimbanque habillé de rose pulmonaire,
Avec de la fourrure aux poignets et aux chevilles.
Il poussait des cris brefs,
Et saluait en écartant gentiment les avant-bras
Mains ouvertes,
Une jambe en arrière, prête à la génuflexion.
Il salua ainsi aux quatre points cardinaux,
Et quand il marcha sur une boule,
Son corps mince devint une musique si délicate que nul parmi les spectateurs n’y fut insensible
Un petit esprit sans aucune humanité,
Pensa chacun.
Et cette musique des formes
Détruisit celle de l’orgue mécanique
Que moulait l’homme au visage couvert d’ancêtres.
Le petit saltimbanque fit la roue
Avec tant d’audacieuse harmonie
Que l’orgue cessa de jouer
Et que l’organiste se cacha le visage dans les mains
Aux doigts semblables aux descendants de son destin,
Fœtus minuscules qui lui sortaient de la barbe,
Nouveaux cris de Peau Rouge.
Musique angélique des arbres.
Disparition de l’enfant.
Les saltimbanques soulevèrent les gros haltères à bout de bras,
Ils jonglèrent avec les poids,
Mais chaque spectateur cherchait en soi l’enfant miraculeux.
Siècle, ô siècle des nuages.
Guillaume Apollinaire.
Les Soirées de Paris , décembre 1913Lundi rue Christine253 §
La mère de la concierge et la concierge laisseront tout passer
Si tu es un homme tu m’accompagneras ce soir
Il suffirait qu’un type maintint la porte cochère
Pendant que l’autre monterait
Trois becs de gaz allumés
La patronne est poitrinaire
Quand tu auras fini nous jouerons une partie de jacquet
Un chef d’orchestre qui a mal à la gorge
Quand tu viendras à Tunis je te ferai fumer du Kief
Des piles de soucoupes des fleurs un calendrier
Pim pam pim
Je dois fiche près de 300 francs à ma probloque
Je préférerais me couper le parfaitement que de les lui donner
Je partirai à 20 h. 27
Six glaces s’y dévisagent toujours
Je crois que nous allons nous embrouiller encore davantage
Cher monsieur
Vous êtes un mec à la mie de pain
255 Cette dame a le nez comme un ver solitaire
Louise a oublié sa fourrure
Moi je n’ai pas de fourrure et je n’ai pas froid
Le Danois fume sa cigarette en consultant l’horaire
Le chat noir traverse la brasserie
Ces crêpes étaient exquises
La fontaine coule
Robe noire comme ses ongles
C’est complètement impossible
256 Voici monsieur
La bague en malachite
Le sol est semé de sciure
Alors c’est vrai
La serveuse rousse a été enlevée par un libraire
Un journaliste que je connais d’ailleurs très vaguement
Ecoute Jacques c’est très sérieux ce que je vais te dire
Compagnie de Navigation mixte
Il me dit monsieur voulez-vous voir ce que je peux faire d’eaux fortes et de tableaux
Je n’ai qu’une petite bonne
Après déjeuner café du Luxembourg
Une fois là il me présente un gros bonhomme
257 Qui me dit écoutez c’est charmant
A Smyrne à Naples en Tunisie
Mais nom de Dieu où est-ce
La dernière fois que j’ai été en Chine
C’est il y a huit ou neuf ans
L’Honneur tient souvent à l’heure que marque la pendule
Guillaume Apollinaire
1914 §
Les Soirées de Paris , janvier 1914Poème sans titre (incipit : « Tu te souviens, Rousseau, du paysage astèque »)259 260 §
Tu te souviens, Rousseau, du paysage astèque,
Des forêts où poussaient la mangue et l’ananas,
Des singes répandant tout le sang des pastèques
Et du blond empereur qu’on fusilla là-bas.
Les tableaux que tu peins, tu les vis au Mexique 261 :
Un soleil rouge ornait le front des bananiers
Et valeureux soldat, tu troquas ta tunique
Contre le dolman bleu des braves douaniers.
Le malheur s’acharna sur ta progéniture 262
,
Tu perdis tes enfants et tes femmes aussi
263 Et te remarias avecque la peinture
Pour faire tes tableaux, enfants de ton esprit.
Nous sommes réunis pour célébrer ta gloire,
Ces vins qu’en ton honneur nous verse Picasso,
Buvons-les donc, puisque c’est l’heure de les boire
En criant tous en chœur : « Vive ! Vive Rousseau ! »
O peintre glorieux de l’alme République,
Ton nom est le drapeau des fiers Indépendants
264 Et dans le marbre blanc, issu du Pentélique,
On sculptera ta face, orgueil de notre temps.
Or sus ! que l’on se lève et qu’on choque les verres
Et que renaisse ici la française gaieté ;
Arrière noirs soucis, fuyez ô fronts sévères,
Je bois à mon Rousseau, je bois à sa santé !
Le Temps , 28 janvier 1914Poème sans titre (incipit : « Gentil Rousseau, tu nous entends »)265 §
Gentil Rousseau, tu nous entends.
Nous te saluons
Delaunay, sa femme, Monsieur Quéval et moi.
Laisse passer nos bagages en franchise
à la porte du ciel
Nous t’apporterons des pinceaux, des couleurs,
des toiles
Afin que tes loisirs sacrés dans la lumière réelle
Tu les consacres à peindre
Comme tu tiras mon portrait
La face des étoiles.
Les Soirées de Paris , février 1914Le Musicien de Saint-Merry266 §
J’ai enfin le droit de saluer des êtres que je ne connais pas
Ils passent devant moi et s’accumulent au loin
Tandis que tout ce que j’en vois m’est inconnu
Et leur espoir n’est pas moins fort que le mien
Je ne chante pas ce monde ni les autres astres
Je chante toutes les possibilités de moi-même hors de ce monde et des astres
Je chante la joie d’errer et le plaisir d’en mourir
Le 21 du mois de mai 1913
Passeur des morts et les mordonnantes mériennes
Des millions de mouches éventaient une splendeur
Quand un homme sans yeux sans nez et sans oreilles
Quittant le Sébasto entra dans la rue Aubry-le-Boucher
Jeune l’homme était brun et ce couleur de fraise sur les joues
Homme Ah! Ariane
Il jouait de la flûte et la musique dirigeait ses pas
Il s’arrêta au coin de la rue Saint-Martin
Jouant l’air que je chante et que j’ai inventé
Les femmes qui passaient s’arrêtaient près de lui
Il en venait de toutes parts
Lorsque tout à coup les cloches de Saint-Merry se mirent à sonner
Le musicien cessa de jouer et but à la fontaine
Qui se trouve au coin de la rue Simon-le-Franc
Puis saint-Merry se tut et l’inconnu reprenant son air de flûte
Revint sur ses pas marcha jusqu’à la rue de la Verrerie
Où il entra suivi par la troupe des femmes
Qui sortaient des maisons
Qui venaient par les rues traversières les yeux fous
Les mains tendues vers le mélodieux ravisseur
Il s’en allait indifférent jouant son air
Il s’en allait terriblement
Puis ailleurs
A quelle heure un train partira-t-il pour Paris
A ce moment
Ces pigeons des Moluques fientaient des noix muscades
En même temps
Mission catholique de Bôma qu’as-tu fait du sculpteur
Ailleurs
Elle traverse le pont qui relie Bonn à Beuel et disparait à travers Pützchen
Au même instant
Une jeune fille amoureuse du maire
Dans un autre quartier
Rivalise donc poète avec les étiquettes des parfumeurs
En somme rieurs vous n’avez pas tiré grand chose des hommes
Et à peine avez-vous extrait un peu de graisse de leur misère
Mais nous qui mourons de vivre loin l’un de l’autre
Tendons nos bras et sur ces rails roule un long train de marchandises
Tu pleurais assise près de moi au fond d’un fiacre
Et maintenant
Tu me ressembles tu me ressembles malheureusement
Nous nous ressemblons comme dans l’architecture du siècle dernier
Ces hautes cheminées pareilles à des tours
Nous allons plus haut maintenant et ne touchons plus le sol
Et tandis que le monde vivait et variait
Le cortège des femmes long comme un jour sans pain
Suivait dans la rue de la Verrerie l’heureux musicien
Cortèges ô cortèges
C’est quand jadis le roi s’en allait à Vincennes
Quand les ambassadeurs arrivaient à Paris
Quand le maigre Suger se hâtait vers la Seine
Quand l’émeute mourait autour de Saint-Merry
Cortèges ô cortèges
Les femmes débordaient tant leur nombre était grand
Dans toutes les rues avoisinantes
Et se hâtaient raides comme balle
Afin de suivre le musicien
Ah! Ariane et toi Pâquette et toi Amine
Et toi Mia et toi Simone et toi Mavise
Et toi Colette et toi la belle Geneviève
Elles ont passé tremblantes et vaines
Et leurs pas légers et prestes se mouvaient selon la cadence
De la musique pastorale qui guidait leurs oreilles avides
L’inconnu s’arrêta un moment devant une maison à vendre
Maison abandonnée aux vitres brisées
C’est un logis du seizième siècle
La cour sert de remise à des voitures de livraison
C’est là qu’entra le musicien
Et sa musique qui s’éloignait devint langoureuse
Et les femmes le suivirent dans la maison abandonnée
Et toutes y entrèrent confondues en bande
Toutes toutes y entrèrent sans regarder derrière elles
Sans regretter ce qu’elles ont laissé abandonné
Sans regretter le jour la vie et la mémoire
Il ne resta bientôt plus personne dans la rue de la Verrerie
Sinon moi-même et un prêtre de saint-Merry
Nous entrâmes dans la vieille maison
Mais nous n’y trouvâmes personne
Voici le soir
A Saint-Merry c’est l’Angélus qui sonne
Cortèges ô cortèges
C’est quand jadis le roi revenait de Vincennes
Il vint une troupe de casquettiers
Il vint des marchands de bananes
Il vint des soldats de la garde républicaine
O nuit troupeau de regards langoureux des femmes
O nuit toi ma douleur et mon attente vaine
J’entends mourir le son d’une flûte lointaine
Guillaume Apollinaire
Lacerba , avril 1914
Voyage à Paris269 270 §
Ah ! la charmante chose
Quitter un pays morose
Pour Paris
Paris joli
Qu’un jour
Dut créer l’Amour
Ah ! la charmante chose
Quitter un pays morose
Pour Paris
As-tu pris la pièce de dix sous
Je l’ai prise
l’X
Toutes les femmes de 45 à 50 ans se souviennent d’avoir été amoureuses de Capoul
M. CAPUS
Et de bien d’autres
Le tabac à priser275 276 §
Tabaquin tabaquin
277 ma tabatière est vide
Mets y pour deux sous de tabac mais du fin
Il fait si beau qu’en leurs bastides
Les messieurs de la ville s’en sont venus dîner
Les olives sont mûres et partout l’on entend
Les chants des oliveuses
278 sous les oliviers
Le ciel est beau il fait tiède et je vais bien
Mais je suis si vieux que je me demande
Si verrai le temps des lucioles
Tabaquin tiens tes deux sous
C’est du fin Merci bien tabaquin
J’ai du bon tabac
Dans ma tabatière
J’ai du bon tabac
Tu n’en auras pas
En matière de religion la première cause du doute est souvent l’ennui surtout chez les jeunes gens
—
Il pensa qu’il ne pensait pas.
—
Goûtant un citron j’eus comme un goût d’huile de ricin pris avec du citron et du café sans sucre
Nyctor a écarté toute préoccupation amoureuse il satisfait un rut qui le pousse et respecte la liberté d’amour de la femme
—
Fumer comme un condamné à mort
—
Le cyclope aveugle à qui on a crevé son œil dit Je suis borgne
Anvers on bâtit une tour
Ville trompée un prince arrive
Dix fois de toi fera le tour
Toutes tes mains à la dérive
Maigre comme un cou de vautour
Maisons deviennent des lumières
Des corps marchent sans intellect
On dira beaucoup de prières
Pour l’œil un volatile infect
Naît soudain œufs tricentenaires
Des noms le mien et celui qui
A la saveur du laurier femme
Ma chambre a la forme d’une cage
Le soleil passe son bras par la fenêtre
Mais moi qui veux fumer pour faire des mirages
J’allume au feu du jour ma cigarette
Je ne veux pas travailler je veux fumer
APOLLINAIRE
Les Soirées de Paris , avril 1914
POUR M. CH.
Ton visage écarlate ton biplan transformable en hydroplan
Ta maison ronde où il nage un hareng saur
Il me faut la clef des paupières
Heureusement que nous avons vu M. Panado
Et nous sommes tranquilles de ce côté-là
Qu’est-ce que tu vois mon vieux M. D…
90 ou 324 un homme en l’air un veau qui regarde à travers le ventre de sa mère
J’ai cherché longtemps sur les routes
Tant d’yeux sont clos au bord des routes
Le vent fait pleurer les saussaies
Ouvre ouvre ouvre ouvre ouvre
Regarde mais regarde donc
Le vieux se lave les pieds dans la cuvette
Una volta ho inteso dire Ach du lieber Gott
Je me mis à pleurer en me souvenant de vos enfances
Et toi tu me montres un violet épouvantable
Ce petit tableau où il y a une voiture m’a rappelé le jour
Un jour fait de morceaux mauves jaunes bleus verts et rouges
Où je m’en allais à la campagne avec une charmante cheminée tenant sa chienne en laisse
Il n’y en a plus tu n’as plus ton petit mirliton
La cheminée fume loin de moi des cigarettes russes
La chienne aboie contre les lilas
Et la veilleuse consumée
Sur la robe ont chu des pétales
Deux anneaux d’or près des sandales
Au soleil se sont allumés
Mais tes cheveux sont le trolley
A travers l’Europe vêtue de petits feux multicolores.
Souvenir du Douanier287 288 §
Un tout petit oiseau
Sur l’épaule d’un ange
Ils chantent la louange
Du gentil Rousseau
Les mouvements du monde
Les souvenirs s’en vont
Comme un bateau sur l’onde
Et les regrets au fond
Gentil Rousseau
Tu es cet ange
Et cet oiseau
De ta louange
Ils se donnaient la main et s’attristaient ensemble
Sur leurs tombeaux ce sont les mêmes fleurs qui tremblent
Tu as raison elle est belle
Mais je n’ai pas le droit de l’aimer
Il faut que je reste ici
Où l’on fait de si jolies couronnes mortuaires en perles
Il faudra que je te montra ça
La belle Américaine
Qui rend les hommes fous
Dans deux ou trois semaines
Partira pour Corfou
Je tourne vire
Phare affolé
Mon beau navire
S’est en allé
Des plaies sur les jambes
Tu m’as montré ces trous sanglants
Quand nous prenions un quinquina
289 Au bar des Iles Marquises rue de la Gaîté
Un matin doux de verduresse
290 Les matelots l’attendent
Et fixent l’horizon
Où mi-corps hors de l’onde
Bayent tous les poissons
Je tourne vire
Phare affolé
Mon beau navire
S’est en allé
Les tessons de ta voix que l’amour a brisée
Nègres mélodieux Et je t’avais grisée
La belle Américaine
Qui rend les hommes fous
Dans deux ou trois semaines
Partira pour Corfou
Tu traverses Paris à pied très lentement
La brise au voile mauve Etes-vous la maman
Je tourne vire
Phare affolé
Mon beau navire
S’est en allé
On dit qu’elle était belle
Près du Mississipi
Mais que la rend plus belle
La mode de Paris
Je tourne vire
Phare affolé
Mon beau navire
S’est en allé
Il grava sur un banc près la porte Dauphine
Les deux noms adorés Clémence et Joséphine
Et deux rosiers grimpaient le long de son âme
Un merveilleux trio
Il sourit sur le Pavé des Gardes à la jument pisseuse
Il dirige un orchestre d’enfants
Mademoiselle Madeleine
Ah ! Mademoiselle Madeleine
Ah !
Il y a d’autres filles
Dans l’arrondissement
De douces de gentilles
Et qui n’ont pas d’amants
Je tourne vire
Phare affolé
Mon navire
S’est en allé
Guillaume Apollinaire
Der Sturm , mai 1914 1re livraison)Au peintre Chagall
Ton visage écarlate ton biplan transformable en hydroplan
Ta maison ronde où il nage un hareng saur
292 Il me faut la clef des paupières
293 Heureusement que nous avons vu M. Panado
294 Et nous sommes tranquilles de ce côté là
Qu’est-ce que tu veux mon vieux M. D.
295 90 ou 324 un homme en l’air un veau qui regarde à travers le ventre de sa mère
J’ai cherché longtemps sur les routes
Tant d’yeux sont clos au bord des routes
Le vent fait pleurer les saussaies
Ouvre ouvre ouvre ouvre ouvre
Regarde mais regarde donc
Le vieux se lave les pieds dans la cuvette
Una volta ho inteso dire Ach du lieber Jott
Et je me pris à pleurer en me souvenant de nos enfances
Et toi tu me montres un violet épouvantable
Ce petit tableau où il y a une voiture m’a rappelé le jour
Un jour fait de morceaux mauves jaunes bleus verts et rouges
Où je m’en allais à la campagne avec une charmante cheminée tenant sa chienne en laisse
296 J’avais un mirliton que je n’aurais pas échangé contre un bâton de maréchal de France
Il n’y en a plus je n’ai plus mon petit mirliton
La cheminée fume loin de moi des cigarettes russes
La chienne aboie contre les lilas
Et la veilleuse consumée
Sur la robe ont chu des pétales
Deux anneaux d’or près des sandales
Au soleil se sont allumés
Tandis que tes cheveux sont comme le trolley
297 A travers l’Europe vêtue de petits feux multicolores
Guillaume Apollinaire
Les Soirées de Paris , mai 1914
Prophéties299 §
J’ai connu quelques prophétesses
Madame Salmajour avait appris en Océanie à tirer les cartes
C’est là-bas qu’elle avait eu encore l’occasion de participer
A une scène savoureuse d’anthropophagie
Elle n’en parlait pas à tout le monde
En ce qui concerne l’avenir elle ne se trompait jamais
Une cartomancienne céretane Marguerite je ne sais plus quoi
Est également habile
Mais Madame Deroy est la mieux inspirée
La plus précise
Tout ce qu’elle m’a dit du passé était vrai et tout ce qu’elle
M’a annoncé s’est vérifié dans le temps qu’elle indiquait
J’ai connu un sciomancien mais je n’ai pas voulu qu’il
Interrogeât mon ombre
Je connais un sourcier c’est le peintre norvégien Diriks
Miroir brisé sel renversé ou pain qui tombe
Puissent ces dieux sans figure m’épargner toujours
Au demeurant je ne crois pas mais je regarde et j’écoute et notez
Que je lis assez bien dans la main
Car je ne crois pas mais je regarde et quand c’est possible j’écoute
Tout le monde est prophète mon cher André Billy
Mais il y a si longtemps qu’on fait croire aux gens
Qu’ils n’ont aucun avenir qu’ils sont ignorants à jamais
Et idiots de naissance
Qu’on en a pris son parti et que nul n’a même l’idée
De se demander s’il connaît l’avenir ou non
Il n’y a pas d’esprit religieux dans tout cela
Ni dans les superstitions ni dans les prophéties
Ni dans tout ce que l’on nomme occultisme
Il y a avant tout une façon d’observer la nature
Et d’interpréter la nature
Qui est très légitime
A Strasbourg en 1904
J’arrivai pour le lundi gras
A l’hôtel m’assis devant l’âtre
Près d’un chanteur de l’Opéra
Qui ne parlait que de théâtre
La Kellnerine rousse avait
301 Mis sur sa tête un chapeau rose
Comme Hébé que les dieux servait
302 303 N’en eut jamais ô belles choses
Carnaval chapeau rose Ave !
A Rome à Nice et à Cologne
Dans les fleurs et les confetti
Carnaval j’ai revu ta trogne
O roi plus riche et plus gentil
Que Crésus Rothschild et Torlogne
304 Je soupai d’un peu de foie gras
De chevreuil tendre à la compote
Un peu de kirsch me ravigote
Que ne t’avais-je entre mes bras
306
Jeanne Houhou la très gentille
Est morte entre des draps très blancs
Pas seule Bébert dit l’Anguille
Narcisse et Hubert le merlan
Près d’elle faisaient leur manille
Et la crâneuse de Clichy
Aux rouges yeux de dégueulade
Répète Mon eau de Vichy
Va dans le panier à salade
Haha sans faire de chichi
Les yeux dansants comme des anges
Elle riait elle riait
Les yeux très bleus les dents très blanches
309 Si vous saviez si vous saviez
Tout ce que nous ferons dimanche
Guillaume Apollinaire
Le Nouvel Imagier , juin 1914Un fantôme de nuées310 §
Comme c’était la veille du quatorze Juillet
Vers les quatre heures de l’après-midi
Je descendis dans la rue pour aller voir les saltimbanques
Ces gens qui font des tours en plein air
Commencent à être rares à Paris
Dans ma jeunesse on en voyait beaucoup plus qu’aujourd’hui
Ils s’en sont allés presque tous en province
Je pris le boulevard Saint-Germain
Et sur une petite place située entre Saint-Germain-des-Prés et la statue de Danton
Je rencontrai les saltimbanques
La foule les entourait muette et résignée à attendre
Je me fis une place dans ce cercle afin de tout voir
Poids formidables
Villes de Belgique soulevées à bras tendus par un ouvrier russe de Longwy
Haltères noirs et creuses qui ont pour tige un fleuve figé
Doigts roulants une cigarette amère et délicieuse comme ta vie
De nombreux tapis usés couvraient le sol
Tapis qui ont des plis qu’on ne défera pas
Tapis qui sont presque entièrement couleur de la poussière
Et où quelques taches jaunes ou vertes ont persisté
Comme un air de musique qui vous poursuit
Vois-tu le personnage maigre et sauvage
La cendre de ses frères lui sortait en barbe grisonnante
Il portait ainsi toute son hérédité au visage
Il semblait rêver à l’avenir
En tournant machinalement un orgue de Barbarie
Dont la lente voix se lamentait merveilleusement
Les glouglous les couacs et les sourds gémissements
Les saltimbanques ne bougeaient pas
Le plus vieux avait un maillot de ce rose violâtre qu’ont aux joues certaines jeunes filles actives mais près de la mort
Ce rose là se niche surtout dans les plis qu’entourent souvent leur bouche
Ou près des narines
C’est un rose plein de traitrise
Cet homme portait-il ainsi sur le dos
La teinte ignoble de ses poumons
Les bras, les bras partout montaient la garde
Le second saltimbanque
N’était vêtu que de son ombre
Je le regardai longtemps
Son visage m’échappe entièrement
C’est un homme sans tête
Un autre enfin avait l’air d’un voyou
D’un apache bon et crapule à la fois
Avec son pantalon bouffant et les accroche-chaussettes
N’aurait-il pas eu l’apparence d’un maquereau à sa toilette
La musique se tut et ce furent des pourparlers avec le public
Qui sou à sou jeta sur le tapis la somme de deux francs cinquante
Au lieu des trois francs que le vieux avait fixé comme prix des tours
Mais quand il fut clair que personne ne donnerait plus rien
On se décida à commencer la séance
De dessous de l’orgue sortit un tout petit saltimbanque habillé de rose pulmonaire
Avec de la fourrure aux poignets et aux chevilles
Il poussait des cris brefs
Et saluait en écartant gentiment les avant-bras
Mains ouvertes
Une jambe en arrière prête à la génuflexion
Il salua ainsi aux quatre points cardinaux
Et quand il marcha sur une boule
Son corps mince devint une musique si délicate que nul parmi les spectateurs n’y fut insensible
Cher petit esprit sans aucune humanité
Pensa chacun
Et cette musique des formes
Détruisit celle de l’orgue mécanique
Que moulait l’homme au visage couvert d’ancêtres
Le petit saltimbanque fit la roue
Avec tant d’audacieuse harmonie
Que l’orgue cessa de jouer
Et que l’organiste se cacha le visage dans les mains
Aux doigts semblables aux descendants de son destin
Fœtus minuscules qui lui sortaient de la barbe
Nouveau cri de Peau-Rouge
Musique angélique des arbres
Disparition de l’enfant
Les saltimbanques soulevèrent les grosses haltères à bout de bras
Ils jonglèrent avec les poids
Mais chaque spectateur cherchait en soi l’enfant miraculeux
Siècle ô siècle des nuages
Guillaume Apollinaire.
Lacerba , juin 1914Quelconqueries (1re série)311 312 §
La Phoque [Le Phoque]313 314 §
J’ai les yeux d’un vrai veau marin
Et de Madame Ygrec l’allure
On me voit dans tous nos meetings
Je fais de la littérature
Je suis phoque de mon état
Et comme il faut qu’on se marie
Un beau jour j’épouserai Lota
Du matin au soir l’Otarie
Papa Mamman
Pipe et tabac crachoir caf’ conc’
315 Laï Tou
C’est la fête de Saint Olaf
D’amour on revient paf
C’est tout à fait exquis
Pas de chichi
696666---6 9----319 320 §
Les inverses 6 et 9
Se sont dessinés comme un chiffre étrange
69 :
Deux serpents fatidiques,
Deux vermisseaux.
Nombre impudique et cabalistique ;
6 : 3 et 3
9 : 3, 3 et 3.
La trinité
La trinité partout
Qui se retrouve
Avec la dualité ;
Car 6 : deux fois 3
Et trinité, 9 : trois fois 3 ;
69 : dualité, trinité.
Et ces arcanes seraient plus sombres
Mais j’ai peur de les sonder ;
Qui sait si là n’est pas l’éternité,
Par delà la mort camuse
321 Qui s’amuse
A faire peur ;
Et l’ennui m’emmantelle
322 Comme un vague linceul de lugubre dentelle
Ce soir.
La Chaste Lise323 324 §
La journée a été longue
Demain sera ce que fut aujourd’hui
326 Et là-bas sur le château enchanté
Nous sommes las ce soir
Mais la maison nous attend
Avec la bonne soupe qui fume
Et dès l’aube demain
Le dur labeur
Nous reprendra
Hélas
Bonnes gens
Un dernier chapitre327 328 §
Tout le peuple se précipita sur la place publique
Il vint des hommes blancs des nègres des jaunes et quelques rouges
Il vint des ouvriers des usines dont les hautes cheminées ne fumaient plus à cause de la grève
Il vint des maçons aux vêtements maculés de plâtre
Il vint des garçons bouchers aux bras teints de sang
Des mitrons pâles de la farine qui les soupoudrait
Et des commis de commerçants de toutes sortes
Il vint des femmes terribles et portant des enfants ou en ayant d’autres accrochés à leurs jupes
Il vint des femmes pauvres mais effrontées plâtrées maquillées aux gestes étranges
Il vint des estropiés des aveugles des culs de jatte des manchots des boiteux
Il vint même des prêtres et quelques hommes mis avec élégance
Et hors la place la ville semblait morte ne tressaillant même pas
Je songe à Gaspard
331 ce n’est certainement pas
Son vrai nom il voyage il a quitté la ville
Bleue Lanchi
332 où tant d’enfants l’appellaient
333 papa
Au fond du golfe calme en face des sept îles
Gaspard marche et regrette et le riz et le thè
334 La voie lactée
La nuit car naturellement il ne marche
Que la nuit attire souvent ses regards
Mais Gaspard
Sait bien qu’il ne faut pas la suivre
Chapeau-tombeau335 336 §
On a niché
Dans son tombeau
Sur ton chapeau
Il a vécu
Ce petit cul
Or
nithologique
Or
J’en ai assez
Je vais pisser.
APOLLINAIRE
Les Soirées de Paris , juin 1914Lettre-Océan339 §
[première image]
Je traverse la ville nez en avant et je la coupe en 2
J’étais au bord du Rhin quand tu partis pour le Mexique
Ta voix me parvient malgré l’énorme distance
Gens de mauvaise mine sur le quai à la Vera Cruz
[carte postale]
Les voyageurs de l’Espagne devant faire
le voyage de Coatzalcoalcos pour s’embarquer
je t’envoie cette carte au lieu
de profiter du courrier de Vera Cruz qui n’est pas sûr
Tout est calme ici et nous sommes dans l’attente
Des événements.
[à gauche]
Juan Aldama
Correos
Mexico
4 centavos
U.S. Postage
2 cents 2
[au centre]
Ypiranga
Republica Mexicana
Tarjeta Postal
[à droite]
11.45
29-5
14
Rue des Batignolles
[motif circulaire, centre]
Sur la rive gauche devant le pont d’Iéna
[motif circulaire, rayons]
Zut pour M. Zun
arrêtez cocher
Vive le Roy
Evviva il Papa
ta gueule mon vieux pad
non si vous avez une moustache
La Tunisie tu fondes un journal
Jacques c’était délicieux
A bas la calotte
Des clefs j’en ai vu mille et mille
Hou le croquant
Vive la République
[à droite du motif circulaire]
TSF
[bas de l’image]
Bonjour Anomo Anora
Tu ne connaîtras jamais bien les Mayas
[deuxième image]
Te souviens-tu du tremblement de terre entre 1885 et 1890
on coucha plus d’un mois sous la tente
bonjour mon frère Albert à Mexico
Jeunes filles à Chapultepec
[motif circulaire, centre]
Haute de 300 mètres
Sirènes
Hou ou ou ou ou ou ou ou Hou Hou Hou
Autobus
R r o o o to ro ro ro ting ting ro o changement de section ting ting
Gramophones
z z z z z z z z z z z z ou ou ou o o o o o o de vos jardins fleuris fermez les portes
Les chaussures neuves du poète
cré cré cré cré cré cré cré cré cré cré cré cré cré cré cré cré cré cré cré cré cré cré cré cré
[motif circulaire, rayons]
et comment j’ai brûlé le dur avec ma gerce
rue St-Isidore à La Havane ça n’existe +
Chirimoya
A la Crème à
Pendeco c’est + qu’un imbécile
Il appelait l’Indien Hijo de la Cingada
priétaire de 5 ou 6 im
je me suis levé à 2h. du matin et j’ai déjà bu un mouton
le câblogramme comportait 2 mots en sûreté
allons circulez Mes
ture les voyageurs pour Chatou
Toussaint Luca est maintenant à Poitiers
Guillaume Apollinaire
La Revue franco-wallonne , juillet 1914Poèmes de Guillaume Apollinaire340 §
Plongeon341 §
Pique une tête pour pêcher les perles du fleuve
Dit vert, qui est bleu et jaunit qu’il neige ou pleuve
Dans l’eau d’acier ton ombre te précèdera
Les vents chantent Jouhé les cors cornent Trara
342 Tête en bas les yeux ouverts pêche la perle
Chois tout nu jambes ouvertes y grec ou pairle
Et des vapeurs pleins de mouchoirs descendent le Rhin
Sur l’autre rive et en rampant s’enfuit un train.
Un soir rhénan transparent pour ma nostalgie,
Dans l’auberge survint deux par deux une noce
Nostalgie cigares pipes courbées en crosses
Ci-gît m’amour mal culotté ô tabagie.
Du dicke Du L’amour revient en boumerang
345 L’amour revient à en vomir le revenant
Ils ont demandé tant de ces bouteilles longues
Comme les longs cyprès d’un grand jardin rhénan
Un phonographe énamouré pour dix pfenings
Chanta l’amour à quatre voix de chanteurs morts
Des châtrés enrhumés en métal ces ténors
Qui n’ont jamais connu la vie ce féminin
La noce de la ville en face à l’autre rive
Et les cigares à deux gros et blonds
wie du
346 La mienne aussi mon vieux était blonde aux yeux doux
Mais pas d’ici Seigneur que votre règne arrive
Mangez les tartines comme du pain béni
Que la mariée soit soûle comme une grive
Je me souviens Amour que votre règne arrive
On ne respire plus Bonsoir la compagnie
Bonsoir la compagnie j’entends un bruit de rames
Dans la nuit sur le Rhin et le coucou chanter
Puis j’ai jasé d’amour de l’amour regretté
Avec tous les sapins changés en bonnes femmes.
Icare
Soleil je suis jeune et c’est à cause de toi
Mon ombre pour être fauste
349 je l’ai jetée
Pardon je ne fais pas plus d’ombre qu’une étoile
Je suis le seul qui pense dans l’immensité
Mon père m’apprit les détours du labyrinthe
Et la science de la terre et puis mourut
Et depuis j’ai scruté longtemps la vieille crainte
Du ciel mobile et me suis nourri d’herbes crues
Les oracles c’est vrai désapprouvaient ce zèle
Mais nul dieu pour tout dire n’est intervenu
Et pieux j’ai peiné pour achever les ailes
Qu’un peu de cire fixe à mes épaules nues
Et j’ai pris mon essor vers ta face splendide
Les horizons terrestres se sont étalés
Des déserts de Lybie aux palus méotides
350 Et des sources du Nil aux brumes de Thulé
351 Soleil je viens caresser ta face splendide
Et veux fixer ta flamme unique aveuglément
Icare étant céleste est plus divin qu’Alcide
352 Et son bûcher sera ton éblouissement
Pâtres
Je vois un dieu oblong flotter sous le soleil
353 Puisse le premier dieu visible s’en aller
Et si c’était un dieu mourant cette merveille
Prions qu’il tombe ailleurs que dans notre vallée
Icare
Pour éviter la Nuit
ta mère incestueuse
354 Dieu circulaire et bon je flotte entre les nues
Loin de la terre où luit ta fille ténébreuse
La Nuit cette inconnue parmi les inconnus
Et je vivrai par ta chaleur et d’espérance
Mais ton amour soleil brûle divinement
Mon corps qu’être divin voulut mon ignorance
Et ciel Humains je tourne en l’éblouissement
Bateliers
Un dieu choît dans la mer un dieu nu les mains vides
Au semblant des noyés il ira sur une île
Pourrir face tournée vers le soleil splendide
Deux ailes feuillolent
355 sous le ciel d’Ionie.
Les dames pisanes sont descendues rêver
Dans leurs vergers où palpitent des lucioles
Et derrière les murs des flûtes des violes
Disent l’amour perdu que l’on veut retrouver
Puis quand les inconnus ont évoqué leur peine
Ou qu’ils s’en vont à l’heure où doit passer le guet
Avec ses vingt lueurs et son cri fatigué
Elles ont peur de l’ombre et de l’heure prochaine
De l’ombre où jusqu’au jour les lucioles sont
Les larmes d’un regret ardent comme une flamme
Tandis que vous sentez dans la nuit de votre âme
Des violes d’amour vibrer le dernier son
Et l’heure va venir ô belles délicates
Ne sera-ce pas l’heure enfin d’avoir sommeil
Quand passera le guet avec son cri pareil
Aux plaintes de l’amour qui vous rendit ingrates
Alors sur les perrons en écoutant mourir
La source qui languit les Pisanes penchées
Comme leur Tour et par la mort effarouchées
Attendent cependant l’amour qui va venir.
Un soir d’Eté358 §
Le Rhin
Qui coule
Un train
Sont en prière
Dans la bruyère
Toutes les filles
A la fontaine
J’ai tant de peine
J’ai tant d’amour
Dit la plus belle
Qu’il soit fidèle
Et moi je l’aime
Dit sa marraine
J’ai la migraine
A la fontaine
J’ai tant de haine.
Le son du Cor361 §
Mon amour est comme un fiévreux que seul apaise
Le poison qui nourrit son mal et dont il meurt
Mon sens comme celui d’un tel que folie lèse
N’exprime plus qu’injuste et très vaine fureur
Je t’avais crue si blanche et tu es noire hélas !
O toi géhenn
e sombre ô toi nuit sans étoile
362 L’amour a incanté mes yeux tristes et las
363 Et tout est irréel comme embrumé de voiles
Peut-être es-tu très pure immaculée ô toi
Qu’à travers ma folie jadis j’ai crue impure
J’ai les yeux de l’Amour qui sont troubles d’émoi
De veilles et de pleurs et des maux qu’il endure.
La Farce du Miroir364 365 §
J’étais indigne un jour dans la chambre au lit blanc
Où Linda dans la glace admirait sa figure
Et j’emportai grâce au miroir en m’en allant
La première raison de devenir parjure
Linda fut nonpareille avant mais aujourd’hui
Je sais bien qu’elle est double au moins grâce à la glace
Mon cœur par la raison où son amour l’induit
Est parjure à présent pour la seconde face
Or depuis ce jour-là j’ai souvent comparé
Dans la chambre où la glace accepte un pur mirage
La grâce de Linda le visage miré
Mais mon cœur pour élire a manqué de courage
Si parjure toujours pour choisir j’ai douté
Ce n’est pas qu’au miroir la dame soit plus belle
Mais parce qu’elle est rare et j’aime ô rareté
Cette fille qui meurt quand veut sa sœur formelle
J’adore de Linda ce mobile reflet
Qui la simule toute et presque fabuleuse
Mais vivante vraiment moderne comme elle est
La dame du miroir est si miraculeuse
Je meurs pour ce fantôme au magique visage
Et la glace où se fige un réel mouvement
Achève froidement son détestable ouvrage
La farce du miroir trompa plus d’un amant
Qui crut aimer sa belle et n’aima qu’un mirage.
Guillaume Apollinaire.
Les Soirées de Paris , juillet-août 1914Idéogrammes lyriques366 §
Voyage (incipit : « Adieu amour nuage qui »)367 §
A Mlle Paula Valmont
[nuage]
Adieu amour nuage qui fuis
et n’a pas chu pluie fécondante
refais le voyage de Dante
[poteau télégraphique]
[oiseau]
télégraphe
oiseau qui laisse tomber
ses ailes partout
[train]
où va donc ce train qui meurt au loin
dans les vals et les beaux bois frais du tendre été si pâle
[ciel]
la douce nuit lunaire et pleine d’étoiles
c’est ton visage que je ne vois plus
Paysage animé368 §
A Roch Grey
[Maison] voici la maison où naissent les étoiles et les divinités
[Arbre] cet arbrisseau qui se prépare à fructifier te ressemble
[Personnage] amants couchés ensemble vous vous séparerez mes membres
[Cigare] un cigare allumé qui fume
La Cravate et la montre369 §
A Edouard Férat
[cravate]
la cravate douloureuse que tu portes et qui t’orne ô civilisé ôte-la si tu veux bien respirer
[montre, remontoir]
comme l’on s’amuse bien
[bord droit de la montre]
la beauté de la vie passe la douleur de mourir
[heures]
Mon cœur
les yeux
l’enfant
Agla
la main
Tircis
semaine
l’infini redressé par un fous de philosophe
les Muses aux portes de ton corps
le bel inconnu
et le vers dantesque luisant et cadavérique
les heures
[aiguilles]
Il est — 5 enfin
Et tout sera fini
Cœur couronne et miroir370 §
A M. Siéglier-Pascal
[cœur]
Mon Cœur semblable à une flamme renversée
[couronne]
Les rois qui meurent tour à tour renaissent au cœur des poètes
[miroir]
Dans ce miroir je suis enclos vivant et vrai comme on imagine les anges et non comme sont les reflets
Guillaume
Der Sturm , juillet 1914 (1re livraison)Le los du Douanier371 372 §
Un tout petit oiseau
Sur l’épaule d’un ange
Ils chantent la louange
Du gentil Rousseau
Les mouvements du monde
Les souvenirs s’en vont
Comme un bateau sur l’onde
Et les regrets au fond
Gentil Rousseau
Tu es cet ange
Et cet oiseau
De ta louange
Ils se donnaient la main et s’attristaient ensemble
Sur leurs tombeaux ce sont les mêmes fleurs qui tremblent
Tu as raison elle est belle
Mais je n’ai pas le droit de l’aimer
Il faut que je reste ici
Où l’on fait de si jolies couronnes mortuaires en perles
Il faudra que je te montra ça
La belle Américaine
Qui rend les hommes fous
Dans deux ou trois semaines
Partira pour Corfou
Je tourne vire
Phare affolé
Mon beau navire
S’est en allé
Des plaies sur les jambes
Tu m’as montré ces trous sanglants
Quand nous prenions un quinquina
Au bar des Iles Marquises rue de la Gaîté
Un matin doux de verduresse
Les matelots l’attendent
Et fixent l’horizon
Où mi-corps hors de l’onde
Bayent tous les poissons
Je tourne vire
Phare affolé
Mon beau navire
S’est en allé
Les tessons de ta voix que l’amour a brisée
Nègres mélodieux Et je t’avais grisée
La belle Américaine
Qui rend les hommes fous
Dans deux ou trois semaines
Partira pour Corfou
Tu traverses Paris à pied très lentement
La brise au voile mauve Etes-vous la maman
Je tourne vire
Phare affolé
Mon beau navire
S’est en allé
On dit qu’elle était belle
Près du Mississipi
Mais que la rend plus belle
La mode de Paris
Je tourne vire
Phare affolé
Mon beau navire
S’est en allé
Il grava sur un banc près la porte Dauphine
Les deux noms adorés Clémence et Joséphine
Et deux rosiers grimpaient le long de son âme
Un merveilleux trio
Il sourit sur le pavé des gardes à la jument pisseuse
Il dirige un orchestre d’enfants
Mademoiselle Madeleine
Ah ! Mademoiselle Madeleine
Ah !
Il y a d’autres filles
Dans l’arrondissement
De douces des gentilles
Et qui n’ont pas d’amants
Je tourne vire
Phare affolé
Mon beau navire
S’est en allé
Guillaume Apollinaire
Lacerba , juillet 1914Quelconqueries (2e série)373 374 §
Texte sans titre (incipit : « Il me paraît fort étrange »)375 §
Il me paraît fort étrange de ne voir que la guerre et son cortège lugubre oh ! mon Dieu que de choses sont enfermées dans les boîtes les Abdéritains furent étonnamment oh ! mon Dieu que de choses étranges dans les boîtes et les yeux voyons mon cher enfant en vos mains on ne pourra redire.
Le Teint376 §
Comme le soufre qui noircit
L’argent et casse l’or l’amour
Ternit mes yeux brisa aussi
Ce cœur
Une créole à la Havane
Le teint blanc
Sauvée par Dieu l’amour la damne
377
[1re colonne] Linda Ilnda Nilda Indla Indal Lnida Lndia Lndai Lidna Lidan
[2e colonne] Adnil Danil Nadil Nalid Dilan Lanid Landi Naldi Dalni
[3e colonne] Alnid Aldin Ildan
Je nettoyai le trou
Voilà qu’un jeune fou
Par derrière me pince la taille
Le balai tombe au fond
Laissez mon jupon
Au même instant j’ajoute Monsieur Aïe ! Aïe !
Ah ! comme c’est bon
Monsieur je fonds
Ne sentez-vous pas le balai dans le trou
Un balai de chiendent
Qui est dedans
Ne t’excite pas répond-il je m’en fous
Je lui réponds M’sieu c’est désolant
J’ai perdu mon balai de chiendent
Je regarde dans le trou
On me repince la taille
Je répète encore un coup
Oh ! Monsieur Aïe ! Aïe !
APOLLINAIRE
1915 §
Lacerba , février 1915Quelconqueries (3e série)382 §
Fagues [Fagnes]383 384 §
Tant de tristesses plénières
Prirent mon cœur aux fagues
385 désolées
Très las j’ai déposé dans les sapinières
Des kilomètres pendant que râlait
Le vent d’ouest
J’avais quitté les jolis bois
Les écureuils y sont restés
Ma pipe essayait de faire des nuages
Au ciel
Qui restait pur obstinément
Je n’ai confié aucun secret
386 Aux tourbières où de l’eau croupissait
Les bruyères fleurant le miel
Attiraient les abeilles
Et mes pieds qui riaient
Foulaient les myrtilles et les airelles
Savamment mariées
Nord
Nord
La vie s’y tord
En arbres forts
Et tors
La vie y mord
La mort
A belles dents
Quand bruit le vent.
Il n’y a que la mère et les deux fils
Tout est ensoleillé
La table est ronde
Dérrière la chaise où s’assied la mère
Briller sous le soleil
Les caps aux feuillages sombres des pins et des oliviers
Et plus près les villas aux toits rouges
Aux toits rouges où fument les cheminées
Car c’est l’heure du repas
Tout est ensoleillé
Et sur la nappe glacée
La bonne affairée
Dépose un plat fumant
Le repas n’est pas une action vile
Et tous les hommes devraient avoir du pain
La mère et les deux fils mangent et parlent
Et des chants de gaîté accompagnent le repas
Les bruits joyeux des fourchettes et des assiettes
Et le son clair du cristal et des verres
Par la fenêtre ouverte viennent les chants des oiseaux
Dans les citronniers
Et de la cuisine arrive
La chanson vive du beurre sur le feu
Un rayon traverse un verre presque plein de vin mélangé d’eau
Oh ! le beau rubis que font du vin rouge et du soleil
Quand la faim est calmée
Les fruits gais et parfumés
Terminent le repas
Tous se lèvent joyeux et adorent la vie
Sans dégoût de ce qui est matériel
Songeant que les repas sont beaux, sont sacrés
Qui font vivre les hommes.
Acousmate (incipit : « Paix sur terre aux hommes de bonne volonté »)390 391 §
Paix sur terre aux hommes de bonne volonté
Les maris voudraient agir l’outil n’a pas de manche
Sur les doigts de cet homme on voit des tâches d’encre
392 Les hommes et les FEMMES sont tous insermentés
393 Les bergers écoutaient ce que disaient les anges
Leurs âmes s’apaisaient comme un midi d’été
Les bergers comprenaient ce qu’ils croyaient entendre
Car ils savaient déjà tout ce qu’ils écoutaient
Sur cette assiette hélas ! j’aperçois trois chiures
Mais presque toutes les mouches sont mortes de froid
Car c’est l’hiver oui mon vieux ça va bien ça va même très bien
Ces pâtres sachant qu’un enfant venait de naître
Près de là
Sur le coup de minuit d’un jour alcyonien
394 Se mirent tous en route au son de leurs musettes
Ma table est rectangulaire. Ses angles sont arrondis. Je fume la pipe bien que le tabac me dégoute397
J’aurais voulu travailler ce matin mais je n’ai fait que fouiller de vieux brouillons à moi. Les machins où l’on adapte du papier buvard sont des trucs idiots, il vaut mieux sécher ce qu’on écrit avec des papiers buvards non montés, c’est ce qu’il y a de mieux. Il est rose comme un visage fardé, peu à peu il noircit au centre rectangulairement. Maintenant, je ne fais rien j’écris ce que je vois, mon mouchoir est près de moi froissé. Il y a aussi une boîte d’allumettes suédoises à l’envers, elle est vieux rose avec un cercle rouge où il y [a] un A un M et un C avec une torche allumée. Ça me fait penser aux réclames de chemin de fer qui furent le principal au398
[motif centré] ATTENTION DANGE[R] DE MORT
C’était écrit sur ces poteaux plus émouvants qu’un mélo. Je m’embête. Je vais casser une pipe de terre qui est vraiment mauvaise il faut aussi que je jette quelques pipes en bois qui petent vraiment trop puis en pensant à plusieurs choses à la fois, ayant mal à la nuque, les yeux fixes je vais m’arracher des peaux autour des doigts et si je saigne je me sucerai le doigt jusqu’à ce que l’obscurité étant complète je me léverai pour allumer ma lampe.
APOLLINAIRE
291 , mars 1915Voyage (incipit : « Adieu amour nuage qui »)399 §
A Mlle Paula Valmont
[nuage]
Adieu amour nuage qui fuis
et n’a pas chu pluie fécondante
refais le voyage de Dante
[oiseau]
télégraphe
oiseau qui laisse tomber
ses ailes partout
[train]
où va donc ce train qui meurt au loin
dans les vals et les beaux bois frais du tendre été si pâle
[ciel]
la douce nuit lunaire et pleine d’étoiles
c’est ton visage que je ne vois plus
Idéogramme
Guillaume Apollinaire
Der Mistral , mars 19152e canonnier conducteur400 401 §
Me voici libre et fier parmi mes compagnons
Le Réveil a sonné et dans le petit jour je salue
La fameuse Nancéenne que je n’ai pas connue
[trompette]
As-tu connu la putain de Nancy
qui a foutu la vxxxxx à toute l’artillerie
l’artillerie ne s’est pas aperçu qu’elle avait mal au [cul]
Les 3 serveants bras dessus bras dessous se sont endormis sur l’avant-train
402 Et conducteur par mont par val sur le porteur
Au pas au trot et parfois au galop je conduis le canon
Le bras de l’officier est mon étoile polaire
Il pleut mon manteau est trempé et je m’essuie parfois, la figure
Avec la serviette-torchon qui est dans la sacoche du sous-verge
Voici des fantassnis
403 aux pas pesants aux pieds boueux
La pluie les pique de ses aiguilles le sac les suit Fantassins marchantes mottes de terre
Vous êtes la puissance
Du sol qui vous a faits
Et c’est le sol qui va
Lors que vous avancer
[botte]
sacré nom de Dieu quelle allure nom de Dieu quelle allure cependant que la nuit descend
[Notre-Dame]
souvenirs de Paris avant la guerre ils seront bien plus doux après la victoire
[Tour Eiffel]
salut monde dont je suis la langue éloquente que sa bouche ô Paris tire et tirera toujours aux Allemands
Un officier passe au galop
Comme un ange bleu dans la plue grise
Un blessé chemine en fumant une pipe
Le lièvre détale et voici un russieau que j’aime
Et cette jeune femme nous salue charretiers
La Victoire se tient après nos jugulaires
Et calcule pour nos canons les mesures angulaires
Nos salves nos rafales sont ses cris de joie
Ses fleurs sont nos obus aux gerbes merveilleuses
Sa pensée se recueille aux trauchées glorieuses
[obus]
j’entends chanter l’oiseau le bel oiseau rapace
Guillaume Apollinaire.
Case d’Armons [exemplaire de Lucien Bodard]404 405 §
[Page de titre]406 §
Guillaume Apollinaire
Case d’Armons
Aux Armées de la République
[signaux optiques d’artillerie] 1915
[Justification du tirage]407 §
[canon de 75]
Justification du tirage
1915
[à l’encre rouge]
nº 25
G. A.
[signal optique d’artillerie] 2
[Envoi autographe]408 §
[à l’encre noire]
Au maréchal des logis
Lucien Bodard
Son compagnon d’armes
Guillaume Apollinaire
Brigadier
le 20 juin 1915
[signal optique d’artillerie] 3
Loin du Pigeonnier409 410 §
[signal optique d’artillerie, avant le titre] 5
Au p’tit Lou
Et vous savez pourquoi
Pourquoi la chère couleuvre411
Hexaèdres412
barbelés
mais un secret
collines bleues
en sentinelle
Malourène 75 Canteraine413
O gerbes des 305 en déroute
dans la Forêt où nous chantons
au maréchal des logis
André Berthier
416
Qu’est-ce qu’on y met
dans la case d’armons417
espèce de poilu de mon Cœur
Pan pan pan
perruque perruque418
Pan pan pan
Perruque à canon
pour lutter contre les vapeurs419
les lunettes pour protéger les yeux
au moyen d’un masque nocivité gaz
un tissu trempé mouchoir des NEZ
dans la solution de bicarbonate de sodium420
les masques seront simplement mouillés des larmes de rire de rire
[signal optique d’artillerie] 6
Reconnaissance421 422 §
Un seul Bouleau crépusculaire
Pâlit au seuil de l’horizon
Où fuit la mesure angulaire
424 Du cœur à l’âme et la raison
Le galop bleu des souvenances
Traverse les lilas des Yeux
Et les canons des indolences
Tirent mes songes vers
les
Cieux
— ———
— • • — • •
— •• — •
— • • • — •
— • — —
[signal optique d’artillerie] 7
À Mlle Carrubba
[signal optique d’artillerie] 8
Chevaux couleur cerise limite de Zélande429
Des mitrailleuses d’or coassent les légendes
Je t’aime liberté, qui veilles dans les hypogées430
Harpe aux cordes d’argent, ô pluie, ô ma musique
L’invisible ennemi plaie d’argent au soleil
Et l’avenir secret que la fusée élucide
Entends nager le Mot, poisson subtil431
Les villes tour à tour deviennent des clefs432
Le masque bleu comme met Dieu, son Ciel
Guerre paisible ascèse solitude métaphysique
Enfant aux mains coupées433
Fête (incipit : « Feu d’artifice en acier »)434 435 §
Feu d’artifice en acier
Qu’il est charmant cet éclairage
Artifice d’artificier
Mêler quelque grâce au Courage
—
Deux fusants
437 — rose éclatement
Comme deux seins que l’on dégrafe
Tendent leurs bouts insolemment
IL SUT AIMER. Quelle épitaphe
—
Un poète dans la forêt
Regarde avec indifférence
Son révolver au cran d’arrêt
438 Des roses mourir d’espérance
—
Il songe aux roses de Saadi
439 Et soudain sa tête se penche
Car une rose lui redit
La molle courbe d’une hanche
L’air est plein d’un terrible alcool
Filtré des étoiles mi-closes
Les obus caressent le mol
Parfum nocturne où tu reposes
Mortification des roses
Rameau central de combat
Contact par l’écoute
On fore dans la direction « des bruits entendus »
Les jeunes de la classe 1915
Et ces fils de fer électrisés
Ne pleurez donc pas sur les horreurs de la guerre
Avant elle nous n’avions que la surface
De la terre et des mers après elle nous les abîmes
441 Le sous-sol et l’espace aviatique
Maîtres du timon
Après, après
Nous prendrons toutes les joies
Des vainqueurs qui se délassent
Femmes Jeux Usines Commerce
Industrie Agriculture Métal
Feu Cristal Vitesse
Voix Regard Tact à part
Et ensemble dans le tact venu de loin et plus encore au delà de cette terre
Une femme qui pleurait
Eh Oh Ha
Des soldats qui passaient
Eh Oh Ha
Un éclusier qui pêchait
Les tranchées qui blanchissaient
Des obus qui pétaient
Les allumettes qui ne prenaient pas
Et tout
a tant changé
en moi
Tout
Sauf mon
Amour
Eh.
Oh.
Ha.
Dans le village arabe446
[étoile]
Des Souvenirs
[cœur]
mais il y a d’autres chansons
moins douces
[lettre, autour d’une croix]
Bonjour mon poète447
Je me souviens de votre voix de votre voix
Votre petite Fée
Photographie tant attendue448
[bombe et canons croisés]
Far tiz rose449
Rapidité attentive à peine un peu d’incertitude
Mais un dragon à pied sans armes
Parmi le vent quand survient la torpille aérienne
[à gauche]
Salut Le Rapace453
[à gauche, verticalement]
SALUT
[au centre]
Le balai de verdure
T’en souviens-tu
Il est roi dans les pierres
Du beau royaume dévasté
[à droite]
Grain de blé
Mais la couleuvre me regarde dressée comme une épée
Vive comme un cheval pif
454 Un trou d’obus propre comme une salle de bains
Berger suivi de son troupeau mordoré
Mais où est un [cœur] et le [svastica]
455 Aÿ
Le crapaud chantait les saphirs nocturnes
[crapauds]
LOU LOU LOU
[insigne de télégraphiste, reconnaissable à ses foudres]
[pipe à opium]
[bouteille de champagne]
[sabre]
Vive le Capiston
De la Batterie de Tir457 §
Au mar
l . logis F. Bodard
458 Nous sommes ton collier France
Venus des Atlantides ou bien des Négrities
Des Eldorados ou bien des Cimmeries
Rivière d’hommes forts et d’obus dont l’orient chatoie
Diamants qui éclosent la nuit
O Roses
Nous nous pâmons de volupté
A ton cou penché vers l’Est
Nous sommes l’Arc-en-terre
Signe plus pur que l’Arc-en-Ciel
Signe de nos origines profondes
Etincelles
O nous les très belles couleurs
1914 1915
[ronde] [drapeau]
1915??
Pensons à Celui qui cria : Debout les morts
459 .
Je porte votre bague
Elle est très finement ciselée
462 Le sifflet me fait plus plaisir
qu’un palais égyptien
[cercle prolongé par un fil]
Mesure du doigt463
Le Sifflet des tranchées
464 Tu sais
Tout au plus si je n’arrête pas
Les métros et les taxis avec
Ô Guerre
multiplication de l’amour
465 Petit sifflet à 2 trous
14 Juin 1915466 §
A maman
Rien
Rien
de ce qui se passe
Mais on change de secteur
468 Ah ! voyageur égaré
Pas de lettres
Mais l’espoir
Mais un journal
Le glaive antique
de la Marseillaise
S’est changé en constellation
470 Il combat pour nous au ciel
Mais cela signifie surtout
Qu’il faut être de ce temps
Pas de Glaive antique
Mais l’Espoir
Venu de Dieuze472 473 §
Au Ml des Logis Bonfari
Halte là [ficelle]
[portée]
Qui vive
France
[portée]
474
Avance au ralliement
Halte là [ficelle]
Le mot475
Claire-Ville-Neuve en cristal Eternel476
[portée]
forte s’allantanado477
Ah ! mon Dieu m’ tchiot’ fille478
Cantato L’Hommé qu’ j’ai
C’est un’ mouq’ dans d’ l’huile
Tout à fouait
Funambule des lianes du printemps
Tu assassines les arbres qui sont tes G.V.C.479
La poule d’eau caquète et plonge à ton approche
Couple des marais les turquoises
Hennissements partout
Amour sacré amour de la Patrie480
Le Général
Il était Antisthène et c’était Fabius481
Au marl logis chef Piot
Grenouilles et rainettes
Crapauds & Crapoussins
484 Ascèse sous les peupliers et les frênes
La reine des prés va fleurir
Une petite hutte dans la forêt
Là-bas plus blanche est la blessure
485
[à gauche, verticalement]
On tire contre avions
Verdun
[au centre]
Le Ciel
Coquelicots
Flacon au col d’or
On a pendu
la mort
à la lisière du bois
On a pendu la mort
Et ses beaux seins dorés
Se montrent
tour à tour
O rose toujours vive
O France
[à droite, verticalement]
L’orvet
Le sac à malice486
La trousse à boutons
Embaume les espoirs d’une armée qui halète
Le Loriot chante
N’est-ce pas rigolo
Enfin une plume d’épervier
487
1915
soldats de faïence et d’escarboucle491
Ô AMOUR
Carte postale (incipit : « Nous sommes bien »)492 493 §
Nous sommes bien495
mais l’auto-bazar
qu’on dit merveilleux496
ne vient pas jusqu’ici
LUL497
on les aura
faire suivre
route transparente
France
(Ulysse que de jours pour rentrer dans Ithaque)498
C’était un temps béni nous étions sur les plages
501 Va-t’en de bon matin pieds nus et sans chapeau
Et vite comme va la langue d’un crapaud
Se décollaient soudain et collaient les collages
502 As-tu connu Guy au galop
Du temps qu’il était militaire
As-tu connu Guy au galop
Du temps qu’il était artiflot
A la guerre
C’était un temps béni. Les temps du waguemestre
503 On est bien plus serré que dans les autobus
Et des astres passaient que singeaient les obus
Quand dans la nuit survint la batterie équestre
As-tu connu Guy au galop
Du temps qu’il était militaire
As-tu connu Guy au galop
Du temps qu’il était artiflot
A la guerre
C’était un temps béni. Jours vagues et nuits vagues
Les marmites
504 donnaient aux rondins des cagnats
Quelque alluminium
505 où tu t’ingénias
A limer jusqu’au soir d’invraisemblables bagues
As-tu connu Guy au galop
Du temps qu’il était militaire
As-tu connu Guy au galop
Du temps qu’il était artiflot
A la guerre
C’était un temps béni. La guerre continue
Les Servants ont limé, limé pendant des mois
Le Conducteur entend bien caché dans les bois
La chanson que chantait cette étoile inconnue
As-tu connu Guy au galop
Du temps qu’il était militaire
As-tu connu Guy au galop
Du temps qu’il était artiflot
A la guerre
Mes désirs étaient-ils ces jardins sans limite
Où le crapaud module un tendre cri d’azur
La biche du silence éperdu passait vite
Un rossignol meurtri par l’amour chantait sur
Le rosier de ton corps où j’ai cueilli les roses
Nos cœurs pendaient ensemble au même grenadier
Et les fleurs de grenade en nos regards écloses
En tombant tour à tour ont jonché le sentier
Le Servant des Dakar [Le Servant de Dakar]509 510 511 §
C’est dans la cagnat en rondins voilés d’osier
Auprès des canons gris voilés tournés vers le nord
Que je songe au village africain
Où l’on dansait où l’on chantait
Où l’on faisait l’amour
Et de longs discours
Nobles et joyeux
Je revois mon père qui se battit
Contre les Achantis au service des Anglais
512 Caresser les seins durs comme des obus
De ma sœur au rire en folie
513 Et je revois
Ma mère la sorcière qui seule du village
Méprisait le sel
Piler le millet dans un mortier
En regardant mon frère bercer
Sa superbe virilité
Qui semblait un petit enfant
Je me souviens du si délicat si inquiétant
Fétiche dans l’arbre
Et du double fétiche de la fécondité
Plus tard une tête coupée
Au bord d’un marécage
O pâleur de mon ennemi
514 C’était une tête d’argent
Et dans le marais
C’était la lune qui luisait
C’était donc une tête d’argent
Là-haut c’était la lune qui dansait
C’était donc une tête d’argent
Et moi dans l’ombre j’étais invisible
C’était donc une tête de nègre dans la nuit profonde
Similitudes pâleurs
Et ma sœur plus tard
Suivit un tirailleur
Mort à Arras
Si je voulais savoir mon âge
Il faudrait le demander à l’évêque
Si doux si doux avec ma mère
De beurre de beurre avec ma sœur
C’était dans une petite cabane
Moins sauvage que notre Cagnat de Canonniers servants
J’ai connu l’affût au bord des marécages
Où la girafe boit les jambes écartées
J’ai connu l’horreur de l’ennemi qui dévaste
Le Village
Viole les femmes
Emmène les filles
Et les garçons dont la croupe dure sursaute
J’ai porté l’administrateur des semaines
De village en village
En chantonnant
Et je fus domestique à Paris
Je ne sais pas mon âge
Mais au recrutement
On m’a donné vingt ans
Je suis soldat français on m’a blanchi du coup
Secteur 59 je ne peux pas dire où
Pourquoi donc être blanc est-ce mieux qu’être noir
Pourquoi ne pas danser et discourir
Manger et puis dormir
Et nous tirons sur les ravitaillements boches
Ou sur les fils de fer devant les bobosses
515 Sous la tempête de feux métalliques
Je me souviens d’un lac affreux
Une nuit folle
Une nuit de sorcellerie
Et de couples enchaînés par un atroce amour
Toujours516 §
Toujours
Nous irons plus loin sans avancer jamais
Et de planète en planète
De nouvelle en nouvelle
Le don Juan des mille et trois comètes
518 Et même sans bouger de la terre
Cherche les forces neuves
Et prend au serieux les fantômes
519 Et tant d’univers s’oublient
Quels sont les grands oublieurs
Qui donc saura nous faire oublier telle ou telle partie du monde
Où est le Christophe Colomb à qui l’on devra l’oubli d’un continent
Perdre
Mais perdre vraiment
Pour laisser place à la trouvaille
520
La Nuit d’Avril 1915521 522 523 §
Le ciel est étoilé par les obus des Boches
525 La forêt merveilleuse où je vis donne un bal
La mitrailleuse joue un air à triples-croches
Mais avez-vous le mot ? Eh ! oui le mot fatal
526 Aux créneaux. Aux créneaux. Laissez là les pioches.
Comme un astre éperdu qui cherche ses saisons
Cœur obus éclaté tu sifflais ta romance
Et tes mille soleils ont vidé les caissons
527 Que les dieux de mes yeux remplissent en silence
Nous vous aimons
O Vie et nous vous agaçons
Les obus miaulaient un amour à mourir
Un amour qui se meurt est plus doux que les autres
Mon souffle nage au fleuve où le sang va tarir
Les obus miaulaient. Entends chanter les nôtres
528 Pourpre amour salué par ceux qui vont périr
Le printemps tout mouillé la veilleuse l’attaque
Il pleut mon âme il pleut mais il pleut des yeux morts
— Ulysse ! que de jours pour rentrer dans Ithaque —
529 Couche-toi sur la paille et songe un beau remords
Qui pur effet de l’art, soit aphrodisiaque
Mais, Orgues aux fétus de la paille où tu dors
L’hymne de l’avenir est paradisiaque
[Achevé d’imprimer]530 §
Le tirage
à 25 exemplaires
des 21 poëmes de
« La Case d’Armons »
a été achevé à la batterie
de tir, devant l’ennemi,
38e Régt . d’artie . HS : Batterie
par les maréchaux des logis
Bodard et Berthier
le 17 Juin 1915.
[bombe et canons croisés]
Case d’Armons [exemplaire d’Alberto Magnelli]531 532 §
[Page de titre]533 §
Guillaume Apollinaire
Case d’Armons
Aux Armées de la République
[signaux optiques d’artillerie] 1915
[Justification du tirage]534 §
[canon de 75]
Justification du tirage
1915
[à l’encre rouge] nº 3
G. A.
[signal optique d’artillerie] 2
[Envoi autographe]535 §
[à l’encre rouge]
A mon cher ami le Florentin
Alberto Magnelli
dont le goût est sûr comme l’amitié
Cordial Souvenir de Guillaume Apollinaire
maréchal des logis
à la 45e Batterie du
38e Régiment d’Artillerie
de campagne
Aux Armées, ce 19 octobre 1915
(secteur postal 138)
[signal optique d’artillerie] 3
[verticalement] VIVE LA FRANCE ET VIVE L’ITALIE
Loin du Pigeonnier536 537 §
[signal optique d’artillerie, avant le titre] 5
Au p’tit Lou
Et vous savez pourquoi
Pourquoi la chère couleuvre538
Hexaèdres539
barbelés
mais un secret
collines bleues
en sentinelle
Malourène 75 Canteraine540
O gerbes des 305 en déroute
dans la Forêt où nous chantons
au maréchal des logis
André Berthier
543
Qu’est-ce qu’on y met
dans la case d’armons544
espèce de poilu de mon Cœur
Pan pan pan
perruque perruque545
Pan pan pan
Perruque à canon
pour lutter contre les vapeurs546
les lunettes pour protéger les yeux
au moyen d’un masque nocivité gaz
un tissu trempé mouchoir des NEZ
asphy
dans la solution de bicarbonate de sodium547
les masques seront simplement mouillés des larmes de rire de rire
[signal optique d’artillerie] 6
Reconnaissance548 549 §
Un seul Bouleau crépusculaire
Pâlit au seuil de l’horizon
Où fuit la mesure angulaire
551 Du cœur à l’âme et la raison
Le galop bleu des souvenances
Traverse les lilas des Yeux
Et les canons des indolences
Tirent mes songes vers
les
Cieux
— ———
— • • — • •
— •• — •
— • • • — •
— • — —
À Mlle Carrubba
[signal optique d’artillerie] 8
Chevaux couleur cerise limite de Zélande556
Des mitrailleuses d’or coassent les légendes
Je t’aime liberté, qui veilles dans les hypogées557
Harpe aux cordes d’argent, ô pluie, ô ma musique
L’invisible ennemi plaie d’argent au soleil
Et l’avenir secret que la fusée élucide
Entends nager le Mot, poisson subtil558
Les villes tour à tour deviennent des clefs559
Le masque bleu comme met Dieu, son Ciel
Guerre paisible ascèse solitude métaphysique
Enfant aux mains coupées560
Fête (incipit : « Feu d’artifice en acier »)561 562 §
Feu d’artifice en acier
Qu’il est charmant cet éclairage
Artifice d’artificier
Mêler quelque grâce au Courage
—
Deux fusants
564 — rose éclatement
Comme deux seins que l’on dégrafe
Tendent leurs bouts insolemment
IL SUT AIMER. Quelle épitaphe
—
Un poète dans la forêt
Regarde avec indifférence
Son révolver au cran d’arrêt
565 Des roses mourir d’espérance
—
Il songe aux roses de Saadi
566 Et soudain sa tête se penche
Car une rose lui redit
La molle courbe d’une hanche
L’air est plein d’un terrible alcool
Filtré des étoiles mi-closes
Les obus caressent le mol
Parfum nocturne où tu reposes
Mortification des roses
Rapidité attentive à peine un peu d’incertitude
Mais un dragon à pied sans armes
Parmi le vent quand survient la torpille aérienne
[à gauche]
Salut Le Rapace570
[à gauche, verticalement]
SALUT
[au centre]
Le balai de verdure
T’en souviens-tu
Il est roi dans les pierres
Du beau royaume dévasté
[à droite]
Grain de blé
Mais la couleuvre me regarde dressée comme une épée
Vive comme un cheval pif
571 Un trou d’obus propre comme une salle de bains
Berger suivi de son troupeau mordoré
Mais où est un [cœur] et le [svastica]
572 Aÿ
Le crapaud chantait les saphirs nocturnes
[crapauds]
LOU LOU LOU
[insigne de télégraphiste, reconnaissable à ses foudres]
[pipe à opium]
[bouteille de champagne]
[sabre]
Vive le Capiston
Rameau central de combat
Contact par l’écoute
On fore dans la direction « des bruits entendus »
Les jeunes de la classe 1915
Et ces fils de fer électrisés
Ne pleurez donc pas sur les horreurs de la guerre
Avant elle nous n’avions que la surface
De la terre et des mers après elle nous aurons les abîmes
Le sous-sol et l’espace aviatique
Maîtres du timon
Après, après
Nous prendrons toutes les joies
Des vainqueurs qui se délassent
Femmes Jeux Usines Commerce
Industrie Agriculture Métal
Feu Cristal Vitesse
Voix Regard Tact à part
Et ensemble dans le tact venu de loin et plus encore au delà de cette terre
Une femme qui pleurait
Eh Oh Ha
Des soldats qui passaient
Eh Oh Ha
Un éclusier qui pêchait
Les tranchées qui blanchissaient
Des obus qui pétaient
Les allumettes qui ne prenaient pas
Et tout
a tant changé
en moi
Tout
Sauf mon
Amour
Eh.
Oh.
Ha.
Dans le village arabe579
[étoile]
Des Souvenirs
[cœur]
mais il y a d’autres chansons
moins douces
[lettre, autour d’une croix]
Bonjour mon poète580
Je me souviens de votre voix de votre voix
Votre petite Fée
Photographie tant attendue581
[bombe et canons croisés]
Far tiz rose582
Je porte votre bague
Elle est très finement ciselée
585 Le sifflet me fait plus plaisir
qu’un palais égyptien
[cercle prolongé par un fil]
Mesure du doigt586
Le Sifflet des tranchées
587 Tu sais
Tout au plus si je n’arrête pas
Les métros et les taxis avec
Ô Guerre
multiplication de l’amour
588 Petit sifflet à 2 trous
14 Juin 1915589 §
A maman
Rien
Rien
de ce qui se passe
Mais on change de secteur
591 Ah ! voyageur égaré
Pas de lettres
Mais l’espoir
Mais un journal
Le glaive antique
de la Marseillaise
S’est changé en constellation
593 Il combat pour nous au ciel
Mais cela signifie surtout
Qu’il faut être de ce temps
Pas de Glaive antique
Mais l’Espoir
Venu de Dieuze595 596 §
Au Ml des Logis Bonfari
Halte là [ficelle]
[portée]
Qui vive
France
[portée]597
Avance au ralliement
Halte là [ficelle]
Le mot598
Claire-Ville-Neuve en cristal Eternel599
[portée]
forte s’allantanado600
Ah ! mon Dieu m’ tchiot’ fille601
Cantato L’Hommé qu’ j’ai
C’est un’ mouq’ dans d’ l’huile
Tout à fouait
Funambule des lianes du printemps
Tu assassines les arbres qui sont tes G.V.C.602
La poule d’eau caquète et plonge à ton approche
Couple des marais les turquoises
Hennissements partout
Amour sacré amour de la Patrie603
Le Général
Il était Antisthène et c’était Fabius604
De la Batterie de Tir605 §
Au mar
l . logis F. Bodard
606 Nous sommes ton collier France
Venus des Atlantides ou bien des Négrities
Des Eldorados ou bien des Cimmeries
Rivière d’hommes forts et d’obus dont l’orient chatoie
Diamants qui éclosent la nuit
O Roses
Nous nous pâmons de volupté
A ton cou penché vers l’Est
Nous sommes l’Arc-en-terre
Signe plus pur que l’Arc-en-Ciel
Signe de nos origines profondes
Etincelles
O nous les très belles couleurs
1914 1915
[ronde] [drapeau]
1915??
Pensons à Celui qui cria : Debout les morts
607 .
Au marl logis chef Piot
Grenouilles et rainettes
Crapauds & Crapoussins
610 Ascèse sous les peupliers et les frênes
La reine des prés va fleurir
Une petite hutte dans la forêt
Là-bas plus blanche est la blessure
611
[à gauche, verticalement]
On tire contre avions
Verdun
[au centre]
Le Ciel
Coquelicots
Flacon au col d’or
On a pendu
la mort
à la lisière du bois
On a pendu la mort
Et ses beaux seins dorés
Se montrent
tour à tour
O rose toujours vive
O France
[à droite, verticalement]
L’orvet
Le sac à malice612
La trousse à boutons
Embaume les espoirs d’une armée qui halète
Le Loriot chante
N’est-ce pas rigolo
Enfin une plume d’épervier
613
1915
soldats de faïence et d’escarboucle617
Ô AMOUR
Carte postale (incipit : « Nous sommes bien »)618 619 §
Nous sommes bien621
mais l’auto-bazar
qu’on dit merveilleux622
ne vient pas jusqu’ici
LUL623
on les aura
faire suivre
route transparente
France
(Ulysse que de jours pour rentrer dans Ithaque)624
C’était un temps béni nous étions sur les plages
627 Va-t’en de bon matin pieds nus et sans chapeau
Et vite comme va la langue d’un crapaud
Se décollaient soudain et collaient les collages
628 As-tu connu Guy au galop
Du temps qu’il était militaire
As-tu connu Guy au galop
Du temps qu’il était artiflot
A la guerre
C’était un temps béni. Les temps du vaguemestre
629 On est bien plus serré que dans les autobus
Et des astres passaient que singeaient les obus
Quand dans la nuit survint la batterie équestre
As-tu connu Guy au galop
Du temps qu’il était militaire
As-tu connu Guy au galop
Du temps qu’il était artiflot
A la guerre
C’était un temps béni. Jours vagues et nuits vagues
Les marmites
630 donnaient aux rondins des cagnats
Quelque aluminium où tu t’ingénias
A limer jusqu’au soir d’invraisemblables bagues
As-tu connu Guy au galop
Du temps qu’il était militaire
As-tu connu Guy au galop
Du temps qu’il était artiflot
A la guerre
C’était un temps béni. La guerre continue
Les Servants ont limé, limé pendant des mois
Le Conducteur entend bien caché dans les bois
La chanson que chantait cette étoile inconnue
As-tu connu Guy au galop
Du temps qu’il était militaire
As-tu connu Guy au galop
Du temps qu’il était artiflot
A la guerre
Mes désirs étaient-ils ces jardins sans limite
Où le crapaud module un tendre cri d’azur
La biche du silence éperdu passait vite
Un rossignol meurtri par l’amour chantait sur
Le rosier de ton corps où j’ai cueilli les roses
Nos cœurs pendaient ensemble au même grenadier
Et les fleurs de grenade en nos regards écloses
En tombant tour à tour ont jonché le sentier
Le Servant des Dakar [Le Servant de Dakar]634 635 636 §
C’est dans la cagnat en rondins voilés d’osier
Auprès des canons gris voilés tournés vers le nord
Que je songe au village africain
Où l’on dansait où l’on chantait
Où l’on faisait l’amour
Et de longs discours
Nobles et joyeux
Je revois mon père qui se battit
Contre les Achantis au service des Anglais
637 Caresser les seins durs comme des obus
De ma sœur au rire en folie
638 Et je revois
Ma mère la sorcière qui seule du village
Méprisait le sel
Piler le millet dans un mortier
En regardant mon frère bercer
Sa superbe virilité
Qui semblait un petit enfant
Je me souviens du si délicat si inquiétant
Fétiche dans l’arbre
Et du double fétiche de la fécondité
Plus tard une tête coupée
Au bord d’un marécage
O pâleur de mon ennemi
639 C’était une tête d’argent
Et dans le marais
C’était la lune qui luisait
C’était donc une tête d’argent
Là-haut c’était la lune qui dansait
C’était donc une tête d’argent
Et moi dans l’ombre j’étais invisible
C’était donc une tête de nègre dans la nuit profonde
Similitudes pâleurs
Et ma sœur plus tard
Suivit un tirailleur
Mort à Arras
Si je voulais savoir mon âge
Il faudrait le demander à l’évêque
Si doux si doux avec ma mère
De beurre de beurre avec ma sœur
C’était dans une petite cabane
Moins sauvage que notre Cagnat de Canonniers servants
J’ai connu l’affût au bord des marécages
Où la girafe boit les jambes écartées
J’ai connu l’horreur de l’ennemi qui dévaste
Le Village
Viole les femmes
Emmène les filles
Et les garçons dont la croupe dure sursaute
J’ai porté l’administrateur des semaines
De village en village
En chantonnant
Et je fus domestique à Paris
Je ne sais pas mon âge
Mais au recrutement
On m’a donné vingt ans
Je suis soldat français on m’a blanchi du coup
Secteur 59 je ne peux pas dire où
Pourquoi donc être blanc est-ce mieux qu’être noir
Pourquoi ne pas danser et discourir
Manger et puis dormir
Et nous tirons sur les ravitaillements boches
Ou sur les fils de fer devant les bobosses
640 Sous la tempête de feux métalliques
Je me souviens d’un lac affreux
Une nuit folle
Une nuit de sorcellerie
Et de couples enchaînés par un atroce amour
Toujours641 §
Toujours
Nous irons plus loin sans avancer jamais
*
Et de planète en planète
De nouvelle en nouvelle
Le don Juan des mille et trois comètes
643 Et même sans bouger de la terre
Cherche les forces neuves
Et prend au sérieux les fantômes
*
Et tant d’univers s’oublient
*
Quels sont les grands oublieurs
?
Qui donc saura nous faire oublier telle ou telle partie du monde
?
Où est le Christophe Colomb à qui l’on devra l’oubli d’un continent
???
Perdre
Mais perdre vraiment
Pour laisser place à la trouvaille
644
La Nuit d’Avril 1915645 646 647 §
Le ciel est étoilé par les obus des Boches
649 La forêt merveilleuse où je vis donne un bal
La mitrailleuse joue un air à triples-croches
Mais avez-vous le mot ? Eh ! oui le mot fatal
650 Aux créneaux. Aux créneaux. Laissez là les pioches.
*
Comme un astre éperdu qui cherche ses saisons
Cœur obus éclaté tu sifflais ta romance
Et tes mille soleils ont vidé les caissons
651 Que les dieux de mes yeux remplissent en silence
Nous vous aimons
O Vie et nous vous agaçons
*
Les obus miaulaient un amour à mourir
Un amour qui se meurt est plus doux que les autres
Mon souffle nage au fleuve où le sang va tarir
Les obus miaulaient. Entends chanter les nôtres
652 Pourpre amour salué par ceux qui vont périr
*
Le printemps tout mouillé la veilleuse l’attaque
Il pleut mon âme il pleut mais il pleut des yeux morts
— Ulysse ! que de jours pour rentrer dans Ithaque —
653 Couche-toi sur la paille et songe un beau remords
Qui pur effet de l’art, soit aphrodisiaque
* * *
Mais, Orgues aux fétus de la paille où tu dors
L’hymne de l’avenir est paradisiaque
[Achevé d’imprimer]654 §
Le tirage
à 25 exemplaires
des 21 poëmes de
« La Case d’Armons »
a été achevé à la batterie
de tir, devant l’ennemi,
38e Régt . d’artie . HS : Batterie
par les maréchaux des logis
Bodard et Berthier
le 17 Juin 1915.
[bombe et canons croisés]
Mercure de France , 1er août 1915Série sans titre655 §
Poème sans titre (« J’ai tant aimé les arts que je suis artilleur »)656 657 §
J’ai tant aimé les arts que je suis artilleur.
Il a fait bien mauvais. Aujourd’hui c’est meilleur.
J’ai sur un grand cheval fait six heures de route,
Genoux en sang, mais que voulez-vous que ça foute ?
Tant d’hommes sur le front meurent à tout moment
Que c’est un vrai plaisir de saigner seulement.
L’artillerie est l’art de mesurer les angles
Et l’équitation de bien serrer les sangles.
L’art du canon est l’art de tout bien mesurer.
Avec l’astronomie on le peut comparer.
Voilà tout le secret de la guerre où nous sommes.
Le reste est dans la joie et la vertu des hommes.
Poème sans titre (« Cher Y… je suis brigadier »)658 659 §
Cher Y… je suis brigadier
Faut pas croire qu’ici l’on vole
Ses galons. Mais un saladier
Les arrose dans la piaule
Agent de liaison, un saule
Me sert d’abri. Mais l’encrier
Est un vieux bidon à pétrole.
La Voce , novembre 1915A l’Italie (incipit : « L’amour a remué ma vie »)660 661 662 §
L’amour a remué ma vie comme on remue la terre dans la zône des armées
J’atteignais l’âge mûr quand la guerre arriva
Et dans ce jour d’août 1915 le plus chaud de l’année
Bien abrité dans l’hypogée que j’ai creusé moi-même
C’est à toi que je songe ITALIE mère de mes pensées
Et dejà quand von Kluck marchait sur Paris avant la Marne
J’évoquais le sac de Rome par les Allemands
Le sac de Rome qu’ont décrit
Un Bonaparte le vicaire espagnol Delicado et l’Arétin
Je me disais
Est-il possible que la nation
Qui est la mère de la civilisation
Regarde sans la défendre les efforts qu’on fait pour la détruire
Puis les temps sont venus les tombes se sont ouvertes
Les fantômes des Esclaves toujours frémissants
Se sont dressés en criant
SUS AUX TUDESQUES
Nous l’armée invisible aux cris éblouissants
Plus doux que n’est le miel et plus simples qu’un peu de terre
Nous te tournons bénignement le dos ITALIE
Mais ne t’en fais pas nous t’aimons bien
ITALIE f
663 mère qui es aussi notre fille
Nous sommes là tranquillement et sans tristesse
Et si malgré les masques les sacs de sable les rondins nous tombions
Nous savons qu’un autre prendrait notre place
Et que LES ARMEES ne périront jamais
Les mois ne sont pas longs ni les jours ni les nuits
C’est la guerre qui est longue
ITALIE
Toi notre mère et notre fille quelque chose comme une sœur
J’ai comme toi pour me réconforter le quart de pinard
Qui met tant de différence entre nous et les Boches
J’ai aussi comme toi l’envol des compagnies de perdreaux des 75
Comme toi je n’ai pas cet orgueil sans joie des Boches et je sais rigoler
Je ne suis pas sentimental à l’excès comme le sont ces gens sans mesure que leurs actions dépassent sans qu’il sachent s’amuser
Notre civilisation a plus de finesse que les choses qu’ils emploient
Elle est au delà de la vie confortable
Et de ce qui est l’extérieur dans l’art et l’industrie
Les fleurs sont nos enfants et non les leurs
Même la fleur de lys qui meurt au Vatican
La plaine est infinie et les tranchées sont blanches
Les avions bourdonnent ainsi que des abeilles
Sur les roses momentanées des éclatements
Et les nuits sont parées de guirlandes d’éblouissements
De bulles de globules aux couleurs insoupçonnées
Nous jouissons de tout même de nos souffrances
Notre humeur est charmante l’ardeur vient quand il faut
Nous sommes narquois car nous savons faire la part des choses
Et il n’y a pas plus de folie chez celui qui jette les grenades que chez celui qui plume les patates
Tu aimes un peu plus que nous les gestes et les mots sonores
Tu as à ta disposition les sortilèges étrusques le sens de la majesté héroïque et le courageux honneur individuel
Nous avons le sourire nous devinons ce qu’on ne nous dit pas nous sommes démerdards et même ceux qui se dégonflent sauraient à l’occasion faire preuve de l’esprit de sacrifice qu’on appelle la bravoure
Et nous fumons du gros avec volupté
C’est la nuit je suis dans mon blockaus éclairé par l’électricité en bâton
Je pense à toi pays des 2 volcans
Je salue le souvenir des sirènes et des scylles mortes au moment de Messine
Je salue le Colleoni équestre de Venise
Je salue la chemise rouge
Je t’envoie mes amitiés ITALIE et m’apprête à applaudir aux hauts faits de ta bleusaille
Non parce que j’imagine qu’il y aura jamais plus de bonheur ou de malheur en ce monde
Mais parce que comme toi j’aime à penser seul et que les Boches m’en empêcheraient
Mais parce que le goût naturel de la perfection que nous avons l’un et l’autre si on les laissait faire serait vite remplacé par je ne sais quelles commodités dont je n’ai que faire
Et surtout parce que comme toi je sais je veux choisir et qu’eux voudraient nous forcer à ne plus choisir
Une même destinée nous lie en cette occase
Ce n’est pas pour l’ensemble que je le dis
Mais pour chacun de tei ITALIE
Ne te borne point à prendre les terres irrédentes
Mets ton destin dans la balance où est le nôtre
Les réflecteurs dardent leurs lueurs comme des yeux d’escargots
Et les obus en tombant sont des chiens qui jettent de la terre avec leurs pattes après avoir fait leurs besoins
Notre armée invisible est une belle nuit constellée
Et chacun de nos hommes est un astre merveilleux
O nuit, o nuit éblouissante
Les morts sont avec nos soldats
Les morts sont debout dans les tranchées
Ou se glissent souterrainement vers les Bien-Aimees
O Lille Saint-Quentin Laon Maubeuge Vouziers
Nous jetons nos villes comme des grenades
Nos fleuves sont brandis comme des sabres
Nos montagnes chargent comme cavalerie
Nous reprendrons les villes les fleuves et les collines
De la frontière helvétique aux frontières bataves
Entre toi et nous ITALIE
Il y a des patelins pleins de femmes
Et près de toi m’attend celle que j’adore
O FRERES D’ITALIE
Ondes nuages délétères
Metalliques débris qui vous rouillez partout
O frères d’ITALIE vos plumes sur la tête
ITALIE
Entends crier Louvain vois Reims tordre ses bras
Et ce soldat blessé toujours debout Arras
Et maintenant chantons ceux qui sont morts
Ceux qui vivent les officiers et les soldats
Les flingots Rosalie le canon la fusée l’hélice la pelle les chevaux
Chantons les bagues pâles les casques
Chantons ceux qui sont morts
Chantons la terre qui bâille d’ennui
Chantons et rigolons
Durant des années
ITALIE
Entends braire l’âne boche
Faisons la guerre à coups de fouets
Faits avec les rayons du soleil
ITALIE
Chantons et rigolons
Durant des années
Guillaume Apollinaire.
18 Août 1915.
1916 §
Les Poètes de la Guerre , 1916Vers un village de l’arrière
S’en allaient quatre bombardiers
666 Ils étaient couverts de poussière
Depuis la tête jusqu’aux pieds.
Ils regardaient la vaste plaine,
En parlant entre eux du passé
Et ne se retournant qu’à peine,
Quand un obus avait toussé.
Tous quatre de la classe seize
667 ,
Parlaient d’antan, non d’avenir,
Ainsi se prolongeait l’ascèse
Qui les exerçait à mourir.
Guillaume APOLLINAIRE.
L’Élan , janvier 1916
par GUILLAUME APOLLINAIRE
Rameau central de combat, [obus]
Contact, par l’écoute,
On fore dans la direction des bruits « entendus »…
Les jeunes de la classe 1915, [étoile]
& ces fils de fer électrisés ?
Ne pleurez donc pas sur les horreurs de la guerre !
Avant elle nous n’avions que la surface
de la terre & des mers ; après elle nous aurons
les abîmes, le sous-sol & l’espace aviatique.
Maîtres du timon
après, après
nous prendrons toutes les joies
des vainqueurs qui se délassent :
femmes, jeux, usines, commerce,
industrie, agriculture, métal,
feu, cristal, vitesse, voix, regard,
.. et plus encore au delà de cette terre
[] L’image suit immédiatement le texte du dernier vers.
La Voce , janvier 1916Série sans titre670 671 §
Mon désir est la région qui est devant moi
Derrière les lignes boches
Mon désir est aussi derrière moi
Après la zône des armées
Mon désir c’est la butte du Tahure
Mon désir est là sur quoi je tire
De mon désir qui est au delà de la zône des armées
Je n’en parle pas aujourd’hui mais j’y pense
Butte de Tahure je t’imagine en vain
Des fils de fer des mitrailleuses des Boches trop sûrs d’eux
Trop enfoncés sous terre déjà enterrés
Ca ta clac des coups qui meurent en s’éloignant
En y veillant tard dans la nuit
Le Decauville qui toussote
La tole ondulée sous la pluie
Et sous la pluie ma bourguignote
Entends la terre véhémente
Vois les lueurs avant d’entendre les coups
Et tel obus siffler de la démence
Ou le tac tac tac monotone et bref plein de dégoût
Je te vois main de Massiges
Si décharnée sur la carte
Le boyau Gœthe où j’ai tiré
J’ai tiré même sur le boyau Nietzche
Décidément je ne respecte aucune gloire
Nuit violente et violette et sombre et pleine d’or par moments
Nuit des hommes seulement
Nuit du 24 septembre 1915
Demain l’assaut
Nuit violente ô nuit dont l’épouvantable cri profond devenait plus intense de minute en minute
Nuit des hommes seulement
Nuit qui criait comme une femme qui accouche
C’est 4 heures du matin
Je me lève tout habillé
Je tiens une savonnette
Que m’a envoyée quelqu’un que j’aime
Je vais me laver
Je sors du trou où nous dormons
Je suis dispos
Et content de pouvoir me laver ce qui ne m’est pas arrivé depuis trois jours
Suis lavé je vais me faire raser
Ensuite bleu de ciel je me confonds avec l’horizon jusqu’à la nuit et c’est un plaisir trés doux
676 De ne rien dire de plus, tout ce que je fais c’est un être invisible qui le fait
puis-qu’une fois boutonné tout bleu confondu dans le ciel je deviens invisible
Guillaume Apollinaire.
L’Élan , mars 1916Nuit d’avril : 1915677 678 §
Le ciel est étoilé par les obus des boches,
La forêt merveilleuse où je vis donne un bal,
La mitrailleuse joue un air à triples croches
Mais avez-vous le mot ? eh ! oui, le mot fatal :
« Aux créneaux, aux créneaux ! Laissez-là les pioches ! »
Comme un astre éperdu qui cherche ses saisons,
Cœur obus éclaté tu sifflais ta romance [étoiles]
Nous vous aimons,
ô vie et nous vous agaçons [trait]
Les obus miaulaient un amour à mourir
— Un amour qui se meurt est plus doux que les autres —
mon souffle nage au fleuve où le sang va tarir,
Les obus miaulaient… entends chanter les nôtres.
Pourpre amour salué par ceux qui vont périr !
Le printemps tout mouillé, la veilleuse l’attaque.
Il pleut, mon âme, il pleut, mais il pleut des yeux morts.
— Ulysse ! que de jours pour rentrer dans Ithaque ! —
Couche-toi sur la paille & songe un beau remords
qui, pur effet de l’art, soit aphrodisiaque.
Mais, Orgues, aux fétus de la paille où tu dors,
— L’hymne de l’avenir est paradisiaque [étoiles]
GUILLAUME APOLLINAIRE
lieutenant français d’infanterie en campagne
679
Le Double Bouquet , mars 1916Epître à Léo Larguier, caporal-brancardier, en réponse à la sienne680 681 §
« Léo Larguier :
Soldat mystique,
O brancardier !
Les vers du caporal plaisent au brigadier…
Ce secteur 114, est-ce Arras ou peut-être
La ferme Choléra sinon le bois Le Prêtre ?
Ici la fraise est rouge et les lilas sont morts,
La couleuvre se love en la paille où je dors
Quand s’éveille la nuit la Champagne Tonnante,
La nuit quand les convois traînent leur rumeur lente
A travers la Champagne où tonnent nos canons
Et les flacons ambrés…
Et si nous revenons,
Dieu ! que de souvenirs !…
Je suis gai, pas malade,
Et comme fut Ronsard : le chef d’une brigade
682 .
Agent de liaison, je suis bien aguerri.
J’ai l’air mâle et fier, j’ai même un peu maigri…
……………………………………………………………
683 Etes-vous en Argonne, ou dans le Labyrinthe ?
Moi, je ne suis pas loin de Reims la ville sainte ,
684 Je vis dans un marais, au fond d’un bois touffu,
Ma hutte est en roseaux et ma table est un fût
Que j’ai trouvé naguère au bord du Bras-de-Vesle
685 .
Le rossignol garrule et l’Amour renouvelle
686 Ce pendant que l’obus rapace en miaulant
Abat le sapin noir ou le bouleau si blanc.
Mais quand reverrons-nous une femme, une chambre ?
Quand nous reverrons-nous ? Mais, sera-ce en septembre ?…
Adieu, Léo Larguier !
ça barde en ce moment…
105 et 305… le beau bombardement !…
687 Je songe au mois de mars, à vous, à la tour Magne…
688 (Où est mon chocolat ?… Les rats ont tout croqué !…)
Et j’ajoute, mon cher, style communiqué :
« Duel d’artillerie, à minuit, en Champagne… »
GUILLAUME APOLLINAIRE.
Le i er juin 1915. »
SIC , avril 1916Soulevons la paille
Regardons la neige
Ecrivons des lettres
Attendons des ordres
Fumons la pipe
En songeant à l’amour
Les deux tours sont là
Regardons la rose
La fontaine n’a pas tari
Pas plus que l’or de la paille ne s’est terni
Regardons l’abeille
Et ne songeons pas à l’avenir
Regardons nos mains
Qui sont la neige
La rose et l’abeille
Ainsi que l’avenir
GUILLAUME APOLLINAIRE
Mercure de France , 1er avril 1916Epître à Léo Larguier, caporal-brancardier, en réponse à la sienne692 §
« Léo Larguier :
Soldat mystique,
O brancardier !
Les vers du caporal plaisent au brigadier…
Ce secteur 114, est-ce Arras ou peut-être
La ferme Choléra sinon le bois Le Prêtre ?
Ici la fraise est rouge et les lilas sont morts,
La couleuvre se love en la paille où je dors
Quand s’éveille la nuit la Champagne Tonnante,
La nuit quand les convois traînent leur rumeur lente
A travers la Champagne où tonnent nos canons
Et les flacons ambrés…
Et si nous revenons,
Dieu ! que de souvenirs !…
Je suis gai, pas malade,
Et comme fut Ronsard : le chef d’une brigade.
Agent de liaison, je suis bien aguerri.
J’ai l’air mâle et fier, j’ai même un peu maigri…
Etes-vous en Argonne, ou dans le Labyrinthe ?
Moi, je ne suis pas loin de Reims, la ville sainte,
Je vis dans un marais, au fond d’un bois touffu,
Ma hutte est en roseaux et ma table est un fût
Que j’ai trouvé naguère au bord du Bras-de-Vesle.
Le rossignol garrule et l’Amour renouvelle
Cependant que l’obus rapace en miaulant
Abat le sapin noir ou le bouleau si blanc.
Mais quand reverrons-nous une femme, une chambre ?
Quand nous reverrons-nous ? Mais, sera-ce en septembre ?…
Adieu Léo Larguier !
Ça barde en ce moment…
105 et 305… le beau bombardement !…
Je songe au mois de mars, à vous, à la tour Magne…
(Où est mon chocolat ?… Les rats ont tout croqué !…)
Et j’ajoute, mon cher, style communiqué :
« Duel d’artillerie, à minuit, en Champagne… »
Guillaume Apollinaire
Le ier juin 1915. »
Cabaret Voltaire , juin 1916Tu chantes avec les autres tandis que les phonographes galopent
Où sont les aveugles où s’en sont-ils allés
La seule feuille que j’aie cueillie s’est changée en plusieurs mirages
Ne m’abandonnez pas parmi cette foule de femmes au marché
Ispahan s’est fait un ciel de carreaux émaillés de bleu
Et je remonte avec vous une route aux environs de Lyon
Je n’ai pas oublié le son d’une clochette d’un marchand de coco autrefois
J’entends déjà le son aigre de cette voix à venir
Du camarade qui se promènera avec toi en Europe tout en restant
En Amérique
Un enfant
Un veau dépouillé pendu à l’étal
Un enfant
Et cette banlieue de sable autour d’une pauvre ville au fond de l’Est
Un douanier se tenait là comme un ange
A la porte d’un misérable paradis
Et ce voyageur épileptique écumait dans la salle d’attente des premières
Engoulevent Grondin Blaireau
Et la Taupe-Ariane
Nous avions loué deux coupés dans le transsibérien
Tour à tour nous dormions le voyageur en bijouterie et moi
Mais celui qui veillait ne cachait point un revolver aimé
Tu t’es promené à Leipzig avec une femme mince déguisée en homme
Intelligence car voilà ce que c’est qu’une femme intelligente
Et il ne faudrait pas oublier les légendes
Dame-Aboude dans un tramway ln nuit au fond d’un quartier désert
694 Je voyais une chasse tandis que je montais
Et l’ascenseur s’arrêtait à chaque étage
Entre les pierres
Entre les vêtements multicolores de la vitrine
Entre les charbons ardents du marchand de marrons
Entre deux vaisseaux norvégiens amarrés à Rouen
Il y a ton image
Elle pousse entre les bouleaux de la Finlande
Ce beau nègre en acier
La plus grande tristesse
C’est quand tu reçus une carte postale de La Co rogne
Le vent vient du couchant
Le métal des caroubiers
Tout est plus triste qu’autrefois
Tous les dieux terrestres vieillissent
L’univers se plaint par ta voix
Et des êtres nouveaux surgissent
Trois par trois
GUILLAUME APOLLINAIRE
SIC , juillet 1916Poème (incipit : « Deux lacs nègres »)695 696 697 §
I [apo-P_1916-07_sic_p004a] §
Deux lacs nègres
Entre une forêt
Et une chemise qui sèche
II [apo-P_1916-07_sic_p004b] §
Bouche ouverte sur une harmonium
698 C’était une voix faite d’yeux
Tandis qu’il traîne de petites gens
III [apo-P_1916-07_sic_p004c] §
Une petite vieille au nez pointu
J’admire la bouillotte d’émail bleu
Mais le rat pénètre dans le cadavre et y demeure
IV [apo-P_1916-07_sic_p004d] §
Un monsieur en bras de chemise
Se rase près de la fenêtre
En chantant un petit air qu’il ne sait pas très bien
Ça fait tout un opéra.
V [apo-P_1916-07_sic_p004e] §
Toi qui te tournes vers le roi
Est-ce que Dieu voudrait mourir encore
GUILLAUME APOLLINAIRE
L’Union des automobilistes & aviateurs militaires , juillet 1916Poèmes de guerre699 §
la nuit d’avril 1915700 701 §
Le ciel est étoilé par les obus des Boches
La forêt merveilleuse où je vis donne un bal
La mitrailleuse joue un air à triples croches
Mais avez-vous le mot eh oui le mot fatal
Aux créneaux aux créneaux laissez-là les pioches
*
Comme un astre éperdu qui cherche ses saisons
Cœur obus éclaté tu sifflais ta romance
Et tes mille soleils ont vidé les caissons
Que les dieux de mes yeux remplissent en silence
Nous nous aimons ô Vie et nous nous agaçons
*
Les obus miaulaient un amour à mourir
Un amour qui se meurt est plus doux que les autres
Mon souffle nage au fleuve où le sang va tarir
Les obus miaulaient entends chanter les nôtres
Pourpre Amour salué par ceux qui vont périr
*
Le printemps tout mouillé la veilleuse l’attaque
Il pleut mon âme il pleut mais il pleut des yeux morts
—
Ulysse que de jours pour rentrer dans Ithaque
—
Couche-toi sur la paille et songe un beau remords
Qui par effet de l’art soit aphrodisiaque
*
Mais O
rgues
aux fétus de la paille où tu dors
L’hymne de l’avenir est paradisiaque
La boucle des cheveux noirs de ta nuque est mon trésor
Ma pensée te rejoint et la tienne la croise
*
Tes seins sont les seuls obus que j’aime
Ton souvenir est la lanterne de repérage qui nous sert à pointer la nuit
*
En voyant la large croupe de mon cheval j’ai pensé à tes hanches
*
Voici les fantassins qui s’en vont à l’arrière en lisant un journal
*
Le chien du brancardier revient avec une pipe dans sa gueule
*
Un chat-huant aile fauve yeux ternes gueule de petit chat et pattes de chat
*
Une souris verte file parmi la mousse
*
Notre amour est un sous les étoiles
*
Le riz a brûlé dans la marmite du campement
Ça signifie qu’il faut prendre garde à bien des choses
*
Le mégaphone crie « allongez le tir »
*
Allongez le tir amour de vos batteries
*
Balance des batteries lourdes cymbales qu’agitent les chérubins fous d’amour
En l’honneur du Dieu des armées
*
Un arbre dépouillé sur une butte
*
Le bruit des tracteurs qui grimpent dans la vallée
*
O vieux monde du
XIX
e
siècle plein de hautes cheminées si belles et si pures
*
Virilités du siècle où nous sommes
O canons
*
Douilles éclatantes des obus de 75 carillonnez pieusement
Guillaume Apollinaire
Mercure de France , 1er juillet 1916Lueurs des tirs705 706 §
La Grâce exilée707 708 §
Va-t’en va-t’en mon arc-en-ciel
Allez-vous-en couleurs charmantes
Cet exil t’est essentiel
Infante aux écharpes changeantes
Et l’Arc-en-ciel est exilé
Puisqu’on exile qui l’irise
Mais un drapeau s’est envolé
Prendre ta place au vent de bise
La Boucle retrouvée709 710 §
Il retrouve dans sa mémoire
La boucle de cheveux châtains
T’en souvient-il à n’y point croire
De nos deux étranges destins
Du boulevard de la Chapelle
Du joli Montmartre et d’Auteuil
Je me souviens murmure-t-elle
Du jour où j’ai franchi ton seuil
Il y tomba comme un automne
La boucle de ton souvenir
Et notre destin qui t’étonne
Se joint au jour qui va finir
Refus de la colombe711 712 §
Mensonge de l’annonciade
La Noël fut la Passion
Et qu’elle était charmante et sade
Cette renonciation
Si la colombe poignardée
Saigne encore de son refus
J’en plume les ailes l’idée
Et le poème que tu fus
Les Feux du bivouac713 714 §
Les feux mourants du bivouac
Éclairent des formes de rêve
Et le songe dans l’entrelac
Des branches lentement s’élève
Voici les dédains du regret
Tout écorché comme une fraise
Le souvenir et le secret
Dont il ne reste que la braise
Les Grenadines repentantes715 716 §
En est-il donc deux dans Grenade
Qui pleurent sur ton seul péché
Ici l’on jette la grenade
Qui se change en un œuf coché
Puisqu’il en naît des coqs Infante
Entends-les chanter leurs dédains
Et que la grenade est touchante
Dans nos effroyables jardins
Tourbillon de mouches717 718 §
Un cavalier va dans la plaine
La jeune fille pense à lui
719 Et cette flotte à Mytilène
Le fil de fer est là qui luit
Comme ils cueillaient la rose ardente
Leurs yeux tout à coup ont fleuri
Et quel soleil la bouche errante
A qui la bouche avait souri
L’Adieu du cavalier720 721 §
Ah Dieu ! que la guerre est jolie
Avec ses chants ses longs loisirs
Cette bague je l’ai polie
Le vent se mêle à vos soupirs
Adieu ! voici le boute-selle
Il disparut dans un tournant
Et mourut là-bas tandis qu’elle
Riait au Destin surprenant
722
Chant de l’horizon en Champagne723 724 725 §
à Monsieur le substitut Granié
726 Voici le tétin rose de l’euphorbe verruquée
Voici les nez des soldats invisibles
Horizon invisible je chante
Que les civils et les femmes écoutent les chansons
Et voici d’abord la cantilène du brancardier blessé
Le sol est blanc la nuit l’azure
Saigne la crucifixion
Tandis que saigne la blessure
Du soldat de Promission
Un chien jappait l’obus miaule
La lueur muette a jailli
A savoir si la guerre est drôle
Les masques n’ont pas tressailli
Mais quel fou rire sous le masque
Blancheur éternelle d’ici
Où la colombe porte un casque
Et l’acier s’envole aussi
Je suis seul sur le chant de bataille
Tranchée blanche bois vert et roux
L’obus miaule
Je te tuerai
Animez vos fantassins à passepoil jaune
Les grands artilleurs roux comme des taupes
Bleu de roi comme les golfes méditerranéens
Veloutés de toutes les nuances du velours
Ou mauves encore ou bleu comme les autres
Ou déteints
Venez le pot en tête
Debout fusée éclairante
Danse grenadier en agitant tes pommes de pin
Alidades des triangles de visée pointez-vous sur les lueurs
Creusez des trous enfants de 20 ans creusez des trous
Sculptez les profondeurs
Envolez-vous essaims des avions blonds ainsi que les avettes
Moi l’horizon je fais la roue comme un grand paon
Ecoutez renaître les oracles qui avaient cessé
Le grand Pan est ressuscité
Champagne viril qui émoustille la Champagne
Hommes faits jeunes-gens
Caméléons des autos-canons
Et vous classe 15
Craquements des arrivées ou bien flottaison blanche dans les cieux
J’étais content pourtant ça brûlait la paupière
Les officiers captifs voulaient cacher leurs noms
Œil du Breton blessé couché sur la civière
Et qui criait aux morts aux sapins aux canons
Priez pour moi Bon Dieu ! je suis le pauvre Pierre
Boyaux et rumeur du canon
Sur cette mer aux blanches vagues
Fou stoïque comme Zénon
Pilote du cœur tu zigzagues
Petites forêts de sapins
La nichée attend la becquée
Pointe-t-il des nez de lapins
Comme l’euphorbe verruquée
Ainsi que l’euphorbe d’ici
Le soleil à peine boutonne
Je l’adore comme un Parsi
Ce tout petit soleil d’automne
Un fantassin presque un enfant
Pur comme le jour qui s’écoule
Pur comme mon cœur triomphant
Disait en mettant sa cagoule
Tandis que nous n’y sommes pas
Que de filles deviennent belles
Voici l’hiver et pas à pas
Leur beauté s’éloignera d’elles
O lueurs soudaines des tirs
Cette beauté que j’imagine
Faute d’avoir des souvenirs
Tire de vous son origine
Car elle n’est rien que l’ardeur
De la bataille violente
Et de la terrible lueur
Il se fait une muse ardente
Il regarde longtemps l’horizon
Couteaux tonneaux d’eaux
Des lanternes allumées se sont croisées
Moi l’horizon je combattrai pour la victoire
Je suis l’invisible qui ne peut disparaître
Je suis comme l’onde
Allons ouvrez les écluses que je me précipite et renverse tout
Guillaume Apollinaire.
Aux armées, septembre-octobre 1915.
Album-catalogue de l’exposition André Derain , octobre 1916Voyage (incipit : « Du joli bateau de Port-Vendres »)727 728 §
A M. P.
Du joli bateau de Port-Vendres
Tes yeux étaient les matelots
Et comme les flots étaient tendres
Dans les parages de Palos
Que de sous-marins dans mon âme
Naviguent et vont l’attendant
Le superbe navire où clame
Le chœur de ton regard ardent
Guillaume Apollinaire
L’Œuvre , 23 octobre 1916Poème (incipit : « Deux lignes nègres »)729 730 §
I [apo-P_1916-10-23_oeuvre_p002a] §
Deux lignes nègres
Entre deux forêts
Et une chemise qui sèche
II [apo-P_1916-10-23_oeuvre_p002b] §
Bouche ouverte sur un harmonium
C’était une voix faite d’yeux
Tandis qu’il est de petites gens
III [apo-P_1916-10-23_oeuvre_p002c] §
Une petite vieille au nez pointu
J’admire une bouillotte d’émail bleu
Mais le rat rentre dans le cadavre et y demeure
IV [apo-P_1916-10-23_oeuvre_p002d] §
Un monsieur en bras de chemise
Se rase près de la fenêtre
En chantant un petit air qu’il ne sait pas très bien
Et ça fait tout un opéra.
Le Rire aux éclats , novembre-décembre 1916Ah ! que c’est bien rire aux éclats
Que c’est bien de n’être pas las,
De sourire dans la tourmente
Dans la terre, (et n’oubliez pas
Que les Boches l’appellent Erde )
Entre deux combats, deux repas
Plus d’un brave poilu s’emm…
On ne peut s’amuser toujours
Du parfum qui subtil émane ;
(Quelle friture aux p’tits amours !)
D’en face chez le pétomane
On n’a pas toujours du pinard,
Corniflot, tacot, cric ou gnolle
734 ;
Les bagues, c’est bien en retard ;
Lettres aux marraines, c’est gnolle.
C’est pourquoi Le Rire aux Eclats
Est une idée exquise et crâne
Et naguère, au temps des lilas
L’Eclat tempêta sous mon crâne
735 .
J’en ris comme l’on rira
De vos Eclats que tous vont lire.
Riez poilus ! On les aura
Par le courage et le sourire !
Guillaume Apollinaire.
6 poèmes , 24 novembre 1916Tristesse d’une étoile736 737 §
Une belle Minerve est l’enfant de ma tête
738 Une étoile de sang me couronne à jamais
La raison est mon fond et le ciel est mon faîte
739 Du chef où dès longtemps Déesse tu t’armais
C’est pourquoi de mes maux ce n’était pas le pire
Ce trou presque mortel et qui s’est étoilé
Mais le secret malheur qui nourrit mon délire
Est bien plus grand qu’aucun âme ait jamais celé
740 Et je porte avec moi cette ardente souffrance
Comme le ver luisant tient son corps enflammé
Comme au cœur du soldat Il palpite la France
Et comme au cœur du lys le pollen parfumé
SIC , décembre 1916Il pleut741 §
Il pleut des voix de femmes comme si elles étaient mortes même dans le souvenir
c’est vous aussi qu’il pleur merveilleuses rencontres de ma vie ô gouttelettes
et ces nuages cabrés se prennent à hennir tout comme un univers de villes auriculaires
écoute s’il pleut tandis que le regret et le dédain pleurent une ancienne musique
écoute tomber les liens qui te retiennent en haut et en bas
GUILLAUME APOLLINAIRE
742
L’Élan , décembre 1916Fête (incipit : « Feu d’artifice en acier »)743 744 §
à André Rouveyre.
Feu d’artifice en acier…
Qu’il est charmant, cet éclairage !
Artifice d’artificier :
mêler quelque grâce au courage.
Deux fusants — rose éclatement,
comme deux seins que l’on dégrafe
tendent leurs bouts insolemment.
Il sut aimer … Quelle épitaphe !
Un poète dans la forêt
regarde avec indifférence
— son revolver au cran d’arrêt —
des roses mourir d’espérance.
Il songe aux roses de Saadi…
Et soudain sa tête se penche,
car une rose lui redit
la molle courbe d’une hanche.
L’air est plein d’un terrible alcool
filtré des étoiles mi-closes…
Les obus caressent le mol
parfum nocturne où tu reposes,
Mortification des roses !
GUILLAUME APOLLINAIRE.
1917 §
Peintures de Léopold Survage, dessins et aquarelles d’Irène Lagut , janvier 1917Série sans titre745 746 §
[Page 1]747 §
Lorsque j’ai connu Léopold Survage il vivait dans un atelier si misérable qu’on y cuisait quand il faisait du soleil, tandis qu’on y gelait l’hiver, et quand il pleuvait on y était aussi trempé que si on s’était mis sous une gouttière. Léopold Survage avait inventé l’art nouveau de la peinture en mouvement : le Rythme coloré . Il y avait travaillé pendant des années, vivant modestement du produit d’un métier manuel qui est celui d’accordeur de piano. Il avait été amené à exercer ce métier par l’entêtement d’un père, grand fabricant de pianos. Ne voulant pas qu’il fût peintre, il exigeait que son fils devint un industriel. Ce Rythme coloré auquel il consacrait ses veilles fut mis au point. Et au moment de la déclaration de guerre allait se manifester au public grâce au Ciné, ce formidable moyen de propagande. La guerre interrompit ces projets qui seront repris et nul doute que les « Concerts lumineux » ne séduisent un jour les dilettantes autant que la musique des sons.
Le Rythme coloré avait développé les qualités plastiques que l’on trouve déjà dans les plus anciens essais picturaux de Léopold Survage. Les efforts qu’il a faits pour donner une vie à la nuance pure l’ont mis à même d’aborder la peinture avec des moyens tous nouveaux.
J’ai senti, pour ma part, un tel accord entre les détails proches et lointains, les précisions anciennes ou futures que l’avenir trouvera dans mes poèmes et la lyrique transfiguration urbaine que l’on trouve dans les tableaux de Survage que j’ai regardé ces ouvrages avec une tendresse fraternelle. J’aime aussi le côté poétique et touchant de ses ouvrages, la fraîcheur de ses bouquets, la simplicité des fruits, des fleurs et des feuilles.
Nul avant Survage n’a su mettre dans une seule toile, une ville entière avec l’intérieur de ses maisons
Et cette ombre humaine qui surgit aux carrefours
[Page 2]748 §
Poème sans titre (incipit : « Il y aura l’âge des choses ») §
Il y aura l’âge des choses
légères, On dépensera des millions
pour des choses qui serviront
durant une minute et qui s’
évanouiront, et des chefs-d’œuvre
seront aussi aériens
que les aviateurs.
[Calligramme (cheval)] §
[cheval] Homme
vous trouverez ici une nouvelle représentation de l’univers en ce qu’il a de plus poétique et de plus moderne
Homme Homme Homme Homme Homme Homme Homme Homme
Laissez-vous allez à cet art où le sublime n’exclut pas le charme et l’éclat ne brouille pas la nuance
c’est l’heure d’être sensible à la poésie car elle domine
tout terriblement
Guillaume Apollinaire
[Page 3]749 §
[Irène Lagut. Introduction] §
Irène Lagut, dont nous eûmes l’occasion de goûter les premières tentatives artistiques durant les premiers mois de 1914, dans un atelier retiré de la rue Maison-Dieu, est une de ces singulières Satanes de l’Art qu’a fait jaillir la magnifique incertitude de notre âge.
Elle a un des dons les plus rares en peinture : celui de la grande mesure.
En elle, se mêlent de la plus bizarre façon le talent, le mépris, la sûreté d’elle-même et le manque d’intérêt pour les dons qui lui ont été départis, la ruse, la coquetterie, le snobisme, la grâce, le goût, la modestie, l’infernale discrétion, le désir de calme et le féerique esprit de révolte.
[Calligramme (chimère)] §
[chimère] Adieu !
à peine la nécessité
l’œillet
la rose
[Page 4]750 §
[Caligramme (silhouette de femme)] §
[silhouette de femme] Vive
Vive la France semble-t-il être écrit dans les dessins et dans les tableaux d’Irène Lagut
vive la France où l’art peut se renouveler si souvent et d’une manière toujours forte et toujours extrêmement gracieuse
[Calligramme (jet d’eau)] §
[jet d’eau] la lune ardente et toujours neuve un bouton de rose doux comme un papillon comme une fleur mourant entre les mains d’un soldat blessé un jet d’eau la queue d’un paon un soir de neige ciel constellé un bombardement un matin à New York les lucioles et tous les souvenirs
O quel bonheur que ce bleu ne soit pas mort encore
[Calligramme (bouquet)] §
[bouquet] Il y a aussi des fleurs vénéneuses pourquoi pleurer revenez demain et des fleurs toujours ouvertes
le soir
elle aime le ciné elle a été en Russie
l’amour marié avec le dédain montre en perles à Montrouge
un voyage
Maisons-Laffitte
et tout finit dans les parfums souvenez-vous-en
laisse s’ouvrir la fleur et laisse pourrir le fruit et laisse germer la graine tandis que soufflent les tempêtes
[Calligramme (jambe d’Arlequin)] §
[jambe d’Arlequin] et laissez le mystère de cette jambe d’Arlequin vous torturer le cœur
[Page 5]751 §
[Calligramme (paysage marin)] §
[paysage marin] les montagnes aux pentes tendres les petites villes maritimes l’attirent il sait qu’il y a encore bien des felouques et son souvenir s’accroche à la proue des polacres de la Méditerranée752
[Calligramme (horloge)] §
[horloge] il y en a tant qui fument des cigarettes pour passer le temps/ pardonne à celui qui connaît la source neuve et sait encore l’heure où elle tarira
[Calligramme (pont)] §
[pont] ce peintre est le fils de cette guerre calme et touffue
son œuvre est un pont entre ce que fut l’art avant la guerre et l’essor magnifique qui emportera les nouveaux peintres
mais il vaut mieux ne pas figurer cette idée-là
[Page 6]753 §
[Calligramme (lunettes)] §
[lunettes] il a contemplé les foules et il en a exprimé la vie par le moyen de quelques ombres humaines il n’attend pas que le temps donne de l’originalité à ses sensations
il est sûr de lui
il sait donner une ordonnance à la fois pompeuse et familière à tous les détails, si bien que dans ce qui est si naturel dans son œuvre, on pourrait le comparer à l’art du dramaturge
[Calligramme (maison)] §
[maison] Survage est le nom qui lui convient car l’homme moderne est un sauvage supérieur notre civilisation quoi qu’on pense n’est plus fondée sur les canons de la beauté humaine tous les efforts des artistes depuis l’impressionnisme ont tendu à retrouver le moyen de se rattacher au grand art pour absorber la vie et la tuer définitivement
[Page 7]754 §
[Calligramme (oiseau)] §
[oiseau] Retenez son nom elle porte en elle des millions d’oiseaux qui donnent une couleur inconnue au ciel de la région où vivent ses personnages familiers, une mouche sur un morceau de sucre, un bouledogue blanc, un oiseau dans une cage une écuyère dans un cirque ouvert à tous les vents, une amazone, un concombre des grappes de raisin, un profil d’homme à la tête bandée une femme nue qui rêve des chevaux à l’écurie et des cavaliers à la guerre
[Calligramme (sphère)] §
[sphère] La famille des funambules s’est attablée autour d’une table pour tirer les rois Devinez qui a la fève ? Le regret confine au Dédain Il y a des chiens singuliers qui ont l’air de savoir faire un chapeau ce n’est pas un métier moderne il faut que les galettes mêmes deviennent modernes
SIC , février 1917Un poème755 §
Il est entré
Il s’est assis
Il ne regarde pas le pyrogène à cheveux rouges
756 L’allumette flambe
Il est parti
Guillaume APOLLINAIRE.
Nord-Sud , mars 1917Un coq chante je rêve et les feuillards agitent
Leurs feuilles qui ressemblent à de pauvres marins
Ailés et tournoyants comme Icare le faux
Des aveugles gesticulant comme des fourmis
Se miraient sous la pluie aux reflets du trottoir
Leurs rires amassés en grappes de raisin
Ne sors plus de chez moi diamant qui parlais
Dors doucement tu es chez toi tout t’appartient
Mon lit ma lampe et mon casque troué
Regards précieux saphirs taillés aux environs de Saint-Claude
Tes joues étaient une pure émeraude
Je me souviens de toi ville des météores
Ils fleurissaient en l’air pendant ces nuits où rien ne dort
Jardins de la lumière où j’ai cueilli des bouquets
Tu dois en avoir assez de faire peur à ce ciel
Qu’il garde son hoquet
On imagine difficilement
A quel point le succès rend les gens stupides et tranquilles
A l’Institut des jeunes aveugles on a demandé
N’avez-vous point ici de jeune aveugle ailé
O Bouches l’homme est à la recherche d’un nouveau langage
Auquel le grammairien d’aucune langue n’aura rien à dire
Et ces vieilles langues sont tellement près de mourir
Que c’est vraiment par habitude et manque d’audace
Qu’on les fait encore servir à la poésie
Mais entêtons-nous à parler
Remuons la langue
Lançons des postillons
On veut de nouveaux sons
de nouveaux sons
de nouveaux sons
On veut des consonnes sans voyelles
Des consonnes qui pètent sourdement
Imitez le son de la toupie
Laissez petiller un son nasal et continu
Faites claquer votre langue
Servez-vous du bruit sourd de celui qui mange sans civilité
Le raclement aspiré du crachement ferait aussi une belle consonne
Les divers pets labiaux rendraient aussi vos discours claironnants
Habituez-vous à roter à volonté
Et quelle lettre grave comme un son de cloche
A travers nos mémoires
Nous n’aimons pas assez la joie
De voir de belles choses neuves
O mon amie hâte-toi,
Crains qu’un jour un train ne t’émeuve
Plus
Regarde-le vite pour toi
Ces chemins de fer qui circulent
Sortiront bientôt de la vie
Ils seront beaux et ridicules
Deux lampes brûlent devant moi
Comme deux femmes qui rient
Je courbe tristement la tête
Devant l’ardente moquerie
Ce rire se répand
Partout
Parlez avec les mains faites claquer vos doigts
Tapez-vous sur la joue comme sur un tambour
O paroles
Elles suivent dans la myrtaie
L’Eros et l’Antéros en larmes
Je suis le ciel de la cité
Ecoutez la mer
La mer peiner au loin et crier toute seule
Ma voix fidèle comme l’ombre
Veut être enfin l’ombre de la vie
Veut être ô mer vivante infidèle comme toi
La mer qui a trahi des matelots sans nombre
Engloutit mes grands cris comme des dieux noyés
Et la mer au soleil ne supporte que l’ombre
Que jettent des oiseaux les ailes éployées
La parole est soudaine et c’est un dieu qui tremble
Avance et soutiens-moi je regrette les mains
De ceux qui les tendaient et m’adoraient ensemble
Quelle oasis de bras m’accueillera demain
Connais-tu cette joie de voir des choses neuves
O Voix, je parle le langage de la mer
Et dans le port la nuit les dernières tavernes
Moi qui suis plus têtu que non l’hydre de Lerne
759 La rue où nagent mes deux mains
Aux doigts subtils fouillant la ville
S’en va
Mais qui sait si demain
La rue devenait immobile
Qui sait où serait mon chemin
Songe que les chemins de fer
Seront démodés et abandonnés dans peu de temps
Regarde
La victoire avant tout sera
De bien voir au loin
Et de tout voir
De près
Et que tout
Ait un nom nouveau
Guillaume APOLLINAIRE.
391 , mars 1917L’Horloge de demain760 761 §
[browning] il te revient des parfums passés mais tu vois des êtres qui vont exister qui se préparent
[soldat] je me souviens de la Provence du danseur du Nord Hélas où est ton cœur
[périscope] pour te faire un enfer artificiel ne sois pas fragile surtout
[cœur] un cœur plein de tous les printemps
[hors motifs] le bonheur et le malheur marchent de compagnie/
Ecoutez-moi bien
il y va de la vie
et tant de nouvelles
Ecoutez-moi tous
La Revue normande , avril-mai 1917
A Pierre VARENNE
Des cloches sonnent dans Paris
Il me semble que c’était avant la guerre
Le vieux monde pleure encore
Il était si doux si joli
Que de choses bonnes pour les antiquaires
Depuis
depuis la guerre
Maintenant tout est énorme
Et il me semble que la paix
Sera aussi monstrueuse que la guerre
O temps de la tyrannie
Démocratique
Beau temps où il faudra s’aimer les uns les autres
Et n’être aimé de personne
Ne rien laisser derrière soi
Et préparer le plaisir de tout le monde
Ni trop sublime ni trop infime
[à gauche, horizontalement]
Voici venir les bannières Démocratiques
ô Cortèges ô fanfares ô tumultes
[à gauche, verticalement de droite à gauche] J’entends encore le son des cloches
[à droite, verticalement de droite à gauche] Le tic tac de mon réveille-matin
Guillaume APOLLINAIRE.
SIC , avril 1917
Deux dames le long le long du fleuve
Elles se parlent par-dessus l’eau
Et sur le pont de leurs paroles
La foule passe et repasse en dansant
un dieu
tu reviendras
Hi ! oh ! Là-bas
Là-bas
[à gauche, un mot par ligne] c’est pour toi seule que le sang coule
Tous les enfants savent pourquoi
Passe mais passe donc
Ne te retourne pas
Hi ! oh ! là-bas là-bas
Les jeunes filles qui passent sur le pont léger
portent dans leurs mains
le bouquet de demain
Et leurs regards s’écoulent
Dans ce fleuve à tous étranger
Qui vient de loin qui va si loin
Et passe sous le pont léger de vos paroles
O Bavardes le long du fleuve
O Bavardes o folles le long du fleuve
767 GUILLAUME APOLLINAIRE
Nord-Sud , avril 1917Série sans titre768 §
Avant le cinéma (Après le cinéma)769 770 §
Et puis ce soir on s’en ira
Au cinéma
Les Artistes que sont-ce donc
Ce ne sont plus ceux qui cultivent les Beaux-Arts.
Ce ne sont pas ceux qui s’occupent de l’Art
Art poétique ou bien musique
Les Artistes ce sont les acteurs et les actrices
Si nous étions des Artistes
Nous ne dirions pas le cinéma
Nous dirions le ciné
Mais si nous étions de vieux professeurs de province
Nous ne dirions ni ciné ni cinéma
Mais cinématographe
Aussi mon Dieu faut-il avoir du goût
Des villages flambaient dans la nuit intérieure
Une fermière conduit son auto sur une route vers Galveston
773 Qui a lancé cette fusée-signal
Néanmoins tu feras bien de tenir la porte ouverte
Et puis le vent scieur de long
774 Suscitera en toi la terreur des fantômes
Ta langue
Le poisson rouge dans le bocal
De ta voix
Mais ce regret
A peine une infirmière plus blanche que l’hiver
Eblouissant tandis qu’à l’horizon décroît
Un régiment de jours plus bleus que les collines
lointaines et plus doux que ne sont les coussins de l’auto
GUILLAUME APOLLINAIRE.
Pierre-Albert Birot, Trente et un poèmes de poche , avril 1917
Poèmepréfaceprophétie775 776 §
Pierre Albert-Birot est une sorte de pyrogène
777 Si vous voulez enflammer des allumettes
Frottez-les donc sur lui
Elles ont des chances de prendre
Trop peu de pyrogènes aujourd’hui
Mais je ne dis rien des allumettes
Il m’a demandé une préface
C’est-à-dire une prophétie
Cependant je n’ai pas le front de prophétiser
Voici donc un poème
Puisque j’aime et que nous aimons les poètes
Mais si vous saviez comme j’aime les prophètes
Et cependant comme j’aime avant tout la réalité
L’avenir m’importe peu
Mais lui Pierre Albert-Birot il est
Avec vous
Avec moi
Le présent
Ce que fait Pierre Albert-Birot est si dépouillé
Ou plein d’une telle simplicité
Qu’à l’abord il surprend désagréablement
C’est qu’il n’a pas peur
Qu’on l’appelle un « primaire »
On aurait pu en dire autant à Charlemagne
Si modeste qu’il a si longtemps gardé l’anonymat
Il est orgueilleux à l’extrême
Pour ceux qu’il affectionne pour ce qu’il aime
Non pour lui-même
Et avant toute chose cela seul prouve qu’il y a
ainsi en lui cet esprit moderne qui est ce qu’il y a
au monde
de plus éloigné de tout égoïsme
La tendresse est la réalité
Où il découvre des nouveautés poétiques
Elles sont formelles ou lyriques
Et si conformes à la vérité
Qu’on s’étonnera avant dix ans
D’avoir pu en être étonné
Et fraternellement je lui donne l’accolade
Et offre à son baiser de paix
La Margelle du Puits Capital
778
GUILLAUME APOLLINAIRE
La Brigata , mai 1917le voyage du Kabyle779 780 §
Belle couleur du Pobiron
781
[à droite, verticalement de gauche à droite] il n’écoute pas il marche vite
et chacun danse à sa manière
lorsque la journée est belle
[à droite, verticalement de droite à gauche] Ordres de Bourse
Dans l’Ombre ou bien dans la lumière
Jusqu’au faux pas pis qu’au trépas
782 Des doigts d’ivoire mourir sur des tombes jaunies
783 il est des jours où j’aime où j’aime
il est des jours où je désaime
Dans la fumée d’un cigare
j’ai vu des mondes des moustres des spirales
784 La boite d’allumettes
Et vous monsieur Bichon
Les râles des mourants
Mourant dans leurs maisons
En automne avec les feuilles
Demain douteux demain
[à gauche, verticalement de droite à gauche] quelques oranges
[à droite, verticalement de droite à gauche] DANS LE JARDIN
Et nous n’avons rien dit
extase d’anges
claquants des dents
De loin un doigt levé
Jamais
Dormons
Dormez
Guillaume Apollinaire
SIC , mai 1917
Voyez ce peintre il prend les choses avec leur ombre aussi et d’un coup d’œil sublimatoire
Il se déchire en accords profonds et agréables à respirer tel l’orgue que j’aime entendre
Des Arlequines jouent dans le rose et bleus d’un beau-ciel Ce souvenir revit
les rêves et les actives mains Orient plein de glaciers L’hiver est rigoureux
Lustres or toile irisée or loi des stries de feu fond en murmurant.
Bleu flamme légère argent des ondes bleues après le grand cri
Tout en restant elles touchent cette sirène violon
Faons lourdes ailes l’incandesce quelques brasses encore
Bourdons femmes striées éclat de plongeon-diamant
Arlequins semblables à Dieu en variété Aussi distingués qu’un lac
Fleurs brillant comme deux perles monstres qui palpitent
Lys cerclés d’or, je n’étais pas seul ! fais onduler les remords
Nouveau monde très matinal montant de l’énorme mer
L’aventure de ce vieux cheval en Amérique
Au soir de la pêche merveilleuse l’œil du masque
Air de petits violons au fond des anges rangés
Dans le couchant puis au bout de l’an des dieux
Regarde la tête géante et immense la main verte
L’argent sera vite remplacé par tout notre or
Morte pendue à l’hameçon… c’est la danse bleue
L’humide voix des acrobates des maisons
Grimace parmi les assauts du vent qui s’assoupit
Ouis les vagues et le fracas d’une femme bleue
Enfin la grotte à l’atmosphère dorée par la vertu
Ce saphir veiné il faut rire !
Rois de phosphore sous les arbres les bottines entre des plumes bleues
La danse des dix mouches lui fait face quand il songe à toi
Le cadre bleu tandis que l’air agile s’ouvrait aussi
Au milieu des regrets dans une vaste grotte.
Prends les araignées roses à la nage
Regrets d’invisibles pièges l’air
Paisible se souleva mais sur le clavier musiques
Guitare-tempête ô gai trémolo
O gai trémolo ô gai trémolo
Il ne rit pas l’artiste-peintre
Ton pauvre étincellement pâle
L’ombre agile d’un soir d’été qui meurt
Immense désir et l’aube émerge des eaux si lumineuses
Je vis nos yeux diamants enfermer le reflet du ciel vert et
J’entendis sa voix qui dorait les forêts tandis que vous pleuriez
L’acrobate à cheval le poète à moustaches un oiseau mort et tant d’enfants sans larmes
Choses cassées des livres déchirés des couches de poussière et des aurores déferlant !
Guillaume APOLLINAIRE
Nord-Sud , mai 1917Allons plus vite788 789 §
Et le soir vient et les lys meurent
Regarde ma douleur beau ciel qui me l’envoyes
une nuit de mélancolie
Enfant souris ô sœur écoute
Pauvres marchez sur la grand route
O menteuse forêt qui surgis à ma voix
Les flammes qui brûlent les âmes
Sur le Boulevard de Grenelle
Les ouvriers et les patrons
790 Arbres de mai cette dentelle
ne fais donc pas le fanfaron
Allons plus vite nom de Dieu
Allons plus vite
Tous les poteaux télégraphiques
Viennent là-bas le long du quai
Sur son sein notre République
A mis ce bouquet de muguet
qui poussait drû le long du quai
Allons plus vite nom de Dieu
Allons plus vite
La bouche en cœur Pauline honteuse
Les ouvriers et les patrons
Oui-dà oui-dà belle endormeuse
Allons plus vite nom de Dieu
Allons plus vite
GUILLAUME APOLLINAIRE
Avanscoperta , mai 1917A l’Italie (incipit : « Italie des temps passés de tous les temps »)792 793 §
Italie des temps passés de tous les temps
Je t’aime
Autant que tu aimas la beauté des tous les temps
Mais je t’aime davantage encore
Italie qui fais la guerre
Moderne Italie
O Electrique
Toi qui glisses en ski sur les pontes blanches
795 Italie
Dont les jeunes gens grandissent dans l’ascèse
Italie
Dont les vieillards s’en vont majestueusement
Tu t’envoles
Tu étincelles
Italie
GUILLAUME APOLLINAIRE
Nord-Sud , juin-juillet 1917Série sans titre799 §
Notre amour est réglé par les calmes étoiles
Or nous savons qu’en nous beaucoup d’hommes respirent
Qui vinrent de très loin et sont un sous nos fronts
C’est la chanson des rêveurs
Qui s’étaient arraché le cœur
Et le portaient dans la main droite
Souviens-t’en cher orgueil de tous ces souvenirs
Des marins qui chantaient comme des conquérants
Des gouffres de Thulé des tendres cieux d’
Ophir
802 Des malades maudits de ceux qui fuient leur ombre
Et du retour joyeux des heureux émigrants
De ce cœur il coulait du sang
Et le rêveur allait pensant
A sa blessure délicate
Tu ne briseras pas la chaîne de ces causes
Et douloureuse et nous disait
qui sont les effets d’autres causes
Mon pauvre cœur mon cœur brisé
Pareil au cœur de tous les hommes
Voici voici nos mains que la vie fit esclaves
Est mort d’amour ou c’est tout comme
Est mort d’amour et le voici Ainsi vont toutes choses
Arrachez donc le vôtre aussi
Et rien ne sera libre jusqu’à la fin des temps
Laissons tout aux morts
Et cachons nos sanglots
GUILLAUME APOLLINAIRE
Jeune homme
de vingt ans
Qui as vu des choses si affreuses
Que penses-tu des hommes de ton enfance
[à droite]
Tu connais la bravoure et la ruse
[transversalement]
Tu as vu la mort en face plus de cent fois tu ne sais pas ce que c’est que la vie
[à gauche]
Transmets ton intrépidité
A ceux qui viendront
Après toi
Jeune homme
Tu es joyeux ta mémoire est ensanglantée
Ton âme est rouge aussi
De joie
Tu as absorbé la vie de ceux qui sont morts près de toi
Tu as de la décision
Il est 17 heures et tu saurais
mourir
Sinon mieux que tes aînés
Du moins plus pieusement
car tu connais mieux la mort que la vie
O douceur d’autrefois
lenteur immémoriale
GUILLAUME APOLLINAIRE
SIC , juin 1917Six Poèmes805 §
à Louise Marion806 807 §
Louise-Marion vous fûtes admirable
Gonflant d’esprit tout neuf vos multiples tétons
La féconde raison a jailli de ma fable
808 Plus de femme stérile et non plus d’avortons
Votre voix a changé l’avenir de la France
Et les ventres partout tressaillent d’espérance.
à Jean Thillois809 810 §
Vous fûtes le mari sublime ingénieux
Qui faisant des enfants nous suscite des dieux
Mieux armés plus unis plus savants plus dociles
Plus forts et plus hardis que nous n’avons été
La Victoire sourit à leurs destins habiles
Et célébrant dans l’ordre et la prospérité
Votre civique sens votre fécondité
Ils seront tous un jour l’orgueil de la Cité.
à Yeta Daesslé811 812 §
Étiez-vous bien à Zanzibar Monsieur Lacouf
Qui mourûtes et remourûtes sans dire ouf ?
Kiosque remuant qui portiez les nouvelles
Vous étiez un cerveau pour toutes les cervelles
Des pauvres spectateurs qui ne le savaient pas
Qu’il leur faut des enfants ou passer au trépas
Vous fûtes par deux fois la presse qui féconde
Le sens et la mémoire en l’un et l’autre monde
Déjà l’écho répète à l’envi vos échos
Merci chère Daesslé les petits moricauds
813 Qui pullulaient au 2e acte de mon drame
Grâce à vous deviendront de bons petits français
Blancs et roses ainsi que vous êtes Madame
Ce sera là notre succès
à Juliette Norville814 815 §
Voici le temps Madame où parlent les gens d’armes
J’en suis et c’est pourquoi suscitant les alarmes
J’ai parlé Vous étiez sur votre beau cheval
Vous représentiez l’ordre et par mont et par val
Nous faisions que revînt dans la race française
Le goût d’être nombreuse afin de vivre à l’aise
Ainsi que les enfants du mari de Thérèse
à Edmond Vallée816 817 §
Merci mon cher Presto
Qui mourûtes bientôt
Vous leur aviez déjà glacé le sang les moelles
Lorsque vous racontiez l’histoire des étoiles.
Vous étiez tout le peuple et gardiez le silence
Peuple de Zanzibar ou plutôt de la France
Il faut laisser le goût et garder la raison
Il faut voyager loin en aimant sa maison
Il faut chérir l’audace et chercher l’aventure
Il faut toujours penser à la France future
N’espérez nul repos risquez tout votre avoir
Apprenez du nouveau car il faut tout savoir
Lorsque crie un prophète il faut que l’alliez voir
Et faites des enfants c’est le but de mon conte
L’enfant est la richesse et la seule qui compte.
GUILLAUME APOLLINAIRE.
OST, Une tendance de la poésie contemporaine , 16 juin 1917
Vous voilà de nouveau près de moi
Souvenirs de mes compagnons morts à la guerre
L’olive du temps
Souvenirs qui n’en faites plus qu’un
Comme cent fourrures ne font qu’un manteau
Comme ces milliers de blessures ne font qu’un article de journal
Apparence impalpable et sombre qui avez pris
La forme changeante de mon ombre
Un indien à l’affût pendant l’éternité
Ombre vous rampez près de moi
Mais vous ne m’entendez plus
Vous ne connaîtrez plus les poèmes divins que je chante
Tandis que moi je vous entends je vous vois encore
Destinées
Ombre multiple que le soleil vous garde
Vous qui m’aimez assez pour ne jamais me quitter
Et qui dansez au soleil sans faire de poussière
Ombre encre du soleil
Ecriture de ma lumière
Caisson de regrets
Un dieu qui s’humilie
GUILLAUME APOLLINAIRE
Nord-Sud , août-septembre 1917Série sans titre821 §
A Luigi Amaro822 823
Poème liminaire de son « Ode à Gallieni »824 §
C’est
Deux drapeaux tricolores le
lundi
Amaro vous savez que je vous aime bien de
Pâques
Comment réussissent-ils à avoir du crin gris perle
Je me souviens de l’émotion sublime qui nous gagna tous
A la lecture de la proclamation du général Galliéni
Aux Parisiens
Vous chantez Galliéni
Avec cette simplicité
Qu’il faut mettre en toutes choses
L’Italie est venue avec nous
Agitant auprès du ciel de notre drapeau
AMARO LE VERT QUI EST LA VÉGÉTATION
L
’
ESP
É
RANCE
ECOUTEZ QUI EST LA HAINE AUSSI
ET L’ENNEMI LUI-MÊME
Amaro écoutez
Le fracas éternel de nos artilleries
Erige un tombeau de rumeurs
Tresse les couronnes faites en fleurs d’éclatements
Amaro écoutez
La Russie chante la Marseillaise
L’Amérique au nom de toutes démocraties
Proclame que tous les Français sont illustres
Et vous Amaro honorez
Tous les soldats français en chantant ce grand pacificateur
France ô Pacifique
ô douce ô belle France
Amaro vous savez que je vous aime bien
Et nous aimons tous deux la France et l’Italie
GUILLAUME APOLLINAIRE
Fagnes de Wallonie825 §
Tant de tristesses plénières
Prirent mon cœur aux fagnes désolées
Quand las j’ai reposé dans les sapinières
Le poids des kilomètres pendant que râlait
Le vent d’ouest
J’avais quitté le joli bois
Les écureuils y sont restés
Ma pipe essayait de faire des nuages
Au ciel
Qui restait pur obstinément
Je n’ai confié aucun secret sinon une chanson énigmatique
Aux tourbières humides
Les bruyères fleurant le miel
Attiraient les abeilles
Et mes pieds endoloris
Foulaient les myrtilles et les airelles
Tendrement mariée
Nord
Nord
La vie s’y tord
En arbres forts
Et tors
La vie y mord
La mort
A belles dents
Quand bruit le vent
GUILLAUME APOLLINAIRE
Nord-Sud , octobre 1917Et leurs visages étaient pâles
Et leurs sanglots s’étaient brisés
Après la neige aux purs pétales
Comme ses mains sur tes baisers
Tombaient les feuilles automnales
GUILLAUME APOLLINAIRE
La Grande Revue , novembre 1917Poèmes de guerre et d’amour828 §
Le dépôt829 §
Je me suis engagé sous le plus beau des cieux
Dans Nice la Marine au nom victorieux
Perdu parmi 900 conducteurs anonymes
Je suis un charretier du neuf charroi de Nîmes
L’Amour dit Reste ici mais là-bas les obus
Epousent ardemment et sans cesse les buts
J’attends que le printemps commande que s’en aille
Vers le nord glorieux l’intrépide bleusaille
Les 3 servants assis dodelinent leurs fronts
Où brillent leurs yeux clairs comme mes éperons
Un bel après-midi de garde à l’écurie
J’entends sonner les trompettes d’artillerie
J’admire la gaîté de ce détachement
Qui va rejoindre au front notre beau régiment
Le territorial se mange une salade
A l’anchois en parlant de sa femme malade
4 pointeurs fixaient les bulles des niveaux
Qui remuaient ainsi que les yeux des chevaux
Le bon chanteur Girault nous chante après 9 heures
Un grand air d’opéra toi l’écoutant tu pleures
Je flatte de la main le petit canon gris
Gris comme l’eau de Seine et je songe à Paris
Mais ce pâle blessé m’a dit à la cantine
Des obus dans la nuit la splendeur argentine
Je mâche lentement ma portion de bœuf
Je me promène seul le soir de 5 à 9
Je selle mon cheval nous battons la campagne
Je te salue au loin belle rose ô tour Magne
Décembre 1914
Il est des loups de toute sorte
Je connais le plus inhumain
Et mon cœur le diable l’emporte
Et qu’il le dépose à sa porte
N’est plus qu’un jouet dans sa main
Les loups jadis étaient fidèles
Comme sont les petits toutous
Et les soldats amants des belles
Galamment en souvenir d’elles
Ainsi que les loups étaient doux
Mais aujourd’hui les temps sont pires
Les loups sont tigres devenus
Et les Soldats et les Empires
Les Césars devenus Vampires
Sont aussi cruels que Vénus
J’en ai pris mon parti Rouveyre
Et monté sur un grand cheval
Je vais bientôt partir en guerre
Sans pitié chaste et l’œil sévère
Comme ces guerriers qu’Epinal
Vendait Images populaires
Que Georgin gravait dans le bois
Où sont-ils ces beaux militaires
Neiges d’antan Où sont les guerres
Où sont les guerres d’autrefois
8 Février 1915
Reconnaissance832 §
Un seul bouleau crépusculaire
Pâlit au seuil de l’horizon
Où fuit la mesure angulaire
Du cœur à l’âme et la raison
Le galop bleu des souvenances
Traverse les lilas des yeux
Et les canons des indolences
Tirent mes songes vers les cieux
Avril 1915
C’était un temps béni nous étions sur les plages
Va-t-en de bon matin pieds nus et sans chapeau
Et vite comme va la langue d’un crapaud
L’amour blessait au cœur les fous comme les sages
As-tu connu Guy au galop
Du temps qu’il était militaire
As-tu connu Guy au galop
Du temps qu’il était artiflot
A la guerre
C’était un temps béni Le temps du vaguemestre
On était plus serrés que dans les autobus
Et des astres passaient que singeaient les obus
Quand dans la nuit survint la batterie équestre
As-tu connu Guy au galop
Du temps qu’il était militaire
As-tu connu Guy au galop
Du temps qu’il était artiflot
A la guerre
C’était un temps béni Jours vagues et nuits vagues
Les marmites donnaient aux rondins des cagnats
Quelque aluminium où tu t’ingénias
A limer jusqu’au soir d’invraisemblables bagues
As-tu connu Guy au galop
Du temps qu’il était militaire
As-tu connu Guy au galop
Du temps qu’il était artiflot
A la guerre
C’était un temps béni La guerre continue
Les Servants ont limé la bague au long des mois
Le Conducteur écoute abrité dans les bois
La chanson que répète une étoile inconnue
As-tu connu Guy au galop
Du temps qu’il était militaire
As-tu connu Guy au galop
Du temps qu’il était artiflot
A la guerre
Avril 1915
Mon désir est la région qui est devant moi
Derrière les lignes boches
Mon désir est aussi derrière moi
Après la zone des armées
Mon désir c’est la butte du Mesnil
Mon désir est là sur quoi je tire
De mon désir qui est au delà de la zone des armées
Je n’en parle pas aujourd’hui mais j’y pense
Butte du Mesnil je t’imagine en vain
Des fils de fer des mitrailleuses des ennemis trop sûrs d’eux
Trop enfoncés sous terre déjà enterrés
Ca ta clac des coups qui meurent en s’éloignant
En y veillant tard dans la nuit
Le Décauville qui toussote
La tôle ondulée sous la pluie
Et sous la pluie ma bourguignote
Entends la terre véhémente
Vois les lueurs avant d’entendre les coups
Et tel obus siffler de la démence
Ou le tac tac tac monotone et bref plein de dégoût
Je désire te serrer dans ma main
Main de Massiges
Si décharnée sur la carte
Le boyau Gœthe où j’ai tiré
J’ai tiré même sur le boyau Nietzsche
Décidément je ne respecte aucune gloire
Nuit violente et violette et sombre et pleine d’or par moments
Nuit des hommes seulement
Nuit du 24 septembre
Demain l’assaut
Nuit violente ô nuit dont l’épouvantable cri profond devenait plus intense de minute en minute
Nuit qui criait comme une femme qui accouche
Nuit des hommes seulement
24 Septembre 1915
De la batterie de tir837 §
Au maréchal des logis F. Bodard.
Nous sommes ton collier France
Venus des Atlantides ou bien des Négrities
Des Eldorados ou bien des Cimméries
Rivière d’hommes forts et d’obus dont l’orient chatoie
Diamants qui éclosent la nuit
O Roses O France
Nous nous pâmons de volupté
A ton cou penché vers l’Est
Nous sommes l’Arc-en-terre
Signe plus pur que l’Arc-en-Ciel
Signe de nos origines profondes
Etincelles
O nous les très belles couleurs
Mai 1915
Le palais du tonnerre838 839 §
Par l’issue ouverte sur le boyau dans la craie
En regardant la paroi adverse qui semble en nougat
On voit à gauche et à droite fuir l’humide couloir désert
Où meurt étendue une pelle à la face effrayante à deux yeux réglementaires qui servent à l’attacher sous les caissons
Un rat y recule en hâte et j’avance en hâte
Et le boyau s’en va couronné de craie semée de branches
Comme un fantôme creux qui met du vide où il passe blanchâtre
Et là-haut le toit est bleu et couvre bien le regard fermé par quelques lignes droites
Mais en deçà de l’issue c’est le palais bien nouveau et qui paraît ancien
Le plafond est fait de traverses de chemin de fer
Entre lesquelles il y a des morceaux de craie et des touffes d’aiguilles de sapin
Et de temps en temps des débris de craie tombent comme des morceaux de vieillesse
A côté de l’issue que ferme un tissu lâche qui sert généralement aux emballages
Il y a un trou qui sert d’âtre et ce qui y brûle est un feu semblable à l’âme
Tant il tourbillonne et tant il est inséparable de ce qu’il dévore et fugitif
Les fils de fer se tendent partout servant de sommier supportant des planches
Ils forment aussi des crochets et l’on y suspend mille choses
Comme on fait à la mémoire
Des musettes bleues des casaques bleues des cravates bleues des vareuses bleues
Morceaux du ciel tissus des souvenirs les plus purs
Et il flotte parfois en l’air de vagues nuages de craie
Sur la planche brillent des fusées détonateurs joyaux dorés à tête émaillée
Funambules qui attendent leur tour de passer sur les trajectoires
Et font un ornement mince et élégant à cette demeure souterraine
Ornée de six lits placés en fer à cheval
Six lits couverts de riches manteaux bleus
Sur le palais il y a un haut tumulus de craie
Et des plaques de tôle ondulée
Fleuve figé de ce domaine idéal
Mais privé d’eau car ici il ne roule que le feu jailli de la mélinite
Le parc aux fleurs de fulminate jaillit des trous penchés
Tas de cloches aux doux sons des douilles rutilantes
Sapins élégants et petits comme en un paysage japonais
Le palais s’éclaire parfois d’une bougie à la flamme aussi petite qu’une souris
O palais minuscule comme si on te regardait par le gros bout d’une lunette
Petit palais où tout s’assourdit
Petit palais où tout est neuf rien rien d’ancien
Et où tout est précieux où tout le monde est vêtu comme un roi
Une selle est dans un coin à cheval sur une caisse
Un journal du jour traîne par terre
Et cependant tout paraît vieux dans cette neuve demeure
Si bien qu’on comprend que l’amour de l’antique
Le goût de l’anticaille
Soit venu aux hommes dès le temps des cavernes
Tout y était si précieux et si neuf
Tout y est si précieux et si neuf
Qu’une chose plus ancienne ou qui a déjà servi apparaît
Plus précieuse
Que ce qu’on a sous la main
Dans ce palais souterrain creusé dans la craie si blanche et si neuve
Et deux marches neuves
Elles n’ont pas deux semaines
Sont si vieilles dans ce palais qui semble antique sans imiter l’antique
Qu’on voit que ce qu’il y a de plus simple de plus neuf est
Ce qui est le plus près de ce que l’on appelle la beauté antique
Et ce qui est surchargé d’ornements
Ce qui a des ornements qui ne sont pas nécessaires
A besoin de vieillir pour avoir la beauté qu’on appelle antique
Et qui est la noblesse la force l’ardeur l’âme l’usure
De ce qui est neuf et qui sert
Surtout si cela est simple simple
Aussi simple que le petit palais du tonnerre
Août 1915
Ton sourire m’attire comme
Pourrait m’attirer une fleur
Photographie tu es le champignon brun
De la forêt
Qu’est sa beauté
Les blancs y sont
Un clair de lune
Dans un jardin pacifique
Plein d’eaux vives et de jardiniers endiablés
Photographie tu es la fumée de l’ardeur
Qu’est sa beauté
Et il y a en toi
Photographie
Des tons alanguis
On y entend
Une mélopée
Photographie tu es l’ombre
Du Soleil
Qu’est sa beauté
Août 1915
Chevaux de frise842 843 §
Pendant le blanc et nocturne novembre
Alors que les arbres déchiquetés par l’artillerie
Vieillissaient encore sous la neige
Et semblaient à peine des chevaux de frise
Entourés de vagues de fils de fer
Mon cœur renaissait comme un arbre au printemps
Un arbre fruitier sur lequel s’épanouissent
Les fleurs de l’amour
Pendant le blanc et nocturne novembre
Tandis que chantaient épouvantablement les obus
Et que les fleurs mortes de la terre exhalaient
Leurs mortelles odeurs
Moi je décrivais tous les jours mon amour à Madeleine
La neige met de pâles fleurs sur les arbres
Et toisonne d’hermine les chevaux de frise
Que l’on voit partout
Abandonnés et sinistres
Chevaux muets
Non chevaux barbes mais barbelés
Et je les anime tout soudain
En troupeau de jolis chevaux pies
Qui vont vers toi comme de blanches vagues
Sur la Méditerranée
Et t’apportent mon amour
Rose lys ô panthère ô colombes étoile bleue
ô Madeleine
Je t’aime avec délices
Si je songe à tes yeux je songe aux sources fraîches
Si je pense à ta bouche les roses m’apparaissent
Si je songe à tes seins le Paraclet descend
O double colombe de ta poitrine
Et vient délier ma langue de poète
Pour te redire je t’aime
Ton visage est un bouquet de fleurs
Aujourd’hui je te vois non Panthère
mais Toutefleur
Et je te respire ô ma Toutefleur
Tous les lys montent en toi comme des cantiques d’amour et d’allégresse
Et ces chants qui s’envolent vers toi
M’emportent à ton côté
Dans ton bel Orient où les lys
Se changent en palmiers qui de leurs belles mains
Me font signe de venir
La fusée s’épanouit fleur nocturne
Quand il fait noir
Et elle retombe comme une pluie de larmes amoureuses
De larmes heureuses que la joie fait couler
Et je t’aime comme tu m’aimes
Madeleine
Novembre 1915
Dans l’abri caverne844 845 §
Je me jette vers toi et il me semble aussi que tu te jettes vers moi
Une force part de nous qui est un feu solide qui nous soude
Et puis il y a aussi une contradiction qui fait que nous ne pouvons nous apercevoir
En face de moi la paroi de craie s’effrite
Il y a des cassures
De longues traces d’outils traces lisses et qui semblent être faites dans de la stéarine
Des coins de cassures sont arrachés par le passage des types de ma pièce
Moi j’ai ce soir une âme qui s’est creusée qui est vide
On dirait qu’on y tombe sans cesse et sans trouver de fond
Et qu’il n’y a rien pour se raccrocher
Ce qui y tombe et qui y vit c’est une sorte d’êtres laids qui me font mal et qui viennent de je ne sais où
Oui je crois qu’ils viennent de la vie d’une sorte de vie qui est dans l’avenir dans l’avenir brut qu’on n’a pu encore cultiver où élever ou humaniser.
Dans ce grand vide de mon âme il manque un soleil il manque ce qui éclaire
C’est aujourd’hui c’est ce soir et non toujours
Heureusement que ce n’est que ce soir
Les autres jours je me rattache à toi
Les autres jours je me console de la solitude et de toutes les horreurs
En imaginant ta beauté
Pour l’élever au-dessus de l’univers extasié
Puis je pense que je l’imagine en vain
Je ne la connais par aucun sens
Ni même par les mots
Et mon goût de la beauté est-il donc aussi vain
Existes-tu mon amour
Où n’es-tu qu’une entité que j’ai créée sans le vouloir
Pour peupler la solitude
Es-tu une de ces déesses comme celles que les Grecs avaient douées pour moins s’ennuyer
Je t’adore ô ma déesse exquise même si tu n’es que dans mon imagination
Décembre 1915
Merveille de la guerre846 §
Que c’est beau ces fusées qui illuminent la nuit
Elles montent sur leur propre cime et se penchent pour regarder
Ce sont des dames qui dansent avec leurs regards pour yeux bras et cœurs
J’ai reconnu ton sourire et ta vivacité
C’est aussi l’apothéose quotidienne de toutes mes Bérénices dont les chevelures sont devenues des comètes
Ces danseuses surdorées appartiennent à tous les temps et à toutes les races
Elles accouchent brusquement d’enfants qui n’ont que le temps de mourir
Comme c’est beau toutes ces fusées
Mais ce serait bien plus beau s’il y en avait plus encore
S’il y en avait des millions qui auraient un sens complet et relatif comme les lettres d’un livre
Pourtant c’est aussi beau que si la vie même sortait des mourants
Mais ce serait plus beau encore s’il y en avait plus encore
Cependant je les regarde comme une beauté qui s’offre et s’évanouit aussitôt
Il me semble assister à un grand festin éclairé à giorno
C’est un banquet que s’offre la terre
Elle a faim et ouvre de longues bouches pâles
La terre a faim et voici son festin de Balthasar cannibale
Qui aurait dit qu’on pût être à ce point anthropophage
Et qu’il fallût tant de feu pour rôtir le corps humain
C’est pourquoi l’air a un petit goût empyreumatique qui n’est ma foi pas désagréable
Mais le festin serait plus beau encore si le ciel y mangeait avec la terre
Il n’avale que des âmes
Ce qui est une façon de ne pas se nourrir
Et se contente de jongler avec des feux versicolores
Mais j’ai coulé dans la douceur de cette guerre avec toute ma compagnie au long des longs boyaux
Quelques cris de flamme annoncent sans cesse ma présence
J’ai creusé le lit où je coule en me ramifiant en mille petits fleuves qui vont partout
Je suis dans la tranchée de première ligne et cependant je suis partout je commence à être partout
C’est moi qui commence cette chose des siècles à venir
Ce sera plus long à réaliser que non la fable d’Icare volant
Je lègue à l’avenir l’histoire de Guillaume Apollinaire
Qui fut à la guerre et sut être partout
Dans les villes heureuses de l’arrière
Dans ceux qui meurent en piétinant dans le barbelé
Dans les femmes dans les canons dans les chevaux
Au Zenith au Nadir aux 4 points cardinaux
Et dans l’unique ardeur de cette veillée d’armes
Et ce serait sans doute bien plus beau
Si je pouvais supposer que toutes ces choses dans lesquelles je suis partout
Pouvaient m’occuper aussi
Mais dans ce sens il n’y a rien de fait
Car si je suis partout à cette heure il n’y a cependant que moi qui suis en moi
Décembre 1915
Toujours847 §
A Madame Faure-Favier
Toujours
Nous irons plus loin sans avancer jamais
Et de planète en planète
De nébuleuse en nébuleuse
Le don Juan des mille et trois comètes
Même sans bouger de la terre
Cherche les forces neuves
Et prend au sérieux les fantômes
Et tant d’univers s’oublient
Quels sont les grands oublieurs
Qui donc saura nous faire oublier telle ou telle partie du monde
Où est le Christophe Colomb à qui l’on devra l’oubli d’un continent
Perdre
Mais perdre vraiment
Pour laisser place à la trouvaille
Perdre
La vie pour trouver la Victoire
Mai 1915
Chef de section848 849 §
Ma bouche aura des ardeurs de géhenne
Ma bouche te sera un enfer de douceur et de séduction
Les anges de ma bouche trôneront dans ton cœur
Les soldats de ma bouche te prendront d’assaut
Les prêtres de ma bouche encenseront ta beauté
Ton âme s’agitera comme une région pendant un tremblement de terre
Tes yeux seront alors chargés de tout l’amour qui s’est amassé dans les regards de l’humanité depuis qu’elle existe
Ma bouche sera une armée contre toi une armée pleine de disparates
Variée comme un enchanteur qui sait varier ses métamorphoses
L’orchestre et les chœurs de ma bouche te diront mon amour
Elle te le murmure de loin
Tandis que les yeux fixés sur la montre j’attends la minute prescrite pour l’assaut
Mars 1916
Guillaume Apollinaire.
Nord-Sud , novembre 1917Le Vigneron champenois850 851 §
Le régiment arrive
Le village est presque endormi dans la lumière parfumée
Un prêtre a le casque en tête
La bouteille champenoise est-elle ou non une artillerie
Les ceps de vigne comme l’hermine sur un écu
Bonjour soldats
Je les ai vus passer et repasser en courant
Bonjour soldats bouteilles champenoises où le sang fermente
Vous resterez quelques jours et puis remonterez en ligne
Echelonnés ainsi que sont les ceps de vigne
J’envoie mes bouteilles partout comme les obus d’une charmante artillerie
La nuit est blonde ô vin blond
Un vigneron chantait courbé dans sa vigne
Un vigneron sans bouche au fond de l’horizon
Un vigneron qui était lui-même la bouteille vivante
Un vigneron qui sait ce qu’est la guerre
Un vigneron champenois qui est un artilleur
C’est maintenant le soir et l’on joue à la mouche
Puis les soldats s’en iront là-haut
Où l’Artillerie débouche ses bouteilles crèmantes
852 Allons Adieu messieurs tâchez de revenir
Mais nul ne sait ce qui peut advenir
GUILLAUME APOLLINAIRE
Portugal Futurista , novembre 1917Série sans titre853 §
Poème inédit par GUILLAUME APPOLLINAIRE PARIS § Tu chantes avec les autres tandis que les phonographes galopent
Où sont les aveugles où s’en sont-ils allés
La seule feuille que j’aie cueillie s’est changée en plusieurs mirages
Ne m’abandonnez pas parmi cette foule de femmes au marché
Ispahan s’est fait au ciel de carreaux émaillés de bleu
Et je remont avec vous une route aux environs de Lyon
855 Je n’ai pas oublié le son d’une clochette d’un marchant
856 de coco
Autrefois
J’entends déjà le son aigre de cette voix à venir
Du camarade qui se promène avec toi en Europe tout en restant
En Amérique
Un enfant
Un veau dépouillé pendu à l’étal
Un enfant
Et cette banlieue de sable autour d’une petite ville
Au fond de l’Est
Un douanier se tenait là comme un ange a la porte d’un misérable paradis
857 Et le voyageur épileptique écumait dans la salle d’attente des premiéres
858 Engoulevent Grondin Blaireau
Et la taupe Ariane
Nous avons loué deux coupés dans le Transsibérien
Tour à tour nous dormions le voyageur en bijouterie et moi
Mais celui qui veillait ne cachait point un réwolver armé
859 Tu t’es promené à Leipzig avec une femme mince déguisée en homme
Intélligence car voilà ce qui est qu’une femme intelligente
Et il ne faudrait pas oublier les légendes
Dame il bonde dans une tramway la nuit au fond d’un quartier désert
Je voyais une chasse tandis que je montais
Et l’ascenseur s’arretait à chaque étage
860 Entre les pierres
Entre les vétements multicolors de la vitrine
861 Entre les charbons ardents du marchant de marrons
862 Entre deux vaisseaux norvégiens amarrés à Rouen
Il y a ton image
Elle pousse entre les tombaux de la Finlande
863 Le beau nègre en acier
La plus grande tristesse
C’est quand tu reçue une carte postale de la Corogne
864 Le vent vient du couchant
Le métal des caronhers
Tout est plus triste qu’autrefois
Tous les dieux terrestres vieillissent
L’Univers se plaint part ta voix
865 Et des êtres nouveaux surgissent
Trois par trois
GUILLAUME APPOLLINAIRE. (Paris.)
A la Tour — 1910866 §
DU NORD
au
SUD
ZENITH NADIR
et les grands cris de l’ EST
l’océan a l’ OUEST
se gonfle
la tour
a la roue
s’adresse
GUILLAUME AP
P
OLLINAIRE
Nord-Sud , décembre 1917Voici de quoi est fait le chant symphonique de l’amour
Il y a le chant de l’amour de jadis
Le bruit des baisers éperdus des amants illustres
Les cris d’amour des mortelles violées par les dieux
Les virilités des héros fabuleux érigées comme des
pièces contre avions
le hurlement précieux de Jason
Le chant mortel du cygne
Et l’hymne victorieux que les premiers rayons du soleil
ont fait chanter à Memnon l’immobile
Il y a le cri des Sabines au moment de l’enlèvement
Il y a aussi les cris d’amour des félins dans
les jongles
La rumeur sourde des sèves montant dans les plantes tropicales
Le tonnerre des artilleries qui accomplissent le terrible amour
des peuples
Les vagues de la mer où naît la vie et la beauté
Il y a là le chant de tout l’amour du monde
GUILLAUME APOLLINAIRE
1918 §
Luigi Amaro, Élégie héroïque pour la mort de Gallieni , 1918
À Luigi Amaro869 §
C’est
le
Deux drapeaux tricolores lundi
de
Amaro vous savez que je vous aime bien Pâques
Je me souviens de l’émotion sublime qui nous gagna tous
A la lecture de la proclamation du Général Galliéni
Aux Parisiens
Vous chantez Galliéni
Avec cette simplicité
Qu’il faut mettre en toutes choses
L’Italie est venue avec nous
Agitant auprès du ciel de notre drapeau
AMARO Le vert qui est la végétation
ÉCOUTEZ l’espérance
Qui est la haine aussi
et l’ennemi lui-même
Amaro écoutez
Le fracas éternel de nos artilleries
Erige un monument de rumeurs
Tresse les couronnes faites en fleurs d’éclatements
Amaro écoutez
La Russie chante la Marseillaise
L’Amérique au nom de toutes les démocraties
Proclame que tous les français sont illustres
Et vous Amaro vous chantez
Tous les soldats français en chantant le grand pacificateur
France ô Pacifique
O douce ô belle France
Amaro vous savez que je vous aime bien
Et nous aimons tous deux la France et l’Italie.
GUILLAUME APOLLINAIRE
PARIS
Nord-Sud , février 1918Série sans titre870 §
Océan de terre871 §
J’ai bâti une maison au milieu de l’océan
Ses fenêtres sont les fleuves qui s’écoulent de mes yeux
Des poulpes grouillent partout où se tiennent les murailles
Entendez battre leur triple cœur et leur bec cogner aux vitres
Maison humide
Maison ardente
Saison rapide
Saison qui chante
Les avions pondent des œufs
Attention on va jeter l’ancre
Attention à l’encre que l’on jette
Il serait bon que vous vinssiez du ciel
Le chèvrefeuille du ciel grimpe
Les poulpes terrestres palpitent
Et puis nous sommes tant et tant à être nos propres fossoyeurs
Pâles poulpes des vagues crayeuses
O poulpes aux becs pâles
Autour de la maison il y a cet océan que tu connais
Et qui ne se repose jamais
Décembre 1915
GUILLAUME APOLLINAIRE
Zénith
Tous ces regrets
Ces jardins sans limite
Où le crapaud module un tendre cri d’azur
La biche du silence éperdu passe vite
Un rossignol meurtri par l’amour chante sur
Le rosier de ton corps dont j’ai cueilli les roses
Nos cœurs pendent ensemble au même grenadier
Et les fleurs de grenade en nos regards écloses
En tombant tour à tour ont jonché le sentier
3 Avril 1915
GUILLAUME APOLLINAIRE
L’Éclair , 26 février 1918Poème sans titre (incipit : « Vous me parlez d’un ministère »)876 §
Vous me parlez d’un ministère
Et des Lettres et des Beaux-Arts
Je vous réponds que c’est la guerre
La guerre avec tous ses hasards
Que pensez-vous donc cher confrère
De celui-ci qu’il faudrait faire
Et qui serait le ministère
Des Embusqués et des Froussards
Signé : Guillaume Apollinaire
L’Éventail , mars 1918La Jolie Rousse877 §
Me voici devant tous un homme plein de sens
Connaissant de la vie et de la mort ce qu’un vivant peut connaître
Ayant éprouvé les douleurs et les joies de l’amour
Ayant su quelquefois imposer ses idées
Connaissant plusieurs langages
Ayant pas mal voyagé
Ayant vu la guerre dans l’Artillerie et l’Infanterie
Blessé à la tête trépané sous le chloroforme
Ayant perdu ses meilleurs amis dans l’effroyable lutte
Je sais d’ancien et de nouveau autant qu’un homme seul pourrait des deux savoir
Et sans m’inquiéter aujourd’hui de cette guerre
Entre nous et pour vous amis
Je juge cette longue querelle de la tradition et de l’invention
De l’Ordre et de l’Aventure
Vous dont la bouche est faite à l’image de celle de Dieu
Bouche qui est l’ordre même
Soyez indulgents quand vous nous comparez
A ceux qui furent la perfection de l’ordre
Nous qui quêtons partout l’aventure
Nous ne sommes pas vos ennemis
Nous voulons vous donner de vastes et d’étranges domaines
Où le mystère en fleur s’offre à qui veut le cueillir
Il y a là des feux nouveaux des couleurs jamais vues
Mille phantasmes impondérables
Auxquels il faut donner de la réalité
Nous voulons explorer la Bonté contrée énorme où tout se tait
Il y a aussi le temps qu’on peut chasser ou faire revenir
Pitié pour nous qui combattons toujours aux frontières
De l’illimité et de l’avenir
Pitié pour nos erreurs pitié pour nos péchés
Voici que vient l’été la saison violente
Et ma jeunesse est morte ainsi que le printemps
O Soleil c’est le temps de la Raison ardente
Et j’attends
Pour la suivre toujours la forme noble et douce
Qu’elle prend afin que je l’aime seulement
Elle vient et m’attire ainsi qu’un fer l’aimant
Elle a l’aspect charmant
D’une adorable rousse
Ses cheveux sont d’or on dirait
Un bel éclair qui durerait
Ou ces flammes qui se pavanent
Dans les roses-thé qui se fanent
Mais riez riez de moi
Hommes de partout et surtout gens d’ici
Car il y a tant de choses que je n’ose vous dire
Tant de choses que vous ne me laisseriez pas dire
Ayez pitié de moi
Guillaume Apollinaire
Paris-Midi , 30 juin 1918Calligramme en forme de morceau de sucre878 879 §
A Paris-Midi,
Calligramme
en forme de morceau de sucre
Tel un contre-filet
Ton bel entrefilet
Planton, je l’apprécie
Et je te remercie.
Guillaume Apollinaire .
28 juin 1918.
Les Trois Roses , octobre-novembre 1918
C’est la barque où fuyait près d’une ombre la reine
Quand les morts se levaient et lorsque les sanglots
Secouaient le monarque ainsi que la carène
Qui tremble à l’horizon sur l’écume des flots
La chanson des rameurs sur les vagues se traîne
La reine et l’enfant d’or agitaient les grelots
Dont la fente évoquait la grenade qu’égrène
Aux échos des récifs le chœur des matelots
Belles chairs de cristal, les joyaux les squelettes
Cherront au fond des mers où surnagèrent tant
De fleurs de cheveux roux et de rames flottant
Parmi les troupes de méduses violettes
Cortège de ta fuite ou floraison d’effroi
Lorsque cet enfant d’or souriait au vieux roi
Guillaume APOLLINAIRE.
Appel pour les musées et les richesses d’art de la France et de la Belgique envahies , novembre 1918Souvenir des Flandres883 884 §
J’ai goûté sur la dune où Dante a dû passer
Les couchants langoureux des pensives Zélandes ;
Les clochers regardaient de la digue et des landes,
Bruges, sur ton canal les bélandres
885 glisser.
Villes, vos monuments, églises et musées,
Renaissent en mon âme. O Flandres, je revois
Vos chefs-d’œuvre debout, et d’eux monte une voix
Qui dit : Nous renaîtrons, nous les pierres brisées.
Qui dit : Nous reviendrons, nous livres et tableaux
Nous autels, nous joyaux, et nous L’AGNEAU MYSTIQUE
886 Nous Châsse de Memlinc, cet éternel cantique
887 ,
Et nous ces fins d’été qui saignent dans les flots.
Nous renaîtrons : corons, hospices, béguinages,
Beffrois et carillons, négoces opulents.
Qu’importe le Malheur ! Sur les canaux dolents
Comme des cygnes vont les misères des âges
888 .
Leur sillage s’efface aussitôt. Les destins
Rient dans les moissons d’or et dans le sein des mères.
Nous renaîtrons aussi, nous fêtes populaires
Kermesses, Carrousels. — O fraîcheur des matins.
Tendresse des longs soirs alanguis dans les Flandres,
Grands ports que chaque nuit colorent les fanaux,
Je me souviens de vous, eaux vertes des canaux
Où glissent lentement les pensives bélandres.
Guillaume APOLLINAIRE
889