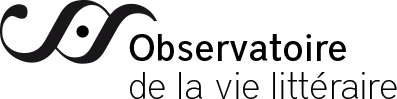Université d’été | Bi-licence "Lettres – Informatique" | Ateliers
PAGE ACCUEIL
Pourquoi une langue plutôt qu’une autre ?
Pourquoi une langue plutôt qu’une autre ?
- Renée Clémentine LUCIEN
Introduction de la conférence d’Eduardo Manet (écrivain, dramature, cinéaste), donnée le 10 avril 2014.
Séminaire de recherche interdisciplinaire « La valeur littéraire à l'épreuve de l'archipel : les écritures des Caraïbes et les études postcoloniales »
Si nous nous en tenons au cadre conceptuel de ce séminaire dont l’invité est Eduardo Manet, l’objet sur lequel portera notre attention répudie l’univocité : quelle(s)langue(s) parle-t-on ? Dans quelle(s) langue(s) écrit-on? Quelles langues sont en concurrence ou parviennent à s’écouter, dans l’expansion horizontale de l’archipel de la Relation, pensée et sentie par Edouard Glissant, cet homme de l’entre-deux, de la pluralité du Divers, s’étant lui-même comparé à l’Orisha de la Santería cubaine, Eleguá, esprit des carrefours où se croisent et bifurquent les chemins, qu’il retrouve avec passion dans la peinture du Cubain Wifredo Lam, autre emblème d’une esthétique de la Relation et créateur de digenèses archipéliques?
Nous accueillons donc Eduardo Manet, qui s’est ainsi défini : « Je suis plutôt un écrivain schizophrène... Je peux être très français ou profondément cubain. Mon ami Andreï Makine –lui aussi, un transfuge de la langue, russe d’origine mais écrivant en français- me dit souvent qu’on appartient à la langue dans laquelle on écrit. Je suis Français quand j’écris en français. J’ai même écrit quelques poèmes en anglais et je commence à tourner en espagnol. Je suis un mélange, et c’est cela qui me plaît beaucoup. Disons que je suis un Franco-Cubain avec quelque chose de basque. » Vous seriez donc, Eduardo Manet, un être de constitution archipélique, au sens le plus glissantien du terme, à l’inventivité protéiforme, multigénérique, en littérature, au cinéma, en dramaturgie. Il suffit de revenir à l’âge d’or du cinéma cubain des années 1960-1968, à l’ébullition à l’œuvre à l’ICAIC, l’Institut Cubain des Arts et Industrie Cinématographique, créé dès 1959 par le jeune gouvernement révolutionnaire, pour vous y retrouver comme scénariste et metteur en scène. En revoyant le film Un día en el solar, de 1965, l’on peut y mesurer la fécondité de l’interpénétration entre des formes vernaculaires et celles de l’esthétique hoolywoodienne. Il faut également se pencher sur la vigueur d’un renouveau du théâtre, porté alors par votre élan et enthousiasme révolutionnaires- vous aviez 29 ans lorsque l’Armée Rebelle des guerrilleros de la Sierra Maestra entra à La Havane après la fuite du dictateur Fulgencio Batista en République Dominicaine-, et vous aviez pris les rênes du Centre Dramatique Cubain.
Votre installation définitive en France depuis 1968, en signe de votre désapprobation de l’appui apporté au Printemps de Prague par le gouvernement de votre pays, et votre citoyenneté française datant de 1979 ne résultent pas du hasard. Vous distinguant d’autres compatriotes ayant succombé à l’appel de Miami, de sa petite Havane et sa calle 8, vous avez fait vôtre ce pays que l’imaginaire de votre mère andalouse avait érigé en un des pôles privilégiés de ses rêves. Animée par un sain respect de la France, elle contribua à l’imprégnation profonde et sûre de l’enfant Eduardo par la culture de ce pays. Dans la mythologie personnelle que vous bâtissez, comme tout écrivain, la fascination envers la France s’était résolument imposée à votre imaginaire, avant même que vous n’y viviez lors d’un premier voyage en Europe, avant de regagner Cuba à l’avènement de la Révolution en 1959.
Mais votre ville de naissance mérite que nous nous y attardions. Vous êtes né à Santiago de Cuba, la capitale de l’Oriente cubain, au sud est de la Isla del Lagarto verde, L’île du lézard vert, titre de l’un de vos romans, qui vous valut le Prix Goncourt des lycéens en 1992, la ville la plus intensément imprégnée de la présence culturelle française, par son histoire. D’abord par sa proximité avec Saint Domingue, la colonie française d’où s’enfuirent nombre de colons français et leurs esclaves mulâtres et noirs au moment de la grande révolte de 1791, et qui amenèrent avec eux les danses, la musique, l’art de faire pousser les caféiers tout en les installant dans un dispositif architectural singulier, et, bien sûr, la langue. L’arrivée de Français ne se tarit pas et se poursuivit au XXème siècle. Forgée par la « transculturation », selon le concept de l’ethnologue cubain, Fernando Ortiz, dans son Contrapunteo del tabaco y del azúcar, proche la dynamique de la Relation archipélique de Glissant, creuset d’une incessante créolisation, Santiago est citée comme foyer exemplaire de ce phénomène identitaire par les penseurs martiniquais de la créolité, Patrick Chamoiseau, Jean Barnabé et Raphael Confiant, dans leur essai, Eloge de la créolité. L’Espagne, déjà bien hybride de ses marranes, Arabes et chrétiens, l’Afrique multiple et la France ont imprimé leur marque à un imparable brassage de phénotypes et de cultures. Vous avez sans nul doute rapporté de votre Santiago le souvenir d’une architecture, de noms de rues, vestiges et témoignages d’un passé français devenu composante d’un espace identitaire créolisé. Les travaux de la chercheuse de l’université de Bordeaux 3, María Elena Orozco, originaire de Santiago, sur les plantations de café, l’architecture, l’acclimatation du style néoclassique au climat et aux séismes –vous êtes né le jour d’un séisme, d’après votre autobiographie Mes années cubaines1, parue en 2004- sur le nom des rues de votre ville de naissance2 lui ont permis de mettre en lumière des données précises de cette empreinte à l’intérieur d’un périmètre excédant largement la rue du Gallo où on la cantonnait, et de repérer des constantes formelles de ce monde créolisé, un typique archipel glissantien, à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Nouvelle Orléans. « Los investigadores se acercaban a los cafetales, pero nadie había trabajado la influencia francesa en la ciudad, que la gente solo limitaba a la calle del Gallo. Es en esta investigación, en la que llego a la conclusión de que coincidía la modernización de la ciudad de Santiago con la llegada de los franceses, que había mezclado en Saint Domingue (actual Haití) la moda neoclásica, con la necesidad de aclimatación al clima y los terremotos, y es ese conocimiento el que traen. Así pasa en el Barrio Francés de Nueva Orleans y la arquitectura de los cafetales la encuentras muy parecidas en Guadalupe y Martinica. Pero era la primera vez que se investigaba. »
Outre cette sensibilité imprimée par un cadre de vie, dans une certaine mesure « afrancesado », un tropisme incoercible envers la langue française vous est aussi venu, comme vous le rappelez, dans Mes années Cuba, dans le giron d’une nourrice originaire d’Haïti, maniant probablement un français plus composite qu’atavique, comme toute langue créolisée, pour reprendre la typologie de Glissant, dans L’imaginaire des langues, Entretiens avec Lise Gauvin, 1991-2009, où il s’explique sur ce processus de créolisation. Mais vôtre tropisme se singularise aussi par votre mythologie familiale, l’ascendance d’un grand-père, le peintre français Edouard Manet, dont le fils aîné, représenté dans le tableau Le fifre, obsède votre imaginaire, au point que vous lui consacrez un de vos romans, en 2011.
Mais après ces quelques considérations sur le pourquoi de la gestation d’une profuse littérature en français, l’interrogation se centre sur comment l’Eduardo Manet, né à Cuba, hispanophone lorsqu’il choisit de résider en France, devenu Président du Conseil Permanent des Ecrivains de France, porte-étendard de ses pairs, tant sont puissants ses liens tissés avec l’intimité d’une langue, compose-t-il avec l’entre-deux? Change-t-il d’univers mental, découpe-t-il différemment le monde quand il choisit, à 38 ans, d’écrire dans la langue que lui parlait sa nourrice haïtienne et qu’idéalisait sa mère? Ou comment s’accommode-t-il avec des découpages singuliers, symboliques, culturels du monde constitutifs des langues? Pour des écrivains bien connus, l’insuperposabilité de ces découpages les a soumis à l’injonction d’un renoncement. Est-ce aussi ce que vous éprouviez lorsque vous avez déclaré, à propos de Samuel Beckett, votre alter ego, au sens où il choisit d’écrire dans une autre langue que sa langue maternelle que, de même qu’il avait dû se détacher de James Joyce dont il était le secrétaire et aller au-delà des mots et du réel, en s’exprimant dans une autre langue, vous vous êtes mis à écrire en français pour vous détacher de Federico García Lorca? Vous n’avez ainsi concédé à la langue de Lorca que trois pièces de théâtre, dont Las monjas, traduite en français, jouée à Cuba et en France très durablement, dont l’arrière-plan sociopolitique est la Révolution de Saint-Domingue. N’est-ce pas comme écrivain français que vous êtes revenu, au mois de mars dernier 2014, au Festival du Théâtre français de Cuba?
Comment écrit-on dans cette langue adoptée à partir d’un imaginaire bâti sur l’histoire, la mémoire, l’identité, la cubanité, ce que prouvent incontestablement les sujets de vos nombreux romans publiés en France, Rhapsodie cubaine, qui vous valut le Prix Interallié en 1996, où vous mettez en fiction des personnages d’une obsédante Histoire nationale, pour en bouleverser le récit officiel? Le dictateur Fulgencio Batista et son coup d’Etat de mars 1952 dans Habanera, Les trois frères Castro, Ramón, Fidel et Raúl, La maîtresse du Commandant Castro, peu ou pas traduits en espagnol?
C’est que malgré votre déclaration où vous vous comparez à Beckett, en réfléchissant mieux à votre voyage dans la langue française, nous nous interrogeons sur le renoncement et sommes tentée de croire que le passage de l’espagnole à la française ne constitue nullement un acte symbolique de rupture avec votre identité-racine mais au contraire, ce qui peut sembler un paradoxe, le meilleur moyen ou la meilleure ruse hégélienne de continuer de porter en vous une Cuba entretenant déjà une Relation archipélique avec la France, comme dirait Edouard Glissant, la Cuba de votre enfance. Le français n’aurait donc jamais été pour vous une langue d’exil.
Vous vous distinguez par là-même de ces Cubano-Américains, tels Gustavo Pérez Firmat,3 de la génération 1 et demi, comme ils se sont désignés eux-mêmes. Pour des raisons historiques, de migration et de circulation des Cubains, s’imposa l’alternative de l’espagnol ou de l’américain. L’éventualité du retour à Cuba, la vigueur du lien avec le paradis perdu, et la blessure de la rupture se sont posées en termes linguistiques. L’exil aux Etats-Unis, que vous avez écarté fermement en 1968, de Pérez Firmat, cet écrivain déterritorialisé, comme le dirait George Steiner, écrivant en espagnol et en anglais, lui inspira, pour traduire cette douleur occasionnée par le choix d’une langue, la métaphore de la « corriente alterna », du courant alternatif, pour signifier l’impossible symbiose due au poids affectif de la langue et de la charge nostalgique que suppose l’écriture en espagnol. Il sentit le besoin de s’entourer de dictionnaires, de différents livres en anglais pour baigner dans un découpage du monde approprié lorsqu’il entreprit d’écrire en anglais. « Changer de langue, c’est comme changer de peau ». “Rivalidad en vez de complicidad”, “Rivalité plutôt que complicité”, « Mi inglés es más alegre que mi español » « Mon anglais est plus gai que mon espagnol »4». Il put soumettre alors la langue anglaise au pire des traitements mais pas l’espagnol car s’il s’y était employé, il n’aurait pas pu se soustraire au rappel à l’ordre de la voix paternelle. Vous semblez avoir échappé aux affres de la déterritorialisation, du déplacement, aux crises inhérentes aux tourments de l’hybridation, de la tension entre la cohérence et la concurrence. Vous ne songez pas à vous lamenter comme ceux qui, pris dans les rets d’une hybridité inconfortable, souhaiteraient ne plus être multiples à la fois et voudraient n’être l’auteur que d’un seul pays. « Je suis un mélange, et c’est ce qui me plaît beaucoup. »
Attardons-nous donc sur l’hybridité et le multilinguisme. Le caribéen Edouard Glissant aborde la question de la coexistence des langues et récuse, comme vous, l’idée d’un écartèlement douloureux, proclamant au contraire que l’hybridation et la plurivocité peuvent s’exalter en symphonie, et même que la dysphonie met en Relation. « L’archipélique, c’est la diversité dans l’étendue. Le continental est l’épais qui pèse sur nous, de pensée de système. […] L’archipélique est adéquat à nos éclatements divers, multidirectionnels, multidimentionnels, rallie des rives et marie des horizons ». Et lorsqu’il est question du monde de mots qu’est la littérature, qui affectionne naturellement les chemins de traverse, en contournant les découpages ataviques et en s’insurgeant contre leur organisation de système, par des détournements, subversions, inventions incessantes, qui, en même temps qu’elle désorganise des codes, en reconfigure d’autres, comme opèrent d’ailleurs les langues créolisées, Edouard Glissant en abordant la question du multilinguisme pose que : « Ce sont là quelques-uns des échos qui ont fait que nous acceptons d’écouter ensemble le cri du monde, sachant que en l’écoutant, nous concevons que tous l’entendent désormais ».
C’est aussi ainsi que l’entendent d’autres hybrides échappés de leur terre caribéenne, hommes d’archipel, le Jamaïcain Britannique Stuart Hall, fondateur des Cultural Studies, se proclamant fièrement mélange de Juif portugais, d’Africain et d’Indien, et les tenants de la théorie postcoloniale. Comment régissez-vous à l’affirmation de Glissant que, dans le monde de la Relation et de la diversalité, où peut s’imposer « l’imprévisible des contiguïtés et des dissonances des langues, l’on écrit en présence de toutes les autres langues en donnant voix à toute la diversité du Tout-Monde » ?
Dans cette perspective archipélique de Glissant, l’alternative d’une langue plutôt qu’une autre serait-elle résolue puisque sa conception de la littérature, qui est poème, repose sur une idée du monde où s’opère la rencontre, depuis son lieu, d’autres idées du monde, conduisant ainsi à la Relation? Peut-être est-ce pour cette raison qu’il n’a jamais tenté d’écrire en créole, alternative qui a séduit les essayistes de la créolité, en particulier Raphael Confiant, dans une moindre mesure, Patrick Chamoiseau. Mais Glissant n’a jamais écrit en créole, se cantonnant dans un marronnage de son français matriciel, à qui il imprime sa marque par nombre de néologismes savants, significatifs d’une révolution anthropologique, de créolismes, eux-mêmes francisés, conjointe sans aucun doute à son légitime désir d’étendre constamment son audience, démontrant ainsi le caractère imparable d’une créolisation ad infinitum..
Dans l’archipel glissantien de la Relation, l’imaginaire de la diglossie et du multilinguisme caribéens doit s’exalter par le biais de l’imaginaire poétique, « là où les pensées de systèmes et les idéologies ont défailli.»6 Dans La mazurka perdue des femmes-couresse7, récemment publié, la protagoniste du roman de la Martiniquaise Mérine Céco fictionnalise la vie de sa grand-mère, en mettant en concurrence le français et le créole, la langue impériale, atavique, et la composite, mal considérée : « Personne ne me pardonnera d’écrire dans cette langue qui a fait notre malheur, mais personne ne me lira jamais si j’écris dans cette langue qui a fait notre grandeur malgré sa misère. » Pour Edouard Glissant, aucune langue ne peut faire le malheur d’une autre, car, dans l’archipel des langues, elles s’écoutent, toutes, et l’écrivain écrit, en présence de toutes les langues du Tout-Monde.
À Cuba, la question de la diglossie et de la créolisation à l’œuvre dans les Antilles françaises fut plus problématique car elle se heurta aux impératifs de la politique de concentration et dissémination des esclaves de même origine, afin d’échapper aux périls de la rébellion.
En fin de compte, dans la question de la valeur littéraire, la littérature est-elle assujettie à l’injonction d’une nationalité ? Andrei Makine vous avait déjà, sans que vous en ayez besoin, soufflé la réponse. Mais sans doute, plus encore, dans le monde globalisé, l’idée d’une littérature nationale, héritage du romantisme semble bien désuète.
Eduardo Manet est-il un écrivain français ou cubain ? Ni l’un, ni l’autre, les deux à la fois. Dans un weltliteratur, ou une littérature monde, telle que la définit Milan Kundera, en hommage à Goethe, où la primauté est donnée à l’audience de la littérature par sa capacité d’être entendue, est-ce si important ?
1Eduardo Manet, Mes années cubaines, Grasset, 2004
2María Elena Orozco Melgar, Presencia francesa e identidad urbana en Santiago de Cuba, Santiago de Cuba, Ediciones Santiago, 2001, Le monde caraïbe: échanges caraïbes et horizons postcoloniaux (dir. Christian Lerat), Séminaires et actes du colloque international Bordeaux, 7 et 8 décembre 2001
3Gustavo Pérez Firmat, Life on the Hyphen (1994), Press University of Texas, 1994, Vidas en vilo, Madrid, Colibrí, 2001
4Diario de Cuba, 28 de febrero de 2014, “¿Existe una literatura cubanoamericana?”, última consulta, 31 de marzo de 2014
Edouard Glissant, Traité du Tout-Monde, Gallimard, p. 16
6Edouard Glissant, Traité du Tout-Monde, op. cit., p. 18
7Merine Ceco, La mazurka des femmes couresse, Ed. Ecriture 20013