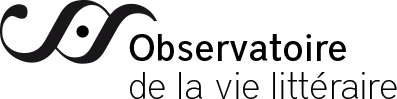Université d’été | Bi-licence "Lettres – Informatique" | Ateliers
PAGE ACCUEIL
Repenser le numérique. Entretien avec Bruno Bachimont
Repenser le numérique. Entretien avec Bruno Bachimont

Quel regard portez-vous sur la révolution numérique ?
Le numérique, aujourd’hui, est un « milieu », au sens où il conditionne désormais tous nos liens avec notre environnement. Ce n’est plus l’outil des années 1950-1960. Seulement, cette technologie prend nos capacités en défaut, car elle nous permet d’élaborer des systèmes de données complexes, que nous ne sommes pas capable de nous représenter. Qui, par exemple, peut se représenter internet ? Ce réseau est une succession de règles locales, dont personne ne peut expliquer les effets globaux. En un sens, c’est la force de ce réseau d’être dynamique et modulable, mais le lien entre la globalité et la localité est rompu et il ne faut parler d’internets qu’au pluriel. Le même problème se pose avec les big data : les multiples choix d’ajustements et le recours à des algorithmes complexes nous permettent de visualiser des résultats sur un écran, mais le fil de la construction des données est perdu. Une cartographie générale d’un corpus de données s’obtient à la condition de sacrifier le point de vue du détail ; inversement l’analyse de détail ne dit rien de l’architecture globale des données. Dans le cas du distant reading par exemple, ce lien rompu entre l’architecture d’ensemble et le texte singulier est souvent problématique : la recherche ne peut produire que des hypothèses et en aucun cas des résultats. Et le problème de nombreux travaux actuels autour des données, c’est qu’on a tendance à prendre les hypothèses pour des résultats… Le défi, aujourd’hui, c’est de parvenir à élaborer des outils de connaissance qui nous permettront de retrouver le même équilibre entre globalité et localité qu’un outil comme le tableau synoptique offrait, avant l’essor du numérique.
Comment le numérique modifie-t-il la recherche universitaire et sa valorisation ?
Le numérique est une mutation de l’écriture. Il concerne tous les domaines de la recherche universitaire et nous engage également à repenser les mécanismes de sa valorisation. Les deux mots-clés sont « accélération » et « massification ». Le raccourcissement des cycles entretient une certaine frénésie, qui n’est pas nécessairement productive, autour de la question de la valorisation. Je partage l’idée du sociologue Hartmut Rosa, selon laquelle l’accélération des processus engendre de l’aliénation et un sentiment d’insécurité, chez les personnes. L’autre point, c’est la massification, qui aboutit à la non-discrimination éditoriale, autrement dit à une sorte d’aplatissement de la valeur de la recherche. Par manque de temps, nous avons tendance à trier les produits de la recherche en nous fondant sur des marqueurs quantitatifs, et non qualitatifs, comme le nombre de mentions ou de citations d’une publication ou d’un auteur. La conséquence, c’est qu’un chercheur ne publie pas pour être lu mais pour être recensé, archivé et cité. Il utilise les revues scientifiques comme de simples labels et publie parallèlement ses recherches sur son blog ou en utilisant d’autres supports de diffusion non institutionnels. Ce mode de fonctionnement n’est pas mauvais en soi, lorsque la recherche est de qualité, mais il fait l’économie des filtres communautaires traditionnels. Le numérique est en train de détruire un équilibre éditorial ancien, qui incarnait une sorte de fil de pertinence au bout duquel une idée, une découverte ou une publication étaient versées dans l’espace public. Face à cette évolution, les institutions et notamment les universités ont le devoir de réorganiser leur rapport à la recherche.
Dans votre essai Patrimoine et numérique, vous appelez à repenser les méthodes de conservation des connaissances.
Le numérique n’a pas fondamentalement révolutionné les techniques de conservation. Le processus de « grammatisation » décrit par Bernard Stiegler, qui désigne notamment la prise en charge d’une inscription et des modes de diffusion et de recopie, n’a pas changé. Ce processus est simplement devenu plus facile à mettre en œuvre, plus fluide et moins coûteux que dans le cas de la copie manuscrite ou de l’imprimé. Les problèmes liés à la conservation restent les mêmes à l’ère du numérique : copies fautives, établissement de variantes, apparat critique, etc. La notion d’œuvre originale est encore et sera toujours une invention des bibliothécaires. Là où, en revanche, le numérique opère un bouleversement cognitif profond, c’est dans notre rapport à l’archive. Nous pouvons aujourd’hui recopier sans lire : c’est le fameux « copier-coller ». Autrement dit, l’acte de conservation d’un objet n’est plus nécessairement associé à une démarche interprétative. D’autre part, la pratique de l’archivage massif, qui est devenu la norme, ne répond aux besoins d’aucune communauté de lecture : cette pratique est en rupture avec notre équilibre culturel et avec une longue tradition de conservation et de transmission des connaissances, qui valorise le lien entre un objet culturel et ses lecteurs. Enfin, dans notre monde contemporain, le mot patrimoine a changé de sens. Il ne désigne plus un legs culturel, officiel et savant, mais une pratique anthropologique où tout objet, dès lors qu’il constitue une mémoire pour quelqu’un ou un collectif, est patrimonial. Je parle d’ailleurs de « mnémophores » pour ces objets, pour redoubler les « sémiophores » de K. Pomian. Aujourd’hui, toute réalité est susceptible de devenir un objet de mémoire et, par exemple, les directions régionales de l’action culturelle (DRAC) sont submergées de demandes. Il y a trente ans, les patrimoines des départements étaient plus faciles à gérer ! Le numérique renforce de processus car, instrument universel de codage et de manipulation, il permet d’enregistrer et de conserver des objets jusque là éphémères ou temporaires. Selon les caprices du vécu de la mémoire, toutes sortes d’objets peuvent devenir, grâce au numérique, mémoriels. Le patrimoine est ainsi devenu un terrain de revendications identitaires. Cette communautarisation de la notion accompagne la désaffection des populations pour les problématiques nationales et supranationales. Paradoxalement, le patrimoine, aujourd’hui, ce n’est plus ce qui réunit mais ce qui sépare. Mon point de vue est qu’il faut repenser le régime d’enrôlement des données que permet le numérique dans la chaîne de patrimonialisation et réhabiliter une rhétorique de la mémoire. Les données patrimoniales n’ont de valeur qu’à l’intérieur d’un récit sur le patrimoine qui les englobe. Tout cela nous ramène aux réflexions de Ricœur sur la capacité du récit à synthétiser l’hétérogène.
À quoi peuvent servir les humanités numériques ?
Je ne suis pas sûr que, pour le moment, le numérique modifie considérablement la recherche en SHS : trop souvent les humanités numériques se réduisent à des nouveaux outils pour de vieux problèmes. Dans ce domaine, la technologie reste un outil comparable au cartulaire de l’archiviste et ne bouleverse pas les équilibres intellectuels. En revanche, les objets numériques ont besoin des humanités. Il y a toute une philologie du numérique à mettre en place, toute une économie de la variante à imaginer et toute une réflexion à faire sur la notion d’original et sur l’idée de copie parfaite, qui occupent l’impensé du numérique. Il reste également à inventer une codicologie du numérique, une herméneutique du numérique, etc. Les sciences humaines sont nécessaires pour penser le numérique et peuvent contribuer à le transformer. Et donc ce sont des humanités du numérique qu’il faudrait avoir, plutôt que des humanités numériques…
propos recueillis par Romain Jalabert.